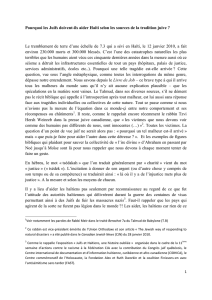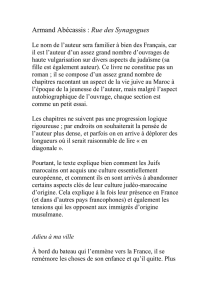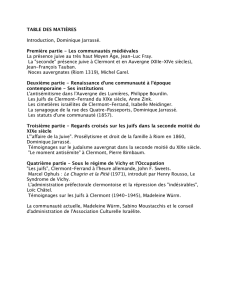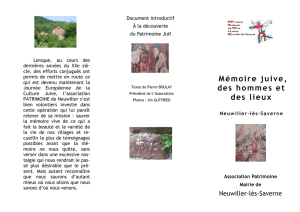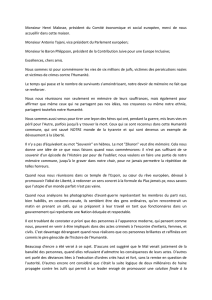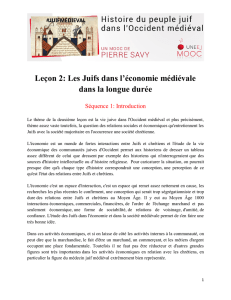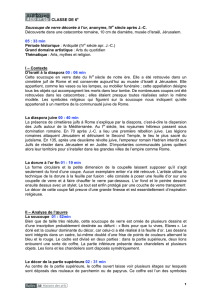histoire - Keren Or

“mon journal”
Lettre à Bandit
p.2
Les juifs de Lyon
par Catherine Déchelette
Elmalek
p.3
La rencontre de la
World Union for
Progressive Judaism
p.4
www.ujl-lyon.com
Les fêtes juives sont polysémiques. Leur
institution remonte à des temps reculés.
Certaines sont déjà fixées par la Torah,
de-oraïta selon la terminologie rabbinique, telles
les trois fêtes de pèlerinage, Pessah, Chavouot et
Souccot, qui donnaient lieu à des « montées » à
Jérusalem et des sacrifices particuliers au Temple.
D’autres ont été fixées par les rabbins à l’époque
talmudique, de-rabbanan selon leur propre
terminologie, comme par exemple Hanoukka.
D’autres enfin sont plus récentes, tel Yom
Yerushalaïm.
Elles ont toutes en commun des règles minutieuses
d’observance fixées par nos rabbins, et certaines
d’entre elles sont décrites en détail par un traité du
Talmud, Pessahim pour Pessah, ou encore Yoma
pour Yom Kippour.
Elles appartiennent à un cycle calendaire propre
au peuple juif, cycle à la fois solaire, dans leur
dimension agricole première pour certaines, et
lunaire, car l’architecture fondamentale est celle de
la succession des mois dont l’entrée est marquée
par la nouvelle lune. Mais la fête des fêtes, la plus
importante et la plus fondamentale est le chabbat
qui célèbre rien de moins que la création du monde.
Elles ont toutes en commun d’être liées à des
moments fondamentaux de notre histoire
collective, sauf peut-être les fêtes de Tichri en partie
commémorant la création de l’homme. Elles orent
à notre peuple une mémoire collective, un peuple
retourné sur sa terre il y a 63 ans, mais qui vit aussi
depuis plus de vingt-cinq siècles en diaspora. Certes,
les historiens remettent en cause la réalité historique
de certains événements que nous célébrons, comme
par exemple l’histoire d’Esther ou encore la sortie
d’Egypte. Mais cela n’enlève rien à leur véracité dans
la constitution de notre mémoire. Et leur polysémie
autorise de les célébrer en dépit de cela car lorsque
nous entrons dans le temps fixé pour chacune
d’entre elles, nous répétons d’anciens rituels,
toujours actuels, et nous redécouvrons à chaque
fois leur sens profond, celui qui nourrit notre identité
collective et notre identité spirituelle.
La fête de Pessah n’échappe pas à cette polysémie.
Elle est Hag Ha’Aviv, la fête de la germination du
blé, ou encore fête du printemps. Elle représente
le temps où, après la sortie de l’hiver et dans ce
printemps qui triomphe, les plantes qui seront
récoltées pour être consommées commencent à
poindre, un peu comme le renouveau du cycle de la
vie. Elle est aussi Hag HaMatzot, la fête des matzot,
le seul pain que nous sommes autorisés à manger
pendant la durée de la fête, en souvenir de la fuite
précipitée de nos ancêtres hors d’Egypte. Et elle est
encore zman heroutenou, le temps de notre liberté,
car nos ancêtres ont pu échapper à l’esclavage
d’Egypte. Mais cette année encore, et depuis quatre
ans déjà, nous devrons avoir à l’esprit que l’un des
nôtres, Gilad Shalit, célébrera Pessah en captivité.
Une des prescriptions essentielles de la semaine de
Pessah est l’interdiction du hametz. Il s’agit de la
fermentation de cinq types de céréales, blé, orge,
avoine, seigle et épeautre. Par la suite, l’interdit
s’étend à toute forme de fermentation, et les listes
de produits interdits sont plus fournies d’année
en année. Mais par-delà l’interdit, cette mitzvah
d’interdiction de consommer du hametz à Pessah
peut aussi symboliser la condition essentielle de la
libération intérieure, ôter tout ce qui peut fermenter
en nous, toutes nos émotions négatives qui sont
autant de freins à notre évolution spirituelle.
Et comme toute joie doit être tempérée par un
rappel de la réalité qui nous entoure, nous retirons
une goutte de vin à l’énoncé de chaque plaie qui
a frappé les Egyptiens au moment de notre sortie
d’Egypte, car il ne faut pas se réjouir du malheur des
autres, fussent-ils nos ennemis.
La libération que nous célébrons, ou que nous
espérons à Pessah, n’est pas un fait acquis, mais un
processus continuel, jamais abouti, toujours le fruit
de nos eorts collectifs et personnels.
* Union Juive Libérale de Lyon, étudiant rabbin au Leo
Baeck College à Londres.
Pessah, ou le temps de notre liberté
par rené pfertzel*
sommaire
#39
avril mai juin 2011
nissan iyyar sivan 5771
Lettre trimestrielle de l’union juive libérale de lyon

D’ici quelques années j’espère
pouvoir t’emmener sur les traces
de notre histoire, te raconter les
aventures de mon grand-père cosaque et
juif fuyant la Russie après avoir combattu
en Sibérie à cheval. Mon père aura peut-
être le temps de te raconter comment
pendant la seconde guerre mondiale il
a vécu dans le Puy-de-Dôme sans être
inquiété, lui qu’on surnommait le petit juif.
Te raconter le Portugal et ma mère, enfant
attendant un bateau et un visa pour
fuir l’Europe. Un autre de tes arrières-
grands-pères, juif, résistant à Lyon a été
arrêté et torturé, un arrière-arrière-grand-
père déporté et assassiné. Je vois d’ici
l’inquiétude de ton père : voyons maman
tu ne vas pas commencer par lui parler
des juifs morts !
Non notre histoire ce n’est pas la Shoah
mais la Shoah fait partie de notre histoire,
comme la sortie d’Egypte, les pogroms de
l’Est, l’exil permanent, l’antisémitisme et
si je dis fièrement que dans notre famille
nous avons un doctorat en antisémitisme
du fait de notre relation au trop célèbre
Alfred Dreyfus, c’est une pirouette. Mais
notre histoire seule ne nous définit pas.
A la même époque tu auras eu largement
le temps de t’habituer à nos habitudes
gastronomiques, tu sauras que ta grand-
mère juive est une « grande malade »
de la cuisine juive ashkénaze. Je t’aurai
appris la confection des Matzeknepflich2
que nous mangeons pendant le seder
de Pessah, mais aussi à Roch Hachana,
que pour ta tante cela vaut largement le
met le plus rané, que le schmalz n’est
Lettre à Bandit1
Yom Hashoah
Place des Terreaux, Lundi 2 mai 2011 à partir de 9h
Lecture publique ininterrompue des noms des juifs déportés
jusqu’à 17h30
mémoire
pas une insulte mais de la graisse d’oie à
l’oignon et que le schmalz Herring c’est
des harengs gras, toute cette culture sera
la tienne aussi. Tu auras eu l’occasion
de te déguiser à Pourim et à Mardi gras
parce que nous vivons en France. Tu
auras peut-être été au Gan3 et appris les
mêmes comptines que ton père apprenait
aux enfants de notre communauté avec
Dov l’ours en peluche. Je t’aurais dit que
deux de tes arrières grand-mères ont
fondé un Gan en Alsace au siècle dernier.
Tu m’auras peut-être demandé si il y avait
déjà des webcams dans les peluches
pour que les parents puissent suivre les
activités de leurs enfants ?
Les souvenirs sont nos forces.
Ils dissipent les ténèbres.
Ne laissons jamais s’eacer les anniversaires
mémorables.
Quand la nuit essaie de revenir,
Il faut allumer les grandes dates,
Comme on allume des flambeaux.
Victor Hugo
Famille Abraham Dreyfus Mulhouse 1905
Notes :
1 - Surnom de l’aîné de mes petits-fils
2 - Oui oui, n’ayons pas peur des mots, l’auteur publie ses recettes :
www.kitchenbazar.fr
3 - Jardin d’enfants
Et là... je m’égare.
Tu poseras les questions à Pessah,
ouvriras la porte pour le prophète Elie
et nous serons fiers de toi, Bandit.
Tu m’accompagneras peut-être lire les
noms chaque année pour Yom Ha shoah,
je te raconterai comment nous avons
commencé cette cérémonie à Lyon.
Comment, avec ton père et ta mère, nous
avons publié sur le web les listes des juifs
persécutés en France. Bien entendu tu
ne seras pas seul, tes oncles et tantes
nous auront d’ici là proposé un casting de
rêve pour votre génération. Je serai alors
heureuse de nous rassembler tous sous le
talith XXL pour entendre sonner le chofar.
Vous serez la cinquième génération de
juifs libéraux puisque mes grands-parents
avaient choisi ce mouvement à New-
York en 1940, prolongeant la tradition
alsacienne d’un judaïsme réformé, éclairé,
adapté. Ce judaïsme nous l’avons choisi
et notre souhait Bandit, mon souhait c’est
qu’il reste le tien et celui des générations
futures.
par Manuela Wyler
2

Les Juifs de Lyon > 2nde partie
histoire
par Catherine Déchelette Elmalek
Au XVIIIe siècle, la pensée des
Lumières ouvre une perspective de
réflexion nouvelle concernant les
Juifs de France. En 1787, un concours est
lancé par la Société Royale des Sciences et
des Arts de Metz dont le sujet est le suivant :
Est-il des moyens de rendre les juifs plus
heureux et plus utiles en France ? Trois
manuscrits sont retenus et primés sur les dix
reçus ; celui de l’abbé Grégoire, alors curé
à Emberménil, celui de Thiéry, un avocat
protestant de Nancy, et celui de Zalkind
Hourwitz, un Juif polonais immigré à Paris.
Ils se partagent donc le prix, et leurs textes
ne manquent pas de relancer le débat sur
les Juifs de France. À l’exception de Zalkind
Hourwitz, le portrait brossé des Juifs est
peu flatteur et non exempt de préjugés,
mais les textes de l’abbé Grégoire et de
Thiéry indiquent clairement que la société
chrétienne est responsable de cet état de
fait et qu’une refonte des mentalités est
nécessaire1.
Ainsi, une quinzaine de familles juives venant
de Provence, de Bordeaux et d’Alsace
arrivent à Lyon au courant de ce siècle. Au
début du règne de Louis XVI, un premier
embryon de communauté commence à
s’organiser. Les familles, venues des deux
mondes culturels et spirituels du judaïsme2,
désignent un représentant appelé syndic3
dont les attributions sont réglées par le
lieutenant général de police de la ville. Les
archives attestent de l’existence d’Elie
Rouget, né vers 1740 et décédé à Lyon
le 26 février 1785, fils de Moise Rouget et
d’Esther Pichaud, époux de Sara Delpuget
est le syndic de la « nation juive » à Lyon.
Notes :
1 - Pierre Serna, « Un juif rebelle dans la Révolution, La vie de Zalkind
Hourwitz (1751-1812). », Annales historiques de la Révolution française
[En ligne], 324 | avril-juin 2001, mis en ligne le 21 avril 2004.
URL : http://ahrf.revues.org/1123
2 - Les juifs dits « bordelais » sont originaires d’Espagne et du Portugal
et sont donc séfarades. Les juifs « alsaciens » viennent quant à eux du
monde juif ashkénaze.
3 - Les termes changent selon les régions : la Nation portugaise de
Bordeaux (surnom de la communauté juive eectivement originaire
d’Espagne ou du Portugal) comme à Lyon a ses syndics, en Alsace ce
sont des préposés généraux, et dans le Comtat Venaissin des beylons.
Rina Neher-Berheim, Les Juifs en France sous la Révolution française et
l’Empire, judaisme.sdv.fr/histoire/historiq/.../rneher.htm, 2002.
4 - Jean-Claude Cohen et Roger Moulinas-site Nouvelle Gallia
Hebraica : ngj.vjf.cnrs.fr.
5 - L’édit d’expulsion de Charles IV de 1394 est toujours en vigueur,
mais selon les régions des traitements divers et plus ou moins tolérants
(spécificité du Comtat Venaissin et de Bayonne) sont constatés.
6 - Ce quartier était ainsi surnommé en raison de la présence d’une
zone de marais née des bras du Rhône et appelés «mouches».
7 - Ils sont répartis sur le territoire français de la manière suivante:
Paris avec seize départements, Strasbourg avec le département du
Bas Rhin, Wintzenheim Haut Rhin avec trois départements, Metz avec
deux départements, Nancy avec cinq départements, Bordeaux avec dix
départements, Marseille avec huit départements.
« Sur les 7 circonscriptions consistoriales, Marseille et Bordeaux étaient
composés essentiellement de séfardim. Les cinq autres étaient des
communautés ashkénazes dont la presque totalité provenait d’Alsace
et de Lorraine. Le règlement de 1808, confirmant les propositions de
l’assemblée des Notables prévoyait que les grands rabbins seraient
choisis en priorité parmi les membres du grand sanhédrin. Un rabbin ne
pouvait être nommé que s’il présentait un certificat de capacité signé
par trois grands rabbins. »
Max Warschawski, La Révolution et l’Empire, site Judaïsme Alsacien :
judaisme.sdv.fr/histoire/rabbins/rabbinat/revol.htm
8 - Eliane Dreyfus et Lise Marx, Autour des Juifs de Lyon, op.cit., p.147.
Les métiers cités sont les suivants : merciers, quincailliers, colporteurs,
marchands de tabac, militaires.
9 - Xavier de Montclos (édit.), Dictionnaire du monde religieux dans
la France contemporaine, Lyon : Le Lyonnais - Le Beaujolais, Paris,
Beauchesne, 1994, p.320.
«Samuel Heyman de Ricqlès est naturalisé en 1842, après avoir reçu
la médaille d’honneur en or du Roi Louis-Philippe pour sa conduite
exemplaire lors des inondations de Lyon en 1840. Ce notable avait
été nommé dès 1838, commissaire-surveillant (Président) de la
Communauté Juive de Lyon qui dépendait alors du Consistoire de
Marseille.» D’après Frédéric Viey : www.judaicultures.info/histoire-6/
Portraits/article/samuel-heyman-de-ricqles10-Site web-synagogue
Tilsitt : www.consistoiredelyon.fr
Il succède à Aaron Ravel, et son successeur
jusqu’à la Révolution est Benjamin Naquet.
En 1781, Elie avait reçu une lettre du
Lieutenant général de la police de Lyon
lui demandant, ociellement, d’être le
syndic de la « nation juive » de Lyon, et
responsable, à ce titre, de la délivrance
des passeports aux Juifs. Les patronymes
Rouget et Delpuget, caractéristiques des
familles judéo-contadines, attestent de leur
origine provençale4.
En 1775, la communauté obtient l’aectation
d’un caveau spécial dans les dépendances
de l’Hôtel Dieu. En infraction avec les lois du
Royaume, les Juifs sont reconnus à Lyon5.
La Révolution, par la voix de l’Assemblée
Constituante, vote l’émancipation des Juifs
le 27 septembre 1791 avec un décret qui
reconnaît aux Juifs de France la qualité de
citoyen français, sous la condition qu’ils
prêtent serment et renoncent à toute
exception de droit.
Les juifs de Lyon cherchent dès lors un
endroit plus conforme à la pratique de leur
culte et, en 1795, ils achètent un terrain dans
le quartier de la Guillotière pour y installer
leur cimetière, plus exactement dans le
quartier dit de « la Mouche »6. Le cimetière
juif de la Mouche est ainsi connu pour être le
site juif lyonnais le plus ancien.
Entre 1806 et 1807, Napoléon décide de
réglementer le culte juif. En échange de la
liberté religieuse et des droits civiques, les
juifs de France s’engagent à obéir au Code
civil et à défendre la patrie. Des consistoires,
structures constituées de laïcs sont créés
dans les départements comptant plus de
2000 juifs. Ils sont chargés, entre autres,
de nommer les rabbins. Les consistoires
régionaux sont sous le contrôle d’un
Consistoire central basé à Paris. La France
est alors divisée en treize consistoires
régionaux.
La communauté juive de Lyon, qui n’a
pas encore de reconnaissance car elle ne
compte pas plus de 200 membres, est dans
un premier temps rattachée au consistoire
de Marseille qui couvre huit départements
avec 2551 juifs dont 450 à Marseille. À la
chute de l’Empire en 1815, on dénombre
environ 40000 juifs en France et il ne reste
que sept consistoires sur les treize crées
initialement puisque les consistoires rhénans
et italiens ne dépendent plus de la France7.
Les archives témoignent des professions
des membres de la communauté
juive lyonnaise8. Il apparaît qu’ils sont
essentiellement commerçants et ont des
revenus pour la plupart modestes. En 1838,
ils nomment Samuel Heyman de Ricqlès,
originaire d’Amsterdam et négociant en
soierie, comme commissaire à la tête de la
communauté9. Selon le recensement général
eectué par le préfet, le département du
Rhône compte 762 juifs en 184110.
Les années suivantes voient la communauté
juive de Lyon « s’ocialiser » par la création
d’un consistoire spécifique et la construction
de la première synagogue. Alors que ce
consistoire prend forme et arme une
présence juive reconnue, un nouveau
siècle déjà commence et voit l’émergence
de nouvelles communautés au gré des
mouvements migratoires.
L’histoire des Juifs à Lyon commence dès les premiers siècles de la Diaspora imposée par Rome à partir
de 70. Les premiers écrits des archives lyonnaises attestant de la présence juive dans la ville de Lyon
datent du Ve siècle. Durant le Moyen-âge, puis la Renaissance, son histoire suit les aléas des politiques
engagées par les rois et les évêques du royaume de France et de la ville de Lyon, alternant tolérance et
expulsion, dialogue et menace.
3

dates
Vendredi 15 avril à 17h30 : Cours d’introduction au
judaïsme, animé par René Pfertzel
Vendredi 15 avril à 19h15 : Oce de Kabbalat Shabbat,
animé par René Pfertzel
Samedi 16 avril : Oce de Shabbat Haggadol animé
par René Pfertzel
Mardi 19 avril : Seder communautaire au Novotel
Part Dieu animé par René Pfertzel
Accueil à partir de 18h30, sous la responsabilité de l’UJL contact Daniela ou Guy
danielle.touati@free.fr ou guy.slama@wanadoo.fr
Lundi 2 mai à partir de 9h : Yom Hashoa Lecture
publique ininterrompue des noms des juifs
déportés Place des Terreaux de 9h à 17h30
Vendredi 13 mai à 17h30 : Cours d’introduction au
judaïsme, animé par René Pfertzel
Vendredi 13 mai à 19h15 : Oce de Kabbalat Shabbat
animé par René Pfertzel suivi d’un repas
chabbatique, nous célébrerons Yom
Haatsmaout
Samedi 14 mai à 10h : Oce de Shabbat Behar, animé
par René Pfertzel
Vendredi 27 mai à 19h15 : Oce de Kabbalat Shabbat,
animé par les jeunes de la communauté
Vendredi 3 juin à 17h30 : Cours d’introduction au
judaïsme, animé par René Pfertzel
Vendredi 3 juin à 19h15 : Oce de Kabbalat Shabbat,
animé par René Pfertzel. Bat Mitsva Magali et
Sydney Vennin à la CJL, 7 quai Jean Moulin,
Lyon 1er code 1738
Samedi 4 juin à 10h : Oce de Shabbat Nasso, Magali
et Sydney Vennin liront la paracha, venez
nombreux les soutenir à cette occasion, un
kiddoush sera oert par la famille après l’oce
Mardi 7 juin à 19h15 : Erev Chavouot, soirée d’études
avec René Pfertzel, merci d’apporter un mets
lacté pour célébrer chavouot comme il se doit !
Carnet rose :
Léopold est né le 9 février 2011 à Paris
chez Nathalie & Jérémy Wyler
Shirel est née le samedi 5 mars à Lyon
chez Sarah Talhaoui et Bruno Pélisse
Mazal tov aux heureux parents ;o)
évènement Brigitte Frois
Conférence de WUPJ
San Francisco, 8 – 13 février 2011
Le thème de cette année, Building
our Future, a permis de faire le
point sur la situation de la WUPJ
qui a traversé la récente crise financière
en réduisant d’environ 40% son budget
et son personnel, ce qui lui a permis de
poursuivre ses activités. Une grande
partie des délégués étaient nord-
américains, reflétant ainsi le poids de
ces communautés dans le monde libéral
(près de 80% de Juifs libéraux y vivent).
Nous avons eu le plaisir d’entendre
des délégués des diérentes régions,
notamment ceux d’Amérique du Sud,
très actifs, en plein développement dans
une zone pourtant en marge des grands
centres juifs. Les Juifs libéraux des pays
de l’ex-Union Soviétique étaient aussi
bien représentés, avec notamment les
6 rabbins de la région. Cette partie du
monde juif fait l’objet de grands eorts
de la WUPJ qui revivifie la vie juive dans
des zones très marquées par la Shoah et
par des régimes communistes hostiles
aux Juifs. Les Européens étaient aussi
bien représentés. Le nouveau chairman
de la WUPJ, Michael Grabiner, est
originaire de Londres. Le centre mondial
de la WUPJ se situe à Jérusalem. Les
Juifs libéraux israéliens étaient aussi
présents, notamment par la voix du
directeur exécutif du mouvement
israélien, l’IMPJ, le rabbin Gilad Kariv.
La délégation française était forte d’une
dizaine de personnes, dont les rabbins
Pauline Bèbe et Delphine Horvilleur.
Nous avons eu des ateliers de qualité
animés par des rabbins et des chercheurs
qui nous ont fait part de leurs recherches
et des résultats de leur réflexion. Les
détails des diérents ateliers peuvent
être retrouvés sur le site de la WUPJ :
www.wupj.org
San Francisco est une ville fort agréable,
une grande ville nord-américaine mais
qui n’écrase pas celui qui s’y promène
par son gigantisme. C’est une ville
connue pour ses positions libérales,
un peu comme un laboratoire pour
les idées progressistes. Participer
à une conférence qui réunit ainsi
des représentants de nos diérents
mouvements libéraux dans le monde
est une expérience enrichissante. La
prochaine conférence aura lieu en 2013 à
Jérusalem. Mais entretemps, la prochaine
conférence européenne aura lieu en mars
2012 à Amsterdam. Deux dates à noter
dans nos agendas !
La World Union for Progressive Judaism a tenu sa 35e
conférence biennale à San Francisco, au Westin Market Hotel.
Plus de 240 délégués venus d’une vingtaine de pays des
diérentes régions de la WUPJ se sont réunis pour échanger
leurs expériences et étudier ensemble.
les aventures
de la rabinette
Péché
originel
Scénario : FZ
Dessins : AJW
Elle persuade
Adam d’y goûter...
Eve se laisse
tenter par le
fruit défendu...
Le péché originel
est une erreur
de Genèse !
4
Lettre bimestrielle de l’union juive libérale de lyon
Ont participé à ce numéro :
Daniela Touati, René Pfertzel, Manuela Wyler,
Catherine Colin, Catherine Déchelette et Frédéric Zeitoun.
Montage : Frédéric Guedj
Courriel rédaction : contact@itoni.org
UJLL : 14 RUE GARIBALDI, 69006 LYON
(CODE PORTE : 5682)
Présidente Daniela Touati Secrétaire Valérie des Roseaux
Tél. 04 72 82 06 83 Courriel danielle.touati@free.fr
www.ujl-lyon.com
PRIX 7€ ABONNEMENT ANNUEL (4 NUMÉROS) 40€
par René Pfertzel
Rabbin Delphine Horvilleur, Sabine
Curiel et le Rabbin Pauline Bebe,
dans l’ordre de gauche à droite.
1
/
4
100%