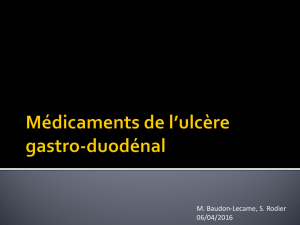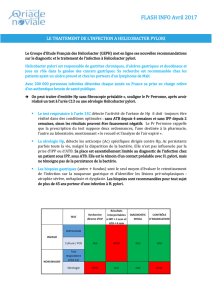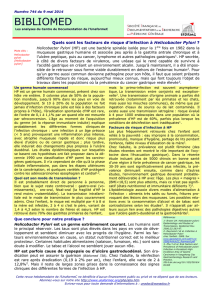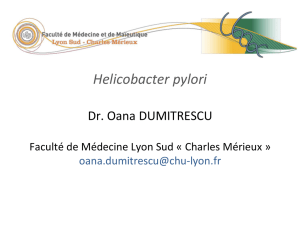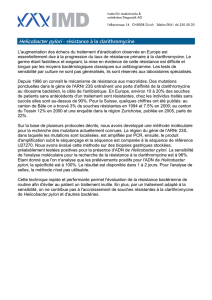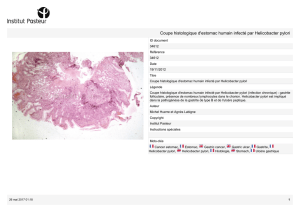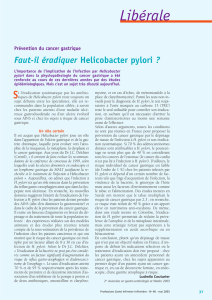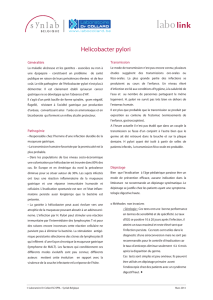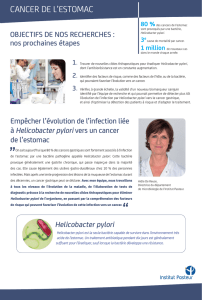Lire l`article complet

Dossier thématique
Dossier thématique
87
La Lettre de l’Hépato-gastroentérologue - Vol. X - nos 5-6 - mai-juin 2007
Quelles recommandations après la troisième conférence
de consensus européenne (Maastricht III) ?
The guidelines after the Maastricht III consensus
쐌쎲 J.C. Delchier*
H. pylori ? Les propositions élaborées par chaque groupe de
travail étaient soumises au vote de l’ensemble des délégués,
et n’étaient acceptées que si elles recueillaient plus de 75 % de
votes positifs de l’ensemble du groupe.
Les données complètes de cette réunion ont fait récemment
l’objet d’une publication (3). Voici les principales conclusions
applicables en pratique courante en France.
QUI TRAITER ?
La conférence de consensus “Maastricht II” était parvenue
en 2000, en termes de patients à traiter, à des conclusions
légèrement diff érentes de celles de la conférence de consensus
française de 1995 révisée en 1999 (tableau). La conférence de
consensus française avait recommandé le traitement de l’infec-
tion à H. pylori dans le cas d’un ulcère gastrique ou duodénal
prouvé endoscopiquement ainsi que dans celui d’un lymphome
gastrique du MALT. Il avait en outre été clairement recommandé
de ne pas rechercher l’infection à H. pylori en l’absence de lésion
macroscopique gastrique ou duodénale. Les recommandations
de “Maastricht II” étaient plus larges, avec un niveau de recom-
mandations classé de 1 à 4 selon le niveau de preuves apporté
par la littérature, le niveau 1 étant un niveau de recomman-
dations fermes et le niveau 4 un niveau de recommandations
reposant sur des avis d’experts. Dans ce cadre, la recherche de
l’infection à Helicobacter était recommandée en cas d’ulcère
peptique (actif ou non) [niveau 1], au cours du lymphome du
MALT et de l’atrophie gastrique (niveau 2), après résection
partielle gastrique pour cancer ou chez les patients ayant un
apparenté du premier degré présentant un cancer (niveau 3)
et chez les patients désirant une éradication de l’infection à
H. pylori (niveau 4).
Globalement, les recommandations de Maastricht II n’ont pas
été remises en cause dans Maastricht III.
L’intérêt de la stratégie du test and treat a été confi rmé pour les
pays où la prévalence de l’infection à H. pylori reste supérieure
à 20 %. Pour les autres, la prescription première d’un IPP peut
être préférable. Plusieurs études ont montré un bénéfi ce symp-
tomatique et un bon rapport coût/effi cacité de la stratégie du
test and treat par rapport à la stratégie préconisant l’endoscopie
première, même dans des pays occidentaux. L’éradication de
l’infection à H. pylori chez un patient dyspeptique âgé de moins
de 45 ans sans signe d’alarme reste donc une option utilisable
en première intention.
* Service de gastroentérologie, CHU Henri-Mondor, Créteil.
POINTS FORTS
La conférence d’experts Maastricht III a conclu à la nécessité
d’un traitement éradicateur de Helicobacter pylori dans les
ulcères, le lymphome du MALT, la dyspepsie fonctionnelle, les
traitements au long cours par AINS, l’atrophie gastrique, les
apparentés à un sujet atteint de cancer gastrique, les gastrec-
tomies partielles et, en n, en cas de désir du malade.
Le test respiratoire au C13 apparaît comme le meilleur test
pour le diagnostic initial et le contrôle de l’éradication.
Le traitement de première ligne reste la combinaison IPP +
amoxicilline + clarithromycine, une durée de 14 jours étant
plus e cace qu’une durée de 7 jours.
Mots-clés : Helicobacter pylori – Diagnostic – Traitement.
Keywords: Helicobacter pylori – Diagnosis – Treatment.
L
es recommandations relatives à la recherche et au traite-
ment de l’infection à H. pylori reposent, en ce qui concerne
la France, sur les données de la conférence de consensus
de 1995, révisée en 1999 (1). Parallèlement, le European Heli-
cobacter Study Group a édicté des recommandations issues de
deux réunions d’experts organisées en 1997 et en 2000 dans la
ville symbolique de Maastricht (2). Compte tenu de l’importance
des données nouvelles apparues depuis 2000, il a semblé inté-
ressant à ce groupe d’organiser une nouvelle réunion, intitulée
Maastricht III guidelines, qui s’est tenue les 17 et 18 mars 2005
à Florence. La méthodologie est assez diff érente de celle d’une
conférence de consensus “à la française”. En eff et, il s’agit là de
défi nir un consensus d’experts parmi 50 représentants provenant
principalement d’Europe, des États-Unis, d’Asie et d’Amérique
du Sud. Trois groupes de travail étaient chargés d’analyser la
littérature et de proposer des recommandations sur trois thèmes
principaux : qui traiter ? Comment diagnostiquer et traiter
H. pylori ? Quelles recommandations dégager en termes de
prévention de cancer gastrique par l’éradication de l’infection
왘
왘
왘
왘

Dossier thématique
Dossier thématique
88
Tableau.
Recommandations de traitement éradicateur de Helico-
bacter pylori en fonction des réunions de consensus.
Conférence
de consensus
française
1995-1999 (1)
Maastricht II
2000 (2)
Maastricht III
2005 (3)
Ulcères gastroduodénaux
Lymphome du MALT
Test and treat
Dyspepsie non ulcéreuse
RGO
RGO traité
AINS prévention
Thrombopénie idiopathique
Carence martiale
Maladies extradigestives
Atrophie gastrique
Apparentés cancer gastrique
Gastrectomie partielle
Désir du malade
+
+
non envisagé
-
-
-
-
non envisagé
non envisagé
non envisagé
non envisagé
non envisagé
non envisagé
non envisagé
+
+
+
+
-
+
+
?
?
-
+
+
+
+
+
+
+
+
-
+
+
+
+
-
+
+
+
+
La Lettre de l’Hépato-gastroentérologue - Vol. X - nos 5-6 - mai-juin 2007
Les relations entre refl ux gastro-œsophagien et infection à H. py-
lori ont été précisées ces dernières années. Sur le plan épidé-
miologique, il existe une relation inverse entre la prévalence de
l’infection à H. pylori et celle du refl ux gastro-œsophagien. Il
n’y a donc pas de rôle de l’infection à H. pylori dans le refl ux
gastro-œsophagien mais, au contraire, une association négative.
Il a été en revanche établi que l’éradication de l’infection à H. py-
lori n’entraîne pas la survenue d’un refl ux gastro-œsophagien et
n’exacerbe pas les symptômes des patients souff rant de refl ux
gastro-œsophagien, qu’ils soient traités ou non par IPP.
En pratique, il n’y a pas de raison de rechercher l’infection à
H. pylori en cas de refl ux gastro-œsophagien, sauf si le patient
doit être soumis à un traitement au long cours par IPP. En eff et,
dans ce cas, l’antisécrétion aff ecte la distribution de l’infec-
tion et, par conséquent, de la gastrite, avec apparition chez
certains patients d’une gastrite fundique, et elle peut accélérer
le processus d’atrophie gastrique liée à l’infection.
Les relations AINS et H. pylori sont complexes. Il existe une
augmentation du risque d’ulcère hémorragique plus marquée
lorsque les deux facteurs ulcérogènes sont associés que lors-
qu’un seul est présent (4). Les eff ets thérapeutiques de l’éradi-
cation semblent diff érer selon que celle-ci est réalisée chez un
malade traité au long cours par les anti-infl ammatoires ou chez
un patient allant recevoir de novo un traitement de ce type.
Dans le premier cas, l’éradication de la bactérie ne semble pas
apporter de bénéfi ce par rapport à un traitement par placebo en
termes de maintien de la rémission après cicatrisation par IPP et
a une effi cacité moins grande que le traitement d’entretien sur
la prévention de la récidive hémorragique. En revanche, chez
les patients naïfs de traitement anti-infl ammatoire, l’éradication
première de la bactérie améliore la tolérance aux AINS sans
supprimer complètement le risque (5). Fait important, chez les
patients développant un ulcère hémorragique sous traitement
par aspirine faible dose, l’éradication de la bactérie diminue le
taux de récidive hémorragique, même si ce taux de prévention est
inférieur à celui obtenu avec une stratégie associant éradication
et traitement d’entretien par IPP (6, 7). Il a donc été conclu que
l’éradication de l’infection à H. pylori était à recommander chez
les patients sous AINS, tout en sachant que chez ceux qui ont
développé des lésions sous AINS la prévention de la récidive
nécessite le maintien à un traitement d’entretien par IPP.
Des relations entre l’infection à H. pylori et de nombreuses
pathologies extradigestives ont été évoquées par le passé. Deux
semblent confi rmées : la relation entre la gastrite à H. pylori et
l’anémie ferriprive inexpliquée, et le purpura thrombopénique
idiopathique. Dans les deux cas, un bénéfi ce peut être attendu
de l’éradication de l’infection (8, 9).
COMMENT RECHERCHER L’INFECTION À H. PYLORI ?
La place des tests indirects a été particulièrement discutée. Le
test respiratoire à l’urée C13 apparaît comme le meilleur test
indirect à la fois pour le diagnostic initial (par exemple, dans le
cadre de la stratégie test and treat) et pour le contrôle d’éradica-
tion (10). Le test de recherche d’antigène dans les selles apparaît
également utilisable, avec des performances un peu moindres que
celles du test respiratoire. La place de la sérologie a également
été débattue. Il est apparu clairement que seules les véritables
sérologies, et non pas les doctor tests pratiqués sur une goutte
de sang, par exemple, étaient utilisables. Plusieurs travaux ont
montré que la sérologie pouvait être utile au diagnostic de l’in-
fection dans des circonstances particulières : prise récente d’un
traitement antibiotique, malades sous IPP au long cours, patients
souff rant d’une gastrite atrophique extensive, malades ayant un
lymphome du MALT ou présentant un ulcère hémorragique.
La recherche d’anticorps dans les urines ou dans la salive, en
revanche, doit être défi nitivement proscrite, car complètement
ineffi cace. Il a été clairement dit que la recherche des marqueurs
de virulence de la bactérie, notamment de la protéine Cag A,
ainsi que la recherche des facteurs génétiques de l’hôte responsa-
bles d’une réaction infl ammatoire plus importante, en particulier
le génotypage des interleukines 1, n’étaient pas utiles en pratique
courante. Enfi n, les tests rapides à l’uréase ont été reconnus,
lorsqu’ils sont positifs, comme de bons marqueurs de l’infection
à H. pylori, permettant d’instaurer un traitement éradicateur
le jour même de l’endoscopie. Cependant, il faut se souvenir
qu’ils ont une sensibilité relative qui peut être diminuée en cas
de traitement antisécrétoire concomitant, comme c’est le cas
pour tous les tests diagnostics, hormis la sérologie.
COMMENT TRAITER ?
Les données sur le traitement de l’infection à H. pylori n’ont
pas beaucoup évolué au cours de ces dix dernières années avec
simplement une augmentation des résistances, notamment

Dossier thématique
Dossier thématique
89
La Lettre de l’Hépato-gastroentérologue - Vol. X - nos 5-6 - mai-juin 2007
à la clarithromycine, dans certains pays comme ceux d’Eu-
rope du Sud. Les trithérapies combinant IPP à double dose et
clarithromycine associés à de l’amoxicilline ou à du métroni-
dazole pendant une semaine restent le traitement de première
ligne recommandé dans les populations où la résistance à la
clarithromycine est inférieure à 15-20 %. Quand le taux de
résistance au métronidazole est inférieur à 40 %, la trithérapie
la plus effi cace paraît être celle qui associe IPP, métronidazole
et clarithromycine (11). Les quadrithérapies comportant du
bismuth restent utilisables dans les pays où celui-ci est autorisé.
Compte tenu de l’augmentation des résistances, la détermination
de la sensibilité à la clarithromycine est utile. En ce qui concerne
la résistance au métronidazole, l’accent a été mis sur l’absence de
méthode consensuelle pour déterminer la résistance in vitro et
l’absence de corrélation avec les résistances in vivo, ce qui rend
inutile la détermination de la sensibilité au métronidazole en
routine. Enfi n, une méta-analyse des études réalisées avec une
trithérapie sur 7 jours et/ou 14 jours montre que les trithérapies
de 14 jours sont en général plus effi caces que les trithérapies
de 7 jours (12).
Le traitement de deuxième ligne recommandé est de deux types.
Dans les pays où le bismuth est utilisable et lorsque le traitement
de première ligne n’en a pas comporté, un traitement par quadri-
thérapie comportant du bismuth semble bien adapté. Dans les
autres pays comme la France, où le bismuth n’est pas utilisable,
il paraît surtout utile de ne pas redonner en deuxième ligne de la
clarithromycine lorsque celle-ci a été administrée en première
ligne, car la résistance à la clarithromycine entraîne un échec
quasi systématique du traitement in vivo. Le traitement par IPP,
amoxicilline et métronidazole pendant 14 jours, tel qu’il a été
utilisé dans une étude française, paraît le mieux adapté.
Quant au traitement de troisième ligne, les participants ont
reconnu qu’il ne devait être entrepris qu’après étude de la sensi-
bilité des bactéries aux antibiotiques. Deux nouvelles classes
d’antibiotiques peuvent être utilisées. La rifabutine tout d’abord,
proche de la rifampicine, en sachant que son usage doit être
limité du fait du risque d’apparition de résistance sur les myco-
bactéries. L’autre classe d’antibiotiques utilisable est la classe
des nouvelles quinolones ; la lévofl oxacine, en particulier, est
utilisée avec d’importants succès (13). Cependant, le taux de
résistance primaire aux quinolones est en augmentation.
PRÉVENTION DU CANCER GASTRIQUE
Contrairement à la conférence de consensus française, la confé-
rence de Maastricht II avait en 2000 recommandé l’éradication de
l’infection à H. pylori en cas de gastrite atrophique, de résection
gastrique antérieure pour cancer gastrique et en cas de relation
du premier degré avec un parent ayant un cancer gastrique. Ces
indications n’ont pas été remises en cause par la conférence de
Maastricht III, qui a revu l’état des données concernant le cancer
gastrique et ses relations avec l’infection à H. pylori.
Le cancer gastrique est un problème de plus en plus important
dans les pays en voie de développement, et l’infection à H. pylori
est le facteur de risque le mieux prouvé pour le cancer gastrique
non cardial. De même, il est maintenant bien admis que certains
facteurs de virulence de la bactérie et certains facteurs immu-
nitaires de l’hôte sont impliqués dans le risque de cancer. Enfi n,
l’existence de facteurs associés, telle l’alimentation pauvre en
inhibiteurs des radicaux libres de l’oxygène, est en cause dans le
risque de cancer observé dans les pays en développement.
Le groupe qui a travaillé sur le thème du cancer gastrique
a considéré, par ailleurs, qu’il existait maintenant dans la littéra-
ture des arguments permettant d’établir que l’infection à H. pylori
joue un rôle majeur dans la physiopathologie du cancer gastrique
chez l’homme et chez l’animal (14). Dans les modèles animaux,
l’éradication de l’infection à H. pylori est effi cace pour prévenir le
cancer gastrique. Des études non contrôlées chez l’homme vont
dans le même sens. Deux grandes études randomisées montrent
l’eff et bénéfi que de l’éradication sur les lésions prénéoplasiques
telles que l’atrophie avec ou sans métaplasie intestinale, avec soit
une régression, soit au moins une absence de progression par
rapport au groupe contrôle. Enfi n, la seule grande étude rando-
misée eff ectuée en Chine sur la prévention du cancer gastrique
après éradication de l’infection à H. pylori montre une absence
d’eff et signifi catif à 5 ans sur l’ensemble du groupe, mais une
réduction signifi cative, en revanche, dans le groupe sans lésion
prénéoplasique initiale (15). Cela renforce l’idée selon laquelle
l’éradication de l’infection à H. pylori est d’autant plus effi cace
qu’elle est réalisée avant la survenue des lésions prénéoplasiques
(atrophie avec ou sans métaplasie intestinale).
Toutes ces études ont amené le groupe à conclure que l’éradica-
tion de l’infection à H. pylori avait le potentiel nécessaire pour
réduire le risque de cancer gastrique. En revanche, compte tenu
des méthodes d’éradication actuellement disponibles, il n’a pas
été recommandé de rechercher et d’éradiquer systématiquement
l’infection à H. pylori pour prévenir le cancer. De nouvelles
thérapeutiques sont nécessaires pour développer une stratégie
globale d’éradication dans le but de prévenir le cancer gastrique.
En revanche, il a été conclu que l’éradication de l’infection à
H. pylori devait être envisagée dans les groupes particulièrement
à risque : malades ayant des lésions prénéoplasiques, apparentés
au premier degré à un malade ayant un cancer gastrique, ayant
subi une résection partielle de l’estomac pour cancer. ■
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES
1. Conférence de consensus Helicobacter pylori. Conclusions révisées en recom-
mandations de groupe de travail. Gastroenterol Clin Biol 1999;23:C95-104.
2. Malfertheiner P, Megraud F, O’Morain C et al. Current concepts in the mana-
gement of Helicobacter pylori infection: the Maastricht II-2000 Consensus
Report. Aliment Pharmacol er 2002;16:167-80.
3. Malfertheiner P, Megraud F, O’Morain C et al. Current concepts in the mana-
gement of Helicobacter pylori infection: the Maastricht III Consensus Report.
Gut 2007.
4. Huang JQ, Sridhar S, Hunt RH. Role of Helicobacter pylori infection and
non-steroidal anti-infl ammatory drugs in peptic-ulcer disease: a meta-analysis.
Lancet 2002;359:14-22.

Dossier thématique
Dossier thématique
90
La Lettre de l’Hépato-gastroentérologue - Vol. X - nos 5-6 - mai-juin 2007
5. Vergara M, Catalan M, Gisbert JP, Calvet X. Meta-analysis: role of Heli-
cobacter pylori eradication in the prevention of peptic ulcer in NSAID users.
Aliment Pharmacol er 2005;21:1411-8.
6. Chan AO, Chu KM, Yuen ST et al. Synchronous gastric adenocarcinoma and
mucosa-associated lymphoid tissue lymphoma in association with Helicobacter
pylori infection: comparing reported cases between the East and West. Am J
Gastroenterol 2001;96:1922-4.
7. Lai KC, Lam SK, Chu KM et al. Lansoprazole for the prevention of recur-
rences of ulcer complications from long-term low-dose aspirin use. N Engl J Med
2002;346:2033-8.
8. Ciacci C, Sabbatini F, Cavallaro R et al. Helicobacter pylori impairs iron
absorption in infected individuals. Dig Liver Dis 2004;36:455-60.
9. Franchini M, Veneri D. Helicobacter pylori infection and immune thrombocy-
topenic purpura: an update. Helicobacter 2004;9:342-6.
10. Gisbert JP, Pajares JM. Review article: C-urea breath test in the diagnosis
of Helicobacter pylori infection - a critical review. Aliment Pharmacol er
2004;20:1001-17.
11. Megraud F. Update on therapeutic options for Helicobacter pylori-related
diseases. Curr Infect Dis Rep 2005;7:115-20.
12. Ford A, Moayyedi P. How can the current strategies for Helicobacter pylori
eradication therapy be improved? Can J Gastroenterol 2003;17(Suppl.B):36B-
40B.
13. Gisbert JP, Morena F. Systematic review and meta-analysis: levofl oxacin-
based rescue regimens after Helicobacter pylori treatment failure. Aliment Phar-
macol er 2006;23:35-44.
14. Uemura N, Okamoto S, Yamamoto S et al. Helicobacter pylori infection and
the development of gastric cancer. N Engl J Med 2001;345:784-9.
15. Wong BC, Lam SK, Wong WM et al. Helicobacter pylori eradication to
prevent gastric cancer in a high-risk region of China: a randomized controlled
trial. JAMA 2004;291:187-94.
La Lettre de l’Hépato-gastroentérologue
vous souhaite de tout cœur un bel été et vous remercie
de la délité de votre engagement
1
/
4
100%