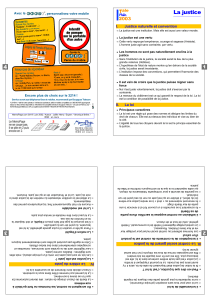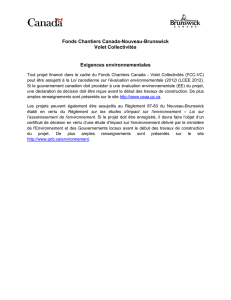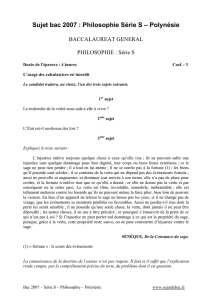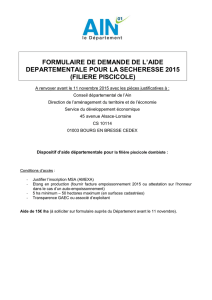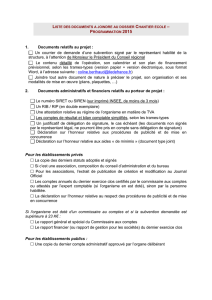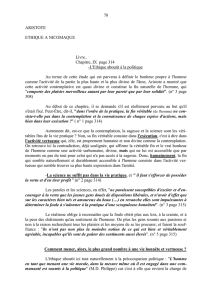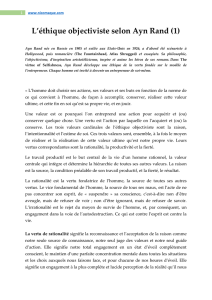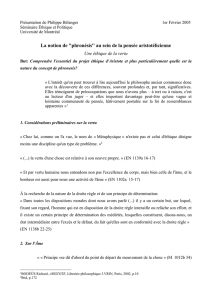L`estime sociale Ou les figures de l`estime

Ces dernières années, des auteurs comme G. Brennan et P. Pettit
(2004), J. Elster (1999), A. Honneth (2000), L. Boltanski et L. Thévenot
(1991) ont contribué à développer la thématique de l’estime sociale.
Cependant leurs compréhensions du phénomène divergent sur de
nombreux points et leurs analyses donnent souvent l’impression d’être
inconciliables. Une lecture attentive montre cependant que leurs thèses
partagent plusieurs éléments communs qui permettent, comme nous
nous proposons de le faire dans cet article, d’établir une ontologie
cohérente de l’estime sociale. Précisons encore que cette cohérence
repose sur le vocabulaire de sens commun afférent à l’estime, dont les
moralistes français ont contribué à développer la richesse. En effet,
Montaigne, Pascal, La Rochefoucauld ou La Bruyère, bien qu’ils
n’utilisent pas l’expression telle qu’elle, rendent le concept d’estime
sociale par les mots « honneur », « respect », « gloire », « grandeur »,
« dignité », « distinction », « renommée », « considération », ou encore
« estime publique ». Notre manière de procéder dans ces pages
consistera donc à examiner ce vocabulaire et à l’analyser en nous
aidant des théories développées par les chercheurs susmentionnés.
Frédéric Minner est licencié en sociologie de l’Université de Genève.
ISBN : 2-940386-05-2978-2-940386-07-9
Working Paper n° 3 / 2009
L’estime sociale
Ou les figures de l’estime
Frédéric Minner
D
É
PARTEMENT DE SOCIOLOGIE

1
L’estime sociale
Ou les figures de l’estime
Frédéric Minner
Working Paper n° 3 / 2009

2
L’estime sociale
Ou les figures de l’estime
Frédéric Minner
Citation conseillée : Minner, Frédéric. L’estime sociale, ou les figures de l’estime
(2009). Genève : Université de Genève.
ISBN : 2-940386-05-2978-2-940386-07-9
3
Table des matières
Table des matières 3
1 Introduction 4
2 La nature de l’estime sociale 5
2.1 Définition de l’estime 6
3 Deux modalités de la comparaison : présence et interaction 10
4 Les formes relationnelles de l’estime sociale 14
5 La reconnaissance sociale et l’éthique des vertus 18
5.1 La formule de la relation pentadique 18
5.2 Éthique attractive et éthique impérative 20
5.3 Étude de cas 21
5.4 Les concepts éthiques épais 25
5.5 La reconnaissance sociale 27
5.6 La formule de la relation pentadique, bis 30
6 Les figures de l’estime 31
6.1 Les vertus cardinales de l’estime 31
6.2 La dignité et l’intégrité 33
6.3 La gloire et l’excellence 37
6.4 L’honneur et le courage 40
6.5 La grandeur et la magnanimité 44
7 Conclusion 53
8 Bibliographie 54

4
On dit souvent que les trois passions présidant à l’existence
humaine sont le désir de propriété, le désir du pouvoir, et le
désir du prestige, de statut ou d’estime (Paul Ricoeur in
L’homme faillible). Les effets du premier désir sont décrits par
l’économie standard, les effets du second par la science politique
– et bien sûr ils sont enregistrés dans les annales de l’histoire.
Mais les effets du désir pour l’estime ont échappé à la sagacité
des chercheurs en sciences sociales. C’est presque comme s’il
existait un complot afin de ne pas rapporter ou attester le fait
que nous sommes, et avons toujours été, une espèce avide
d’honneur.
Geoffrey Brennan, Philip Pettit, The Economy of esteem
1 Introduction
Ces dernières années, des auteurs comme G. Brennan et P. Pettit (2004),
J. Elster (1999), A. Honneth (2000), L. Boltanski et L. Thévenot (1991) ont
contribué à développer la thématique de l’estime sociale. Cependant leurs
compréhensions du phénomène divergent sur de nombreux points et leurs
analyses donnent souvent l’impression d’être inconciliables. Une lecture
attentive montre cependant que leurs thèses partagent plusieurs éléments
communs qui permettent, comme nous nous proposons de le faire dans cet
article, d’établir une ontologie cohérente de l’estime sociale. Précisons
encore que cette cohérence repose sur le vocabulaire de sens commun
afférent à l’estime, dont les moralistes français ont contribué à développer
la richesse1. En effet, Montaigne, Pascal, La Rochefoucauld ou La Bruyère,
bien qu’ils n’utilisent pas l’expression telle qu’elle, rendent le concept
d’estime sociale par les mots « honneur », « respect », « gloire »,
« grandeur », « dignité », « distinction », « renommée », « considération »,
ou encore « estime publique ». Notre manière de procéder dans ces pages
consistera donc à examiner ce vocabulaire et à l’analyser en nous aidant des
théories développées par les chercheurs susmentionnés.
L’estime sociale consiste en une attitude évaluative, comparative et
directive dépendante de relations établies par l’interaction ou par la mise en
présence d’un individu dans le contexte social d’un autre. Au sens le plus
fort pris par l’estime, ces relations ont la forme de relations pentadiques où
1 Elster (1999) préconise ces auteurs pour qui veut comprendre les mécanismes de
l’estime.
5
l’individu en quête d’estime se compare et est comparé à un autre individu,
par un public, relativement à des idéaux moraux. Ces idéaux sont indexés à
des statuts sociaux – ce que nous illustrons au moyen d’exemples tirés
d’une étude sociologique menée aux Hôpitaux Universitaires de Genève. Le
fait que les individus cherchent à être positivement estimés, relativement à
ces idéaux afférents à leurs statuts sociaux, assimile la quête de l’estime des
autres à une quête de reconnaissance. Remarquons encore que les relations
pentadiques, d’où l’estime tire son origine, se traduisent dans des formes
sociales caractéristiques qui permettent de dégager les quatre figures
principales de l’estime : la dignité, la gloire, l’honneur et la grandeur,
auxquels sont respectivement associés quatre idéaux : l’intégrité,
l’excellence, le courage et la magnanimité qu’un individu en quête d’estime
cherche à personnifier par ses manières d’être. Nous posons ainsi que
l’estime sociale consiste en un phénomène agrégeant des états mentaux, des
relations, des formes sociales, et des comportements éthiques.2
2 La nature de l’estime sociale
Comme le montre l’épigraphe à notre article, Brennan et Pettit postulent
que l’espèce humaine est une espèce avide d’honneur : les êtres humains
tendent à rechercher l’estime de leurs pairs et à éviter leur mésestime. Ces
auteurs ajoutent que
« […] L’évidence fait valoir, jusqu’à un certain point, que l’estime, de
manière inconditionnelle ou intrinsèque, a prise sur nous […] – l’estime
étant quelque chose que la nature a disposé dans l’être humain afin qu’il
la trouve attractive, peut-être pour des raisons de fitness biologique. Nous
nous préoccupons souvent de l’estime lorsqu’il y a peu ou rien à gagner
[…]. Nous nous préoccupons de notre rang vis-à-vis de gens que nous ne
serons probablement pas conduits à voir – disons ceux qui viendront après
nous – et vis-à-vis de gens qui savent si peu à notre sujet que leur opinion
ne peut guère nourrir l’image […] que nous avons de nous-mêmes.
(Brennan, Pettit, 2004, p.29)
2 Nous souhaitons vivement remercier Stéphane Augsburger, Antoine Läng et Emma
Tieffenbach, qui, par leurs remarques éclairées, ont grandement contribué à améliorer
le contenu de ces pages.

6
Restant prudents sur la généalogie évolutionniste du phénomène, les
auteurs n’en déclarent pas moins que l’estime est une capacité naturelle de
l’être humain qu’il est disposé à trouver attractive de manière
inconditionnelle, « jusqu’à un certain point ». De fait, certains sujets sociaux
se soucient de leur réputation auprès d’individus qu’ils ne connaîtront
jamais, comme ceux de générations futures. Cet intérêt irrationnel pour
l’opinion d’un public futur semble donc indiquer que l’estime est attractive
de manière intrinsèque et compte pour être une fin en soi. On ne peut
néanmoins nier qu’un sujet puisse, dans certaines circonstances, chercher
l’estime des autres à des fins purement utilitaires, comme dans le cas où
celle-ci permet d’accéder à des statuts conférant du pouvoir sur autrui.
Toutefois, dans le cas de l’exercice du pouvoir, l’histoire montre que tous
les grands tyrans ont su instaurer autour d’eux un véritable culte de la
personnalité, comme Mao Zedong, pour ne citer que lui. Dans notre article,
nous nous en tiendrons ainsi à l’hypothèse que l’estime possède une valeur
intrinsèque aux yeux de l’humain, sans chercher à explorer les rapports que
sa quête entretient avec celles du pouvoir ou de la richesse.
2.1 Définition de l’estime
L’estime sociale est une attitude évaluative consistant à approuver ou
désapprouver la ou les manières d’être au monde d’un individu. Comme
objets de l’estime, ces manières d’être sont les actes, les pensées, les traits
de caractère et les apparences physiques de cet individu – c’est-à-dire que
tout composant relevant soit de son vécu culturel, soit de son héritage
génétique, est susceptible d’être évalué comparativement à un référent
axiologique. Afin d’éviter toute confusion, précisons que le concept
d’estime est utilisé dans le sens technique suivant : estimer quelqu’un ou
quelque chose signifie évaluer positivement ou négativement cette personne
ou cette chose. Ce concept est donc neutre : il retrace le fait qu’estimer un
objet signifie simplement lui conférer une valeur positive ou négative
(Brennan, Pettit, 2004). Ainsi, si une manière d’être au monde d’un individu
est estimée par rapport à un référent et que cette manière d’être est
conforme à celui-ci, alors l’estime est positive ; dans le cas inverse, l’estime
est négative. Ajoutons que les référents à partir desquels sont déterminées
les valences positives ou négatives de l’estime ressortissent à trois types : ils
consistent en des standards, des normes ou des idéaux (Brennan, Pettit,
2004).
7
La propriété de ces référents axiologiques est d’orienter ce que doit être
une manière d’être comparativement à eux. En effet, les mécanismes de
l’estime ne se bornent pas aux seuls jugements de valeur ; ils indiquent
également la direction de ce qui est à faire préférentiellement ou
impérativement. Sans nous préoccuper de leur provenance culturelle, nous
pouvons donner quelques exemples d’impératifs que l’on peut rencontrer
dans le monde : premièrement, les impératifs portant sur ce qu’il est adéquat
de faire : manger avec des baguettes ; arriver à l’heure à un rendez-
vous ; ouvrir les portes aux dames ; deuxièmement, ceux qui portent sur les
manières de penser : ne pas convoiter la femme de son voisin ; se réjouir de
la réussite d’autrui ; ne pas croire en une théorie hétérodoxe ;
troisièmement, il y a ceux qui visent le paraître : se coiffer à la dernière
mode ; scarifier son visage ; porter de faux ongles ; et finalement, ceux qui
portent sur ce qu’il est adéquat d’être : être poli, probe, subtil ; ou de n’être
pas : stupide, avare, hypocrite. Pour résumer : l’estime sociale a pour cible
les caractéristiques comportementales, psychologiques et physiques d’un
agent qu’elle contribue à façonner culturellement, en indiquant la direction à
suivre, afin d’acquérir du prestige ou d’éviter le déshonneur. Cette
conception de l’estime comme attitude est redevable à G. Brennan et P.
Pettit qui considèrent que trois caractéristiques fondamentales la
caractérisent :
« (1) C’est une attitude évaluative
Parce qu’elle implique de classer une personne sous un aspect ou un
autre.
(2) C’est une attitude comparative
Parce que dans la plupart des cas, l’intensité de l’estime ne dépend pas
seulement du classement absolu, mais aussi de la manière dont une
personne se compare avec les individus pertinents dans le classement en
cause.
(3) C’est une attitude directive
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
1
/
29
100%