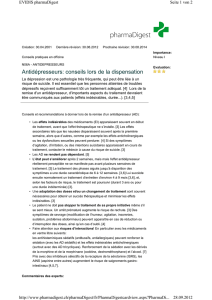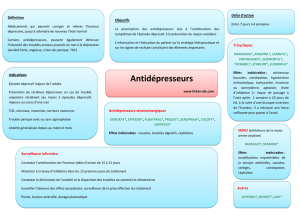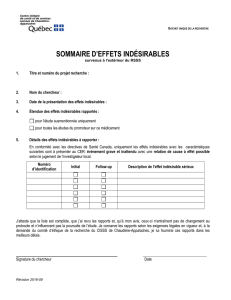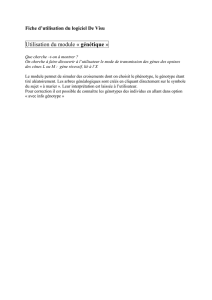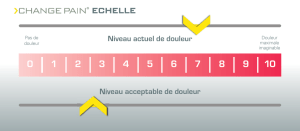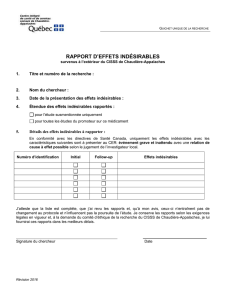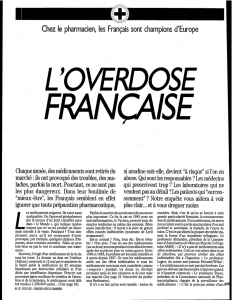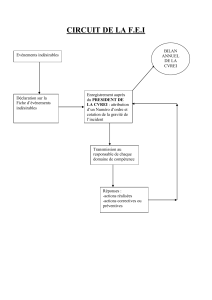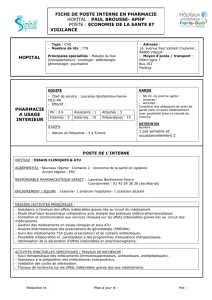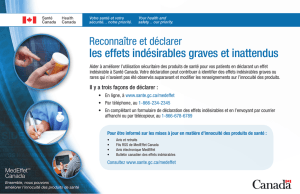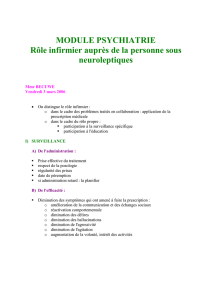Lire l`article complet

34 | La Lettre du Psychiatre • Vol. VIII - no 1 - janvier-février 2012
MISE AU POINT
Dépression du sujet âgé :
quelles perspectives
pour individualiser
le traitement antidépresseur ?1
Depression in elderly patients: how to personalize
antidepressant treatment?
P. Vandel*
L
a dépression représente le trouble psychiatrique
le plus fréquent chez la personne âgée et pour-
rait atteindre la deuxième place au classement
des maladies invalidantes d’ici à 2020. En méde-
cine générale, 15 à 30 % des personnes âgées qui
consultent présentent des symptômes dépressifs
significatifs. Les études menées chez les patients
âgés hospitalisés en gériatrie mettent en évidence un
taux de dépression de 20 à 40 %, et la fréquence est
similaire dans les maisons de retraite et les services
de soins de longue durée (1).
Dépression du sujet âgé :
les problématiques
Cette affection est souvent non diagnostiquée
ou insuffisamment traitée. Les médicaments
antidépresseurs sont en effet sous-utilisés chez
les personnes âgées présentant un état dépressif
majeur, puisque moins de 20 % des patients âgés
identifiés comme dépressifs sont traités avec des
antidépresseurs. Les posologies utilisées sont le
plus souvent faibles, avec pour conséquence une
efficacité médiocre (2). Enfin, les benzodiazépines
sont fréquemment prescrites de façon inadaptée
pour traiter un état dépressif. Les antidépresseurs
ont aujourd’hui démontré leur efficacité, mais il
reste des obstacles à cette thérapie.
Ces obstacles concernent à la fois l’efficacité théra-
peutique, le délai d’action, qui peut atteindre
plusieurs semaines, et enfin les effets indésirables.
Chez le sujet âgé, les études de cohorte s’appuyant
sur les essais cliniques ont montré que l’efficacité des
traitements antidépresseurs, définie par la rémission
à 3 mois, est nettement inférieure à ce qu’on obtient
dans la population générale. Les données des études
de la méta-analyse de la base Cochrane comparant
les traitements antidépresseurs à un placebo chez
les sujets âgés déprimés trouvent en effet que 28 %
des patients traités par inhibiteur de la recapture de
la sérotonine (IRS) et 47 % des patients recevant un
antidépresseur tricyclique sont efficacement traités
à 3 mois (3). Cependant, ces résultats restent assez
éloignés des 60 % attendus.
Il est admis par ailleurs que la plupart des antidépres-
seurs montrent un délai d’action de 2 à 4 semaines
avant qu’une amélioration clinique ne soit notable
chez les patients. Ce délai diffère peu en fonction
des molécules utilisées mais est en général plus long
chez les personnes âgées (4 à 8 semaines) [4].
Les antidépresseurs sont souvent prescrits aux
personnes âgées à des posologies réduites. Une
étude récente a ainsi montré que 43 % des individus
d’une cohorte rétrospective de 12 130 patients de
plus de 65 ans sous antidépresseurs n’étaient pas
traités de manière optimale (5). En particulier, 35 %
recevaient un traitement insuffisant (du fait de sa
dose ou de sa durée).
Cette attitude est principalement due à la crainte ou
à la survenue d’effets indésirables. Les effets indé-
sirables surviendraient en effet plus fréquemment
chez les personnes âgées (6), et sont responsables
d’une moins bonne observance.
* Service de psychiatrie de l’adulte,
CHU de Besançon; université de
Franche-Comté, Besançon.
1
Congrès de la Société de psycho-
gériatrie de langue française,
Toulouse, 14-16 septembre 2011 :
symposium “Dépression du sujet
âgé : évaluation bénéfices/risques
des traitements antidépresseurs”.

La Lettre du Psychiatre • Vol. VIII - no 1 - janvier-février 2012 | 35
Résumé
La dépression, qui constitue le trouble psychiatrique le plus fréquent chez la personne âgée, est souvent
non diagnostiquée ou insuffisamment traitée.
L’individualisation de la prescription dans cette population représente un défi pour le clinicien.
La pharmacogénétique, qui vise à utiliser l’analyse du génome pour évaluer son implication dans la
réponse au traitement (efficacité, délai d’action et effets indésirables), est un des outils de cette adapta-
tion thérapeutique.
Mots-clés
Dépression
Personnes âgées
Pharmacogénétique
CYP2D6
Transporteur
desérotonine
Summary
Depression is one of the
leading causes of disability and
the most frequent psychiatric
disorder in the elderly.
Depression in the elderly is
underdiagnosed and under-
treated.
A “tailored” treatment based
on individual characteristics is
a challenge for the physician.
One of the tools for this
tailored medication is the use
of pharmacogenetics, leading
to an evaluation of the human
genome implications in the
treatment response (efficacy,
time of onset and adverse
events).
Keywords
Depression
Elderly
Pharmacogenetic
CYP2D6
Serotonin transporter
La prescription d’un traitement antidépresseur,
souvent indispensable, se fonde alors sur des
recommandations en population générale, adap-
tées en fonction de l’expérience du médecin et de
l’observation des réactions individuelles au trai-
tement. Les recommandations nous engagent à
commencer le traitement par des doses faibles en
veillant aux interactions médicamenteuses. Cepen-
dant, cette règle de prescription risque de conduire
à un sous-dosage de l’antidépresseur, susceptible
d’avoir pour conséquence une efficacité diminuée,
voire nulle.
Tableau. Polymorphismes étudiés dans la dépression du sujet âgé et résultats obtenus.
Polymorphisme étudié Bibliographie Antidépresseur Résultats
CYP2D6 Pollock et al., 1992
(9)
La proportion de phénotypes et la corrélation
génotype/phénotype sont conservées
dans la population âgée
Murphy et al., 2001
(10)
Nortriptyline Corrélation négative entre la présence d’allèle
mutant et la concentration plasmatique
Murphy et al., 2003
(11)
Paroxétine
Mirtazapine
Pas de corrélation établie entre le génotype
etl’apparition d’effets indésirables
CYP2C9, CYP2D6
et CYP2C19
Egger et al., 2005
(12)
Amitriptyline
Citalopram
Pas de corrélation établie entre le génotype
etl’apparition d’effets indésirables
5HTTLPR Kim et al., 2006
(13)
Fréquence des génotypes conservée
dans la population âgée
Pollock et al., 2000
(14)
Paroxétine –Génotype
ll
lié à une diminution du délai
d’action
–Pas de corrélation avec le nombre
derépondeurs
Nortriptyline Pas de corrélation entre le génotype et le délai
d’action ou le nombre de répondeurs
Murphy et al., 2004
(15)
Paroxétine –Relation linéaire entre le nombre d’allèles S
et les effets indésirables
–Pas de corrélation avec l’efficacité
dutraitement
Mirtazapine –Relation linéaire entre le nombre d’allèles L
et les effets indésirables
–Pas de corrélation avec l’efficacité
dutraitement
Schillani et al., 2011
(16)
Escitalopram Correlation entre le nombre d’allèles S
et l’efficacité sur l’anxiété
5HTR2A Murphy et al., 2003
(11)
Fréquence des génotypes conservée
dans la population âgée
Paroxétine Relation linéaire entre le nombre d’allèles C
etles effets indésirables
Mirtazapine Pas de corrélation entre le génotype et les
effets indésirables
5HTTLPR et 5HTR2A Murphy et al., 2004
(15)
Paroxétine
Mirtazapine
Les effets des polymorphismes s’additionnent
mais n’interagissent pas

36 | La Lettre du Psychiatre • Vol. VIII - no 1 - janvier-février 2012
MISE AU POINT Dépression du sujet âgé : quelles perspectives pourindividualiser
letraitement antidépresseur ?
Peut-on individualiser
la prescription ?
L’individualisation du traitement dans le but d’opti-
miser son efficacité et d’en diminuer les effets indé-
sirables prend tout son sens chez la personne âgée.
La première approche concernant l’individualisation
du traitement en caractérisant le métabolisme du
patient s’est faite par le dosage plasmatique des
médicaments (Therapeutic Drug Monitoring [TDM]).
Le dosage plasmatique cherche à évaluer la posologie
médicamenteuse individuelle après instauration du
traitement (7). Dans les années 1990, la pharmaco-
génétique est venue compléter le TDM (8).
La pharmacogénétique est un aspect de la pharma-
cologie clinique qui vise à évaluer les implications
de la variabilité du génome humain dans les diffé-
rents aspects de la réponse à un traitement tant en
termes d’efficacité, de délai d’action que d’effets
indésirables. Elle est particulièrement indiquée chez
les patients de plus de 65 ans, puisqu’elle prend en
compte les facteurs de variabilité de la pharmaco-
cinétique et de la pharmacodynamique spécifiques
à cette population.
Différentes études menées spécifiquement chez la
personne âgée s’intéressent aux gènes candidats de
la pharmacogénétique de la dépression du sujet âgé.
Les cytochromes P450 (CYP), dont le CYP2D6, ont
été les premiers étudiés : l’objectif était de mettre
en relation leurs polymorphismes et l’efficacité des
antidépresseurs (tableau, page 35). Les résultats de
la plupart des études montrent que le lien entre la
concentration plasmatique d’antidépresseur et le
génotype CYP2D6 est conservé chez les personnes
âgées, mais peut être modifié par les thérapeutiques
concomitantes. Actuellement, cependant, l’étude du
génotype CYP2D6 ne permet pas de prédire les effets
indésirables et la discontinuation du traitement ni
de déterminer des indications thérapeutiques (9-12,
17, 18).
Les autres polymorphismes étudiés chez les sujets
âgés concernent principalement le transporteur de la
sérotonine (5HTT) [11, 13-16]. Les liens concernent
principalement les antidépresseurs de la catégorie
des IRS qui agissent en effet via l’inhibition du trans-
porteur de la sérotonine (5HTT). Ainsi, les variations
génétiques de 5HTT ont été considérées comme une
cible évidente de l’étude de la pharmacogénétique
de la dépression. Le polymorphisme le plus étudié
est celui du promoteur (5HTTLPR) du gène du trans-
porteur de la sérotonine. Les résultats montrent
un lien entre le nombre d’allèles s du 5HTTLPR, le
nombre d’allèles C du 5HTR2A et les effets indési-
rables ainsi que l’efficacité du traitement par certains
IRS (tableau, page 35).
Il apparaît alors, comme dans les études sur le
CYP2D6, que l’antidépresseur considéré conditionne
le résultat obtenu et que l’on ne peut pas établir de
loi générale concernant l’implication d’un génotype
dans la réponse individuelle à un traitement antidé-
presseur quel qu’il soit, chaque molécule ayant des
particularités pharmacologiques et des affinités pour
des sites et des transporteurs différentes.
Conclusion
Les études effectuées chez les personnes âgées
sont moins avancées que celles effectuées dans la
population générale et ne permettent pas encore
l’instauration d’un traitement “sur mesure” pour
les patients âgés dépressifs. Les études en cours
montrent quelques résultats encourageants, mais
de nombreux paramètres sont à améliorer afin
d’augmenter la pertinence des études fondées sur
la pharmacogénétique.
Il semble en effet intéressant de considérer l’en-
semble des caractéristiques génétiques d’un patient
et donc de prendre en compte son génotype pour
différents gènes cibles, mais aussi le phénotype,
résultant des interactions gènes-gènes et gènes-
environnement (19).
Ces résultats restent cependant préliminaires et
exigent d’être approfondis, même s’ils laissent
entrevoir de nombreuses possibilités d’étude de la
pharmacogénétique de la dépression, en particulier
chez la personne âgée.
Enfin, il faut également envisager l’utilisation
d’autres méthodes associées à la génétique comme
F. Holsboer le suggère dans son article publié dans
Nature en 2008 (20). Il propose, entre autres, de
rechercher des biomarqueurs (c’est-à-dire des méta-
bolites) qui permettraient de classer les individus
par sous-groupes pour un même diagnostic et qui
représenteraient leur capacité à répondre aux diffé-
rents traitements. ■
Conflit d’intérêts. L’auteur déclare avoir un conflit d’intérêts :
honoraires, financements de congrès et subventions de recherche
reçus de différents laboratoires pharmaceutiques (Bristol-Myers
Squibb, GlaxoSmithKline, Wyeth, Servier, Janssen, Sanofi, Biocodex,
Pfizer, Lundbeck, Lilly) depuis 10ans pour conférences, coordination
d’études et conseil ou expertise scientifique.

La Lettre du Psychiatre • Vol. VIII - no 1 - janvier-février 2012 | 37
MISE AU POINT
1. Baldwin R. Mood disorders. In : Jacoby R, Oppenheimer C,
Dening T, Thomas A. Oxford text book of old age psychiatry.
Oxford : Oxford University Press, 2008:524-56.
2. Unützer J, Katon W, Callahan CM et al. Depression treat-
ment in a sample of 1,801 depressed older adults in primary
care. J Am Geriatr Soc 2003;51(4):505-14.
3. Wilson K, Mottram P, Sivanranthan A, Nightingale A.
Antidepressant versus placebo for depressed elderly.
Cochrane Database Syst Rev 2001;(2):CD000561.
4. Baldwin RC, Anderson D, Black S et al. Guideline for the
management of late-life depression in primary care. Int J
Geriatr Psychiatry 2003;18(9):829-38.
5. Wang PS, Schneeweiss S, Brookhart MA et al. Suboptimal
antidepressant use in the elderly. J Clin Psychopharmacol
2005;25(2):118-26.
6. Mottram P, Wilson K, Strobl J. Antidepressants for
depressed elderly. Cochrane Database Syst Rev 2006;(1):
CD003491.
7. Reis M, Aamo T, Spigset O, Ahlner J. Serum concentrations
of antidepressant drugs in a naturalistic setting: compilation
based on a large therapeutic drug monitoring database. Ther
Drug Monit 2009;31(1):42-56.
8. Dahl ML, Sjoqvist F. Pharmacogenetic method as a
complement to therapeutic monitoring of antidepressants
and neuroleptics. Ther Drug Monit 2000;22:114-7.
9. Pollock BG, Perel JM, Altieri LP et al. Debrisoquine
hydroxylation phenotyping in geriatric psychopharmaco-
logy. Psychopharmacol Bull 1992;28: 163-8.
10. Murphy GM Jr, Pollock BG, Kirshner MA et al. CYP2D6
genotyping with oligonucleotide microarrays and nortrip-
tyline concentrations in geriatric depression. Neuropsycho-
pharmacology 2001;25:737-43.
11. Murphy GM Jr, Kremer C, Rodrigues HE, Schatzberg AF.
Pharmacogenetics of antidepressant medication intole-
rance. Am J Psychiatry 2003;160:1830-5.
12. Egger T, Dormann H, Ahne G et al. Cytochrome p450
polymorphisms in geriatric patients: impact on adverse
drug reactions–a pilot study. Drugs Aging 2005;22(3):
265-72.
13. Kim H, Lim SW, Kim S et al. Monoamine transporter gene
polymorphisms and antidepressant response in Koreans with
late-life depression. JAMA 2006;296:1609-18.
14. Pollock BG, Ferrell RE, Mulsant BH et al. Allelic varia-
tion in the serotonin transporter promoter affects onset
of paroxetine treatment response in late-life depression.
Neuropsychopharmacology 2000;23:587-590.
15. Murphy GM, Jr, Hollander SB, Rodrigues HE, Kremer C,
Schatzberg AF. Effects of the serotonin transporter gene
promoter polymorphism on mirtazapine and paroxetine
efficacy and adverse events in geriatric major depression.
Arch Gen Psychiatry 2004;61:1163-9.
16. Schillani G, Capozzo MA, Era D et al. Pharmacogenetics
of escitalopram and mental adaptation to cancer in palliative
care: report of 18 cases. Tumori 2011;97(3):358-61.
17. De Leon J, Susce MT, Murray-Carmichael E. The Ampli-
Chip CYP450 genotyping test: Integrating a new clinical
tool. Mol Diagn Ther 2006;10(3):135-51.
18. Monnin J, Haffen E, Sechter D, Vandel P. Pharmacogene-
tics of depression in elderly patients. Psychol Neuropsychiatr
Vieil 2009;7(1):43-55.
19. Meisel C, Gerloff T, Kirchheiner J et al. Implications of
pharmacogenetics for individualizing drug treatment and for
study design. J Mol Med (Berl) 2003;81(3):154-67.
20. Holsboer F. How can we realize the promise of perso-
nalized antidepressant medicines? Nat Rev Neurosci
2008;9:638-46.
Références bibliographiques
Géographies de la folie : figures atypiques
de la subjectivité et littérature
Séminaire animé par Cécile Ladjali et Bruno Verrecchia
De 18 h 30 à 20 h 30 au ministère de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche, 25, rue de la Montagne-Sainte-Geneviève,
75005 Paris
Entrée libre et gratuite sur présentation de votre pièce d’identité
Mercredi 1er février : I. Folie mythologique et
folie biblique : les racines du haut mal
Mercredi 28 mars, salle JA05 :
II. Renaissance
Mercredi 2 mai, salle JA01 :
III. Folie baroque et folie classique
Mercredi 30 mai, salle JA05 :
IV. Russie, le thème du double
Mercredi 13 juin, salle JA05 :
V. France, idéalisme et névrose fin de siècle
Mercredi 27 juin, salle JA01 :
VI. Allemagne : le pacte avec le diable
Pour tout renseignement, tél. : 01 44 41 46 80 ; www.ciph.org
Agenda
1
/
4
100%