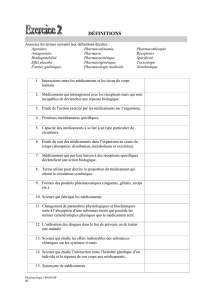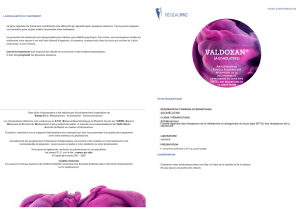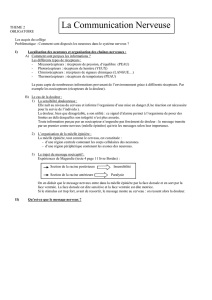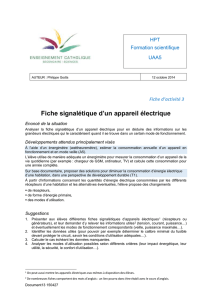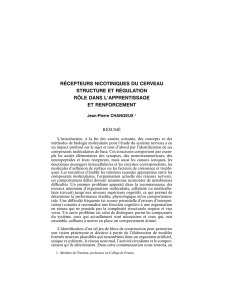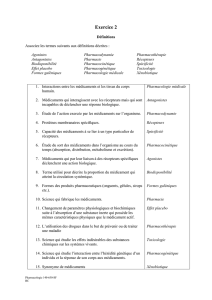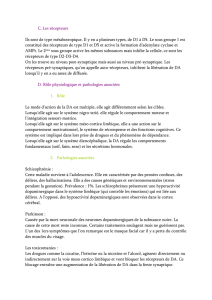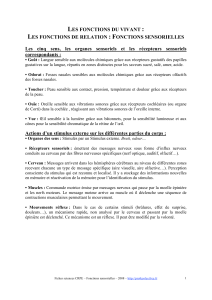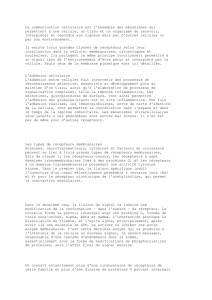Cours DU -Eschalier

Cours DU -Eschalier
IMPLICATION DU SYSTÈME MONOAMINERGIQUE DANS LA
TRANSMISSION
ET LA RÉGULATION DU MESSAGE NOCICEPTIF
D. Jourdan, Clermont-Ferrand
Dernière mise à jour : 05-02-02
De nombreuses études ont été consacrées à la mise en évidence de l’implication des monoamines dans
les phénomènes douloureux. L’implication de la sérotonine et de la noradrénaline dans la régulation
centrale (essentiellement spinale) a été largement démontrée. D’autre part, ces molécules, interagissent à
d’autres niveau avec le message nociceptif: par une action pronociceptive en périphérie pour la sérotonine,
par une participation du système sympathique au développement et au maintien de certaines douleurs
chroniques pour la noradrénaline. La dopamine, dont les effets sont moins connus, pourrait aussi être
impliquée, mais des progrès dans la connaissance de son rôle dans les phénomènes liés à la douleur sont
encore nécessaires.
PLAN
I - SYSTÈME CATECHOLAMINERGIQUES
1°- Les catécholamines
2° - Système noradrénergique central
3°- Système noradrénergique périphérique
II - SYSTÈME SEROTONINERGIQUE
1°- Système sérotoninergique central
2°- Sérotonine périphérique et nociception
I - SYSTÈME CATECHOLAMINERGIQUES
On regroupe sous le nom de catécholamines trois composés dérivés de la phényléthylamine, tous
hydroxylés en position 3 et 4 sur le noyau aromatique. Ce sont l’adrénaline, la noradrénaline et la dopamine.
L’adrénaline, dont l’action est essentiellement hormonale, provient surtout de la glande médullo-surrénale,
bien qu’on la trouve aussi dans le cerveau. La noradrénaline est le neuromédiateur des terminaisons
nerveuses sympathiques. La dopamine, précurseur biosynthétique de l’adrénaline et de la noradrénaline,
agit essentiellement comme neuromédiateur dans le système nerveux central et en particulier dans la voie
file:///C|/Documents%20and%20Settings/malou%2...z/Bureau/stephado/capacite/cours/monoamin.htm (1 sur 11) [17/01/2003 11:47:00]

Cours DU -Eschalier
négro-striée. En terme d’influence sur la transmission du message douloureux, c’est la noradrénaline qui est
le produit le mieux connu.
1°- Les catécholamines
- Les structures des catécholamines.
- Les récepteurs adrénergiques sont au nombre de 4 : alpha1, alpha2, bêta1, bêta2 avec des
sous-types (p.ex. alpha2A, alpha 2B...).
2° - Système noradrénergique central
2.1. Les voies noradrénergiques centrales.
Les voies noradrénergiques centrales sont constituées par les prolongements de groupements neuronaux
(A1-A7) situés dans la partie latérale du bulbe et de la région pontique.
Ces groupements neuronaux donnent naissance à des voies longues ascendantes ou descendantes (vers
la moelle épinière en particulier) et à des voies courtes plus localisées. Certains d’entre eux participent à la
régulation de la nociception.
2.1.1. Les prolongements neuronaux descendants.
Plusieurs groupes neuronaux (A5, A7, noyau subcoeruleus, locus coeruleus) se projettent sur
la corne postérieure mais l’importance relative de chacun d’entre eux dans l’innervation de
cette corne postérieure varie suivant les espèces et même les souches. Les terminaisons
noradrénergiques établissent des contacts avec les neurones du faisceau spino-thalamique
dans la corne postérieure.
Le locus coeruleus (A6) et le groupe A5 innervent au niveau thoracique les neurones de la
corne intermédio-latérale. Le locus coeruleus innerve également la corne ventrale. Enfin les
neurones à destinée cardiovasculaire sont différents de ceux à destination de la corne
postérieure.
2.1.2. Projections neuronales courtes.
Les neurones noradrénergiques établissent également de nombreuses connections locales,
soit entre les différents groupes de neurones noradrénergiques, soit avec d’autres systèmes.
Par exemple, le locus coeruleus et le noyau subcoeruleus envoient des prolongements vers
d’autres groupes catécholaminergiques. Le groupe A5 reçoit et établit de nombreuses
connections, c’est un noyau carrefour. Parmi les structures neuronales impliquées dans ces
connections locales, citons la substance grise péri-aqueducale et les noyaux du raphé, en
particulier le raphé magnus riche en neurones sérotoninergiques.
2.1.3. Prolongement neuronaux ascendants.
Des projections noradrénergiques ont également été décrites vers le thalamus, il existe des
neurones bulbo-thalamiques qui projettent vers le noyau ventro-postéro-latéral et
file:///C|/Documents%20and%20Settings/malou%2...z/Bureau/stephado/capacite/cours/monoamin.htm (2 sur 11) [17/01/2003 11:47:00]

Cours DU -Eschalier
proviendraient du locus coeruleus, du noyau subcoeruleus et du groupe A5.
En conclusion : retenons l’importance du système noradrénergique bulbo-pontique et l’absence
d’interneurones médullaires noradrénergiques au niveau de la corne postérieure.
2.2. Rôle physiologique du système noradrénergique central dans la nociception.
2.2.1. Système noradrénergique bulbo-spinal.
A partir des différents groupes neuronaux bulbaires, on distingue trois voies
noradrénergiques à projection spinale directe et une voie noradrénergique à projection
spinale indirecte. Les trois premières voies directes exercent un effet antinociceptif, la 4ème
voie exerce un effet pronociceptif.
2.2.1.1. Preuves expérimentales de leur effet inhibiteur.
La stimulation du locus coeruleus provoque de l’antinociception avec
augmentation des taux de noradrénaline spinale et inhibition des neurones
nociceptifs spinaux. La stimulation de la substance grise périaqueducale qui
renferme des neurones noradrénergiques provoque une libération de
noradrénaline médullaire. La stimulation des noyaux A5 et A7 provoque une
antinociception par inhibition des neurones nociceptifs de la corne
postérieure. Les voies noradrénergiques bulbospinales sont donc inhibitrices
de la transmission du message nociceptif, leurs origines sont situées, pour ce
qui est des voies à transmission directe, dans le noyau subcoeruleus, le locus
coeruleus et les noyaux A5 et A7. La substance grise périaqueducale
intervenant de façon indirecte par le noyau raphe magnus.
A côté de ces preuves directes du rôle inhibiteur des voies noradrénergiques
bulbospinales, d’autres arguments confirment l’effet antinociceptif de la
noradrénaline au niveau spinal : l’application iontophorétique dans la moelle
de noradrénaline inhibe l’activité des neurones de la corne postérieure et leur
excitation par des stimuli nociceptifs. Cet effet inhibiteur de la noradrénaline
est dû à une augmentation de la conductance au potassium qui provoque
une hyperpolarisation neuronale. Le recours à des tests comportementaux
confirme cet effet antinociceptif, la noradrénaline administrée par voie
intrathécale augmente les seuils de douleur. Ceci est confirmé par l’action
antinociceptive d’agonistes des récepteurs alpha2-noradrénergiques, tels que
la clonidine efficace chez l’animal mais également chez l’homme après
administration péridurale. Il existe donc bien un effet inhibiteur des voies
bulbospinales dû à une libération de noradrénaline au niveau de la moelle.
Voyons maintenant quelles sont les modalités précises de cette action spinale
de la noradrénaline.
2.2.1.2. Modalités de l’action spinale des voies noradrénergiques
descendantes.
Les terminaisons noradrénergiques bulbospinales sont, comme nous l’avons
dit, groupées dans les couches superficielles de la corne postérieure de la
moelle épinière. A ce niveau, l’essentiel des synapses qui ont pu être
étudiées sont des synapses axo-dentritiques et axo-somatiques superficielles
file:///C|/Documents%20and%20Settings/malou%2...z/Bureau/stephado/capacite/cours/monoamin.htm (3 sur 11) [17/01/2003 11:47:00]

Cours DU -Eschalier
et profondes établies donc entre les voies noradrénergiques et les neurones
médullaires. Il semble exister également des synapses axo-axioniques entre
les terminaisons noradrénergiques et les fibres afférentes primaires, mais
elles sont très rares. Ces éléments anatomiques suggèrent que l’influence
des voies noradrénergiques descendantes est une influence essentiellement
de nature post-synaptique sur les neurones nociceptifs médullaires. Les
données sur les récepteurs noradrénergiques impliqués confirment cette
notion.
La majorité des récepteurs médullaires noradrénergiques sont de type alpha.
Il existe quelques récepteurs bêta, mais leur concentration est
essentiellement marquée autour des motoneurones ; ils ne semblent donc
pas impliqués dans les phénomènes de régulation de la nociception, comme
le confirment d’ailleurs un certain nombre d’études pharmacologiques
réalisées avec des agonistes ou des antagonistes bêta.
Parmi les récepteurs alpha, il semble que ce sont les récepteurs alpha2 qui
sont de façon prédominante impliqués dans la régulation de la nociception.
En effet ces récepteurs alpha2 sont présents et particulièrement concentrés
dans les parties superficielles de la corne postérieure. Ils sont localisés tant
au niveau thoracique cervical que lombaire, avec cependant une plus forte
concentration dans ce dernier site. Cette distribution se rencontre chez le rat,
chez le chat, chez la brebis et chez l’homme. Il semblerait que le sous-type
alpha2A soit prédominant au niveau de cette partie superficielle de la corne
postérieure. Ceci a particulièrement été vérifié chez le rat. La majorité des
récepteurs alpha2 ne serait pas localisée sur les fibres afférentes primaires ou
sur les terminaisons des voies bulbo-spinales. En effet une rhizotomie ne
diminue que de 20% la densité en récepteurs alpha2 médullaire.
L’administration de capsaïcine à des doses susceptibles de détruire les fibres
C, n’entraîne pas de variation de densité des récepteurs alpha2. La
destruction des neurones catécholaminergiques descendants ne réduit pas la
concentration en récepteurs alpha2, que ce soit au niveau de la corne dorsale
ou de la corne ventrale où l’on peut retrouver ces récepteurs. Ce rôle des
récepteurs alpha2 dans la régulation noradrénergique de la nociception est
confirmé par une série d’expériences : les effets inhibiteurs de la stimulation
du locus coeruleus sont inhibés par l’administration intrathécale
d’antagonistes alpha2, l’effet de la clonidine est inhibé par la même
administration d’antagoniste alpha2, de même que l’effet de l’administration
intrathécale de noradrénaline. A l’inverse des antagonsites alpha1, tels que la
prazosine ou que le WB4101 sont inefficaces dans ces différentes situations
expérimentales.
Si les récepteurs alpha1 sont également présents au niveau de la moelle
épinière, tant au niveau cervical, thoracique que lombaire, où leur
concentration est la plus importante, ils ne semblent pas impliqués dans la
régulation noradrénergique de la nociception. Il n’est d’ailleurs pas possible
de démontrer une localisation préférentielle des récepteurs alpha1 en fonction
des différentes couches médullaires. Par ailleurs, les récepteurs alpha1 sont
impliqués dans des régulations motrices ; cet effet moteur rend d’ailleurs
l’analyse de leur participation à la nociception difficile.
file:///C|/Documents%20and%20Settings/malou%2...z/Bureau/stephado/capacite/cours/monoamin.htm (4 sur 11) [17/01/2003 11:47:00]

Cours DU -Eschalier
2.2.1.3. Conditions de mise en jeu des voies noradrénergiques
descendantes.
Existe-t-il une mise en jeu permanente tonique des voies noradrénergiques
descendantes ? Les résultats d’un certain nombre d’études expérimentales
tendraient à répondre positivement à cette question. En effet, la lésion des
voies noradrénergiques par des neurotoxines telles que la 6-
hydroxydopamine ou l’administration d’antagonsites au niveau spinal tend à
provoquer une hyperalgie selon certains auteurs avec augmentation de la
réponse à des stimulations nociceptives. Cependant, il existe toute une série
d’études expérimentales qui sont en contradiction avec ces résultats, que ce
soit chez le chat, chez le rat normal, chez le rat polyarthritique, chez le rat
mono-neuropathique ou chez le rat diabétique. Dans ces différentes situations
expérimentales, l’administration de yohimbine ou d’idazoxan, deux
antagonistes des récepteurs alpha2 noradrénergiques n’entraîne pas
d’hyperalgie. Il est donc difficile aujourd’hui de conclure à l’existence d’une
mise en jeu tonique des voies noradrénergiques descendantes. Il est en
revanche clair que ces voies peuvent être mises en jeu par des stimulations
d’origine cérébrale ou autres, s’intégrant dans les mécanismes de contrôles
supra-segmentaires de la transmission spinale.
Nous avons évoqué l’existence de quatre systèmes noradrénergiques bulbo-
spinaux dont trois à action directe sur la moelle avec effet antinociceptif et un
à action indirecte avec effet pronociceptif. C’est ce dernier système que nous
allons étudier maintenant. Il s’agit en fait de réseaux neuronaux
essentiellement établis entre le groupe de corps cellulaire noradrénergique A5
et le noyau raphe magnus sérotoninergique.
2.2.2. Système noradrénergique bulbaire.
2.2.2.1. Preuves physiologiques de l’existence de cette voie
noradrénergique bulbaire.
L’application iontophorétique de noradrénaline dans le noyau raphe magnus
(NRM) provoque une dépression des neurones de ce noyau. L’administration
d’antidépresseurs inhibiteurs du recaptage de la noradrénaline par voie intra-
cérébro-ventriculaire ou intra-cisternale provoque, dans des modèles
animaux comportementaux, une petite hyperalgie. Enfin, l’administration
d’antagonistes des récepteurs noradrénergiques, en l’occurrence la
phentolamine, dans le noyau raphe magnus provoque une analgésie. Ces
données expérimentales convergent donc vers le constat qu’il existe une
influence inhibitrice sur les neurones du noyau raphe magnus exercée par
des terminaisons noradrénergiques dont l’action pronociceptive paraît être
tonique.
2.2.2.2. Aspect neurobiochimique.
L’implication du noyau raphe magnus est confirmée par l’influence
d’antagonistes sérotoninergiques : l’effet antinociceptif provoqué par
l’administration dans ce noyau raphe magnus d’antagonistes
noradrénergiques est inhibé par l’administration intrathécale de méthysergide
file:///C|/Documents%20and%20Settings/malou%2...z/Bureau/stephado/capacite/cours/monoamin.htm (5 sur 11) [17/01/2003 11:47:00]
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
1
/
11
100%