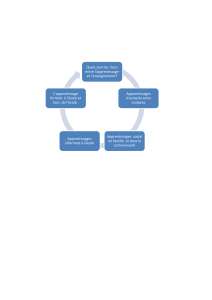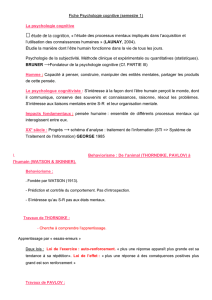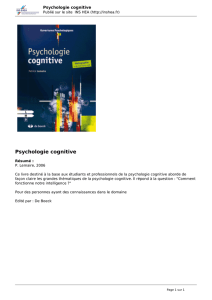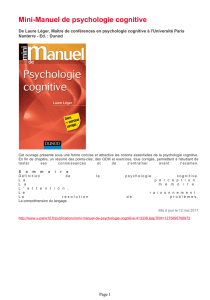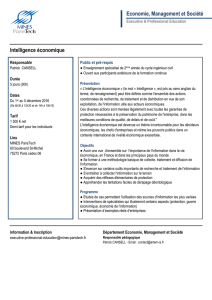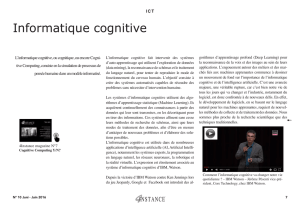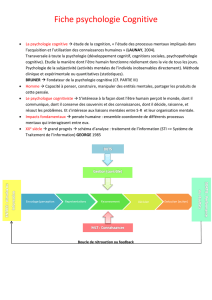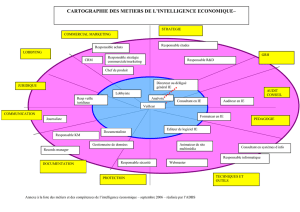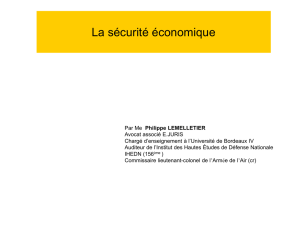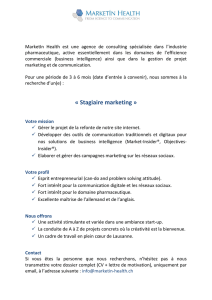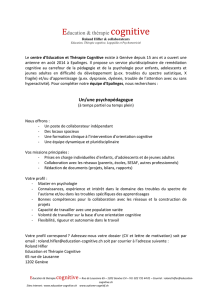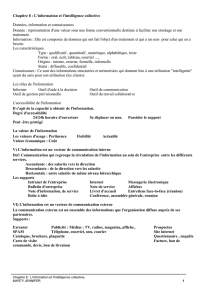Cahiers de la sécurité et de la justice

Cahiers de la
sécurité et de la justice
n°37
Revue de l’Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice
Dossier
Le Service régional d’identité judiciaire de Paris
dans les attentats de janvier 2015
Xavier ESPINASSE
Le Fichier national d’identification balistique (F.N.I.B.)
Jean-Luc GEORGES
L’affaire Scheffer : une victoire de la science contre le crime ?
Jean-Marc BERLIÈRE
International
Guerre économique et guerre cognitive
Giuseppe GAGLIANO
L’expansion des groupes criminels chinois
en Amérique latine et dans les Caraïbes
Quels acteurs ? Quelles menaces ?
Iris MARJOLET
L’enquête criminelle :
la trace et la preuve
L’enquête criminelle :
la trace et la preuve

3 Éditorial – Hélène CAZAUX-CHARLES
Dossier
Dossier coordonné par Dominique NAZAT
4 Préambule
5 Le Service régional d’identité judiciaire de Paris dans
les attentats de janvier 2015 – Xavier ESPINASSE
14 Le Fichier national d’identification balistique (FNIB)
Jean-Luc GEORGES
20 La chaîne de détection de produits explosifs dans le cadre
du circuit postal aérien – Stéphane FOSSÉ
27 Rétro-analyse des formats de vidéoprotection – Denis PERRAUD
31 De l’identification odonto-maxillo-crânienne aux avis
de recherche internationaux : perspectives policières
Dominique NAZAT
38 Les caractères morphologiques apparents : un début
d’identification de la photographie génétique – L’équipe du
Laboratoire d’Hématologie Médico-Légale de Bordeaux
42 Police technique et scientifique. La formation au sein de
la gendarmerie nationale – Jacques-Charles FOMBONNE
54 Blessures par explosion : spécificité des espaces confinés
MC Nicolas PRAT, MP Jean-Louis DABAN, Dr Loic EHRHARDT
66 La 17025 et les experts. Le Laboratoire de police scientifique de
Lille et le processus d’accréditation – Samuel REMY
Bonnes feuilles
71 L’affaire Scheffer : une victoire de la science contre le crime ?
Jean-Marc BERLIÈRE
Sommaire
Directrice de la publication :
Hélène CAZAUX-CHARLES
Rédacteur en chef :
Manuel PALACIO
Comité de rédaction :
AMADIEU Jean-Baptiste, Agrégé de lettres, chargé de recherches au CNRS
BERLIÈRE Jean-Marc, Professeur émérite d’histoire contemporaine,
Université de Bourgogne
DOMINIQUE BERTELOOT, Inspecteur d’Académie, inspecteur pédagogique
régional
BERTHELET Pierre, Chercheur au centre de documentation et de recherches
européennes (CRDE), Université de Pau
COOLS Marc, Professeur en criminologie, Université libre de Bruxelles,
Université de Gand
DE BEAUFORT Vivianne, Professeur à l’Essec, co-directeur du CEDE
DE MAILLARD Jacques, Professeur de Science politique, Université de
Versailles Saint-Quentin
DIAZ Charles, Contrôleur Général, Inspection Générale de la Police Nationale
DIEU François, Professeur de sociologie, Université Toulouse 1 Capitole
EVANS Martine, Professeur de droit pénal et de criminologie, Université de Reims
HERNU Patrice, Administrateur INSEE
LATOUR Xavier, Professeur de droit, Université de Nice
LOUBET DEL BAYLE Jean-Louis, Professeur émérite de Science politique,
Université de Toulouse I, Capitole
NAZAT Dominique, Docteur en Sciences odontologiques, expert au Groupe
de travail permanent pour la révision des normes d’identification du DVI
d’Interpol
PARDINI Gérard, Chef du service des affaires immobilières de la Prefecture
de police de Paris
PICARD Jean-Marc, Enseignant-chercheur à l’Université de Technologie de
Compiègne
RENAUDIE Olivier, Professeur de droit public à l’Université de Lorraine, Nancy
RIDEL Laurent, Directeur interrégional de l’Administration pénitentiaire
DE LA ROBERTIE Catherine, Rectrice, Professeure des universités, Paris I,
Directrice du Master2 Statégie Internationale & Intelligence Économique
ROCHE Jean-Jacques, Directeur de la formation, des études et de la
recherche de l’Institut des hautes études de la défense nationale (IHEDN)
SAURON Jean-Luc, Professeur de droit à l’Université Paris Dauphine
TEYSSIER Arnaud, Inspecteur Général de l’Administration, Professeur Associé
à l’Université Paris I
VALLAR Christian, Doyen de la Faculté de droit, Nice Sophia Antipolis
WARUSFEL Bertrand, Professeur agrégé des facultés de droit, Université Lille 2
Responsable de la communication : Axelle de FONTGALLAND
Conception graphique et fabrication : Laetitia BÉGOT
Vente en librairie et à la librairie de la Documentation française
29-31, quai Voltaire – 75344 Paris Cedex 07 – Tél. : +33 (0)1 40 15 70 00
Par correspondance – La Direction de l’information et administrative (DILA),
Service Abonnements, 29-31, quai Voltaire – 75344 Paris Cedex 07
www.ladocumentationfrancaise.fr
Tarifs : Prix de vente au numéro : 23,10 € – Abonnement France (4 numéros) :
70,20 € – Abonnement Europe (4 numéros) : 75,30 €
Abonnement DOM-TOM-CTOM : 75,30 € (HT, avion éco) – Abonnement
hors Europe (HT, avion éco) : 79,40 €
Impression : DILA
Tirage : 1 000 exemplaires
© Direction de l’information légale et administrative, Paris, 2015
Conditions de publication : Les Cahiers de la sécurité et de la justice publient
des articles, des comptes rendus de colloques ou de séminaires et des notes
bibliographiques relatifs aux différents aspects nationaux et comparés de
la sécurité et de ses acteurs. Les offres de contribution sont à proposer à la
rédaction pour évaluation. Les manuscrits soumis ne sont pas retournés à leurs
auteurs.
Toute correspondance est à adresser à l’INHESJ à la rédaction de la revue.
Tél. : +33 (0)1 76 64 89 00 – Fax : +33 (0)1 76 64 89 31
publications@inhesj.fr – www.cahiersdelasecuriteetdelajustice.fr
INHESJ
École militaire - Case 39
75700 Paris 07 SP
Tél : +33 (0)1 76 64 89 00
Fax : +33 (0)1 76 64 89 31
www.inhesj.fr
Cahiers de la
sécurité
et de la justice
Troisième trimestre 2016 n°37

Sécurité et société
110 La jeunesse à l’ère du numérique : pratiques, exposition
au risque et victimation – Giorgia MACILOTTI
130 L’évolution des comportements des mineurs les mettant
en danger – Ludovic JAMET, Adeline RENUY
140 Étude de la culture de sécurité des patients dans un service
de radiothérapie – Marius KAMTO KENMOGNE,
Didier VAN CAILLIE, Deniz BOGA, Philippe COUCKE
Sécurité intérieure
151 Le préfet de police des Bouches-du-Rhône : une innovation, pour quels résultats ?
Baptiste LE TENIER
Document
156 L’enquête de victimation pilote IHESI-INSEE – Jean-Paul GREMY
156
79
110
14
31
International
79 Guerre économique et guerre cognitive
Giuseppe GAGLIANO
85 L’expansion des groupes criminels chinois
en Amérique latine et dans les Caraïbes.
Quels acteurs ? Quelles menaces ?
Iris MARJOLET
99 La délinquance du salarié en Belgique
Marc COOLS
106 August Vollmer. Un des plus grands
réformateurs de la police quasi inconnu
de ce côté de l’Atlantique
Éric MEYNARD

unir le crime passe par le préalable
de l’identification du criminel et par la
preuve qu’il a commis son acte, preuve
qui permet à la justice de le sanctionner.
Cette phase de l’enquête représente l’essentiel
du travail du policier, mais aussi de sa difficulté.
Historiquement. La police moderne est le produit
d’un long cheminement qui a connu une accélération
au XIXe siècle avec le recours à des méthodes
scientifiques qui vont dans un premier temps
favoriser l’identification fiable des criminels. Du
signalement anthropométrique du Français Adolphe
Bertillon à l’utilisation des empreintes digitales
grâce aux travaux de l’Anglais Francis Galton,
c’est un véritable bond en avant qui changera
définitivement les conditions de l’enquête policière.
Désormais celle-ci s’appuiera sur la science en
investissant de nombreux domaines d’études :
toxicologie, médecine légale, balistique, techniques
d’identification par la recherche d’ADN, etc. Cette
révolution dans la pratique s’est accompagnée de
la naissance et du développement d’une discipline
scientifique à part entière. Au début du XXe siècle, le
Professeur de médecine légale Edmond Locard crée
à Lyon le premier laboratoire de police scientifique.
Il est l’auteur d’un important Traité de criminalistique
qui consacre l’étude scientifique de la criminalité.
Le rôle de la science dans l’enquête de police
s’est considérablement renforcé parallèlement aux
nouvelles découvertes qui se sont multipliées.
Aujourd’hui, le déroulement de l’enquête criminelle
est indissociable de l’activité de la police scientifique.
En 2005, dans son numéro 56, les Cahiers de la
sécurité présentaient un dossier complet autour
de la question des moyens de l’identification au
service de l’enquête de police. Onze ans plus tard
les méthodes et les techniques de recherche se
sont considérablement accrues et il était nécessaire
que la revue aborde de nouveau ce sujet au
regard de l’actualité. La révolution scientifique
et technique initiée au XXe siècle a continué son
développement à un rythme toujours accru au
XXIe siècle. L’information, la biotechnologie, la
recherche autour de l’intelligence artificielle, entre
autres, connaissent un essor qui ne se dément
pas. L’imbrication entre la recherche scientifique
et l’innovation technologique produit des effets
pratiques immédiats qui bouleversent de nombreux
champs de connaissance et de production. Celui de
la police scientifique est, comme les autres, impacté.
La démarche scientifique appliquée au travail de
police est l’objet des sciences forensiques dont ce
numéro des Cahiers de la sécurité et de la justice
explore de manière détaillée plusieurs champs
d’expériences en France à travers des contributions
d’experts reconnus dans leurs domaines respectifs.
Il présente à la fois des terrains d’investigations,
par exemple à travers le travail intense du Service
régional d’identité judiciaire de Paris, des outils
comme le fichier national d’identité balistique ou
encore un état de la recherche en matière d’analyse
de la molécule ADN présenté par le laboratoire
d’hématologie médico-légale de Bordeaux à la
pointe de ce domaine d’expertise n
P
Éditorial
Hélène CAZAUX-CHARLES,
directrice de l'INHESJ
I 3

80 I INTERNATIONAL
Guerre économique et guerre cognitive - Giuseppe GAGLIANO
stratégies internes d’« intelligence » économique, adoptées
récemment par de nombreux gouvernements, réservent
justement aux opérateurs privés un rôle central dans le
maintien de la sécurité, en les dotant d’infrastructures
informatiques et de ce qui représente le bien primaire
de l’ère numérique : les données. De la sauvegarde des
activités économiques privées à la protection des intérêts
économiques nationaux, il n’y a qu’un pas.
Par « intelligence » économique on entend justement
l’ensemble des activités de collecte et de transformation
des informations, de surveillance de la concurrence, de
protection des informations stratégiques, de capitalisation
des connaissances afin de contrôler et d’influencer
l’environnement économique mondial. C’est donc un
instrument de détention du pouvoir à la disposition d’un
État. Mais qui sont les acteurs de la guerre économique ?
- les États avant tout, qui restent les régulateurs les plus
inuents de l’échiquier économique, malgré leur relatif
déclin dans la vie des nations et les différentes contraintes
qui pèsent sur eux, à commencer par les organisations
internationales comme l’Union européenne. Ce qui a
vraiment changé c’est qu’aujourd’hui les États doivent
tenir compte de nombreux stakeholders (ONG, instances
internationales, entreprises, médias). Cependant, ils
conservent un rôle d’arbitre que les autres acteurs ne
font que mettre en lumière, en sollicitant régulièrement
leur intervention ;
- les entreprises, lesquelles, face au nouveau scénario
géoéconomique hypercompétitif, ont adopté comme
instrument de compétitivité et de sécurité économique
le contrôle de l’information stratégique ;
- la société civile : l’élargissement des débats sur les
questions sociales concernant l’activité des entreprises
elles-mêmes (alimentation et bien-être, progrès
technique et risques sur la santé publique, industrie et
environnement, transport et sécurité des voyageurs,
technologie de l’information et libertés individuelles),
la massication et la démocratisation de l’utilisation
d’Internet, l’implication croissante de la justice dans
le monitorage de l’action des entreprises comportent
une augmentation des attaques informatiques contre
les entreprises de la part des acteurs de la société civile.
L’élargissement des débats sur les risques associés
à l’environnement, sur le développement durable,
sur l’investissement socialement responsable, sur
la responsabilité sociale des entreprises amplie la
légitimité des questions sociales ;
- l’infosphère : elle n’est pas constituée d’une catégorie
de personnes physiques ou juridiques, mais plutôt d’une
dynamique, c’est-à-dire d’un ensemble
d’interventions, de messages diffusés
à travers les médias et le web. Il s’agit
d’un instrument particulièrement
insidieux parce qu’il agit comme une
caisse de résonance dans laquelle
se mélangent et se recombinent
continuellement des idées, des
émotions et des pulsions émises par
un nombre indéni de personnes,
sans un vrai sujet dominant et qui,
toutefois, exerce une influence
déterminante, positive ou néfaste, sur
les individus et sur les organisations.
Lancée dans l’infosphère, une
déclaration peut avoir le pouvoir de
déchaîner des polémiques féroces,
des réactions politiques dures, des
crises médiatiques, des atteintes à la
réputation aux dépens des entreprises.
Elle peut donc se transformer
en une arme de déstabilisation
particulièrement efcace. Il ne faut pas oublier que
l’image et la réputation d’une marque représentent un
capital stratégique qui impacte les activités commerciales
et nancières des entreprises.
Mais sous quelles formes s’exprime la guerre économique ?
On la confond souvent avec l’espionnage industriel qui
est, en revanche, un phénomène difcile à cerner même
s’il est utilisé comme instrument de guerre économique,
à la fois parce que les sociétés qui en sont victimes ne le
communiquent pas, et parce qu’il est difcile à circonscrire
juridiquement et, par conséquent, à dénoncer.
Une des formes de guerre économique les plus pratiquées
est celle des acquisitions d’entreprises, qui peuvent
conduire à de véritables formes d’encerclement des
industries sur un territoire donné, à travers des opérations
qui répondent à des motivations à la fois d’ordre nancier,
économique et technologique.
Une dernière forme de guerre économique, elle aussi
particulièrement courante et insidieuse, est le lobbying,
c’est-à-dire une stratégie d’inuence qui vise directement
les décisionnaires publics à travers une action vouée à
inuencer l’élaboration des normes. Nos États nationaux
sont particulièrement marqués par le problème de la
prolifération de normes et, pour une action de lobbying,
participer et influencer le processus d’élaboration,
interprétation ou application des mesures législatives
et, en général, inuencer directement ou indirectement
toute intervention ou décision des pouvoirs publics,
Lancée dans
l’infosphère, une
déclaration peut
avoir le pouvoir
de déchaîner des
polémiques féroces,
des réactions
politiques dures, des
crises médiatiques,
des atteintes à
la réputation
aux dépens des
entreprises. Elle peut
donc se transformer
en une arme de
déstabilisation
particulièrement
efficace.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
1
/
9
100%