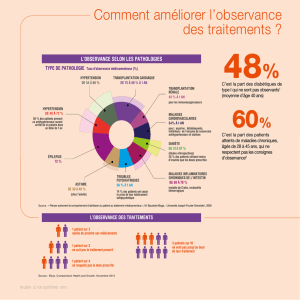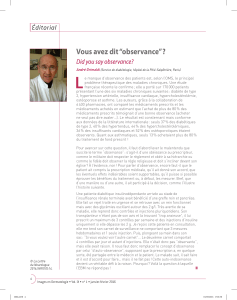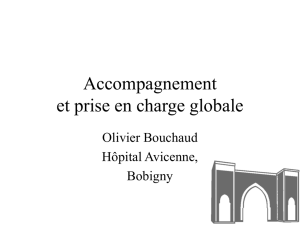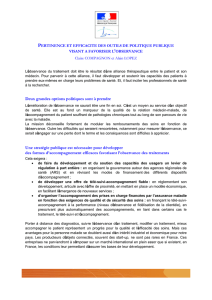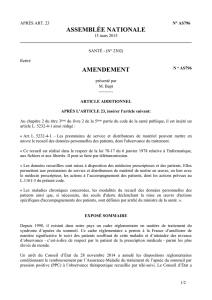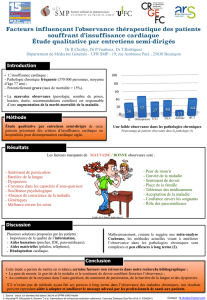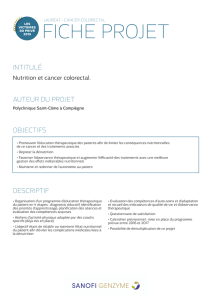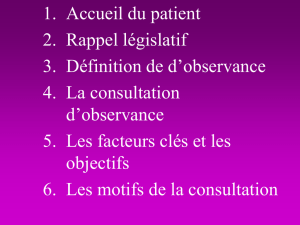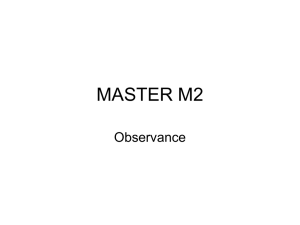Observance et persistance du traitement : particularités dans la

Jean-Luc Novella
1
Stéphane Sanchez
2
Max Prudent
3
1
Hôpital de jour de neurologie gériatrie,
CHU de Reims,
51100 Reims
2
Service de gériatrie,
CHU de Reims,
51100 Reims
3
Université de Reims Champagne-Ardenne,
Faculté de médecine,
EA 3797, 51100 Reims
Tirés à part : J.-L. Novella
Observance et persistance
du traitement : particularités
dans la maladie d’Alzheimer
Observance and persistance of the treatment:
Characteristics in Alzheimer’s disease
Résumé ■La maladie d’Alzheimer pose de nombreux problèmes aux cliniciens, pro-
blèmes de compréhension physiopathologique, d’atypie sémiologique, de diagnostic et
de traitement. Face à cette pathologie évolutive, il apparaît nécessaire de structurer le
mieux possible nos stratégies cliniques. L’observance et la persistance thérapeutiques
pourraient être un reflet indirect de la qualité de la prise en charge engagée. L’objectif
est ici de faire le point sur les éléments contributifs à une observance et une persistance
thérapeutiques optimales.
Mots clés maladie d’Alzheimer, observance, persistance, anticholinestérasiques, personne âgée
Abstract ■Alzheimer’s disease causes numerous problems to clinicians mainly in its pysio-
pathology issues, its atypical semiology, its prognosis, and its treatment. In front of an evolving
disease, it seems necessary to structure as well as possible our management strategies. The
observance and the persistence of the treatment could be an indirect reflection of the quality
of care. The aim of this work was to take stock of the different elements that contribute to
optimise observance and persistence of the treatment.
Key words Alzheimer’s disease, observance, persitence, cholinesterase inhibitors, elderly
Selon les recommandations de la Haute Autorité de santé
(HAS) un traitement spécifique doit être envisagé chez
tout patient atteint de la maladie d’Alzheimer lorsque le
diagnostic a été annoncé en prenant en compte son rapport
bénéfice/risque. Cette recommandation se fonde sur les béné-
fices démontrés des traitements symptomatiques. Ainsi, les dif-
férents essais thérapeutiques, repris dans trois méta-analyses
[1-3], mettent en évidence un gain versus placebo. S’il n’est
effectivement pas de nature à stabiliser au long cours l’état
clinique du patient, le médicament participe à l’ensemble du
processus mis en œuvre pour ralentir son déclin.
Ce bénéfice thérapeutique ne peut être perceptible que si
l’observance du traitement est réelle, et le renouvellement de
l’ordonnance par le médecin traitant effectif dans un contexte
de suivi toujours perfectible. La bonne compréhension de ces
deux éléments, sous-jacents à la prise en charge, semble
aujourd’hui importante pour améliorer le service rendu à nos
patients.
L’observance peut se définir par : « L’action d’obéir à une
habitude, de se conformer à un modèle, une coutume ; la
règle de conduite elle-même, convention. » (Dictionnaire
Larousse). Le terme de compliance est également utilisé pour
désigner la plus ou moins grande obéissance du patient et son
désir de se conformer aux directives médicales. Ces notions se
définissent dans la pratique médicale par le respect strict
des prescriptions en termes d’horaires, de posologie et de
contenu. Elles renvoient parfois à une conception ancienne
d’asymétrie du rapport médecin/patient. Il conviendrait donc
davantage de parler « d’adhésion au traitement » où l’adhé-
sion correspond à l’ensemble des conditions, qu’il s’agisse de
la motivation, de l’acceptation, de l’information, qui permet
l’observance à partir d’une participation active du patient.
L’adhésion est ainsi fondée sur un contrat thérapeutique
clairement explicité dans ses fondements et objectifs, négocié
et accepté par les deux parties (patient/médecin).
Pour en revenir à l’observance, certains auteurs ont introduit
une notion de seuil, considérant les sujets observants comme
étant ceux prenants plus de 80 % de leur traitement [4]. Pour
Ankri et al. Il n’existe pas à ce jour de définition consensuelle
sur les patients observants ou non observants [5]. L’absence
de gold standard concernant la définition et l’évaluation de
l’observance thérapeutique explique les difficultés de sa
Ann Gerontol 2011 ; 3 (n° spécial 1) : 21-7
doi: 10.1684/age.2010.0119
Synthèse
•Annales de Gérontologie •vol 3, n° spécial 1, février 2011 •21
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 24/05/2017.

mesure. Pour cette raison, il existe très peu d’études ayant
spécifiquement ciblé ce sujet.
Dans ce contexte, le patient âgé et encore plus le patient souf-
frant de maladie d’Alzheimer, qui par définition présente des
capacités cognitives altérées, nécessite une prise en charge
particulière quant à l’observance et à la persistance du traite-
ment. La prise en charge pluridisciplinaire, mais surtout le rôle
pivot de la médecine générale, sont gages du respect et de la
persistance des traitements spécifiques.
En raison d’un état polypathologique, les personnes
âgées ont des particularités en termes de consommation
médicamenteuse.
Environ 1,5 million de personnes âgées consommeraient plus
de 7 médicaments par jour, de classes thérapeutiques différen-
tes [6]. Ce phénomène semble s’accentuer depuis les années
1990, il est encore plus marqué pour les personnes institution-
nalisées. La seule donnée française disponible est l’enquête
Paquid [7] : avec une moyenne de 5,2 médicaments par jour
pour les patients institutionnalisés versus 3,9 chez les plus de
65 ans vivant à domicile. L’enquête ESPS de l’Irdes [8]
en 2000 montre par ailleurs la proportion des médicaments
consommés chez les plus de 65 ans : 51 % de médicaments
cardiovasculaires, 21 % de médicaments du système nerveux
central, 17 % pour l’appareil digestif, 16 % pour l’appareil loco-
moteur, 16 % pour les psychotropes.
La consommation médicamenteuse s’avère être assez concen-
trée, ainsi 16 % de la population consomment 39 % des
médicaments prescrits chaque année [9].
Une enquête « budget et ménage » (Insee, 1995) montrait que
le budget « santé » des plus de 60 ans est 1,6 fois supérieur au
budget « santé » des ménages français. Ces données sont
corrélées par des enquêtes plus récentes de l’Irdes [10],
montrant que le budget passe de 771 €/an pour les 65-74 ans
à 971 €/an pour les plus de 75 ans. Plus l’âge augmente, plus
le budget santé devient important. En situation économique
difficile, cette charge financière peut être un frein à la persis-
tance des traitements. L’inscription de la maladie d’Alzheimer
sur la liste des pathologies ouvrant droit à une prise en charge
à 100 % par la caisse primaire d’assurance-maladie (ALD 30)
est là pour limiter ce phénomène.
La population des plus de 65 ans est aujourd’hui un groupe
hétérogène avec des spécificités physiques, économiques et
sociales. En raison de cette hétérogénéité, des états polypatho-
logiques, d’une prévalence de la fragilité plus importante et
d’une susceptibilité accrue à la iatrogénie, les personnes
âgées sont ainsi bien souvent sous-représentées dans les essais
thérapeutiques [11]. Lorsqu’elles y sont présentes, elles consti-
tuent un groupe de petite taille. Une méta-analyse récente
soulignait les limites méthodologiques de ces études réalisées
sur des populations de petite taille [12]. Cette sous-
représentation conduit le médecin à extrapoler un bénéfice
attendu vis-à-vis d’une pathologie à une population sur
laquelle le traitement n’a pas toujours été testé. Au regard
des spécificités physiologiques des sujets âgés (absorption,
fixations protéiques, modification du volume de distribution,
altérations rénale et/ou hépatique), le risque iatrogène et
donc le risque d’inobservance sont plus importants.
Observance
L’observance repose donc sur le principe de suivi de la règle,
édictée par d’autres, la compréhension n’étant pas nécessaire.
À cette notion stricte, même chez les patients atteints de mala-
die d’Alzheimer, nous préférerons le terme « d’adhésion au
traitement ». De nombreux travaux sur le concept d’obser-
vance permettent de proposer un récapitulatif général concer-
nant l’observance chez la personne âgée. Le tableau 1 résume
assez bien les variables d’intérêts dans cette thématique, il
propose un ensemble de variables réévalué selon la littérature.
La prévalence générale de l’observance chez le sujet âgé varie
selon les définitions retenues pour l’observance et la métho-
dologie de l’étude. Les taux d’observance constatés varient
de 26 à 59 %, tous médicaments confondus [15]. L’inobser-
vance se décompose pour la plus grande partie en une sous-
utilisation du traitement prescrit. Ainsi, 90 % des patients non
adhérents le sont par une réduction des doses, horaires, voire
l’arrêt de certains traitements [16]. Les 10 % restants de
patients inobservants le sont sur un mode de surconsommation
[16]. Cette observance et ses facteurs restent complexes à
expliquer. Si l’information du patient et sa formalisation jouent
un rôle certain dans l’observance [17-19], les rapports sont
complexes et de nombreuses inconnues persistent dans
l’explication de l’observance chez la personne âgée [15, 19].
Très peu d’études se sont spécifiquement attachées à explorer
l’observance chez les patients touchés par la maladie d’Alzhei-
mer. À partir des données générales sur l’inobservance, on
peut tirer un certain nombre d’éléments concernant de façon
plus spécifique le patient souffrant de troubles cognitifs. Ainsi,
au regard des déterminants de l’observance établis par Bar-
beau et al. (figure 1), le sujet souffrant de maladie d’Alzheimer
est plus à risque d’inobservance, en raison de la diminution de
ses capacités d’apprentissage et de mémorisation des instruc-
tions qui lui ont été données. Col et al. [20], dans une autre
étude, expliquaient que les facteurs statistiquement associés au
risque de non-adhésion aux traitements chez les sujets âgés
hospitalisés étaient : le sexe féminin, le fait de ne pas se
rappeler son traitement, sa posologie, ou la nécessité de la
prise, l’intervention de nombreux médecins, et la multiplicité
des traitements.
Cependant, cet état pathologique n’est que l’un des éléments
contributifs à un défaut d’adhésion thérapeutique. La connais-
sance de la gravité de la maladie et de l’efficacité du traite-
ment est un des déterminants favorisant l’observance du
patient. Cette donnée s’intègre dans la nécessité d’une
annonce diagnostique de qualité. Il semble difficile
22 •Annales de Gérontologie •vol 3, n° spécial 1, février 2011 •
JEAN-LUC NOVELLA,STÉPHANE SANCHEZ,MAX PRUDENT
Ann Gerontol 2011 ; 3 (n° spécial 1) : 21-7
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 24/05/2017.

Tableau 1. Principaux déterminants de l’observance [13, 14].
Table 1. Main determinants of compliance [13, 14].
Déterminants
de l’observance
Caractéristiques Influence sur
l’observance
Remarques des auteurs du tableau Données actuelles
de la littérature
(CRESIF)
Sociales
Age Indirecte Attention aux 75 ans et plus Pas d’influence
directe
Sexe Indirecte Les femmes sont plus exposées parce qu’elles reçoivent
plus d’ordonnances Facteur retrouvé
Éducation Indirecte L’éducation peut influencer les valeurs
et les comportements Facteur non retrouvé
dans la littérature
Ethnie Variable La juxtaposition des facteurs de communication
et d’éducation peut influencer l’observance Non retrouvé
Isolement social Variable L’isolement social peut entraîner un manque
de motivation et une perception négative de la personne Retrouvé
Statut économique Variable Facteur second Non retrouvé
Soutien naturel Inconnue Le soutien familial est l’élément clé
Facteur associé à l’isolement social Non étudié
précisément
Physiques
Dextérité Directe La perte de dextérité cause des difficultés à manipuler
certains contenants dits sécuritaires Retrouvé
Acuité visuelle
et auditive Directe Ladiminutiondel’acuité visuelle et auditive entraîne
des difficultés de compréhension des instructions verbales
et écrites
Retrouvé
Cognitives
Capacité de mémorisa-
tion et d’apprentissage Directe La diminution de la capacité d’apprendre et de retenir
des instructions réduit l’impact de l’information Retrouvé
Psychologiques
Perception
de l’individu Directe Une attitude négative entraîne à l’égard du traitement Retrouvé
Acceptation des limites
physiques et mentales Inconnue Le refus de ses limites rend improbable l’acceptation
du traitement Non étudié
Perception de la gravité
de la maladie Directe La perception négative de la maladie et du traitement
modifie l’observance Non étudié
Maladies chroniques Directe Les traitements prolongés favorisent l’abandon Retrouvé
Gravité de la maladie Variable La connaissance de la gravité de la maladie et de
l’efficacité du traitement favorise l’observance Retrouvé
Symptômes Directe Les maladies asymptomatiques favorisent l’inobservance Retrouvé
Polypathologies Variable Non prévisibles, sauf en présence de maladies
psychiatriques où l’inobservance est constante Retrouvé
Ordonnances Directe Le patient informé de sa maladie et de son traitement
est plus enclin à faire exécuter sa prescription Retrouvé, ainsi
que la qualité
de l’explication
Contenants Variable Les contenants mal adaptés compliquent la prise
de médicaments Retrouvé
massivement
Etiquette Directe Les indications doivent être précises et complètes
pour en faciliter la compréhension Retrouvé
Nombre de
médicaments Directe Lenombred’erreurs et d’oublis est directement
proportionnel au nombre de médicaments Retrouvé
Simplicité de
l’ordonnance Directe Le nombre de doses quotidiennes va de pair avec
le nombre de médicaments Retrouvé
Effets indésirables Indirecte Le lien entre les effets indésirables et le médicament
est peu marqué Retrouvé de façon
importante
Couleur des
comprimés Inconnue La similarité physique des comprimés peut compromettre
la gestion du traitement Retrouvé, avec
en plus des questions
de taille et de goût
Milieu physique Inconnue L’aménagement non favorable à la confidentialité
diminue la communication avec le malade Non étudié
(suite)
•Annales de Gérontologie •vol 3, n° spécial 1, février 2011 •23
OBSERVANCE ET PERSISTANCE DU TRAITEMENT :PARTICULARITÉS DANS LA MALADIE D’ALZHEIMER
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 24/05/2017.

d’envisager une observance thérapeutique ou une adhésion au
traitement si le patient ne se sait ou ne se croit pas malade.
Cette annonce doit contribuer à la mise en place d’un projet
thérapeutique et d’un plan suivi, négocié avec le patient,
permettant de minorer un défaut d’adhésion au traitement.
L’isolement est également un déterminant de l’inobservance.
Celui-ci est fréquent chez le patient atteint de la maladie
d’Alzheimer dont l’observance pourrait être un indicateur de
prise en charge, notamment au niveau du soutien formel ou
informel dont il bénéficie. Aujourd’hui la population vieillit,
et c’est en vieillissant que les rapports intergénérationnels
sont les plus importants : 50 % des sujets âgés reçoivent
l’aide de leurs enfants et la même proportion de personnes
âgées aident leur descendance. Seules 20 % des personnes
aidées le sont par une aide extérieure et environ 80 % des
aidants sont des femmes. L’entourage, la prise en charge
adaptée au sein d’une institution, à domicile et généralement,
nécessitent un scénario où chaque acteur (social, médical,
familial) trouve sa place.
La presbyacousie est un phénomène fréquent, sa prévalence
élevée chez la personne âgée peut être un paramètre influen-
çant la conduite et l’adhésion au traitement. Si le lien entre la
maladie d’Alzheimer et la presbyacousie n’est pas démontré
de façon claire et fait encore débat [21], on imagine que
l’atteinte sensorielle et l’absence d’appareillage jouent un
rôle dans la communication du patient avec son aidant et le
praticien. Si l’information et la communication sont au cœur
du suivi, la presbyacousie peut être un sérieux frein à celles-ci.
Les problèmes liés à l’altération de la vision sont aussi un
écueil dans l’adhésion [22] et la persistance des anticholi-
nestérasiques. Les formes galéniques, la couleur et la poso-
logie sont aussi des facteurs de risque. Les traitements de la
maladie d’Alzheimer sont complexes à mettre en place, et
l’on imagine aisément qu’un changement dans la forme ou la
couleur des comprimés peut avoir un effet néfaste sur l’adhé-
sion. Cependant, l’absence d’étude sur le sujet rend difficile
l’établissement d’un rapport de cause à effet véritable.
Le passage en forme généricable des anticholinestérasiques
d’ici deux ans devrait permettre des études sur le sujet.
Le médicament est un des aspects du projet thérapeutique
négocié. Les traitements spécifiques de la maladie d’Alzheimer
ont fait l’objet d’une recommandation de la HAS récente [23].
On retrouve dans ces recommandations la possibilité d’instau-
rer un traitement quel que soit le stade de la maladie, après
évaluation du rapport bénéfice/risque. Cependant, il reste
recommandé dans le stade léger d’utiliser les inhibiteurs de la
cholinestérase, dans les stades modérés les anticholinestéra-
siques ou les glutamatergiques, dans les stades sévères unique-
ment les glutamatergiques. Ces recommandations sont corrélées
et étayées par trois méta-analyses [1-3], elles impliquent une
évaluation constante du rapport bénéfice/risque du traitement
dans la pathologie d’Alzheimer. Cela suppose une réévaluation
périodique du projet thérapeutique négocié.
La mise en place d’un traitement médicamenteux ne se
conçoit que sur un argumentaire bénéfice/risque en faveur
du patient. Le bénéfice des anticholinestérasiques reste limité.
Roe et al. [24] montrent lors d’une étude rétrospective que les
patients atteints de démence sous anticholinestérasique pren-
nent un traitement anticholinergique dans 33,0 % des cas ver-
sus 23,4 % pour le groupe témoin non dément. Ces données
suggèrent une prévalence de la polymédicamentation anti-
cholinergique plus élevée chez les patients déments.
Ces traitements symptomatiques peuvent également altérer la
qualité de vie des patients par leurs effets indésirables. C’est
l’un des éléments bien argumentés dans la littérature concer-
nant l’inobservance. Aussi il est nécessaire, lors de la négocia-
tion du projet thérapeutique proposé aux patients, d’aborder
ces possibles désagréments et d’envisager avec eux la
conduite pratique en cas de survenue.
Pour les anticholinestérasiques, on peut regrouper les effets
secondaires en fonction de leur fréquence attendue. Ainsi,
dans plus de 1 cas sur 100, il est possible de retrouver :
anorexie, hallucination, agitation, agressivité, diarrhée, vomis-
sements, nausées, rash cutané, crampes musculaires, inconti-
nence, fatigue, céphalées, douleurs, vertiges. Dans plus de
1 cas sur 1 000, il est possible de retrouver : convulsion,
hémorragies gastro-intestinales, ulcère gastrique, bradycardie.
Tableau 1 (suite)
Déterminants
de l’observance
Caractéristiques Influence sur
l’observance
Remarques des auteurs du tableau Données actuelles
de la littérature
(CRESIF)
Composante sociale
Médecin Directe La mauvaise relation patient-médecin favorise
l’inobservance Retrouvé
Pharmacien Directe Le pharmacien peut évaluer la fidélité au traitement Retrouvé sous forme
de conseils
Autres professionnels Directe Infirmières, diététiciens, travailleurs sociaux et autres
professionnels de la santé peuvent influencer l’attitude
du malade face à son traitement
Retrouvé
24 •Annales de Gérontologie •vol 3, n° spécial 1, février 2011 •
JEAN-LUC NOVELLA,STÉPHANE SANCHEZ,MAX PRUDENT
Ann Gerontol 2011 ; 3 (n° spécial 1) : 21-7
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 24/05/2017.

Ces effets surviennent majoritairement à l’instauration du
traitement et ne durent généralement pas plus d’une semaine.
Cette mauvaise tolérance clinique peut cependant être la
source d’un défaut d’observance [25], notamment devant les
effets digestifs aigus (perte de poids, anorexie, diarrhée).
Il est aussi à souligner que dans la méta-analyse de Birks et al.
[26], les effets indésirables des traitements anticholinestéra-
siques sont responsables d’arrêt dans 18 % des cas versus
8 % dans le groupe placebo (OR = 2,32 ; IC 95 % 1,95-2,76 ;
p< 0,00001), et que la survenue d’effets indésirables est
beaucoup plus fréquente sous anticholinestérasiques que
sous placebo (OR = 2,51 ; IC 95 % 2,14-2,95 ; p< 0,00001).
La galénique utilisée peut jouer un rôle dans l’observance
des traitements. Les nouveautés récentes en matière de voie
d’administration ouvrent de nouveaux horizons en termes de
tolérance, d’adhésion et de mise en pratique pour l’aidant.
La disponibilité de formes à libération prolongée ou utilisant
la voie transdermique permet un dosage optimal par rapport
à la prise de capsule de la même molécule deux fois par jour
[27]. La prise trois fois par jour de certains traitements amé-
liore les effets d’intolérance, notamment digestive [28], mais
nécessite la présence d’un aidant plus souvent. D’autres
voies d’avenir sont à l’étude sur l’animal [29], comme des
capsules sous-cutanées à libération prolongée. Des formes à
libération continue sont actuellement en essai [30].
Les glutamatergiques utilisés dans les formes modérées à sévè-
res présente globalement une bonne tolérance. La fréquence
de survenue d’effets indésirables ne diffère significativement
pas du placebo. Dans 1 cas sur 100 on retrouve la survenue
de vertiges, céphalées, somnolence, hypertension, dyspnée,
constipation. Et dans 1 cas sur 1 000 la survenue : d’infections
fongiques, troubles de la marche, confusion, insuffisance
cardiaque, thrombose veineuse, vomissements, fatigue.
Il paraît donc nécessaire d’informer au mieux les praticiens et
acteurs de la prise en charge du patient Alzheimer concernant
la iatrogénie et son rôle dans l’inobservance [25].
Parmi le faible nombre d’études s’étant spécifiquement
intéressées à l’observance chez le sujet souffrant de maladie
d’Alzheimer, Gardette et al. dans une étude prospective [25]
ont récemment montré que la prévalence de la non-adhésion
était de 12,7 pour 100 patients traités par an (taux d’arrêt de
3,6, taux de changement de 9,1) chez les patients atteints de la
maladie d’Alzheimer. Les résultats de l’analyse multivariée
montrent que les facteurs d’inobservance entraînant un chan-
gement de thérapeutique sont les suivants : l’inefficacité des
anticholinestérasiques, un déclin cognitif rapide, une hospita-
lisation sans rapport avec la maladie d’Alzheimer et des
manifestations d’anxiété. Les facteurs de risque d’arrêt sont
les suivants : une hospitalisation avec ou sans rapport avec la
maladie d’Alzheimer, la prise de médicaments anticholiner-
giques et la perte de poids traduisant la mauvaise tolérance
digestive.
Certaines équipes ont présenté des résultats intéressants
concernant l’utilisation d’un pilulier qui serait gage d’une
adhérence au traitement de plus de 90 % [31]. Il est cepen-
dant à noter que l’assistance à la mise en place du pilulier
pourrait être la cause de ces résultats très élevés.
En somme, l’adhésion au traitement est le fruit de multiples
paramètres dont les principaux semblent être l’information du
patient et la formation de l’aidant [32], la communication dans
la relation médecin/malade, ainsi que le suivi et l’éducation
du patient comme de l’aidant. Le patient atteint d’une maladie
d’Alzheimer ou d’un syndrome apparenté est un patient
complexe. Sa prise en charge demande une évaluation perma-
nente des bénéfices/risques réalisée par le soignant, tant au
niveau de la thérapeutique que de l’ensemble des mesures
associées à la vie quotidienne.
Le caractère multifactoriel de l’adhésion relève ainsi d’une
prise en charge globale et cohérente, prenant en compte les
déterminants liés au milieu, à l’individu et aux traitements.
La persistance
La persistance peut être définie comme le fait de persister à
prendre son traitement sur un temps défini nécessaire en se
conformant à la prescription [33]. Cette notion rejoint celle
de l’adhésion au traitement en incluant la notion de tempora-
lité nécessaire au fonctionnement du traitement. Cette conti-
nuité dans la prise du traitement est nécessaire pour une
prise en charge de qualité. La persistance est donc un outil
qualitatif à part entière, dont l’importance est capitale dans la
gestion de la maladie [34]. La personne âgée, lorsque ses
attentes restent insatisfaites ou lorsque les réponses aux
questions qu’elle se pose ne sont pas apportées, présente un
plus grand risque d’interruption de traitement [35].
Les études qui s’intéressent à la persistance thérapeutique dans
la maladie d’Alzheimer sont peu nombreuses. Elles comparent
majoritairement les différents traitements disponibles [36-38].
La persistance d’un traitement anticholinestérasique à un an
semble significativement moins importante chez les plus de
80 ans. Par ailleurs, on retrouve une persistance significative-
ment plus marquée chez les patients pour lesquels un traite-
ment antidépresseur est présent au moment de l’introduction
d’un traitement spécifique [39].
1
Les facteurs explicatifs de la persistance thérapeutique
apparaissent globalement liés à ceux de l’observance. Un
anticholinestérasique prescrit par le spécialiste, impliquant
les aidants, et étant bien toléré par le patient a toutes les
chances d’être suivi dans le temps. Cela implique une prise
1
Les psychotropes n’ont pas d’effet préventif sur la survenue des TCP. Il n’est
pas recommandé de prescrire en première intention et sans évaluation préa-
lable un traitement par psychotrope, en particulier neuroleptique, en cas
d’opposition, de cris, de déambulations.
•Annales de Gérontologie •vol 3, n° spécial 1, février 2011 •25
OBSERVANCE ET PERSISTANCE DU TRAITEMENT :PARTICULARITÉS DANS LA MALADIE D’ALZHEIMER
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 24/05/2017.
 6
6
 7
7
1
/
7
100%