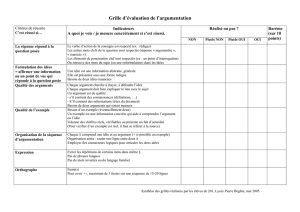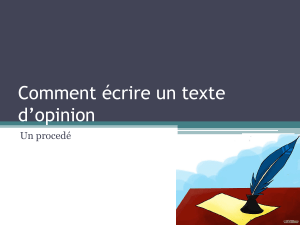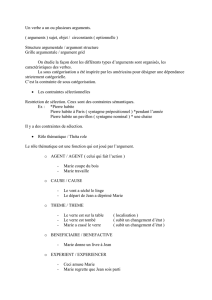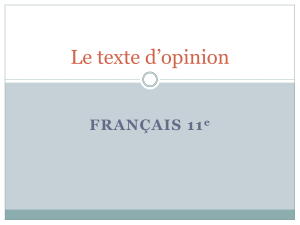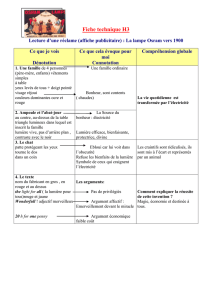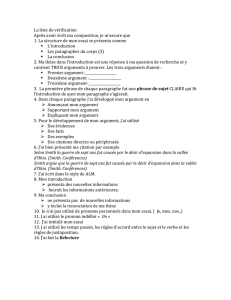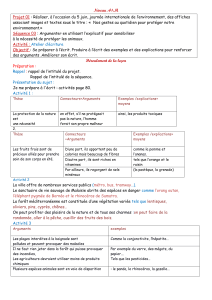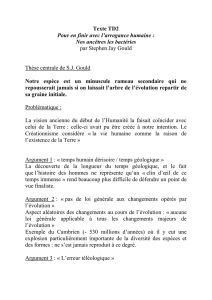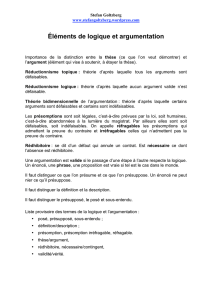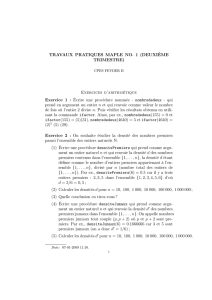A QUOI SERT LA LOGIQUE ?*

David Miller
Warwick University (Coventry)
A QUOI SERT LA LOGIQUE ?*
Traduit de l'anglais par Alain Boyer
Parmi les philosophes, à tout le moins parmi ceux qui s'intéressent plus à l'éducation qu'à
l'édification, autrement dit ceux qui ont à cœur d'argumenter, il est de bon ton de juger que les
arguments sont plus importants que leurs conclusions. Qui n'a pas condamné, ou entendu
condamner un livre par ces quelques mots
:
«J'en
approuve les
conclusions,
mais
l'argumentation
en est
très faible
!
»
Il y a, me semble-t-il, trois explications possibles à cet étrange désintérêt
pour ce que les autres essayent de communiquer. En premier lieu, nombre de thèses philo-
sophiques sont à ce point évidemment vraies que seul un philosophe, dit-on, peut perdre son
temps à les mettre en question. On pourrait prendre comme exemples diverses formes simples
de
réalisme.
En second
lieu,
tant de thèses philosophiques sont si évidemment fausses qu'elles ne
valent pas la peine
d'être
discutées. La doctrine de l'impossibilité de la discussion rationnelle
appartient sans doute à cette catégorie. Mais pour l'ensemble des autres questions philo-
sophiques, il n'est pas de réponse qui soit à l'évidence correcte ou incorrecte
;
j'ai personnelle-
ment tendance à considérer
le
problème de
l'âme
et du corps comme relevant de ce dernier type.
Or dans ce cas aussi, assez curieusement, l'intérêt pour l'argumentation est prépondérant.
La coexistence d'opinions incompatibles chez des personnes réfléchies est considérée
comme un signe que
les
problèmes eux-mêmes sont insolubles
:
le mieux que l'on puisse faire est
d'évaluer la force des arguments proposés par chacune des parties. Rien d'étonnant dès lors à ce
que la philosophie persiste à avoir la réputation
d'être
incapable de
progresser.
J'aimerais dans la
suite de cet article soutenir l'opposé de ce que je tiens pour l'opinion dominante, autrement dit
HERMÈS
15,
1995 291

David Miller
soutenir qu'un argument en tant que tel est en règle générale de peu d'importance par rapport
aux questions qui font l'objet de l'argumentation. De manière plus explicite, ma thèse est que les
arguments sont dénués d'importance
épistémologique.
Mais je cours, ce faisant, le risque d'être
brocardé comme un irrationaliste si je ne réponds pas à la question de savoir pourquoi nous
argumentons, puisqu'il pourrait sembler que je défends ce que Popper a appelé (en se référant à
Whitehead) la méthode du «à prendre ou à laisser» (1945, vol. 2, p. 249). Je soutiendrai donc
simplement que les arguments ont une importance méthodologique. Puisque la logique est le
véhicule de l'argumentation, c'est grâce à cette distinction entre l'épistémologie et la méthodolo-
gie que je répondrai à la question : À quoi sert la
logique
?
Par « logique », j'entends la logique déductive, plus précisément la logique élémentaire, le
calcul des propositions et le calcul des prédicats du premier ordre avec égalité. Je ne pense pas
que l'introduction dans ce débat de diverses extensions de la logique élémentaire, telles que les
logiques modale, temporelle et autres, m'amènerait à modifier sensiblement mon propos. Je me
contente sans trop d'états d'âme de l'idée selon laquelle ce n'est pas la logique qui risque de
souffrir de ces adjonctions, mais plutôt nos théories de la nécessité et du temps. Quant à la
logique inductive, c'est une autre affaire
;
non parce que je pense que l'on surestime énormément
l'importance des prétendus « arguments inductifs » (ce que je crois par ailleurs), mais plutôt
parce je ne pense pas qu'elle puisse être sous-estimée. À la question :
«
À quoi
pourrait
servir la
logique inductive
?
», je répondrai brièvement à la fin de l'article
:
à rien...
Il doit être clair tout d'abord que je ne compte pas énoncer ici de thèses bien nouvelles. On
peut trouver les idées principales à la base de mon propos dans les développements très clairs,
quoique trop brefs, de Popper sur le rôle de la logique dans les sciences et plus généralement
dans le champ de la discussion rationnelle. Voici un passage particulièrement pertinent
(1963,
p.
51 ; trad. p. 86) : « Exiger de la
science
des preuves
rationnelles
signifie qu'on ne parvient pas à
distinguer le vaste domaine de la
rationalité
du
champ
restreint de la certitude
rationnelle :
c'est là
une
exigence impossible
et
déraisonnable.
L'argumentation
logique,
le raisonnement
déductif,
n'en
assure
pas moins un rôle décisif pour la
démarche critique ;
et
ce,
non
parce
qu'il nous permettrait
de prouver
nos
théories
ou de
les inférer à partir des énoncés
d'observations,
mais parce
que seul un
raisonnement purement déductif nous donne la possibilité de découvrir les implications de nos
théories
et,
partant, de les soumettre
efficacement
à la
critique,
La
critique consiste
à
rechercher
les
points faibles d'une théorie, et l'on ne peut, en
général,
faire
apparaître
ceux-ci que dans les
conséquences les plus lointaines de la théorie en question.
C'est
précisément en cela que le
raisonnement
logique
joue un rôle essentiel dans la
démarche
scientifique.
»
À dire vrai, le thème de cet article pourrait être résumé par la caractérisation que donne
Popper de la logique formelle comme Γ«
organon
de la critique rationnelle » plutôt que comme
Vorganon
de la preuve.
Il me faut tout de même me justifier quelque peu de vouloir réouvrir un dossier que la
plupart des auteurs jugent définitivement clos. Ma seule excuse est que je ne crois pas qu'il le
soit. Il me semble que les idées principales du rationalisme critique et du falsificationnisme (qui
292

A quoi sert la
logique
?
n'est autre que le rationalisme critique appliqué aux sciences empiriques), n'ont pas encore été
bien comprises. Naturellement, nombreux sont ceux qui ont reconnu que puisque la science
empirique est bien plus concernée par les énoncés universels que par les existentiels, il existe une
asymétrie fondamentale entre vérification et falsification. Les énoncés universels peuvent être
réfutés, mais pas vérifiés par des énoncés singuliers. Pourtant, le falsificationnisme en tant que
théorie de la connaissance est encore souvent opposé au vérificationnisme, comme
s'ils
jouaient
dans la même équipe, à ceci près que l'un serait au plus haut niveau, tandis que l'autre serait
relégué au dernier rang. De la même manière, le rationalisme critique, quand on daigne lui
accorder quelque attention, est considéré comme étant en compétition avec les diverses formes
d'épistémologie justificationniste dont on admet qu'elles constituent la gloire de l'histoire de la
philosophie. Or il existe une seconde asymétrie, rarement prise en considération, entre les
arguments critiques et les preuves ou justifications, une asymétrie qui me paraît devoir conforter
l'idée selon laquelle les premiers peuvent être importants et féconds, tandis que les seconds ne
sauraient l'être.
Notre discussion pourrait commencer par l'examen d'une curieuse conception de la
logique, que l'on trouve dans un ouvrage de David Stove, au titre d'ailleurs peu engageant de
The Rationality of Induction. Au cours d'une manœuvre destinée à repousser l'idée que la
logique inductive devrait être formelle, ce qui la placerait à la merci des ébouriffants paradoxes
goodmaniens, Stove consacre une quinzaine de pages (p. 115-131) à critiquer l'idée selon
laquelle la logique déductive serait formelle. Une partie de son développement, qui ne me
retiendra pas ici (en particulier parce que ce n'est que du pur non-sens), consiste à arguer qu'il
n'existe pas de formes d'arguments universellement valides de généralité quelconque. Stove se
penche ensuite de manière plus intéressante sur les formes non valides de raisonnement, ce
qu'on appelle parfois les sophismes formels. Il remarque à juste titre que la plupart de ces formes
dites non valides ont bel et bien des instances valides : ainsi, l'exemple suivant de l'affirmation
du conséquent est (sémantiquement) valide : Ρ -* - - Ρ, - - Ρ
I
— P. Il en tire (fallacieusement)
l'idée qu'il existe des instances valides de toutes les formes non valides exprimables sans
constantes (propositionnelles, predicatives ou individuelles) ; et tout en concédant qu'il ne
peut prouver une telle assertion, il affirme que nous disposons de « bonnes raisons » de la
croire vraie. (Malheureusement pour Stove, on peut aisément prouver qu'elle est fausse :
aucune forme ayant pour prémisses des tautologies et pour conclusion une contradiction, par
exemple Ρ ν —Ρ
I —·
Ρ et - Ρ, n'a d'instances valides. Tant pis pour les « bonnes raisons »...)
Plus gravement, Stove en infère qu'il n'est jamais possible de démontrer la non-validité d'un
raisonnement particulier en mettant en évidence le fait qu'il est une instance d'une forme non
valide. (Il n'a manifestement pas cherché à comprendre ce que les logiciens attendent de la
méthode des contre-exemples.) De manière encore plus inquiétante, Stove en arrive à l'idée qu'il
n'existe pas de normes générales par lesquelles on puisse juger de la validité ou de la non-validité
d'un raisonnement
déductif.
Tout ce que nous puissions faire en fin de compte, c'est faire appel
à notre « intuition déductive », et nous demander s'il est
possible
que les prémisses soient vraies
et la conclusion fausse. Si ce n'est pas le cas, le raisonnement est non valide.
293

David Miller
Rien de ce qu'affirme Stove dans son livre sur la logique déductive ne mérite qu'on s'y
attarde outre mesure, et j'ai le sentiment d'avoir à m'excuser d'attirer l'attention du lecteur sur
de telles idées. Mais il y a, me semble-t-il, quelque chose à apprendre de son refus malen-
contreux de reconnaître l'existence de normes universelles de validité et de non-validité (qu'elles
soient formelles ou non) en dehors de l'appel à une intuition modale, et de son insistance
subséquente sur les inferences particulières — ce qu'il appelle des jugements singuliers de
validité (et de non-validité), par exemple l'inférence (formellement valide) suivante :
(A) Tous les hommes sont mortels
Socrate est un homme
Socrate
est mortel
Cet argument possède des prémisses vraies et une conclusion vraie. Mais c'est le cas
également de l'inférence (formellement non valide) suivante :
(B) Tous les hommes sont mortels
Platon est un homme
Socrate
est mortel
(A) et (B) ont la même conclusion. En quoi donc (A) constitue-t-il un meilleur argument en
faveur de cette conclusion que ne le fait (B) ? La réponse du logicien serait que si (A) est analysé
de manière appropriée et en détail (à savoir, dans le langage des prédicats, et non dans le seul
langage des propositions), il se conforme à un schéma valide, alors que (B) n'est conforme à
aucun schéma valide. En toute rigueur, un logicien ne saurait comprendre ce qui pourrait faire
que (A) puisse être compté au nombre des arguments valides, sinon le fait qu'il est une instance
d'un schéma valide. À l'opposé, Stove, si je le comprends bien, distingue (A) et (B) en disant
qu'il est
possible
dans le cas de (B), mais pas dans celui de (A), que les prémisses soient vraies et
la conclusion fausse. C'est à cela, et apparemment tout juste à cela, que se ramènerait le
jugement concernant la non-validité de (B). Ce que je ne parviens pas à comprendre, c'est la
raison pour laquelle la seconde de ces explications de la non validité de (B) (et par association, la
première aussi) devrait avoir la moindre importance si ce qui nous intéresse est la vérité ou la
fausseté de la conclusion de (B). Le fait est que dans (A) aussi bien que dans (B), les prémisses et
la conclusion sont vraies, même s'il serait de notre part injustifié de croire que nous avons une
connaissance certaine de ce fait. En quoi la possibilité abstraite que la conclusion de (B) puisse
être fausse alors que ses prémisses sont vraies rabaisserait ses mérites en tant qu'argument en
faveur de sa conclusion ? N'est-il pas clair que tout ce qui compte, c'est le fait que cette
conclusion soit fausse ou non ? De même, il est difficile de comprendre en quoi le fait qu'il
294

À quoi sert la
logique
?
existe un argument d'une forme similaire à (B) et dont les prémisses sont vraies et la conclusion
fausse devrait attenter à la force de (B) lui-même. La validité ou la non-validité de l'argument, je
l'accorde, serait une question d'importance si notre intérêt s'étendait au-delà de la vérité de la
conclusion, et portait sur la question de la validité de l'argument. (La logique est importante du
point de vue logique). Mais je tiens que si, dans notre investigation du monde, nous nous
intéressons à la validité d'un argument particulier, c'est à cause de l'aide qu'il peut nous apporter
dans la recherche de la vérité, non pour son propre compte.
Il me semble que l'épistémologie peut être caractérisée correctement comme cette partie de
la théorie de la connaissance qui tente de procéder à des distinctions entre les propositions, non
eu égard à leur valeur de vérité, mais eu égard à la manière dont elles sont affectées par les
procédures d'investigation auxquelles nous les soumettons. Elle a pour objets des concepts
comme la vérification et la confirmation, le soutien ou la falsification. La méthodologie, en
revanche, s'intéresse aux procédures qui nous permettent de classer les propositions selon leurs
valeurs de vérité. Ses objets sont le vrai et le faux. Or, ce que je soutiens, c'est qu'au niveau
épistémologique, il n'y a rien à dire en faveur des arguments valides et à l'encontre des
arguments non valides. Un argument valide, tel que (A), ne confère pas plus de qualité à sa
conclusion que ne le fait (B). Peut-être y
a-t-il
de nos jours un peu moins de philosophes à
attendre des arguments non seulement qu'ils nous aident à déterminer la valeur de vérité de nos
conclusions, mais aussi qu'ils leur donnent quelque stimulant épistémologique, qu'ils leur
accordent leur soutien, les étayent. David Stove semble être l'un de ceux-là
:
il paraît penser que
(A) constitue un meilleur argument que (B) pour sa conclusion, et ce parce qu'il nous donne de
meilleures raisons, peut-être même la raison, de croire à la conclusion en question. J'ai soutenu
ailleurs (1987/1989, section 4) que, même s'il existait quelque chose comme des bonnes raisons
en faveur de nos propositions, nous ne gagnerions rien dans notre investigation de la valeur de
vérité d'une proposition par la possession de telles « bonnes raisons » (« bonnes », mais non
décisives) ; et que même s'il existait des raisons décisives, concluantes, peu de choses au fond
pourraient être dites en leur faveur. Etant donné que (A) et (B) ont tous deux des prémisses dont
on peut douter, il s'ensuit qu'en tant qu'instrument d'investigation de la valeur de vérité de la
conclusion «Socrate est mortel», (B) n'est pas un plus mauvais argument que (A). Le fait de
disposer d'un argument valide en faveur d'une conclusion ne confère aucune espèce d'avantage
épistémologique.
Des considérations tout à fait parallèles conduisent à soutenir que si c'est à la
conclusion que nous nous intéressons, nous pourrions aussi bien ne mentionner aucune pré-
misse. Si nous cherchons à déterminer la valeur de vérité d'une proposition, nous ne gagnerons
rien en fournissant un argument en sa faveur. Nous pouvons tout aussi bien l'affirmer, sans
prétendre qu'elle est soutenue par un argument. Est-ce là la méthode du « à prendre ou à
laisser » ? C'est peut-être, je l'avoue volontiers, celle du « à prendre ». Mais non nécessairement
celle du « à laisser », comme je vais tenter de le montrer.
Les arguments déductifs peuvent bien entendu permettre d'arriver à une conclusion, tout
comme les conjectures, les rêves, ou quelques doses de bon
Scotch.
(Mais je doute qu'ils le
295
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
1
/
10
100%