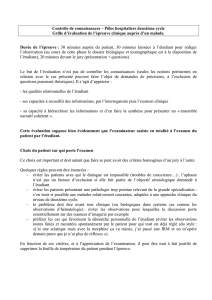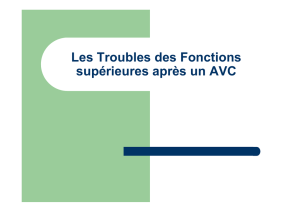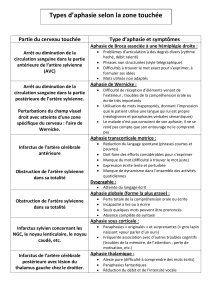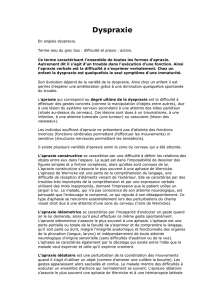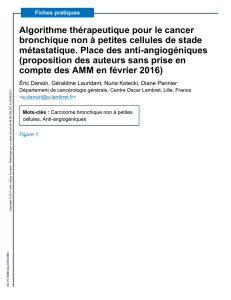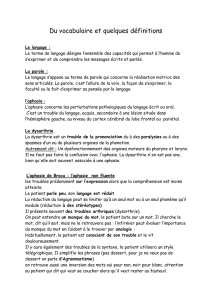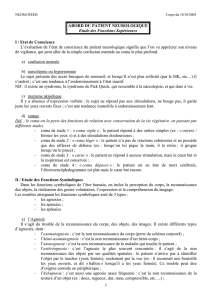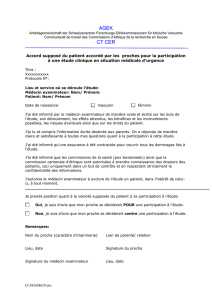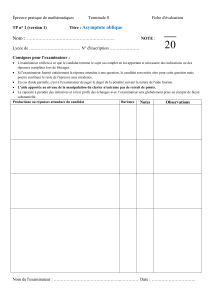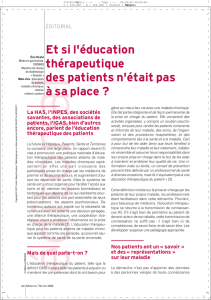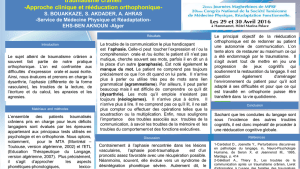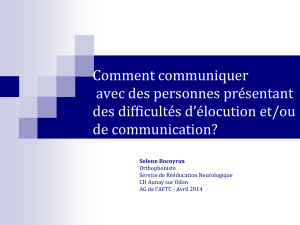Troubles cognitifs aigus révélateurs d`un accident vasculaire cérébral

Mini-revue
Troubles cognitifs aigus révélateurs
d’un accident vasculaire cérébral
Marie Sarazin
1
, Pierre Amarenco
2
1
Fédération des maladies du système nerveux, Centre de neuropsychologie-CMRR d’IDF, hôpital de la Salpêtrière,
75013 Paris
2
Service de Neurologie et centre d’accueil et de traitement de l’attaque cérébrale, hôpital Bichat, 75018 Paris
Les manifestations les plus habituelles des troubles cognitifs
d’apparition brutale se caractérisent principalement par des
troubles de la mémoire et du langage. Un scanner cérébral doit
être réalisé en urgence, parfois suivi d’une ponction lombaire.
Les mécanismes étiologiques sont nombreux. Les causes les plus
fréquentes de déficit cognitif sont représentées par les accidents
vasculaires cérébraux. La méningoencéphalite herpétique im-
pose la mise en route d’un traitement en urgence.
Mots clés :accident vasculaire cérébral, mémoire, langage,
méningoencéphalite herpétique
Les causes les plus fréquentes de déficit cognitif d’apparition brutale
sont représentées par les accidents vasculaires cérébraux (AVC).
Rechercher et analyser un trouble cognitif d’apparition aiguë per-
met : 1) d’évoquer le diagnostic d’AVC surtout lorsque le trouble
cognitif est isolé sans signe moteur associé ; 2) d’apporter des arguments sur sa
localisation ; 3) de caractériser le profil évolutif et déterminer des facteurs
pronostiques ; 4) de proposer précocement une prise en charge de rééducation
orthophonique. Aux urgences, le principal diagnostic différentiel à ne pas
méconnaître est la méningo-encéphalite herpétique qui impose la mise en route
d’un traitement antiviral sans attendre.
Trouble du langage d’apparition aiguë
L’aphasie est le plus fréquent des troubles cognitifs associés à un AVC. Les
troubles du langage répondent à une sémiologie précise qui permet de caractéri-
ser le niveau du désordre neuropsychologique et ses bases neuronales anatomi-
ques.
Terminologie
On distingue trois niveaux principaux de désordre du langage.
1) Les troubles acquis de la parole renvoient à un trouble de la réalisation
motrice de l’articulation du langage par dysfonctionnement de l’appareil bucco-
phonatoire, sans atteinte du code linguistique.
Tirés à part :
M. Sarazin
Sang Thrombose Vaisseaux 2006 ;
18, n° 8 : 433-9
STV, vol. 18, n° 8, octobre 2006 433
doi: 10.1684/stv.2006.0003
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 24/05/2017.

2) Les aphasies correspondent aux troubles linguistiques
proprement dits. On distingue les aphasies non fluentes qui
se caractérisent par une réduction du débit du langage
(trouble de la production) des aphasies fluentes où le débit
est normal voire exagéré (logorrhée). Le prototype de
l’aphasie non fluente est l’aphasie antérieure de Broca, le
prototype de l’aphasie fluente est l’aphasie postérieure de
Wernicke.
3) Les troubles supralinguistiques du discours correspon-
dent à une altération du fonctionnement du langage sans
atteinte linguistique [1]. Le prototype est l’aphasie dynami-
que frontale dans laquelle le débit du discours est réduit
mais correctement énoncé. L’analyse sémiologique s’ap-
puie sur les définitions suivantes :
– anomie : défaut de production de mots (ou manque de
mots) ;
– paraphasie (ou déformations linguistiques) = mots
mal prononcés ou mal attribués : paraphasie phonétique :
atteinte articulatoire (réalisation motrice finale) du langage
aboutissant à la substitution de phonèmes par des phonè-
mes proches (« ba » par « pa ») ; paraphasie phonémique :
transformation d’un mot par élision, adjonction, déplace-
ment de ses phonèmes constitutifs (« lon » pour « lion » ;
« trambour » pour « tambour » ; « hérélicotère » pour « hé-
licoptère ») ; paraphasie verbale : remplacement d’un mot
par un autre mot sans rapport de sens avec le mot cible
(« carte » pour « arbre ») ; paraphasie sémantique : rem-
placement d’un mot par un autre mot appartenant au même
champ sémantique ou ayant un sens commun (« verre » ou
« soucoupe » pour « tasse ») ;
– néologisme : déviation linguistique aboutissant à la
production d’un « faux mot », utilisé comme un mot bien
qu’il n’ait aucun sens (« tanpularte » pour « couverture ») ;
– agrammatisme et dyssyntaxie : perturbations syntaxi-
ques (absence ou réduction de l’emploi des termes gram-
maticaux) ;
– jargon : production langagière incompréhensible en
raison de la richesse des néologismes, des paraphasies et
des troubles de la syntaxe ;
– troubles de l’écriture : paragraphies graphiques, gra-
phémiques, sémantiques, verbales.
Examen des troubles du langage
L’examen des troubles du langage peut se faire rapidement
et efficacement au lit du patient. Il comporte plusieurs
étapes. Il est important de noter précisément les réponses du
patient, comme référence évolutive :
a) étude du langage spontané et en réponse à quelques
questions simples ;
b) étude de la dénomination d’objets (par exemple
l’oreiller, la montre, les lunettes, le téléphone, la poche de la
blouse, le stylo...) ou d’images (prendre un magazine à
portée de main) et de la production du langage complexe
par la construction de phrases à partir de 2 ou 3 mots
imposés (train et gare ; pain et boulanger...) ;
c) étude de la répétition de mots, puis de phrases phonéti-
quement difficiles (« le spectacle exceptionnel - j’habite
33, rue Ledru Rollin ») ou longue (« le train est arrivé à la
gare de Nevers avec plus d’une heure de retard ») ;
d) étude de la compréhension sur consignes orales simples
(« montrez-moi la fenêtre ; levez la main gauche ») et sur
consignes complexes (« fermez les yeux et tirez la langue ;
mettez la main gauche sur votre épaule droite ») ;
e) étude de la fluence verbale (« citez le maximum de mots
d’animaux en 1 minute ») ;
f) l’analyse du langage oral doit systématiquement être
complétée par une étude du langage écrit (lecture et écriture
sur le même modèle que pour le langage oral) ;
g) recherche d’une apraxie bucco-linguo-faciale par la réa-
lisation d’ordres simples tels que tirer la langue, gonfler les
joues, siffler, ou d’ordres séquentiels (tirer puis claquer la
langue puis gonfler les joues) ;
h) on recherchera également des troubles de la coordination
pneumo-articulatoire et une dysprosodie (trouble du timbre
de la voix).
Aphasie brutale
Les AVC représentent la cause la plus fréquente des apha-
sies brutales chez les adultes de plus de 45 ans [2]. Le
tableau le plus typique est celui de l’aphasie de Broca
secondaire à un accident ischémique sylvien gauche (artère
cérébrale moyenne). Les accidents hémorragiques sont res-
ponsables de tableaux cliniques souvent plus atypiques en
raison de leur siège sous-cortical et d’un possible effet de
masse initial.
Aphasie de Broca par infarctus
de l’artère cérébrale moyenne
Elle se caractérise avant tout par une réduction de la pro-
duction quantitative et qualitative du langage, s’accompa-
gnant d’une apraxie bucco-linguo-faciale et d’un déficit
moteur brachio-facial droit. Au stade initial aigu, le patient
peut être mutique ou n’être capable de fournir que des
stéréotypies verbales (« nan-nan »). Il est conscient de ses
difficultés. Dans les formes moins sévères, un manque de
mots et une anomie prédominent le tableau clinique dans le
langage spontané et dans les épreuves de dénomination. On
note également un agrammatisme avec un appauvrissement
des éléments syntaxiques. Le langage reste cependant infor-
matif. Les paraphasies phonémiques, verbales et sémanti-
ques sont nombreuses. Une dissociation automatico-
volontaire est classique, le patient étant capable de
STV, vol. 18, n° 8, octobre 2006
434
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 24/05/2017.

s’exprimer dans un contexte automatique (réponses stéréo-
typés, contexte émotionnel) alors que, sur commande, sa
production verbale devient impossible ou est très limitée.
La compréhension, bien que nettement moins perturbée,
n’est toutefois que rarement totalement intègre. On peut
ainsi constater des troubles de compréhension pour les
phrases complexes. Les troubles de la lecture et de l’écri-
ture sont congruents à ceux du langage oral.
La région infarcie se situe typiquement dans la région de
Broca : opercule frontal, partie postérieure de F2 (seconde
circonvolution frontale) et de F3 (troisième circonvolution
frontale) [3].
Autres tableaux cliniques
Les autres tableaux cliniques de troubles du langage d’ap-
parition aiguë secondaires à un AVC sont décrits et résumés
dans le tableau I.
Héminégligence d’apparition aiguë,
apraxie, agnosie
Terminologie et examen clinique
Héminégligence : L’héminégligence spatiale se voit après
lésion hémisphérique droite, principalement après un in-
farctus de l’artère cérébrale moyenne droite. Le patient se
comporte comme si la moitié gauche de l’espace n’existait
pas. Il n’écrit que sur la moitié droite de la page, ne désigne
que les personnes présentes dans sa chambre dans l’hémi-
champ droit par exemple. L’héminégligence est toujours
accompagnée d’une anosognosie. Le syndrome d’Anton-
Babinski associe une héminégligence spatiale, une anoso-
gnosie, une hémiasomatognosie (le patient considère que la
moitié gauche hémiplégique ne lui appartient pas, allant
jusqu’à expliquer que son propre bras paralysé qui lui est
présenté est celui du médecin), et une anosodiaphorie (in-
différence à son état). L’héminégligence spatiale est recher-
Tableau I.Principaux tableaux neurologiques avec troubles cognitifs associés à un AVC
Sémiologie Territoire vasculaire
Aphasie de Broca Aphasie non fluente
Manque de mots
Paraphasies (erreurs de prononciation
et de sélection des mots)
Agrammatisme (trouble de grammaire)
Compréhension orale mieux préservée
que la production
ACM gauche
(Région périsylvienne gauche)
Aphasie de Wernicke Langage fluent
Logorrhée avec jargon
Langage peu informatif
Compréhension très altérée
Anosognosie
ACM gauche
(région temporale sup post
et lobule pariétal inférieur)
Aphasie globale Non fluente avec mutisme
Compréhension très altérée
ACM gauche complète
Aphasie de conduction
(suit fréquemment la récupération
d’une aphasie de Broca)
Fluente
Paraphasies nombreuses,
avec tentatives d’autocorrections
Compréhension préservée
ACM gauche
(faisceau arqué)
Apraxie idéomotrice
Apraxie constructive
Réalisation des gestes imités altérée
Copie de dessins géométriques altérée
Souvent associé à une aphasie
ACM gauche
Héminégligence gauche Négligence de l’espace gauche
Hémiplégie gauche avec hémiasomatognosie
Anosognosie
HLH gauche
ACM droite
Cécité corticale Cécité + anosognosie
Conservation du réflexe photomoteur
ACP bilatérale
Syndrome de Balint Ataxie optique (impossibilité de pointer
ou d’attraper une cible sous contrôle
visuel) + apraxie optique (trouble de l’orientation
du regard) + simultagnosie (incapacité à analyser
un tout alors que les détails sont identifiés)
ACP bilatérale ou jonction ACM et ACP
(régions pariéto-occipitales)
ACM = artère cérébrale moyenne ; ACA = artère cérébrale antérieure ; ACP = artère cérébrale postérieure ; HLH = hémianopsie latérale homonyme.
STV, vol. 18, n° 8, octobre 2006 435
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 24/05/2017.

chée facilement et rapidement par la réalisation de dessins
(la partie gauche de la figure n’est pas dessinée), par le
barrage de lignes (des lignes horizontales sont dessinées sur
une feuille de longueur différente, on demande au patient
de barrer le milieu de chaque trait) et le barrage de signes
(des ronds et carrés de petites tailles sont réparties sur une
feuille, on demande au patient de barrer les ronds) qui
montreront un « oubli » de l’hémi-espace gauche de la
feuille. On peut aussi demander au patient de se représenter
mentalement une place connue de la ville et de la décrire en
s’imaginant en face d’un monument précis (il ne décrit que
l’hémi-espace droit). Enfin, l’inspection simple du patient
montre un regard tourné vers la droite, une tendance spon-
tanée à ne s’adresser que vers son côté droit. On peut
d’emblée noter que pour favoriser une rééducation précoce,
il vaut mieux se placer sur la gauche du patient et, dans les
chambres à deux lits, placer le voisin de chambre sur la
gauche du lit du patient.
Apraxie : il s’agit d’un trouble de l’action et de la com-
mande du geste, qui ne peut s’expliquer ni par une atteinte
motrice, ni par une atteinte sensorielle, ni par un trouble de
la compréhension. La lésion se situe habituellement dans la
région pariétale [4].
L’apraxie idéomotrice est la plus fréquente. Elle se définit
par une incapacité à imiter des postures sans signification
(faire un anneau avec le pouce et l’index, poser le dos de la
main sur la joue controlatérale). On peut observer des
difficultés pour les gestes symboliques (salut militaire,
signe de croix, au revoir, gronder...), lors du mime de
l’utilisation d’objet (planter un clou avec un marteau, jouer
du violon. Une dissociation automatico-volontaire est fré-
quente : le geste est bien réalisé de manière automatique
dans son contexte naturel, alors que le patient ne peut le
faire sur commande de l’examinateur. Les lésions siègent le
plus souvent dans la région pariétale gauche.
L’apraxie idéatoire se définit par une incapacité à utiliser
réellement des objets familiers (comme allumer une allu-
mette, mettre une lettre dans une enveloppe, utiliser des
ciseaux). Elle est la conséquence de lésions pariétales gau-
ches ou plus souvent, bilatérales.
L’apraxie constructive correspond à un trouble de la réali-
sation de dessins en 2 ou 3 dimensions, le plus fréquem-
ment secondaire à des lésions pariétales droites.
L’apraxie de l’habillage correspond à un trouble spécifi-
que de l’habillage. Les lésions responsables siègent habi-
tuellement dans l’hémisphère droit.
Agnosie visuelle : l’agnosie visuelle correspond à un trou-
ble de la reconnaissance d’une information visuelle par
atteinte des aires visuelles associatives occipitales, pouvant
aller jusqu’à la cécité corticale. Le patient ne peut pas
dénommer un objet présenté visuellement ni en préciser la
fonction, alors que leur dénomination par une autre entrée
sensorielle tactile, auditive ou olfactive est possible. La
description de l’image présentée se fait par le détail sans
analyse globale. C’est la simultagnosie (par ex., lors de la
présentation d’images enchevêtrées). Lors d’un infarctus
de la région vascularisée par les deux artères cérébrales
postérieures, le tableau peut aller constituer une cécité
corticale ou un syndrome de Balint (cf. tableau II).
Certaines agnosies visuelles sont spécifiques : l’agnosie
des couleurs se définit par l’incapacité à discriminer les
couleurs ou à attribuer une couleur à un objet et s’observe
après infarctus de l’artère cérébrale postérieure gauche. La
prosopagnosie se définit par l’incapacité à reconnaître des
visages alors que l’identification de la personne est possible
par la voix ou la démarche par exemple. La prosopagnosie
est secondaire à des lésions temporo-occipitales droites ou
bilatérales.
Sémiologie en fonction
du site lésionnel vasculaire
Les accidents vasculaires cérébraux sont responsables des
déficits les plus nets et les plus purs [5]. Le tableau II en
résume les principaux profils cliniques.
Troubles de la mémoire
d’installation aiguë ou subaiguë
Terminologie et examen clinique
Un AVC peut entraîner un trouble de la mémoire. Encore
faut-il s’entendre sur le terme de trouble de la mémoire. En
effet, il est maintenant bien reconnu qu’il n’y a pas une
mémoire mais des systèmes de mémoire, correspondant à
des unités fonctionnelles et neuroanatomiques déterminées
[6]. La mémoire à court terme désigne le stockage des
informations sur une durée brève et transitoire. La mémoire
à long terme, au contraire, correspond au stockage des
informations impliquant un processus de consolidation
mnésique correspondant à la formation d’une trace mnési-
que. Une amnésie antérograde se définit par une altération
de la mémorisation de nouveaux souvenirs, depuis l’instal-
lation de l’événement causal. Une amnésie rétrograde se
définit par une incapacité à se souvenir d’éléments anciens,
antérieurs à l’événement causal. On peut aussi distinguer la
mémoire, en fonction de son contenu, en mémoire verbale
qui est plutôt sous la dépendance de l’hémisphère gauche et
mémoire non verbale (visuospatiale) qui est plutôt sous la
dépendance de l’hémisphère droit ; ou encore en mémoire
épisodique (mémoire d’événements factuels) et mémoire
sémantique (mémoire des faits généraux). Enfin, on peut
distinguer la mémoire en fonction du traitement de l’infor-
STV, vol. 18, n° 8, octobre 2006
436
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 24/05/2017.

Tableau II.Batterie rapide d’évaluation frontale (BREF, d'après B. Dubois et al., 1997)
1. Similitudes (élaboration conceptuelle)
« En quoi se ressemblent :
•Une banane et une orange
(aider le patient en cas d’échec total :
« elles ne se ressemblent pas » ou partiel : « elles ont toutes les deux une peau », en disant : « une orange et une banane sont toutes les deux
des ... » ; ne pas aider le patient pour les deux items suivants),
•Une table et une chaise,
•Une tulipe, une rose et une marguerite ?»
Cotation : seules les réponses catégorielles (fruits, meubles, fleurs) sont considérées comme correctes. 3 réponses correctes=3;
2 réponses correctes=2;1réponse correcte=1;aucune réponse correcte = 0 /3
2. Evocation lexicale (flexibilité mentale)
« Nommez le plus possible de mots différents, par exemple des animaux, des plantes, des objets, mais ni prénoms,
ni noms propres, commençant par la lettre « S ». »
Si le patient ne donne aucune réponse pendant les 5 premières secondes, lui dire :
« par exemple serpent ». Si le patient fait des pauses de plus de 10 secondes, le stimuler après chaque pause en lui disant
« n’importe quel mot commençant par la lettre S ».
Cotation : le temps de passation est de 60 secondes ; les répétitions de mots, les variations sur un même mot (sifflet, sifflement), les noms et
prénoms ne sont pas comptés comme des réponses correctes. Plus de 10 mots=3;de6à10mots=2;de3à5mots=1;moinsde
3 mots = 0 /3
3. Comportement de préhension (autonomie environnementale)
L’examinateur est assis en face du patient dont les mains reposent sur les genoux, paumes ouvertes vers le haut.
L’examinateur approche doucement les mains et touche celles du patient, pour voir s’il va les saisir spontanément si le patient les prend, lui
demander : « maintenant, ne prenez plus mes mains ».
Cotation :lepatientneprendpaslesmainsdel’examinateur=3;lepatienthésite ou demande ce qu’il doit faire=2;lepatient prend les
mains de l’examinateur, après que celui-ci lui ait demandé de ne pas le faire = 0 /3
4. Séquences motrices (programmation)
« Regardez attentivement ce que je fais ».
L’examinateur assis en face du patient exécute seul trois fois avec sa main gauche la séquence de Luria « tranche-poing-paume ».
« Maintenant, vous allez exécuter avec votre main droite cette séquence, d’abord en même temps que moi, puis
seul ».
L’examinateur effectue alors trois fois la séquence avec sa main gauche en même temps que le patient, puis lui dit : « continuez ».
Cotation : le patient exécute seul 6 séquences consécutives correctes=3;lepatient exécute seul au moins 3 séquences consécutives
correctes=2;lepatientéchoueseul,maisexécute 3 séquences consécutives correctes en même temps que l’examinateur=1;lepatient ne
peut exécuter 3 séquences consécutives correctes, même avec l’examinateur = 0 /3
5. Consignes conflictuelles (sensibilité à l’interférence)
« Lorsque je tape une fois, vous devez taper deux fois ». Pour s’assurer que le patient a bien compris la consigne, l’examinateur
lui fait réaliser une séquence de trois essais : 1-1-1.
« Lorsque je tape deux fois, vous devez taper une fois ».
Pour s’assurer que le patient a bien compris la consigne, l’examinateur lui fait réaliser
Une séquence de trois essais : 2-2-2. La séquence proposée est la suivante : 1-1-2-1-2-2-2-1-1-2
Cotation :aucuneerreur=3;1ou2erreurs=2;plusdedeuxerreurs=1;lepatienttapelemême nombre de coups que l’examinateur
au moins 4 fois consécutives = 0 /3
6. Go-No Go (contrôle inhibiteur)
“Lorsque je tape une fois, vous devez taper une fois”.
Pour s’assurer que le patient a bien compris la consigne, l’examinateur lui fait réaliser une séquence de trois essais : 1-1-1
« Lorsque je tape deux fois, vous ne devez pas taper ».
Pour s’assurer que le patient a bien compris la consigne, l’examinateur lui fait réaliser une séquence de trois essais : 2-2-2. La séquence
proposée est la suivante : 1-1-2-1-2-2-2-1-1-2.
Cotation :aucuneerreur=3;1ou2erreurs=2;plusdedeuxerreurs=1;lepatienttapelemême nombre de coups que l’examinateur
au moins 4 fois consécutives = 0 /3
SCORE TOTAL = /18
STV, vol. 18, n° 8, octobre 2006 437
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 24/05/2017.
 6
6
 7
7
1
/
7
100%