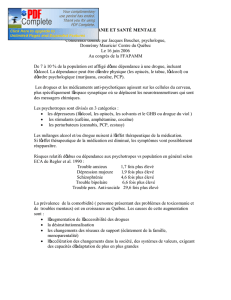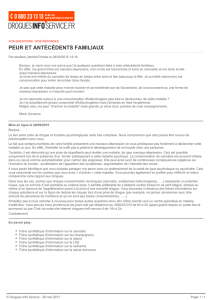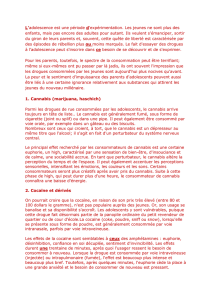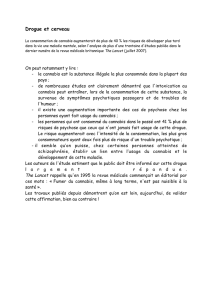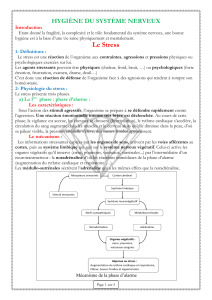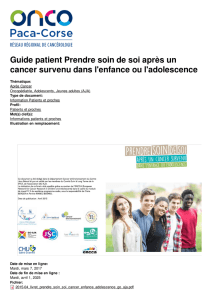Faire la fête : rite de passage, mode de vie ou échappatoire ?

Le Courrier des addictions (10) – n ° 3 – juillet-août-septembre 2008
19
Faire la fête : rite de passage,
mode de vie ou échappatoire ?
A. Coppel*
Les débordements en tous genres des “jeunes”, des
charivari d’autrefois, aux teufs d’aujourd’hui, en pas-
sant par les excès des Sioux, les violences des Blou-
sons Noirs, les défonces des Hells Angels, ou de certains night-clubeurs
ou teufers de nos week-ends, ont toujours suscité peurs, fantasmes, rejets.
Et suscité diverses et divergentes explications et analyses, compréhension
parfois, répression souvent… Mais il faut bien que jeunesse se passe, elle
qui s’est fait définitivement son trou comme une catégorie sociale auto-
nome. Et c’est en son sein que la consommation de drogues illicites, com-
portement déviant plutôt que délinquant, est devenue un des symptômes
de “la crise d’adolescence”. Le concept de “comportements à risques”,
qui s’est imposé au cours des années 1990, en a rendu plus rigoureux les
contours. Concept épidémiologique qui se veut purement objectif, justifié
par les indicateurs quantitatifs de la santé publique, il comporte différents
“paragraphes”, “les comportements à risque”. Avec lui, le discours n’est
plus seulement moral : il se veut fondé par la science, celle des chiffres et
des neurotransmetteurs.
Mais au-delà de la connaissance, scientifique ou non, du phénomène,
reste “la vraie réalité” de la fête et de ses enjeux : en l’absence de perspec-
tive d’intégration, elle n’est pas seulement un lieu et un espace-temps pour
se “vider la tête”, un défouloir nécessaire face aux pressions sociales. Elle
peut devenir un mode de vie qui s’affirme comme alternatif. Les logiques
de dissidence s’affrontent à celles d’intégration. Redoubler les processus
d’exclusion ou favoriser l’intégration des jeunes, tels sont les enjeux de la
réaction sociale face aux pratiques festives.
* Sociologue, Paris.
Mlle A., une longue tradition
d’excès à tous produits
Que les jeunes fassent la fête est générale-
ment admis. Ce sont les excès qui inquiè-
tent aussi bien les parents que les spécialis-
tes de l’adolescence, et ce, d’autant qu’aux
abus d’alcool, traditionnels en France, s’as-
socient désormais différentes drogues illici-
tes. Les polyconsommations sont de rigueur
et les jeunes d’aujourd’hui – où du moins
certain d’entre eux précisent les spécialis-
tes – feraient “n’importe quoi”. Les prises
de risque seraient d’autant plus inquiétan-
tes que les consommations de psychotropes
seraient initiées à un âge de plus en plus
précoce. Le récit de Mlle A. des fêtes de son
adolescence illustre ces interprétations in-
quiétantes. Cette jeune fille, âgée de 21 ans,
a été interviewée dans une recherche menée
en 2006 en banlieue parisienne (1). Mlle A.
a été élevée par sa mère qui fait partie des
travailleurs pauvres. Dès l’âge de 15 ans,
elle a commencé à fumer du cannabis et
boire de l’alcool avec une bande de copains
vivant comme elle dans sa cité ou dans les
petits pavillons environnants. Rapidement,
cette “bande de potes” n’est plus tolérée
dans les chambres ou les garages, d’abord
investis. Faute d’un lieu où “squatter”, Mlle
A. et sa copine décident alors d’explorer
une boîte de nuit que lui a fait connaître
sa sœur aînée. Commence alors une vie de
“night-clubeuse frénétique” selon ses pro-
pres termes. Bien qu’encore mineure, elle
est accueillie à bras ouverts : “Moi je suis
une petite métis et comme y’en a pas beau-
coup, les videurs ils aiment trop ma tête. À
cette époque-là, j’avais 16 ans, 17 ans et
pourtant je rentrais à l’œil, ‘mais vas-y, les
portes sont grand ouvertes !’, c’était vrai-
ment la fête quoi”.
Les sorties, restreintes d’abord à une soi-
rée par semaine, s’étendent rapidement du
vendredi au dimanche soir. Très vite égale-
ment, Mlle A. expérimente tous les psycho-
tropes qui passent à sa portée. L’ecstasy est
le premier produit qui bouleverse les cadres
de perceptions : “ça m’a retourné le cer-
veau”, raconte-t-elle. À l’ecstasy, s’ajoute
toute une série de produits qu’elle n’est pas
en mesure d’identifier :
– “À l’époque, moi je savais même pas
qu’est ce que c’était, tu vois, quand j’en
prenais, je ne savais pas ce que c’était.
– Tu ne demandais pas ce que c’était ?
– Non pas spécialement, on me disait : t’in-
quiète, c’est du bon !” (rires).
En vrac, elle consomme amphétamines,
ecstasy, cocaïne et même du LSD qu’elle a
bu dans un verre sans savoir ce que c’était :
“J’allais pas demander qu’est ce que c’était.
Moi ce qui était important c’était ma fon-
cedé (défonse) […] Je me suis enflammée
quoi ! Je prenais tout ce qui me passait par
la main pour monter tellement haut que je
puisse plus redescendre, tu vois, c’était ça”.
Les descentes sont violentes et douloureu-
ses : “Mes potes, ils étaient obligés de me
porter à quatre pour me sortir de la boîte
[…]. Enfin, moi les comas éthyliques, c’était
à chaque fois que je rentrais de soirée […].
Je me voyais mourir tous mes week-ends…”
Ces pratiques d’excès sont minoritaires
dans le milieu des fêtes techno. Dans les
raves ou free-parties, les participants reven-
diquent au contraire un “usage festif” qu’ils
opposent à la dépendance ou “usage toxi-
comaniaque”, l’usage festif impliquant une
maîtrise des consommations, limitées dans
le temps, avec une connaissance précise des
risques liés à l’usage de chacun des pro-
duits expérimentés. Les polyconsommations
chaotiques n’en sont pas moins observées
par les équipes de réduction des risques qui
Faculté de pharmacie
de l’Observatoire
27 mars 2008

Le Courrier des addictions (10) – n ° 3 – juillet-août-septembre 2008 20
interviennent dans les fêtes. Dans les tekni-
vals, il s’agit souvent de jeunes marginaux
au regard du mouvement techno, mais nom-
bre d’usagers qui se définissent eux-mêmes
comme “usagers festifs” décrivent en des
termes similaires la période d’expérimenta-
tion, l’usager apprenant progressivement à
éviter les excès, sanctionnés par des descen-
tes douloureuses. Si malgré les bad trips,
Mlle A. a poursuivi de 16 à 19 ans un mode
de consommation caractérisé par la recher-
che systématique de l’ivresse, c’est d’abord
qu’elle a plongé très jeune dans l’univers
festif. C’est aussi que Mlle A. s’est saisie de
l’univers festif comme d’une porte de sortie
du monde des cités auquel elle appartenait
par son origine sociale. Pour entrer dans
l’univers culturel de la fête, dominé alors
par la musique techno, Mlle A. a dû mettre
à distance les codes et valeurs de son en-
fance. Elle a dû s’oublier elle-même. Et elle
a aimé ce vertige particulier.
Mlle A. parle le langage des jeunes des cités
parisiennes, mais le récit de cette escalade
entre en résonance avec toutes les généra-
tions d’usagers de drogue qui ont précédé
la sienne. Chacune à son tour s’est saisie de
tous les produits psychotropes qui passaient
à sa portée. Chacune a recherché l’ivresse
qui fait voler en éclats les contraintes du jeu
social, en même temps qu’elle les fait sortir
d’eux-mêmes. Chaque génération plonge à
son tour dans ce maelström dont les victi-
mes, souvent musiciens, sont célèbres. Des
films ou romans emblématiques illustrent
ces figures légendaires. Dans les années
1990, ce sont les héros de Transpotting de
Irvine Welsh, qui, comme Mlle A., vont au-
delà d’eux-mêmes. Dans les années 1980,
les héros de Neige sur Beverdy Hills de Bret
Easton Ellis les avaient précédés. Tous sont
les enfants illégitimes de la génération des
années 1960, celle qui a prôné le scandaleux
Sex, drugs and rock and roll. Avant elle, dès
la fin des années cinquante dans les pays
anglo-saxons, des bandes de jeunes avaient
expérimenté “le tout et n’importe quoi”…
du moment que ça défonce. C’est la vie que
mènent les Hells Angels, qu’un journaliste
s’est aventuré à partager pendant quelques
mois. Tandis que ces motards distribuent
à chacun des pilules avalées par poignées
avec de grandes goulées de bière, Thomson,
“le journaleux”, interroge, inquiet :
– “Mais c’est quoi ?
– Des benzines, mec !
– C’est dosé à combien ?
– T’en prends une dizaine, et plus si c’est
pas assez !”
Les Angels ne faisaient pas dans le détail.
Tout était bon : la bière, l’herbe, le vin, du
sécobarbital et autres barbituriques, en vo-
gue à l’époque, faisaient partie de l’ordi-
naire, auquel les Hells Angels ajouteront du
LSD après leur rencontre avec les étudiants,
au milieu des années soixante (2).
Jeune ou ado, l’apparition
d’une nouvelle classe d’âge
Les Hells Angels font partie de ces bandes
de jeunes qui se regroupent dès la fin de
la Seconde Guerre mondiale, et qui font
scandale dans tous les pays occidentaux.
Ce sont souvent des enfants de la classe
ouvrière, tels les Skunafolkes à Stockholm,
les Halbstarkenkravalle à Berlin, les Teddy
boys à Londres, les JV, jeunes voyous à Pa-
ris. Mais à côté des blousons-noirs, il y a
aussi “les blousons-dorés”, enfants de la
bonne bourgeoisie. Certaines de ces bandes
de jeunes sont relativement homogènes par
leur origine de classe. Les Mods et les Roc-
kers qui s’affrontent à Brighton en 1963 et
mettent le quartier à feu à sang affirment
leur appartenance de classe. Les Mods, em-
ployés de banque ou vendeurs sont habillés
à l’italienne, filent sur leur Vespa. Leur
musique, c’est le rythm and blues. Les roc-
kers, eux, sont bardés de cuir, les cheveux
gominés. Leurs idoles sont Chuck Berry et
Gene Vincent. Ces enfants d’ouvriers n’ont
pas tous fait sécession. Certains travaillent
comme leurs parents, mais tous adoptent
des comportements qui se manifestent
d’abord par la violence : ils se castagnent
entre eux, brisent des vitrines, écoutent des
musiques de “sauvage”. La jeunesse a fait
son apparition comme une catégorie sociale
autonome. Partout en Europe, elle s’insurge
et fait peur. “Presque tous les pays d’Eu-
rope découvrent le nouveau visage de leur
jeunesse : violente, immorale, désabusée”,
écrit Jean Monod, un des premiers eth-
nologues français à étudier le phénomène
des bandes (3). Des années cinquante aux
années soixante, “jeunes” ou “ados”, ont
acquis une existence propre, avec leurs
musiques, leurs modes de communication,
et leurs consommations de psychotropes.
Telles sont du moins leurs caractéristiques
dans les pays anglo-saxons.
Car l’association “Drogues et jeunes” a
longtemps été une spécialité américaine.
En France, l’alcool est longtemps restée
la seule drogue consommée. Sans doute
les blousons-noirs ou dorés en consom-
maient-ils sans modération, mais ni l’opi-
nion publique ni les premiers experts n’y
attachaient de l’importance, tant l’ivresse
alcoolique est banalisée en France. En mai
1968, seuls quelques hippies expérimentent
l’usage de cannabis. Ils sont alors très mi-
noritaires alors que ni les étudiants contes-
tataires ni les gauchistes ne consomment
(en principe !) de drogues illicites. Si les
parlementaires se décident à voter une loi
sur les stupéfiants en 1970, c’est qu’ils sont
persuadés que cette loi aura une fonction de
prévention : la sévérité de la loi protégera
la jeunesse française d’un phénomène qui
semble purement anglo-saxon.
Or ce n’est pas ce qui s’est passé. À peine la
loi a-t-elle été votée, que la consommation
de drogues illicites commence à se diffuser
dans cette nouvelle classe d’âge qu’est la
jeunesse.
Il s’agit essentiellement du cannabis, mais
comme dans les pays anglo-saxons, cer-
tains groupes de jeunes recherchent l’ivresse
par tous les moyens possibles. C’est ce que
constate le premier rapport officiel sur la
toxicomanie, le rapport Pelletier, publié en
1978 (4) : “à la toxicomanie accrochée à
un seul produit tend à se substituer une po-
lytoxicomanie associant plusieurs produits
ou sautant d’un produit au hasard des pos-
sibilités d’approvisionnement, de l’héroïne
aux amphétamines ou aux médicaments”.
Telle est, selon ce rapport, la principale ca-
ractéristique de “l’évolution actuelle de la
toxicomanie”.
Les spécialistes, consultés dans le cadre de
ce rapport, s’inquiètent du “caractère non
maîtrisé et sauvage” de ces nouveaux usa-
ges. D’autant que “la panoplie des drogues
ne cesse de s’accroître : avec des substan-
ces nouvelles beaucoup plus toxiques, dont
l’huile de cannabis, beaucoup plus riche
en principe actif, ou le PCP, nouvelle dro-
gue venue d’Amérique”. Parallèlement,
“des produits licites sont détournés de leur
usage (solvants, détachant)” constate le
rapport, et surtout “des médicaments uti-
lisés soit à doses massives soit en soupes,
mélangés au hasard et souvent associés à
l’alcool, dont l’usage accru paraît un des
éléments marquants des nouvelles formes
de toxicomanie”.
Le rapport Pelletier ne cherche pas à inquié-
ter l’opinion publique, bien au contraire.
Alors que la loi de 1970 justifie la sévérité
de la sanction (soit une année d’incarcéra-
tion pour usage) par la menace du fléau, les
spécialistes consultés de 1976 à 1978 re-
fusent de considérer la drogue comme une

Le Courrier des addictions (10) – n ° 3 – juillet-août-septembre 2008
21
menace. Le problème – car problème il y a
effectivement – n’est pas le produit, mais
la souffrance psychique ou l’inadaptation
sociale à l’origine de ces consommations.
Pour les experts, la consommation de dro-
gues illicites, comportement déviant plutôt
que délinquant, est devenue un des symptô-
mes de “la crise d’adolescence”.
Autres passages à l’acte comparables, se-
lon le rapport Pelletier, “l’errance, l’exas-
pération des conduites érotiques, certaines
conduites suicidaires, vandalisme, vols,
viols collectifs”. Toutes ces conduites trou-
vent leur origine dans “l’ennui, la pauvreté
des investissements affectifs, la perte d’idéal,
l’incapacité à supporter la frustration” (4).
De la crise d’adolescence
au comportement à risque
Le rapport Pelletier marque l’introduction
de la thématique de la drogue dans la pro-
blématique de l’adolescence. C’est une rup-
ture avec l’approche purement répressive
de la loi de 1970 qui fait du toxicomane
soit un malade soit un délinquant. La fin
des années 1970 se veut pacificatrice. Mai
68 en France avait fait fonction d’électro-
choc. Au lendemain, la classe politique
semble d’abord unanime : il faut rétablir
l’ordre social, restaurer les valeurs mora-
les qui fondent l’ordre républicain. Mais,
une fois l’ordre public garanti, les plus li-
béraux veulent comprendre cette flambée
soudaine. Loin d’être purement gratuite, la
contestation a une signification : “Manifes-
tement, la France n’a pas ouvert ses portes
aux jeunes générations […]” écrit le jour-
naliste Alfred Sauvy en 1970. “La révolte
des jeunes était prévisible, elle ne se limite
pas aux semaines de Mai 1968”. Enfermés
dans leurs certitudes, les adultes ont voulu
ignorer les bouleversements économiques
et sociaux, qui ont affecté la société depuis
la Seconde Guerre mondiale.
Considérer l’usage de drogue comme un
symptôme de la crise d’adolescence, c’est
adopter de fait une attitude compréhensive.
En témoigne la dépénalisation de fait de
l’usage de cannabis que préconise ce rap-
port. Alors que dans les années cinquante,
les bandes de jeunes font peur, le concept de
“crise d’adolescence” est élaboré au cours
des années 1960 par de nouveaux spécialis-
tes, psychologues, psychiatres, éducateurs,
qui s’attachent à comprendre ces compor-
tements apparemment irrationnels. Avec le
concept d’ordalie que proposent Marc Val-
leur et Aimé Charles Nicolas au début des
années soixante-dix, même les prises de ris-
ques les plus extrêmes perdent le statut de
pathologie mentale. S’affronter à ses pro-
pres limites, ce n’est pas chercher à mou-
rir, mais au contraire conquérir le droit de
vivre. Ces concepts explicatifs font appel à
plusieurs théories psychologiques, de Pia-
get à Freud, qui, pour convaincantes qu’el-
les soient, sont des interprétations qui ne
peuvent prétendre à la rigueur des sciences
dites “dures”. Elles peuvent être discutées
et restent entachées de subjectivisme.
Le concept de “comportements à risques”,
qui s’est imposé au cours des années 1990,
se veut plus rigoureux, celui épidémiolo-
gique purement objectif. Le regroupement
des différents comportements à risque est
justifié par les indicateurs quantitatifs de
la santé publique. Ainsi, les jugements de
valeur sensibles sous la formulation “exas-
pération des conduites érotiques” utilisée
dans le rapport Pelletier n’ont plus cours.
“Les comportements sexuels à risque”
correspondent à des infections sexuelles
transmissibles précises dont les risques sont
identifiés et quantifiés. Il en est de même
des comportements dangereux sur la route
ou des pratiques sportives à risques. La
consommation d’alcool fait désormais par-
tie de celle des substances psychoactives,
qu’elles soient licites ou illicites. Le concept
de comportement à risque se veut purement
descriptif. À la recherche des causes, s’est
substitué un modèle multifactoriel, qui re-
pose sur des méthodologies statistiques
dont la fiabilité est quantifiable. Identifier
les facteurs de risque, tel est l’enjeu de ces
nouvelles approches, qui permettront d’in-
tervenir le plus précocement possible dans
un objectif de prévention. L’expertise issue
de ces nouvelles approches semble d’autant
plus crédible que tous ces comportements
sollicitent également des neurotransmet-
teurs, autorisant l’hypothèse d’une base
biologique du concept de “comportements
à risque”.
De la science au stigmate
La crédibilité de cette nouvelle expertise
tient aussi au fait que dans le conflit inter-
générationnel, elle semble donner une base
scientifique – donc apparemment incon-
testable – à la peur des jeunes. Car la peur
des jeunes est récurrente. De génération en
génération, les discours sont étonnement
semblables : “Les jeunes d’aujourd’hui”
seraient victimes d’un mal-être à l’origine
de conduites agressives ou autodestructives.
Le manque de repère, l’absence d’idéal ou
de projet les conduiraient à “faire n’impor-
te quoi”. Ce serait d’autant plus inquiétant
que ces conduites seraient de plus en plus
précoces. Avec le concept de “comporte-
ment à risque”, ce discours n’est plus seu-
lement moral, il se veut fondé en science :
“C’est à force de voir des jeunes abîmés
dans leur développement, des familles en
souffrance majeure face à un mur invisi-
ble contre lequel elles butent que l’intuition
m’est venue : ces jeunes ont toutes les ca-
ractéristiques des patients ayant perdu les
fonctions hébergées par la partie antérieure
de notre cerveau, les aires préfrontales fon-
dant la différence entre l’homme et le singe”
tel est le discours tenu par le Dr Saladin,
auditionné comme expert par la commission
d’enquête sénatoriale en 2001. L’argumen-
taire fait référence à des données épidémio-
logiques, neurobiologiques, sans compter
des expériences biologiques menées en
laboratoire, données qui conduisent à incri-
miner “l’écoute excessive de musique, la té-
lévision, les images à connotation sexuelle,
le stress lié à la surmotorisation et, enfin, le
cannabis” (5). Comme le remarque Patrick
Peretti-Vatel, la croisade morale est de tra-
dition dans la lutte contre la toxicomanie.
Le détournement de résultat scientifique ne
remet pas nécessairement en cause les ré-
sultats eux-mêmes, mais, dans les sciences
sociales, la coïncidence de l’expertise avec
les peurs collectives implique nécessaire-
ment un retour réflexif : comment se fait le
glissement ?
Pour légitime que soit l’ambition d’une ap-
proche scientifique des comportements hu-
mains, la démarche se heurte à des limites
épistémologiques précises qui doivent être
identifiées. Nous en retiendrons deux : le
caractère multifactoriel des comportements
humains, en premier lieu. Certes, les études
épidémiologiques se veulent multifactoriel-
les. Le problème, c’est que les facteurs sont
hétérogènes. Il est aujourd’hui impossible
d’évaluer de façon quantitative le poids
respectif des variables personnelles, fami-
liales, environnementales et génétiques.
Comparer ces différents facteurs revient à
additionner une botte de carottes, un jarret
de veau et du cerfeuil. Voilà qui peut être de
bonne cuisine, mais la démarche scientifi-
que obéit à d’autres recettes.
Ce n’est pas un hasard si les études mul-
tifactorielles aboutissent à des conclusions
circulaires : les parents inadaptés, souffrant
de troubles mentaux, aux ressources précai-

Le Courrier des addictions (10) – n ° 3 – juillet-août-septembre 2008 22
res sont des facteurs de risque pour leurs
enfants. Autrement dit, il vaut mieux être
riche et bien portant que pauvre et malade !
Fallait y penser…
Seconde limite épistémologique : le risque
défini sur des critères objectifs ne tient pas
compte de l’évaluation subjective du ris-
que. Refuser de mettre un casque lorsqu’on
utilise un vélo est aujourd’hui une prise
de risque vécue comme telle par le jeune.
Ce n’était pas le cas, il y a peu. La prise
de risque volontaire n’a pas la même signi-
fication que la prise involontaire. Aucun
Français n’a le sentiment d’une prise de ris-
que inconsidérée lorsqu’il boit un verre de
vin à table. Nombre d’usagers de cannabis
n’ont pas plus d’inquiétude lorsqu’ils tirent
occasionnellement sur un joint lors d’une
fête. Peut-être ont-ils tort, mais quoi qu’il
en soit, éliminer le point de vue de l’acteur,
c’est-à-dire la signification que la personne
donne à ses actes, c’est éliminer la personne
elle-même.
Les facteurs individuels familiaux et en-
vironnementaux, qui peuvent induire des
conduites préjudiciables à la santé, sont
innombrables. S’ils sont relativement limi-
tés dans les études épidémiologiques, c’est
qu’ils sont sélectionnés en fonction des hy-
pothèses du chercheur. Ainsi, au début des
années 1970, plusieurs études épidémio-
logiques ont démontré la corrélation entre
l’usage de drogue et le divorce des parents.
La démonstration a été abandonnée avec le
développement des divorces et des familles
recomposées. Il n’y a aucune raison pour
que nous ne reproduisions pas le même
glissement aujourd’hui. Pour le moment,
la valeur des études statistiques qui décri-
vent le comportement humain est fonction
de la qualité des hypothèses du chercheur.
Quels que soient les progrès de la biologie
– il y en a de remarquables – nous n’avons
pas encore trouvé les moyens d’éliminer la
subjectivité de l’acteur, qu’il soit chercheur,
praticien ou patient. Le savoir, c’est se don-
ner les moyens d’une démarche rigoureuse,
dans la recherche en sciences sociales com-
me dans la clinique.
Interprétation des pratiques
festives et relations
intergénérationnelles
Les interprétations des pratiques festives
des jeunes sont en fonction des relations
intergénérationnelles. Lorsque le procureur
du tribunal de Bobigny s’inquiète de ce que
le jeune amateur de techno se transforme
en “fauve” pendant le week-end, il renoue
avec le mythe du loup-garou, qui tradition-
nellement cristallise les peurs ancestrales
de l’autre, du sauvage enfoui en nous “bru-
tal, vorace, prêt à resurgir” et que la com-
munauté se doit de réprimer (5). Des an-
nées cinquante à aujourd’hui, nous n’avons
cessé de balancer entre répression et com-
préhension. Stigmates et rejets ont été do-
minants jusqu’à ce que “les rebelles sans
cause” des années soixante trouvent majo-
ritairement leur place et fondent à leur tour
une famille. Aussi, les jeunes ont-ils acquis
un “droit à la fête”, qui, en principe, n’est
plus contesté. L’inquiétude que suscitent les
pratiques festives des jeunes d’aujourd’hui
tient en partie au trouble des relations inter-
générationnelles. Très conflictuelles dans les
années soixante, les relations intergénéra-
tionnelles s’étaient apaisées au cours des
années soixante-dix, tandis que les valeurs
d’autonomie se sont valorisées contre l’im-
position de normes sociales. La dépendance
économique d’une grande majorité de jeu-
nes introduit un trouble nouveau dans les
relations entre générations. C’est particu-
lièrement le cas des jeunes appartenant aux
couches populaires, enfants de l’aristocratie
ouvrière et des petites classes moyennes, qui
se sont appropriés en masse de nouvelles
pratiques festives. En l’absence de perspec-
tive d’intégration, la fête n’est pas seulement
un lieu et un espace-temps pour se “vider la
tête”, “se lâcher”, un défouloir nécessaire
face aux pressions sociales. Elle peut devenir
un mode de vie qui s’affirme comme alterna-
tif. Les logiques de dissidence s’affrontent à
celles d’intégration. Redoubler les processus
d’exclusion ou favoriser l’intégration des jeu-
nes sont les enjeux de la réaction sociale face
aux pratiques festives.
n
Références bibliographiques
1. Coppel A. Enquête exploratoire portant sur la
consommation de stimulants auprès des jeunes ha-
bitants des cités de la région parisienne. AFR-Sida
Parole. Pour la DGS, 2006
2. Bachmann C, Coppel A. Le Dragon domestique,
deux siècles de relations étranges entre la drogue et
l’Occident. Albin Michel, 1989.
3. Monod J. Les Barjots. Julliard, 1968 ; Hachette
Littérature, 2006.
4. Rapport de la mission d’étude des problèmes de
la drogue, présenté par Monique Pelletier. La Do-
cumentation française, 1978.
5. Peretti-Vatel P. Cannabis, ecstasy : du stigmate
au déni. Les deux morales des usages récréatifs des
drogues. L’Harmattan, 2005.
Les effets de la cocaïne sur le cerveau du fœtus
Une équipe de chercheurs des Instituts nationaux de la santé des États-
Unis (NIH) vient de montrer pourquoi l’exposition prénatale du cer-
veau du fœtus à la cocaïne provoque des troubles du comportement
et des anomalies neurologiques*. Selon ces chercheurs, cela serait dû à
l’interaction du métabolisme d’un des produits de la cocaïne avec une
protéine, qui, outre de provoquer l’apoptose de neurones cérébraux,
joue un rôle important dans la division cellulaire, ce qui en entraverait le
développement. Ils ont également démontré que la cimétidine (utilisée
pour traiter les ulcères de l’estomac et du duodénum) pouvait contre-
carrer l’inhibition de cette division cellulaire. Est-ce vraiment la seule
explication, et les conditions de l’expériences in vitro peuvent-elles être
transposées à celles de la “vraie” vie ? D’autres études sont nécessaires,
comme concluent si souvent les publications scientifiques…
* Lee CT, Chen J, Hayashi T, Tsai SY et al. A Mechanism for the inhibition of
neural progenitor cell proliferation by cocaine. PLOS Medicine 2008;5,6.
Cocaïne, la traînée de poudre
La MILDT s’inquiète de la progression importante de la consommation
de cocaïne dans tous les milieux sociaux. En 2005, plus d’un million de
personnes avaient essayé d’en consommer et 200 à 250 000 y recourent
régulièrement. 2, 6 % des 15-64 ans, et 3,9 % des 26-44 ans, ont déjà pris
de la cocaïne, et 3,2 % sont des usagers réguliers parmi les 18-25 ans (ils
étaient 22 % en 2000)*. Cette hausse inquiétante de la consommation de
cocaïne depuis trois ans est le fruit d’une augmentation importante de
l’offre, dont les réseaux de trafic ont chaussé les bottes de ceux du can-
nabis, et à la baisse des prix qui rend la drogue abordable par (presque)
tous : 60 E le gramme en moyenne contre 125 E en 1998 (parfois même
40 E dans certaines cités). Les cartels sud-américains ont bel et bien jeté
leur dévolu sur les marchés européens, via l’Afrique de l’Ouest.
Chiffres de l’OFDT, 2005.
P.d.P.
Brèves
1
/
4
100%