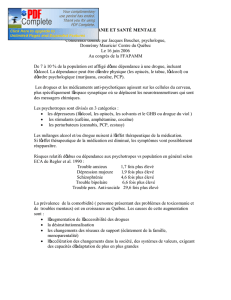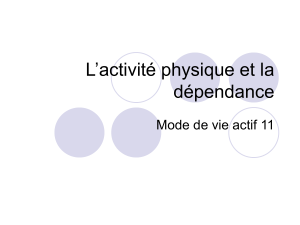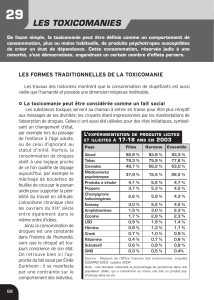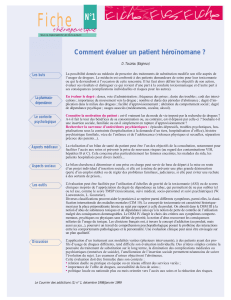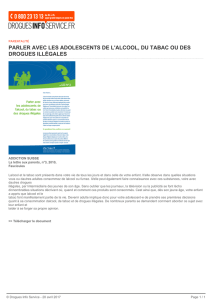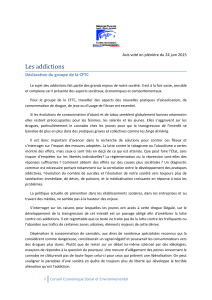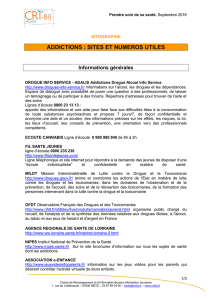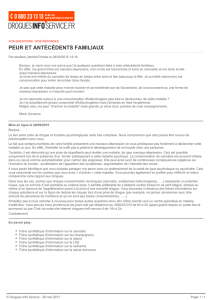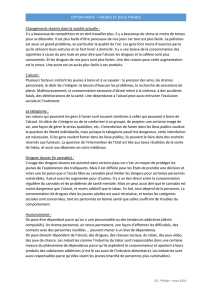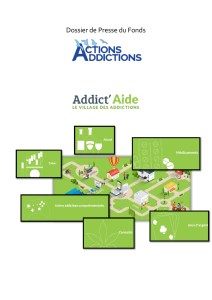Culture(s) et toxicomanies : l`apport de l`anthropologie

Le Courrier des addictions (11) – n ° 4 – octobre-novembre-décembre 2009 28
I
n
f
l
u
e
n
c
e
s
i
n
f
l
u
e
n
c
e
s
I
n
f
l
u
e
n
c
e
s
Culture(s) et toxicomanies :
l’apport de l’anthropologie
Anthropological data about drug addictions
Robert Berthelier*
Sachant qu'il n'y pas de culture sans drogue(s), les anthropologues
se sont de longue date intéressés à la consommation de substances
psychoactives dans les différents types de sociétés, traditionnelles
comme industrielles. Ils estiment, à tort ou à raison, que les
problématiques qui les sous-tendent pourraient aider à
comprendre l'essor des toxicomanies dans notre culture. Éclairage…
* Psychiatre, 5, allée des Cailles, 91210 Draveil.
UNE MACHINE À ORDONNER
LA JOUISSANCE
H. B.M. Murphy avait, en 1987, posé le cadre
général de la question : "Bien qu’il soit géné-
ralement acquis que la toxicomanie résulte
de la rencontre entre la possibilité de se pro-
curer de la drogue et une attirance personnelle
– ce qui rejoint l’aphorisme fameux de Claude
Olivenstein, pour qui elle naît de la rencontre
entre un produit, un sujet et un moment so-
cio-culturel –, il existe de nombreuses sociétés
dans lesquelles les drogues sont disponibles et
dont les membres sont ni plus ni moins équi-
librés qu’ailleurs, mais dans lesquelles l’abus
des drogues présentes sur le marché est rare….
Les facteurs socio-culturels doivent donc être
considérés comme jouant un rôle important
dans la répartition mondiale de l’usage et de
l’abus des drogues et, parmi les variables re-
pérables, celles d’essence culturelle sont plus
importantes que celles purement sociales". Un
certain nombre de données semblent pou-
voir être considérées comme acquises. Elles
concernent essentiellement le but recherché à
travers la consommation du produit et le choix
de celui-ci.
La plupart des toxicomanies actuelles ont une
origine ancienne et ont été d’abord des moyens
utilisés pour obtenir soit une "intoxication re-
ligieuse" dans les sociétés naguère qualifiées de
primitives (kawa, haschich, peyotl, boissons
fermentées et même le tabac dans une secte
brésilienne et certaines tribus indiennes d’Amé-
rique du Nord), soit des "ivresses divines" chez
A short review of some anthropological data about drug addictions shows that cultural or social
factors implicated in these behaviours can give informations for preventive policies but not for in-
dividual therapies. However, they give prominence to importance of cultural changes and of lace-
rations of social fabric.
les peuples indo-européens (soma des Hin-
dous, ivresse dionysiaque).
Il en va ainsi du peyotl, utilisé au Mexique de-
puis des temps immémoriaux et, aujourd’hui
encore, dans la religion qui porte son nom,
chez certaines tribus amérindiennes. L’eth-
nologue Mario Benzi (1) l’a étudiée chez les
Huichols en Amérique du Nord. Le peyotl est
utilisé comme produit sacré et son principe
actif, la mescaline, drogue hallucinogène, est
censée procurer une expérience communau-
taire et religieuse d’où l’on sort spirituellement
édifié. L’important est que la drogue n’est pas
consommée de façon habituelle en dehors des
cérémonies rituelles et que son utilisation est
étroitement contrôlée par les chamans de la
tribu. C’est une des raisons qui a permis à la
législation américaine, en 1964, de considérer
le culte du peyotl comme une religion et non
comme une toxicomanie. C’est aussi classi-
quement le cas, au Proche-Orient, du canna-
bis chez les "haschischins", adeptes nizârites
de la secte des Ismaéliens, en Syrie. L’histoire
plus ou moins légendaire du "Vieux de la mon-
tagne", a permis à l’orientaliste Sylvestre de
Sacy, au XIXe siècle, d’en faire l’étymologie du
mot "Assassin" et de le transformer en herbe
du crime, alors que son usage initial était bien
de l’ordre du sacré.
Au XVe siècle, le cheikh soufi Haider en fera
une drogue réservée aux fakirs, considérée
comme une faveur divine : "Les vertus de cette
plante dissiperont les soucis qui obscurcissent
vos âmes et dégageront vos esprits de tout ce
qui peut en ternir l’éclat" (2). Le cannabis sera
répandu dans le monde musulman au niveau
des confréries qui en feront usage dans un but
religieux ou thérapeutique pour accélérer les
états extatiques et produire la transe : c’est
ainsi qu’en Turquie, les derviches tourneurs ab-
sorbent, avant les répétitions des noms divins,
un mélange de haschich et de yaourt.
Ce qui apparaît ici, au premier chef, est l’usage
religieux et limité initial de bon nombre de
drogues, renvoyant au fait que la religion
possède de fonction régulatrice, apparais-
sant, selon une expression utilisée par Gérard
Pommier, comme "une machine à ordonner la
jouissance".
LA LAÏCISATION DES DROGUES
Toutefois, la majorité des produits ont été
désacralisés. Ils se sont, en quelque sorte, laï-
cisés, passant dans le domaine des habitudes
sociales, souvent utilisés pour "soulager la mi-
sère et la faim, et rendre la vie un peu moins
intolérable" (3). C’est le cas par exemple de la
mastication de la feuille de coca au Pérou et
en Bolivie.
Par ailleurs, les facteurs culturels se rappor-
tant aux croyances et aux rites associés à la
consommation de ces produits renvoient aux
mythes de la culture d’appartenance. L’action
du toxique semble dépendre alors de facteurs
aussi divers que le style de consommation ou
même, dans certains cas, d’un effet placebo
qui rend souvent difficile de distinguer, dans
son activité, ce qui revient à la psychopharma-
cologie et ce qui procède d’une autosuggestion
collective dictée par les croyances : ce pourrait
être le cas, par exemple, du produit de la secte
du tabac (Brésil, etc.).
L’alcool, pour sa part, pose un problème
un peu particulier dans la mesure où, chez
nombre de peuples, son usage est resté
ignoré jusqu’à une date relativement récente.
Sa consommation est toutefois attestée depuis
la plus Haute Antiquité. Dans les sociétés qui
l’utilisent, l’alcoolisme a connu des phases
successives de progression et de régression
renvoyant à des facteurs socio-économiques
et culturels: la principale fonction de l’alcool
dans les cultures traditionnelles serait de sou-
lager les tensions anxieuses, renforcer les liens
sociaux, parfois permettre l’expression d’une
agressivité habituellement réprimée (4). Les
manifestations provoquées par la surconsom-
mation varient d’une population à l’autre et
suggèrent que le comportement de l’homme
ivre est appris, déterminé par la société d’ap-
partenance qui définit également les limites
imposées aux conduites déviantes (5).
Ainsi, dans l’Himalaya, chez les Lepchas,
l’ivresse détermine une suspension temporaire
de tous les tabous sexuels, à l’exception de l’in-
ceste. Dans de nombreuses sociétés, des pé-
riodes d’exception – comme le carnaval dans
notre culture – autorisent temporairement
des conduites normalement interdites.

Le Courrier des addictions (11) – n ° 4 – octobre-novembre-décembre 2009
29
I
n
f
l
u
e
n
c
e
s
i
n
f
l
u
e
n
c
e
s
I
n
f
l
u
e
n
c
e
s
Cela étant, on ne peut réduire la probléma-
tique de l’alcoolisme aux seules données eth-
nologiques, car nombre d’autres variables
opérantes, individuelles ou collectives, inter-
viennent et doivent être prises en compte.
QUEL(S) TOXIQUE(S) ?
En règle générale, le choix du toxique se porte
sur la drogue la plus facile à se procurer, celle
qui est présente sur le marché, même si cer-
tains groupes ethniques et/ou culturels im-
posent des discriminations entre produits.
G.M. Carstairs (6) cite ainsi l’exemple de deux
castes coexistant dans un village du nord de
l’Inde: les Brahmanes, en tête de la hiérarchie
spirituelle, se voient interdire l’usage de l’alco-
ol mais s’enivrent souvent avec le bhang, infu-
sion de chanvre procurant une ivresse consi-
dérée comme une aide à la méditation solitaire
prescrite par la religion. Les Rajputs, guerriers
et propriétaires fonciers, consomment le
daru, liqueur fortement alcoolisée, ab-réactif
bienvenu dans une existence caractérisée par
des fortes tensions et des conflits, qui soulage
leur anxiété.
Dans l’ensemble, cependant, chaque popula-
tion utilise simplement la drogue qui lui est la
plus familière : ce fut l’opium en Chine – lar-
gement répandu par l’Inde, pays producteur
et exportateur, alors sous domination britan-
nique – ou dans l’ex-Indochine française, où
les autorités coloniales contribuèrent large-
ment au progrès de sa consommation. C’est
le khat au Yémen, le kif au Maroc, l’alcool,
auquel on pourrait sans doute ajouter au-
jourd’hui le cannabis en France...
Toutefois, ces types de consommation ritua-
lisés et strictement codifiés de substances
psychoactives dans les sociétés traditionnelles
ne sont pas des toxicomanies : on sait par
exemple que seule une très faible proportion
des utilisateurs indiens de la feuille de coca en
Amérique du Sud deviennent des "coqueros" et
développent une authentique dépendance au
toxique.
On pourrait ajouter que, chez nous, les cancé-
reux porteurs d’une pompe à morphine dans
un but antalgique n’évoluent qu’exceptionnel-
lement vers une addiction aux opiacés. On
est ici, de toute évidence, dans le registre de
l’usage simple (rechercher un soulagement et
non la "défonce"), non dans celui du nocif ou
de l’abusif.
DE L’USAGE À L’ABUS
C’est donc hors de ces processus de consom-
mation limités et ritualisés des sociétés – tra-
ditionnelles ou non – qu’il faut rechercher les
facteurs des toxicomanies d’aujourd’hui, avec
leur caractère massif et planétaire. H.B.M
Murphy (7) en cite quelques-unes : globale-
ment, la consommation de drogues est plus
fréquente dans les sociétés ou cultures valo-
risant l’individu aux dépens des valeurs grou-
pales, où tout facteur réduisant la cohésion
sociale favorise l’émergence des conduites
addictives. Il me semble que c’est ce que vi-
vent aujourd’hui les sociétés industrielles ou
en voie d’industrialisation dans le contexte
politico-socio-économique actuel. Christian
Bachmann et Anne Coppel (8) notent ainsi
qu’une authentique religion révolutionnaire
s’est un temps édifiée autour du cannabis,
mais que "le culte est mort et l’emploi, désor-
mais laïque, est conforme à une société où
prévalent le pragmatisme, l’individualisme et
l’esprit d’entreprise".
Les situations de dominance inter-ethniques
ou internationales font augmenter de façon
spectaculaire, dans la société dominée, la
consommation de drogues, et en particulier
d’alcool. Cela perdure jusqu’à ce que le groupe
ait pu s’adapter – au moins relativement – à la
nouvelle situation, soit en intégrant certaines
caractéristiques de la nation dominante, soit
en modifiant son système de valeurs : entre-
temps, les membres de la culture dominée ont
recours à une échappatoire leur permettant de
ne pas se rendre à une évidence pénible. Ce-
pendant, "ce seront les caractéristiques de la
situation culturelle locale qui pourront déter-
miner s’il y aura ou non un recours à la dro-
gue, même s’il existe un problème général de
déstabilisation ou une confrontation avec une
puissance dominante" (2).
C’est ainsi que, lorsque la Chine conquit
Taiwan, les tribus aborigènes des montagnes,
confrontées à la culture de la nation domi-
nante, ont traversé une période d’alcoolisme
massif, et ce jusqu’à leur intégration dans la
nouvelle société. En revanche, en Indonésie,
dans une situation similaire, il n’y a pas eu de
recours à la drogue chez les bouddhistes de
Ceylan, dont les valeurs principales étaient
avant tout spirituelles.
Exemple très actuel et presque caricatural :
la flambée des toxicomanies à l’héroïne en
Palestine, supplantant la consommation tra-
ditionnelle de cannabis. Les individus et les
familles s’y trouvent confrontés à la fois à un
affrontement avec Israël, nation technologi-
quement, économiquement et politiquement
dominante, et à la situation socio-économique
catastrophique qui en découle. Les deux fac-
teurs se conjuguent pour faire le lit de la toxi-
comanie, via la déculturation et la marginali-
sation croissantes sans cesse plus importantes
de la population. Parallèlement, Israël, nation
aussi en situation d’insécurité permanente,
connaît le même phénomène : il semble bien
qu’il soit alors la résultante des tensions in-
ternes au sein d’une société israélienne très
loin d’être homogène (9).
L’évolution technologique et son retentisse-
ment croissant sur l’emploi sont un exemple
de la relation entre usage de drogues et chan-
gement culturel. À partir du moment où l’ab-
sence de travail, la précarité de l’emploi et la
paupérisation entraînent la perte des satisfac-
tions que la culture nous a appris à rechercher,
le risque est patent que les couches les plus
éprouvées de la société se tournent vers les
drogues qui peuvent offrir une compensation
illusoire.
Il est assez facile de trouver des exemples il-
lustrant ces diverses données : Christian
Bachmann et Anne Coppel (8) ont largement
évoqué la véritable épidémie de toxicomanies
au laudanum survenue au XIXe siècle dans une
Grande-Bretagne en cours d’industrialisation
et de prolétarisation. Au Canada, on a vu flam-
ber l’alcoolisme dans les localités dont l’écono-
mie reposait sur une industrie unique lorsque
celle-ci venait à disparaître.
D’une manière générale, la montée des addic-
tions, aux produits licites aussi bien qu’illicites,
avec celles du chômage, de la précarité et des
incertitudes sur l’avenir illustre bien, en Europe
occidentale et orientale, l’impact des boulever-
sements sociaux sur les comportements.
Il est à signaler que même des changements
pouvant a priori être tenus pour bénéfiques
sont susceptibles d’avoir le même effet. C’est
ainsi qu’en Jamaïque, la poussée encore ré-
cente des addictions à la cocaïne, paraît être
au moins en partie liée au succès de la mu-
sique reggae. Il a offert à toute une partie de
la population une chance de renommée et de
carrière internationale, suscitant une florai-
son de groupes musicaux. Leur prolifération,
la compétition entre eux pour l’obtention de
contrats, la dépense psychologique et phy-
sique des répétitions et des représentations
ont conduit à l’utilisation de cette drogue psy-
choactive stimulante (2).
En première ligne,
la souffrance
Au total, les données apportées par l’anthro-
pologie peuvent se résumer ainsi : dans les
cultures traditionnelles, la consommation des
drogues est limitée et ritualisée, intégrée à
un système de valeurs – morales, religieuses,
sociales, etc. –, et très souvent considérée
comme facilitant la sociabilité. Mais il s’agit
d’usage de drogues, pas de toxicomanies.
Cependant, l’évolution technologique, l’exis-
tence de situations de dominance politique
et/ou socio-économique, la prolétarisation,
le chômage et, plus globalement, tout ce qui
contribue à fragiliser ou déchirer le tissu so-
cial, précarisant ou déniant les normes et va-
leurs traditionnelles, favorisent l’apparition
des conduites d’addiction.
Cet apport de l’anthropologie, toutefois, se
décline avant tout à l’échelon collectif, grou-
pal. Il décrit des facteurs de risque globaux

Le Courrier des addictions (11) – n ° 4 – octobre-novembre-décembre 2009
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
Nouvelles conduites addictives
chez les jeunes
vL’équipe du service de psychiatrie de l’hôpital Saint-Antoine
à Paris (C. Debacq, C. Agbokou, P. Nuss) a choisi ce thème
de communication lors des derniers Entretiens de Bichat.
Bilan : depuis 2006, le cannabis est le produit le plus consommé
en France, particulièrement chez les jeunes, "malgré une baisse des
niveaux d’usage depuis 2002, après dix ans de hausse continue. En
2007, 5 % des garçons et 2 % des filles en déclarent à 16 ans un usage
régulier. Par ailleurs, le retour de l’héroïne se confirme et la cocaïne
est plus disponible". À 17 ans, c’est respectivement 15 % et 6,3 %.
Reste que les jeunes consomment toujours beaucoup d’alcool et de ta-
bac : 12 % des jeunes de 17 ans déclarent en boire (17,7 % des garçons
et 6,1% des filles), 33 % en fument dont 33,6 % des garçons et 32,3 % des
filles de cette classe d’âge. Bien sûr, leur consommation de tabac a tout
de même également baissé, comme celle de cannabis. En revanche, celle
d’alcool a augmenté entre 2003 et 2007, mais est restée globalement
stable si l’on remonte à 1999. Dans ce contexte, les filles sont de plus en
plus représentées parmi les consommateurs de moins de 20 ans de bois-
sons alcoolisées. Et, comme de nombreux observateurs l’ont remarqué,
"la pratique du binge drinking chez les jeunes adolescents est devenue
préoccupante, quoique assez rare".
Enfin, à 16 ans, la polyconsommation régulière, "pharmacodépendance
simultanée à de nombreuses sortes de produits, apparaît nettement plus
répandue que la poly-expérimentation. En 2007, 1 adolescent âgé de 16
ans sur 9 reconnaissait n’avoir jamais consommé ni alcool, ni tabac, ni
cannabis au cours de sa vie".
C. Debacq en appelait, en conclusion, au renforcement des actions de pré-
vention en addictologie chez les jeunes et des efforts de recherche fonda-
mentale et clinique dans le domaine de l’ensemble des troubles addictifs.
États-unIS, la guerre au tabac
marque le pas
vLa prévalence du tabagisme aux États-Unis n’a pas changé ou
presque, depuis 2004 et encore moins entre 2007 et 2008, en
dépit des intenses campagnes menées dans ce pays. L’an pas-
sé, 46 millions d’adultes américains (20,6 %) fumaient contre 20,9 %
quatre ans plus tôt. Parmi ceux-ci, près de 80 % fumaient tous les
jours (36,7 millions), et les autres (9,3 millions), seulement certains
jours de la semaine.
Tabac + alcool = cancer aéro-digestif
vLes cancers aéro-digestifs, bien connus des spécialistes, le
sont beaucoup moins du grand public, alors qu’ils représen-
tent le cinquième cancer le plus important en nombre après
celui du sein, du poumon, de la prostate et du côlon. En effet, l’alcool
et le tabac sont les principaux facteurs de risque de développement
d’une tumeur maligne dans la cavité buccale. D’où la communica-
tion faite sur ce thème à Paris lors des 35es Entretiens dentaires
de Garancière. Le dentiste est souvent le premier à diagnostiquer
cette pathologie, car il est l’un des seuls praticiens à regarder dans la
bouche. Son rôle est donc essentiel dans le dépistage mais aussi dans
la prévention et l’orientation du patient vers des praticiens compé-
tents pour mettre en route rapidement les traitements.
P. de Postis
30
et ignore – car ce n’est pas de son domaine
– bon nombre de variables opérantes au ni-
veau individuel, c’est-à-dire ce sur quoi nous
sommes, en tant que soignants, amenés à in-
tervenir. En cela, il ouvre probablement des
pistes, voire fournit même quelques clefs, en
vue de la mise en œuvre de politiques de pré-
vention. Toutefois, il ne semble pas offrir de
données réellement efficaces pour la prise en
charge individuelle/individualisée des toxi-
comanes, sinon, peut-être, dans une pers-
pective purement comportementaliste. C’est
cela, qui définit sa contribution en termes de
compréhension globale du phénomène et,
dans le même temps, marque ses limites.
On ne saurait évidemment ignorer qu’outre
les déchirures du tissu social, les formidables
flux financiers mobilisés par le trafic de dro-
gues (estimés en 2007 à 243 milliards d’euros
annuels, soit à peu près le PIB de la Suède),
ce facteur très objectif qu’est la faim dans le
monde, les déplacements massifs de popu-
lation auxquels nous assistons, s’ajoutant à
tout ce qui, au niveau personnel, induit une
incertitude identitaire, favorisent chez le
sujet l’émergence de pulsions orales dont té-
moignent les conduites addictives. Mais cela
me paraît aussi un peu contradictoire avec
l’idée d’une étiologie purement culturelle de
l’abus des drogues et amène à penser qu’il est
sans doute préférable de prendre en compte
une autre dimension, individuelle ou collec-
tive, qui est celle de la souffrance toujours
présente, la toxicomanie apparaissant alors,
selon l’expression de Jean-Pierre Jacques,
moins comme une recherche de plaisir que
comme celle d’un moindre déplaisir (10).
Ce qui est d’abord en jeu, nous le savons bien,
est une trajectoire/histoire/biographie per-
sonnelle singulière qui, au gré de ses aléas,
vient en permanence modifier, remodeler,
les stéréotypes culturels. Et c’est peut-être ici
qu’il est bon de se remémorer que, si Jacques
Lacan (11) a énoncé que "l’on ne saurait mé-
connaître les appartenances symboliques d’un
sujet", Albert Tatossian a prolongé cet apho-
risme par: "Les faits psychopathologiques sont
hors culture car ils sont porteurs d’une signifi-
cation individuelle" (12).
v
I
n
f
l
u
e
n
c
e
s
i
n
f
l
u
e
n
c
e
s
I
n
f
l
u
e
n
c
e
s
Références bibliographiques
1. Benzi M. Les derniers adorateurs du peyotl. Paris:
Gallimard, 1972.
2. Hamza M. Existe-t-il une spécificité de la toxico-
manie des Maghrébins de la deuxième génération ?
Reims : èse de doctorat en médecine, 1995.
3. Ellenberger HF. Les toxicomanies. Encyclopédie
Médico-Chirurgicale –Psychiatrie – 1978;37725:C¹º
4.
4. Horton D. e function of alcohol in primitive so-
ciéties. Quart J Stud Alcohol 1943;4.
5. Mac Andrew C, Edgerton RB. Drunken comport-
ment: a social explanation. Chicago : Aldine, 1964.
6. Carstairs GM. Daru and bhang – Cultural fectors
in the choice of intoxicants. Quarter J. Stud Alcohol
1954;15:220-37.
7. Murphy HBM. Cultures et toxicomanies. Confron-
tations Psychiatriques 1987;28:123-40.
8. Bachmann C, CoppeL A. La drogue dans le monde.
Paris : Seuil, coll. Point Actuel, 1991.
9. Berthelier R. Toxicomanie en Palestine. Le Cour-
rier des Addictions 2001 ; 3, 2 : 85-7.
10. Jacques JP. Pour en finir avec les toxicomanies.
Bruxelles : De Boeck, 1999.
11. Lacan J. Les écrits techniques de Freud, livre 1.
Paris : Seuil.
12. Tatossian A. Culture et psychiatrie. In Psychiatrie
phénoménologique. Paris : Alcan, 1997.
1
/
3
100%