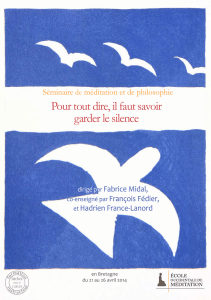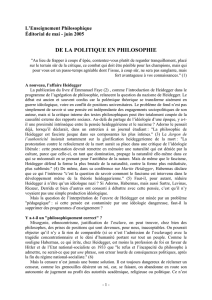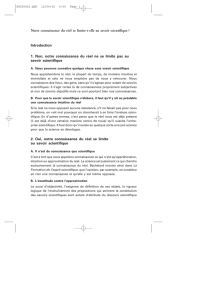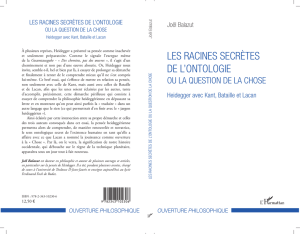Philosophie et biologie dans un esprit de “coopération”

Philosophie et biologie dans un esprit de “coopération”
Miguel de Beistegui
Dans une conférence faite à Athènes en 19671, Heidegger reprend à son
compte un mot de Nietzsche, selon lequel « ce n’est pas la victoire de la science,
qui caractérise notre dix-neuvième siècle, mais la victoire de la méthode
scientifique sur la science »2, et voit dans l’avènement de la cybernétique
l’aboutissement d’une telle victoire. Par « méthode », dit-il, il faut entendre le
projet qui d’avance a prise sur le monde, soit la façon et la manière dont d’emblée
un domaine d’objets est délimité dans son objectivité. Or aujourd’hui, poursuit-il,
c’est l’étant dans son entier qui est soumis à un projet unique, projet de calcul et
de contrôle. Les sciences elles-mêmes lui sont assujetties. C’est même en cela
qu’elles sont devenues techno-sciences. Si la cybernétique constitue bien
l’aboutissement de cet esprit de méthode, dont les origines remontent à Galilée et
à Newton, c’est bien dans le sens où la caractéristique fondamentale de tous les
processus calculables est la commande au moyen de laquelle l’information est
échangée. Dans la mesure où le processus qui est commandé renvoie de
l’information à celui qui le commande, la commande a le caractère de la
rétroaction (feedback). Cette circularité de l’information, et la nécessité de la
contrôler, est le caractère fondamental du monde que projette la cybernétique.
En traitant tous les systèmes comme des systèmes d’information, la
cybernétique unifie l’étant dans son ensemble – réalisant ainsi le vieux rêve
métaphysique de la mathesis universalis – et va jusqu’à abolir les différences
entre l’animé et l’inanimé, entre la machine et le vivant. C’est peut-être sur les
sciences du vivant, de la bio-chimie et de la bio-physique en particulier, que
l’impact de la cybernétique a été le plus grand3. Les gènes sont considérés comme
la source de l’information, et le poste de commande, à partir duquel les
organismes se développent et se reproduisent. Dans la même conférence, et dans
ce qui s’avère être un compte-rendu précis et bien informé de l’état des
1. « La provenance de l’art et la destination de la pensée », trad. de l’allemand par Jean-Louis Chrétien
et Michèle Reifenrath in Martin Heidegger, Paris, Éditions de l’Herne, 1983, p. 84-92.
2. F. Nietzsche, La volonté de puissance, 466.
3. Ces dernières années ont vu la naissance d’une discipline appelée « biologie informatique »
(computational biology), et dont les chercheurs sont formés en biologie comme en science
informatique. De plus en plus, la biologie se tourne vers les phénomènes informatiques
d’« intégration » et de « comportement systémique » afin de comprendre le système cellulaire.

MIGUEL DE BEISTEGUI
120
recherches biologiques de l’époque, Heidegger évoque la façon dont cette
recherche permet à la communauté scientifique de dépasser l’idée de
« préformisme » (selon laquelle le gène contiendrait l’organisme à venir sous
forme miniature, comme une sorte de germe) et d’adopter une position plus
épigénétique (selon laquelle les gènes stockent l’information nécessaire au
développement de l’organisme). À partir de là, on envisage les gènes comme un
alphabet (l’« alphabet des nucléotides »), ou bien encore un code, dont la
séquence définit un organisme donné. Et très naturellement, on en vient à voir la
vie elle-même comme un « livre », comparable au livre géométrique de la nature
qui faisait l’admiration de Galilée à l’aube de la physique moderne. A cette
différence près, conviendrait-il d’ajouter, que le livre de la vie a trouvé le moyen
de transmettre son information d’un système à l’autre, et ainsi d’évoluer. Il s’agit
d’un livre écrit selon un code qui lui est propre et qui lui permet de se reproduire
et de s’inventer à mesure qu’il évolue. Le code génétique de l’information,
enchaîne Heidegger, témoignant ainsi de sa connaissance des débats de l’époque,
est comparable à un « programme » informatique1. Qu’on parle de programme,
ou simplement de code, ne change rien à l’idée fondamentale d’Heidegger, qui
consiste à indiquer comment, sous l’influence de la cybernétique, la biologie a vu
ses concepts fondamentaux s’éloigner de ceux de la physique (« masse »,
« énergie », « force ») et adopter ceux de la science informatique (« information »,
« contrôle », « traduction » et « transmission », « codage » et « recodage », « auto-
régulation » et « rétroaction »). Ce faisant, c’est la spécificité du vivant, et de
l’homme dans son rapport à lui et à l’étant dans son ensemble, qui est effacée. Si,
comme le disait Wiener2, l’homme n’est qu’un support d’information comme un
autre, et dont la singularité, à savoir le langage, peut-être à son tour calculé et
modellisé, et si la science est tout entière sous l’emprise du projet cybernétique
ainsi défini, alors la philosophie, en tant qu’elle vise à penser l’essence de la
science et le destin de l’homme, n’a rien à attendre ni de la science ni du projet
cybernétique qui l’encadre. Il n’en fut pas toujours ainsi, cependant.
Une fois au moins, Heidegger aura envisagé la possibilité d’un véritable
dialogue avec les sciences de la nature. Assurément, un tel espoir fut formulé
avant que le diagnostic historico-destinal concernant la provenance
essentiellement technique de la science moderne ne fût prononcé dans les années
1. Sans vouloir ici rentrer dans le débat concernant la justesse de l’idée de programme, aujourd’hui
contestée, et non seulement de code génétique, contentons-nous de mentionner le fait qu’une telle
idée, formulée par le biologiste Ernst Mayr, et reprise ensuite par François Jacob et Jacques Monod,
remonte au début des années 1960.
2. Norbert Wiener, The Human Use of Human Beings. Cybernetics and Society, Garden City, New
York, Doubleday Anchor Books, 1950-1954, p. 74 sq.

PHILOSOPHIE ET BIOLOGIE CHEZ HEIDEGGER
121
30 et ne vînt sceller le destin des sciences aux yeux de Heidegger. Ce n’est donc
que rétrospectivement, et en ignorant ce diagnostic, ou bien en voulant le
remettre en question, que cet espoir pourra continuer d’être entretenu. Par
ailleurs, on notera aussi qu’il fut formulé après que Heidegger eut envisagé la
philosophie comme science fondamentale dans les années 20, soit comme science
visant l’être de cet étant positif et d’emblée donné sur lequel portent les sciences
positives, et que toujours elles présupposent. C’est donc très précisément entre la
période de l’ontologie fondamentale, soit celle consacrée à l’élaboration d’une
science de l’être de l’étant, et celle de la pensée méditante, qui s’ouvre à l’être
dans son déploiement historico-destinal, que Heidegger envisagea la possibilité
d’un véritable dialogue entre les sciences positives et la philosophie. Moment tout
à fait singulier dans l’itinéraire de cette pensée, et qui mérite qu’on s’y arrête.
D’autant plus singulier, convient-il de souligner, que cet esprit de coopération
avec les sciences intervient dans un cours qui, s’agissant de la tâche et du destin
de la pensée philosophique, commence par reléguer la science à un rôle
subalterne, notamment par rapport à celui auquel peut aspirer l’art1. L’intérêt et
la richesse de ce cours tiennent en partie au bouillonnement et à l’effervescence
de la pensée d’Heidegger à cette époque (1929-1930), qui semble encore indécise
sur un certain nombre de points, et notamment sur la nature du rapport de la
philosophie à l’art et la science. En effet, après avoir limité la science à ce rôle de
« servante » au début du cours, Heidegger en vient, dans la dernière partie du
cours et à propos du concept de « monde », à poser les fondements d’un rapport
authentique et productif à la zoologie et la biologie de l’époque. Il convient par
conséquent d’emblée de préciser la nature de cet esprit de coopération, en
soulignant qu’il ne s’applique pas à toutes les sciences, du moins pas a priori ou
par principe, mais bien à celle du vivant, et ce à partir d’une problématique
proprement philosophique (celle du « monde » comme accès au Dasein humain).
C’est donc que celui-ci témoigne d’une singularité que les autres sciences
ignorent, et sur la base de laquelle une véritable rencontre avec la philosophie, à
l’époque encore dans le sillage de l’ontologie fondamentale, devient possible.
La question générale dont traite la dernière partie du cours de 1929-30 est
celle de la différence entre ce que d’ordinaire on appelle le « monde » de l’animal,
et celui de l’homme. Ont-ils le même sens? Ou bien le monde de l’homme, ce
monde qu’Être et temps décrivait de façon aussi précise et sytématique diffère-t-il
essentiellement de celui de l’animal? On peut s’interroger, après tout, sur la
1. M. Heidegger, Die Grundbegriffe der Metaphysik. Welt–Endlichkeit–Einsamkeit, Gesamtausgabe
Band 29/30, p. 7 ; trad. Daniel Panis. Les Concepts fondamentaux de la métaphysique.
Monde–Finitude–Solitude, Paris, Gallimard, 1992, p. 21. Désormais GA 29/30, suivi de la pagination
allemande et française. Nous modifions la traduction par endroits.

MIGUEL DE BEISTEGUI
122
validité d’une telle distinction d’essence: l’homme n’est-il pas lui-même un
animal ? Saurait-on, dès lors que se pose la question de la différence de l’homme
et de l’animal en termes de « monde », ignorer le fait que l’homme n’est peut-être
rien de plus qu’un système nerveux particulièrement développé, un super-
neocortex adjoint à un cerveau reptilien, et qui partage un monde avec d’autres
vivants ? Heidegger envisage-t-il réellement de distribuer la vie selon des lignes
départageant l’humain de tous les autres organismes, de l’amibe aux types les
plus évolués de mammifères, avec lesquels on sait que l’homme partage une
histoire, un héritage, un code ? Se pourrait-il que la possibilité même de la
philosophie envisagée comme ontologie soit ancrée dans une distinction aussi
peu ferme et assûrée, et si constamment assiégée par une quantité de données
empiriques, que celle de l’homme et de l’animal ? Peut-on déclarer la philosophie
par principe et a priori immunisée contre de tels assauts, contre la menace de
déterminations empiriques et ontiques ? Nous verrons comment Heidegger lui-
même se débat dans ces questions, et la réponse qu’il leur apporte. Pour être plus
précis, nous verrons comment le dialogue qu’il entame avec la biologie découle
précisément de la difficulté – mais en même temps de la nécessité – qu’il y a de
maintenir séparés l’ordre transcendental et l’ordre empirique, l’ontologique et
l’ontique. Le terme de métontologie, qui caractérise le projet heideggerien des
années 1929-1930, vise précisément à signaler ces difficultés, en proposant de
faire retour sur la façon dont la transcendance de l’existence est à l’œuvre dans
l’élaboration même du projet de l’ontologie fondamentale, sur la façon dont cette
tâche est à la fois rendue possible et limitée par la manière dont l’existence y est
impliquée. Cela signifie que la philosophie, ou ce que Heidegger appelle à
l’époque la « métaphysique du Dasein » doit se prolonger et se radicaliser en un
mouvement de retour de l’ontologie vers le fond ontique dans lequel elle est
prise d’emblée. C’est ce « moment » second de la métaphysique du Dasein qui
doit constituer la méta-ontologie, dont la problématique centrale est précisément
celle du monde en tant que tel, ou de l’étant dans sa totalité (das Seiende im
Ganzen), auquel le Dasein est toujours et d’emblée confronté. On notera donc
que la « rencontre » de Heidegger avec la biologie – et la discussion concernant le
rapport de l’homme à l’animal – a lieu dans le cadre d’une analyse visant à
éclaircir le fond ontique et factice duquel surgit la science de l’être en tant
qu’être.
Dans ce cours de 1929 - 30, le point de départ d’Heidegger est donc bien
métaphysique, et vise à cerner la singularité du Dasein humain au moyen du
concept de monde. Et c’est à cette fin qu’il compare le monde humain au monde
animal, non pour les rapprocher, mais pour indiquer l’abîme qui les sépare, qui
est précisément celui qui sépare le caractère métaphysique du Dasein – déjà

PHILOSOPHIE ET BIOLOGIE CHEZ HEIDEGGER
123
exposé dans le détail dans la conférence « Qu’est-ce que la métaphysique ? »
(1929) ainsi que dans « De l’essence du fondement » (1929) – du caractère
purement physique de l’étant vivant. La double thèse, au moyen de laquelle
Heidegger exprime cette différence, est la suivante : l’homme est « configurateur
de monde », tandis que l’animal est « pauvre en monde ».
La puissance configuratrice de monde de l’homme lui vient de son désir d’être,
selon une formule empruntée à Novalis, « partout chez soi ». Ce désir est le désir
même de l’homme, celui qui le fait s’affronter à l’étant dans son entièreté, et qui
est à l’origine de sa curiosité et de son questionnement. C’est bien au monde en
tant que tel que l’homme est ouvert. Il a, pour lui, cette valeur de totalité. C’est
vers le monde en tant que tel que l’homme est porté, comme vers son propre
horizon. L’homme est lui-même cet être d’horizon. C’est là qu’il se profile, ave lui
qu’il se confond. C’est la raison pour laquelle Heidegger l’assimile à une
transcendance. À titre de comparaison, l’animal, lui, a bien un monde, mais ce
n’est pas le monde en tant que tel. C’est toujours un bout de monde pour ainsi
dire, une part ou une parcelle de l’étant, mais jamais l’étant dans son entier. Son
monde (Welt) est ce qu’on appelle un milieu, ou bien encore un environnement
(Umwelt). L’animal est toujours et forcément dans un rapport d’immanence au
monde. Il y est plongé, prisonnier pour ainsi dire, et jamais ne peut le voir pour
ce qu’il est.
Si Heidegger se tourne vers la biologie et la zoologie, c’est afin de mettre à
l’épreuve cette double thèse métaphysique. Ce faisant, il se voit contraint de
penser et de thématiser la nature du rapport de la philosophie aux sciences, et
aux sciences du vivant en particulier. Or ce qui ressort de cette analyse, c’est que
la philosophie, du moins en tant que métontologie, ne peut se situer vis-à-vis des
sciences dans un rapport de pure fondation. Celui-ci, comme nous le verrons
dans un premier temps, est plutôt de « circularité » et d’« ambiguïté ». Alors même
qu’elle émet des thèses métaphysiques portant sur l’essence de l’homme et du
vivant, la philosophie ne saurait ignorer ce que la recherche positive dit de ces
phénomènes. Elle doit au contraire se confronter aux concepts, aux
interprétations et aux résultats de la recherche scientifique. C’est cette
confrontation que nous analyserons dans un second temps. Elle nous réserve,
nous le verrons, quelques surprises, allant jusqu’à remettre en question, sur un
point au moins – mais ô combien déterminant ! – la différence qu’elle était
censée confirmer.
–!I!–
S’agissant de la question du rapport de l’homme et de l’animal, on note avec
intérêt que, contrairement à ce qu’affirmait le § 3 d’Être et temps, l’attitude de la
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
1
/
24
100%