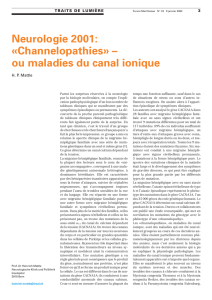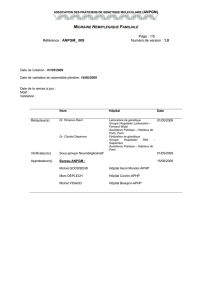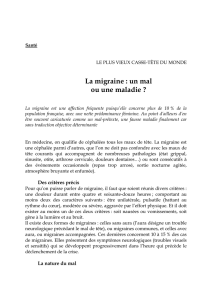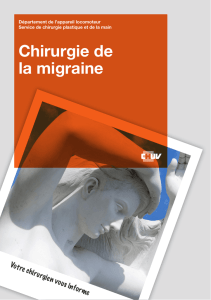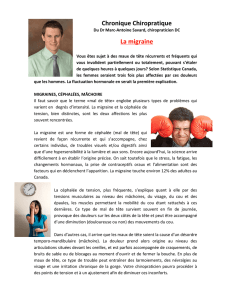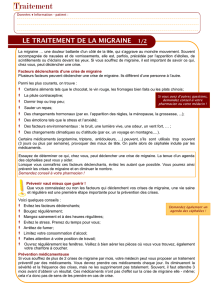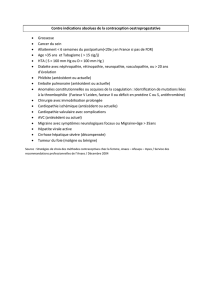Migraine et génétique : quoi de neuf depuis le chromosome 19 dans

La Lettre du Neurologue - Supplément Céphalées au n° 6 - vol. VII - juin 2003 7
1
1.
.Depuis l’identification de mutations d’un gène codant
pour un canal calcique sur le chromosome 19 dans cer-
taines familles de migraine hémiplégique, quelles autres
anomalies génétiques ont été retrouvées ?
La migraine hémiplégique familiale est la seule variété monogé-
nique, autosomique dominante, de migraine. Dans une famille,
tous les membres affectés sont porteurs de la même mutation et
un parent (père ou mère) atteint transmet un gène muté et donc
la maladie à 50 % de ses enfants. Un premier gène a été localisé
en 1993 sur le chromosome 19, puis identifié en 1996 comme
étant CACNA1A (Calcium Channel Alpha-1A) qui code pour la
sous-unité alpha-1A des canaux calciques neuronaux dépendant
du voltage de type P/Q. CACNA1A n’est pas le seul gène de la
migraine hémiplégique familiale. En effet, il a été démontré que
cette affection était hétérogène sur le plan génétique, plusieurs
gènes différents étant impliqués dans plusieurs groupes de
familles (tableau et figure 1). Le gène CACNA1A situé sur le
chromosome 19 est muté dans environ 50 % des familles. Un
autre gène, localisé en 1997 sur le chromosome 1, est muté dans
environ 20 % des familles. Enfin, 30 % des familles ne sont liées
ni au chromosome 19, ni au chromosome 1, démontrant l’exis-
tence d’au moins un troisième gène responsable. Le gène loca-
lisé sur le chromosome 1 a été identifié début 2003. Il s’agit
d’ATP1A2 qui code pour la sous-unité α2 d’une pompe Na+/K+
ATP dépendante. Cette protéine membranaire est fortement
exprimée dans les neurones, les astrocytes et les cellules muscu-
laires. Il s’agit d’une pompe qui utilise l’énergie de l’ATP pour
faire entrer contre les gradients transmembranaires du potassium
dans la cellule en échange de sodium. Elle intervient dans le
maintien du potentiel membranaire. Deux mutations du gène
Migraine et génétique : quoi de neuf depuis
le chromosome 19 dans la migraine hémiplégique familiale ?
1
1.
.
Depuis l’identification de mutations d’un gène codant pour un canal calcique
sur le chromosome 19 dans certaines familles de migraine hémiplégique,
quelles autres anomalies génétiques ont été retrouvées ?
2.
2.
Existe-t-il des différences cliniques entre les familles liées au chromosome 19
et celles liées aux autres loci ?
3.
3.
Pouvez-vous rappeler le type de dysfonctionnement du canal calcique lié aux mutations du gène CACNA1A
sur le chromosome 19 ?
4.
4.
Que sait-on des autres gènes de la migraine hémiplégique familiale ?
5.
5.
A-t-on idée du mécanisme par lequel une mutation d’un canal ionique peut provoquer des phénomènes
de migraine hémiplégique ?
6.
6.
Faut-il systématiquement à l’heure actuelle faire une analyse génétique chez un patient atteint de migraine
hémiplégique familiale ?
7
7.
.
Y a-t-il des différences cliniques entre la migraine hémiplégique familiale et la migraine hémiplégique
sporadique ? Connaît-on les prévalences respectives de ces deux types de migraine ?
8.
8.
Parmi les patients souffrant de migraine hémiplégique, connaît-on la prévalence de ceux qui souffrent en
plus de leur crises hémiplégiques de crises sans aura et de crises avec aura typique sans déficit moteur ?
9.
9.
A-t-on progressé dans la génétique de la migraine sans aura et de la migraine avec aura ? Une responsabilité
du chromosome 19 a-t-elle été recherchée ? Quels sont les arguments pour penser que ces deux types de
migraine ont une transmission génétique similaire ou au contraire différente ?
Les questions du neurologue
●
●H. Massiou*
* Service de neurologie, hôpital Lariboisière, Paris.
** Urgences céphalées, hôpital Lariboisière, Paris.
Les réponses du généticien
●
●
A. Ducros**
DIALOGUE

La Lettre du Neurologue - Supplément Céphalées au n° 6 - vol. VII - juin 2003
8
ATP1A2 ont été identifiées dans deux familles atteintes de
migraine hémiplégique. Les analyses électrophysiologiques ont
démontré que ces deux mutations étaient responsables d’une
haploinsuffisance, les sous-unités mutées étant non fonction-
nelles.
Ces données confirment que la migraine hémiplégique familiale
est liée à une perturbation des flux ioniques membranaires neuro-
naux avec hyperexcitabilité.
2.
2. Existe-t-il des différences cliniques entre les familles
liées au chromosome 19 et celles liées aux autres loci ?
Plusieurs études ont comparé l’expression clinique de la migraine
hémiplégique familiale entre les familles liées au chromosome
19, les familles liées au chromosome 1 et les familles qui ne sont
liées à aucun de ces deux loci. Avant l’ère de la génétique, les cli-
niciens avaient déjà distingué deux formes cliniques. La forme
la plus fréquente est la migraine hémiplégique pure qui touche
80 à 85 % des familles et dans laquelle l’examen clinique entre
deux crises est strictement normal chez tous les patients. La
seconde forme clinique est la migraine hémiplégique avec signes
cérébelleux permanents qui touche 15 à 20 % des familles et dans
laquelle certains patients atteints de migraine hémiplégique ont
de façon permanente un nystagmus et/ou une ataxie de sévérité
variable. Les études de corrélations génotype/phénotype ont
montré que ces deux formes cliniques correspondaient à des
formes génétiques distinctes. En effet, toutes les familles de
migraine hémiplégique avec signes cérébelleux permanents sont
liées au chromosome 19 et donc à des mutations du gène
CACNA1A. Au contraire, la migraine hémiplégique pure est
hétérogène sur le plan génétique avec un premier groupe de
familles liées au chromosome 19 et donc à des mutations de
CACNA1A,un deuxième groupe de familles liées au chromo-
some 1 et un troisième groupe de familles non liées à ces deux
loci. Les mutations du gène CACNA1A responsables de migraine
hémiplégique avec signes cérébelleux sont différentes des muta-
tions responsables de migraine hémiplégique pure. Enfin, les
familles liées au chromosome 1 sont caractérisées par une péné-
trance plus faible de la maladie, c’est-à-dire une fréquence plus
élevée de sujets porteurs du gène muté mais n’ayant pas de crise
de migraine hémiplégique.
3.
3. Pouvez-vous rappeler le type de dysfonctionnement
du canal calcique lié aux mutations du gène CACNA1A
sur le chromosome 19 ?
Quinze mutations différentes du gène CACNA1A ont été identi-
fiées à ce jour dans différentes familles de migraine hémiplé-
gique (figure 2). Toutes ces mutations sont de type faux-sens,
entraînant une substitution d’un seul des 2 500 acides aminés
qui composent la sous-unité protéique alpha-1A. Toutes les
mutations sont situées près du pore ionique du canal. Les études
électrophysiologiques comparant les courants calciques produits
par les sous-unités mutées aux courants normaux ont montré que
ces mutations modifiaient la cinétique des courants calciques.
Ces changements sont probablement à l’origine d’une modifi-
cation de l’excitabilité neuronale.
DIALOGUE
Type de migraine Chromosome Gène
MHF avec signes cérébelleux 19p13 CACNA1A
MHF pure 19p13 CACNA1A
MHF pure 1q21-q23 ATP1A2
1q31
MA 19p13.2 Distinct
de CACNA1A
MA 4q24 ?
MA/MSA 1q ?
MA/MSA Xq24-q28 ?
Tableau. Loci et gènes de susceptibilité identifiés dans la migraine
hémiplégique familiale (MHF) et la migraine avec aura (MA).
Figure 1. Hétérogénéité génétique de la migraine hémiplégique familiale.
Figure 2. Mutations de CACNA1A responsables de MHF.
Le gène CACNA1A code pour la sous-unité
α
1A des canaux calciques P/Q
représentée sur cette figure. La sous-unité est située dans la membrane cellu-
laire et comporte quatre domaines répétés constitués de six segments trans-
membranaires et d’une boucle “P” pour pore. Les quatre boucles “P”
se replient et tapissent la partie interne du pore calcique. Les mutations
responsables de MHF pure sont représentées par des ronds violets. Les
mutations responsables de MHF avec signes cérébelleux sont représentées
par des étoiles roses. Toutes ces mutations altèrent des parties fonction-
nelles importantes du canal, proches du pore ionique.

La Lettre du Neurologue - Supplément Céphalées au n° 6 - vol. VII - juin 2003 9
4.
4. Que sait-on des autres gènes de la migraine hémiplé-
gique familiale ?
Le gène CACNA1A sur le chromosome 19 est un canal calcique.
Le gène ATP1A2 situé sur le chromosome 1 est une pompe
NA+/K+. Les deux gènes identifiés pour l’instant dans la migraine
hémiplégique codent donc pour des canaux ioniques. L’argument
le plus fort en faveur de l’implication de canaux ioniques dans
les migraines hémiplégiques familiales non liées au chromo-
some 19 ou au chromosome 1 est clinique : ce sont des affections
paroxystiques et la plupart des autres maladies neurologiques
paroxystiques héréditaires sont des canalopathies comme les
ataxies épisodiques, les paralysies périodiques hyper- ou hypo-
kaliémiques et certaines épilepsies. Dans ces maladies, une
mutation d’un canal ionique entraîne une hypo- ou une hyper-
excitabilité neuronale (ataxie épisodique, épilepsie) ou muscu-
laire (paralysies périodiques) responsable des crises.
5.
5. A-t-on idée du mécanisme par lequel une mutation
d’un canal ionique peut provoquer des phénomènes de
migraine hémiplégique ?
Les canaux ioniques jouent un rôle essentiel dans le contrôle
de l’excitabilité cellulaire. Les mutations de CACNA1A et
d’ATP1A2 perturbent cette excitabilité. On peut donc émettre
l’hypothèse que les neurones des patients ont une excitabilité
modifiée, mais on ne sait pas comment cette anomalie conduit à
des crises de migraine avec aura motrice. Il est possible que cette
anomalie de l’excitabilité favorise le phénomène de dépression
corticale envahissante. En effet, plusieurs études d’imagerie ont
suggéré que la dépression corticale envahissante était à l’origine
de l’aura chez des patients atteints de migraine avec aura non
hémiplégique. Mais il n’a pas encore été démontré que ce même
phénomène se produisait lors des crises de migraine hémiplégique.
6.
6. Faut-il systématiquement à l’heure actuelle faire une
analyse génétique chez un patient atteint de migraine
hémiplégique familiale ?
La réponse est claire : il n’y a pas de nécessité ni d’utilité à faire
un diagnostic génétique chez un patient atteint d’une forme
typique de migraine hémiplégique familiale. Le diagnostic de
cette affection reste clinique, fondé sur la mise en évidence par
l’interrogatoire de crises de migraine avec aura motrice chez le
patient et chez au moins un de ses apparentés au premier degré
et sur la normalité des examens complémentaires.
7
7.
.Y a-t-il des différences cliniques entre la migraine hémi-
plégique familiale et la migraine hémiplégique spora-
dique ? Connaît-on les prévalences respectives de ces
deux types de migraine ?
La prévalence de la migraine avec aura motrice est voisine de
1 à 2 pour 1 000 dans la population générale. Récemment, une
étude de population danoise a identifié 147 patients atteints de
migraine hémiplégique familiale sur 5,2 millions d’habitants, ce
qui donne une prévalence de 3 pour 10 000. Les cas non fami-
liaux de migraine hémiplégique se répartissent en deux groupes.
Certains sont liés à une mutation autosomique dominante d’un
des gènes de la migraine hémiplégique familiale (mutation de
novo absente chez les parents biologiques ou mutation transmise
par un des parents porteur sain). D’autres cas sporadiques se rap-
prochent des variétés plus habituelles de migraine avec aura et
sont d’origine multifactorielle avec intrications de facteurs envi-
ronnementaux et de facteurs génétiques complexes.
8.
8. Parmi les patients souffrant de migraine hémiplégique,
connaît-on la prévalence de ceux qui souffrent en plus
de leurs crises hémiplégiques de crises sans aura et de
crises avec aura typique sans déficit moteur ?
De 10 à 60 % (selon les études) des patients atteints de migraine
hémiplégique familiale ont aussi des crises de migraine avec aura
non motrice. Cette prévalence est plus élevée que dans la popu-
lation générale. En revanche, seulement 10 à 20% ont aussi des
crises de migraine sans aura, ce qui n’est pas plus élevé que dans
la population générale.
9.
9. A-t-on progressé dans la génétique de la migraine sans
aura et de la migraine avec aura ? Une responsabilité du
chromosome 19 ou du chromosome 1 a-t-elle été recher-
chée ? Quels sont les arguments pour penser que ces
deux types de migraine ont une transmission génétique
similaire ou au contraire différente ?
Les études épidémio-génétiques les plus récentes ont montré que
la migraine sans aura et la migraine avec aura étaient des affec-
tions polygéniques, à transmission génétique complexe. Plu-
sieurs mutations dans plusieurs gènes différents sont nécessaires
chez un même patient pour que le phénotype migraineux appa-
raisse. Ces facteurs génétiques interagissent avec des facteurs
environnementaux dont le poids est plus important dans la
migraine sans aura que dans la migraine avec aura. Le gène
CACNA1A situé sur le chromosome 19 n’est probablement pas
impliqué dans les variétés plus habituelles de migraine. En
revanche, différentes études ont mis en évidence plusieurs loci
de susceptibilité à la migraine, en particulier la migraine avec
aura, sur le chromosome 4, le chromosome 19 (différent du
locus de la migraine hémiplégique familiale), sur le chromosome
X et peut-être le chromosome 1 (tableau). Aucun des gènes
mutés situés au sein de ces loci de susceptibilité n’a encore été
identifié.
L’implication du gène ATP1A2 n’a pas encore été analysée dans
la migraine sans ou avec aura. ■
Imprimé en France - Point 44 - 94500 Champigny-sur-Marne - Dépôt légal : à parution. © février 1997 - ALJAC S.A. Locataire gérant de Edimark SA.
Les articles publiés dans La Lettre du Neurologue le sont sous la seule responsabilité de leurs auteurs.
Tous droits de traduction, d’adaptation et de reproduction par tous procédés réservés pour tous pays.
1
/
3
100%