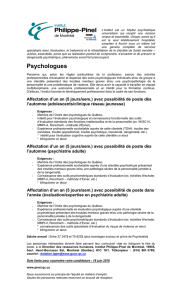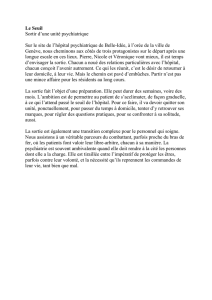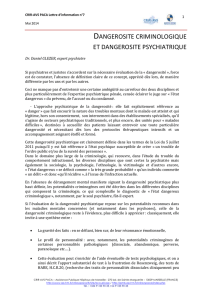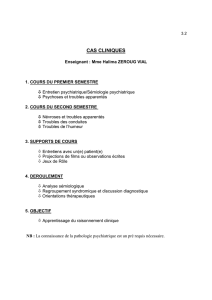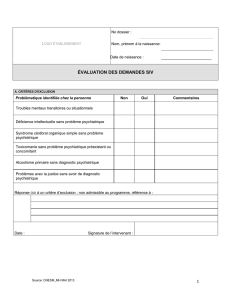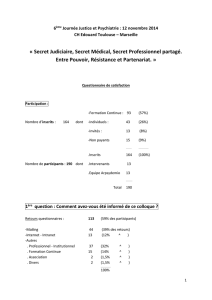Abolition, altération du discernement : destin pénal et

BANQUE DES MEMOIRES
Master de droit pénal et sciences pénales
Dirigé par Yves Mayaud
2010
Abolition, altération du discernement :
destin pénal et médical des mis en cause
Laetitia Lopez Mora
Sous la direction de Jean-Claude Bossard

UNIVERSITE PARIS-II (PANTHEON-ASSAS)
Droit – Economie – Sciences sociales
Master 2 Recherche de Droit pénal et Sciences pénales.
ABOLITION, ALTERATION DU DISCERNEMENT :
DESTIN PENAL ET MEDICAL DES MIS EN CAUSE.
Mémoire présenté par Laetitia LOPEZ MORA
- Mai 2010 -
SOUS LA DIRECTION DU DOCTEUR BOSSARD

1
REMERCIEMENTS
Je tiens à remercier tout particulièrement le Docteur BOSSARD, instigateur du
sujet et directeur de ce mémoire, pour sa disponibilité et ses précieux conseils.

2
SOMMAIRE
INTRODUCTION
PARTIE 1 : Destin pénal des criminels malades mentaux : vers une
pénalisation de la folie
Chapitre 1 : La raréfaction des non-lieux judiciaires pour raisons psychiatriques
Chapitre 2 : La tendance à la judiciarisation de la maladie mentale
PARTIE 2 : Destin médical des malades mentaux criminels : vers une
carcéralisation des soins psychiatriques
Chapitre 1 : Entre hôpitaux et prisons, la prise en charge médicale des
délinquants atteints de troubles mentaux
Chapitre 2 : La dangerosité comme principal critère du soin
CONCLUSION

3
INTRODUCTION
Quelles que soient les époques, quels que soient les lieux, les sociétés humaines ont été
confrontées à la gestion de certains de leurs membres qui transgressaient les lois et à ceux qui
présentaient des troubles mentaux. Parfois, mais pas le plus souvent, les deux situations
cumulent délinquance et maladie mentale. Face à ces infracteurs atteints de troubles mentaux,
les rapports du couple psychiatrie-justice ont nourri de nombreux débats, sans cesse
renouvelés. Aujourd’hui encore, l’actualité, tant médiatique que juridique, illustre combien la
folie criminelle anime les esprits.
Si la justice a dû composer avec ce double paramètre, fort est de constater que la réception de
la maladie mentale par le droit pénal a varié au fil des siècles, à mesure que les mentalités
évoluaient et que de nouveaux principes trouvaient leur traduction dans notre droit. La clé de
voûte de la réponse en la matière réside dans le concept de responsabilité ou d’irresponsabilité
pénale. Etre responsable pénalement signifie l’obligation de répondre des infractions
commises et de subir la peine prévue par la loi pénale qui les réprime. Pour qu’une infraction
soit constituée, trois éléments doivent être réunis : un élément légal – selon lequel le
comportement en cause doit avoir été érigé en infraction par le législateur en vertu du principe
de légalité, un élément matériel – consistant en un acte de commission ou d’omission, et un
élément moral. En France, la responsabilité pénale suppose la culpabilité et l’imputabilité. La
première est établie lorsqu’est commise une faute constituant l’élément moral de l’infraction.
La seconde renvoie à la possibilité de mettre la faute au compte de celui qui en est l’auteur,
supposant donc une conscience et une volonté libre.
Si l’objet de ce mémoire n’est pas de traiter de l’évolution de la gestion des troubles mentaux
par la justice pénale, un bref historique s’impose toutefois, afin de mieux appréhender les
réponses actuelles qui sont données aux confins du droit et de la psychiatrie. Il s’agira dans
cette introduction, notamment, de revenir sur la manière dont ont été conciliés les fondements
du droit pénal et l’apport de la clinique psychiatrique depuis l’Antiquité jusqu’à la
consécration de l’article 122-1 du code pénal qui régit aujourd’hui l’irresponsabilité ou
l’atténuation de la responsabilité pénale pour cause de trouble mental.
L’irresponsabilité pénale pour raison psychiatrique est un vieux concept qui a évolué au cours
de l’Histoire. Ce principe était déjà présent dans certains textes du droit romain classique.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
 90
90
 91
91
 92
92
 93
93
 94
94
 95
95
 96
96
 97
97
 98
98
 99
99
 100
100
 101
101
 102
102
 103
103
 104
104
 105
105
 106
106
 107
107
 108
108
 109
109
 110
110
 111
111
 112
112
 113
113
 114
114
 115
115
 116
116
 117
117
 118
118
 119
119
 120
120
 121
121
 122
122
 123
123
 124
124
 125
125
 126
126
 127
127
 128
128
 129
129
 130
130
 131
131
 132
132
 133
133
 134
134
 135
135
 136
136
 137
137
 138
138
 139
139
 140
140
1
/
140
100%