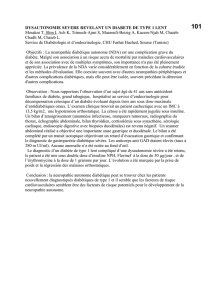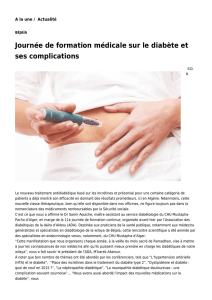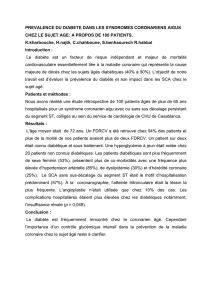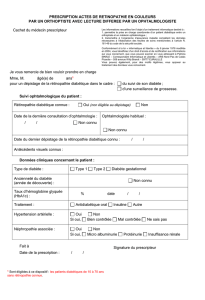diabète et travail - Diabète et Obésité

PROFESSION
Diabète & Obésité • Juin 2011 • vol. 6 • numéro 50 209
Les correspondants médi-
caux du salarié diabétique
sont différents en fonction
du secteur d’exercice.
LE SALARIÉ DIABÉTIQUE
ET LE SECTEUR PRIVÉ
Le médecin du travail est un mé-
decin spécialiste dont le rôle est
exclusivement préventif n’ayant
aucune activité de soins en de-
hors de situations d’urgence. Son
rôle consiste « à éviter toute alté-
ration de la santé des salariés du
fait de leur travail, notamment en
surveillant les conditions d’hy-
giène du travail, les risques de
contagion et l’état de santé des
*Service des maladies professionnelles et environnementales,
Hôpital Purpan, Toulouse
travailleurs » (1). Sa mission est
double avec une action en mi-
lieu de travail (études des condi-
tions de travail, des risques et
des nuisances professionnels) et
des examens médicaux (visites
d’embauche, visites périodiques,
visites de reprise). Légalement,
le médecin du travail est le seul
habilité à décider si le salarié est
médicalement apte au poste de
travail défini par l’employeur
(2). Ainsi l’aptitude à un poste ne
peut être déterminée qu’après
analyse des caractéristiques de ce
poste. Cette connaissance néces-
saire du poste de travail repose
sur la présence du médecin du
travail sur le milieu de travail.
Diabète et travail
Aspects réglementaires
Dr Fabrice Herin*, Dana Macovei*, Dr Céline Puel-Sonneville*, Pr Jean-Marc Soulat*
Le diabète est l’une des patholo-
gies chroniques rencontrées le plus
fréquemment chez l’adulte en âge
de travailler. Le patient diabétique
peut avoir des difficultés pour l’ob-
tention d’un emploi mais aussi pour
son maintien du fait de l’apparition
possible de complications pouvant
modifier ses capacités physiques et
donc son aptitude à son poste de
travail.
Il est souhaitable que le patient dia-
bétique informe son médecin du
travail sur sa pathologie (celui-ci
comme tout médecin, est soumis
au secret professionnel). Ainsi, le
médecin du travail pourra jouer un
rôle important dans la surveillance
du diabétique tout au long de sa
carrière professionnelle. Lors des
visites (embauche et périodiques),
il devra évaluer le retentissement
du diabète sur le travail mais aussi
du travail sur le diabète ; grâce à sa
connaissance du poste de travail
il se prononcera sur l’aptitude au
poste avec la possibilité d’apporter
des aménagements.
Introduction
Fotolia - © Olivier Tuffé / © FlemishDreams / © Gennadiy Poznyakov / © goodluz

210Diabète & Obésité • Juin 2011 • vol. 6 • numéro 50
PROFESSION
VISITE D’EMBAUCHE
Elle est obligatoire avant l’expi-
ration de la période d’essai. Elle
a pour but de vérifier que le sala-
rié peut être affecté au poste dé-
signé sans risque pour sa santé
et qu’il n’est pas porteur d’une
affection dangereuse pour les
autres salariés (2).
Le médecin du travail, dans le
cas d’un patient diabétique, doit
faire une double évaluation pour
déterminer le retentissement du
diabète sur le travail et de l’ac-
tivité professionnelle sur le dia-
bète. Il doit préciser :
• les caractéristiques du diabète :
type, âge d’apparition, existence
des complications, traitement,
évaluation de l’équilibre glycé-
mique et du risque d’hypoglycé-
mie et de malaise ;
• les caractéristiques du poste de
travail : type d’activité, rythme
de travail, possibilité de prise
des repas réguliers, risques in-
fectieux, possibilité d’effectuer
des autocontrôles glycémiques.
A la fin de cette visite, le médecin
du travail doit statuer sur l’ap-
une fragilité particulière. Lors
de cette visite, le médecin du
travail fait une réévaluation du
diabète, recherche l’apparition
d’éventuelles complications. A
cette occasion, il peut formuler
des restrictions avec un amé-
nagement de poste. Si cela est
impossible il peut proposer un
reclassement professionnel.
VISITE DE PRÉ-REPRISE
Si une restriction d’aptitude ou un
aménagement de poste doit être
thologie non professionnelle. La
visite de reprise a également lieu
après un arrêt de travail, quelle
que soit sa durée, pour une ma-
ladie professionnelle ou pour
un congé maternité (2). Dans le
cadre de cette visite le médecin
du travail doit vérifier les causes
de l’arrêt pour juger de l’interfé-
rence de la maladie ou de l’ac-
cident sur le diabète. Il se pose
aussi la question d’un éventuel
facteur professionnel à l’origine
de cet arrêt et qui pourrait agir
sur l’équilibre du diabète.
VISITE SPONTANÉE
Elle peut être demandée par le
salarié auprès du médecin du
travail.
LE SALARIÉ DIABÉTIQUE
ET LA FONCTION
PUBLIQUE
Il existe en France trois grandes
fonctions publiques (4) : Etat,
territoriale et hospitalière.
Les conditions médicales d’apti-
tude à l’embauche sont précisées
par l’article 20 du décret n° 86-
442 du 14 mars 1986 : « Nul ne
peut être nommé à un emploi
de la fonction publique s’il ne
produit à l’administration, à la
Professions non accessibles/
professions à risque (3)
Les dispositions réglementaires ne concernent que la fonction publique.
Ainsi, l’accès à certaines professions est légalement interdit (cependant
certaines situations peuvent être évaluées médicalement au cas par cas) :
• les écoles militaires et les métiers de l’armée : armée de terre, de l’air,
de la marine, pompiers de Paris, gendarmes ;
• métiers conditionnés par l’aptitude au service militaire national :
ingénieur des eaux et forêt, ingénieur de génie rural, officier de haras,
préposé ou agent de douane, agent de la sécurité nationale ;
• métiers aux réglementations particulières : ingénieur et adjoint de travaux
publics de l’Etat (mines, ponts et chaussées), service de lutte contre
l’incendie (pompiers), surveillant des établissements pénitentiaires.
titude à un poste de travail dé-
fini ; il rédige un certificat d’ap-
titude avec ou sans restriction ou
d’inaptitude.
VISITE PÉRIODIQUE
Elle a pour but de s’assurer que
l’état de santé du salarié est
toujours compatible avec le
poste occupé. Sa fréquence est
bi-annuelle (2) dans le secteur
privé. L’intervalle entre 2 visites
peut être diminué s’il existe des
risques professionnels qui le jus-
tifient ou si le salarié présente
envisagé, le salarié diabétique
peut demander à passer une vi-
site dite de pré-reprise auprès du
médecin du travail. Elle permettra
d’étudier les conditions de reprise
du travail du salarié et d’adapter
le poste ou les horaires de travail
dès le retour du salarié.
VISITE DE REPRISE
Elle est obligatoire après un ar-
rêt de travail de 8 jours secon-
daire à un accident de travail,
pour un arrêt de travail de plus
de 21 jours consécutifs à une pa-
La visite d’embauche est obligatoire avant
l’expiration de la période d’essai.

DIABÈTE ET TRAVAIL
Diabète & Obésité • Juin 2011 • vol. 6 • numéro 50 211
date fixée par elle, un certificat
médical délivré par un méde-
cin généraliste agréé consta-
tant que l’intéressé n’est atteint
d’aucune maladie ou infirmité
ou que les maladies ou infir-
mités constatées et qui doivent
être indiquées au dossier médi-
cal de l’intéressé, ne sont pas in-
compatibles avec l’exercice des
fonctions postulées » (1).
Le patient diabétique n’est sou-
mis à aucune particularité en ce
qui concerne son accès dans la
fonction publique. Cependant,
avant 1983 le statut de fonction-
naire n’était pas accessible aux
candidats ayant eu un cancer ou
une maladie grave (tuberculose,
poliomyélite, affection psychia-
trique) ne pouvant fournir un cer-
tificat médical de guérison. Ac-
tuellement dans la mesure où ses
affections sont stabilisées, elles ne
sont pas une cause d’exclusion.
La seule restriction reste dans le
décret du 14 mars 1986 qui exige
que ces maladies « ne soient pas
incompatibles avec l’exercice de
la fonction postulée » (1).
LE MÉDECIN AGRÉÉ
C’est un médecin généraliste ou
spécialiste inscrit sur une liste
établie par le préfet dans chaque
département, sur proposition
des agences régionales de santé
(ARS). Il a la charge de procé-
der aux examens médicaux des
fonctionnaires (4).
• Il se prononce sur l’aptitude aux
emplois publics ; il recherche si
l’agent n’est pas atteint d’une
maladie incompatible avec
l’exercice de la fonction. Ainsi il
vérifie l’aptitude aux fonctions et
non pas au poste de travail.
• Il vérifie aussi l’imputabilité
médicale des arrêts de travail,
fixe la date de guérison ou de
consolidation. Il établit les taux
d’incapacité permanente par-
tielle (IPP) pour les accidents et
maladies professionnelles.
En cas de désaccord c’est le Co-
mité Médical (4) qui statut. Il est
composé de 2 médecins généra-
listes agréés et d’un spécialiste
agréé de l’affection à l’origine de
la demande.
LE MÉDECIN DE PRÉVENTION
❚Dans la fonction publique d’Etat
et territoriale
Il n’est pas réglementairement
impliqué par la visite d’aptitude
même s’il lui est possible de for-
muler à la demande de l’admi-
nistration un avis ou émettre des
propositions d’adaptation des
conditions de travail lors de l’af-
fectation de l’agent à un poste de
ritoriale), chaque agent au mo-
ment de l’embauche doit être
examiné non seulement par le
médecin agréé mais aussi par
le médecin du travail (4, 5) et ce
« avant la prise de fonction », afin
que ce dernier puisse « s’assurer
qu’il est médicalement apte au
poste de travail auquel son affec-
tation est envisagée », ou le cas
échéant pour « proposer éven-
tuellement les adaptations du
poste ou l’affectation à d’autres
postes » (article R. 242-15 Code
du travail) (1). Les deux avis d’ap-
titude, l’un émis par le médecin
agréé et l’autre par le médecin du
travail sont donc distincts.
A l’issue de chacun de ces exa-
mens médicaux (visite d’em-
bauche, visite périodique, visite
de reprise) qu’il effectue, le mé-
travail au vu des particularités
du poste de travail et au regard
de l’état de santé de l’agent (son
rôle étant différent du médecin
agréé qui ne connaît pas le poste
de travail) (4, 5).
Conformément à l’article 15 du
décret n° 82452 modifié : « le
médecin de prévention est le
conseiller de l’administration
(…) sur :
• l’adaptation des postes (…) à
la physiologie humaine,
• la protection des agents contre
(…) des risques d’accidents de
service » (1).
❚Dans la fonction publique
hospitalière
A la différence de deux autres
fonctions publiques (Etat et ter-
decin de prévention établit un
certificat d’aptitude (4) mention-
nant seulement les contre-indi-
cations ou recommandations.
DIABÈTE ET MAINTIEN
DANS L’EMPLOI
De nos jours, les complica-
tions du diabète apparaissent
plus tardivement du fait d’une
meilleure prise en charge théra-
peutique ; c’est à ce stade que se
pose le plus souvent le problème
du maintien dans l’emploi et de
l’invalidité.
INVALIDITÉ/REPRISE DU TRAVAIL
Le patient diabétique n’est sou-
mis à aucune particularité en ce
qui concerne la reconnaissance
Le médecin de prévention est le conseiller de
l’administration sur l’adaptation des postes à la
physiologie humaine, la protection des agents
contre des risques d’accidents de service.

212Diabète & Obésité • Juin 2011 • vol. 6 • numéro 50
PROFESSION
de l’invalidité (3).
Par définition, l’invalidité est la
perte de la capacité de travail
ou de gain mettant le sujet hors
d’état de se procurer, dans une
profession quelconque, un sa-
laire supérieur au tiers de la ré-
munération normale correspon-
dant à l’emploi qu’il occupait
avant la date de l’arrêt de travail
ayant entraîné l’état d’invalidité.
Pour en bénéficier, la perte de la
capacité de travail ou de gain doit
être due à une maladie ou un ac-
cident non professionnel ; le tra-
vailleur doit être âgé de moins de
60 ans, être immatriculé depuis
12 mois au premier jour du mois
au cours duquel débute l’affec-
tion invalidante et justifier d’un
minimum d’heures de travail.
L’état d’invalidité intervient soit
en relais de l’Assurance mala-
die (après 3 ans de versement
d’indemnités journalières), soit
lors de la constatation médicale
d’une « usure prématurée de
l’organisme » (1). La demande
est faite soit par la caisse soit par
le salarié.
❚Le médecin conseil
Le médecin conseil évalue l’im-
portance de l’invalidité
(Encadré)
.
Il est à noter que l’attribution
d’une pension d’invalidité n’in-
terdit pas à l’invalide de tra-
vailler. Il faut bien différencier
la notion d’invalidité reconnue
par l’organisme d’Assurance
maladie et l’aptitude à un poste
de travail formulée par le méde-
cin du travail.
❚Médecin du travail
Le médecin du travail a pour
rôle de déterminer l’aptitude au
poste lors de la reprise du tra-
vail à temps partiel du salarié en
invalidité 1re catégorie, ou sous
certaines conditions du salarié 2e
catégorie. Le médecin du travail
détermine l’aptitude du salarié à
conserver son poste antérieur de
travail et peut apporter des res-
trictions pour adapter son poste
à sa pathologie. L’employeur
doit reclasser le salarié en fonc-
tion des restrictions ; s’il est dans
l’impossibilité de le faire le sala-
rié sera licencié pour inaptitude
médicale.
La pension d’invalidité prend
toujours fin à 60 ans où elle est
automatiquement substituée
par la pension de vieillesse au
titre de l’inaptitude médicale au
travail.
RECONNAISSANCE DE LA QUALITÉ
DE TRAVAILLEUR HANDICAPÉ
Tout diabétique dont les possi-
Catégories d’invalidité
L’invalidité est classée en 3 catégories :
• catégorie 1 : l’invalide est capable d’exercer une activité rémunérée au
tiers des capacités antérieures ;
• catégorie 2 : l’invalide est absolument incapable d’exercer une activité
professionnelle quelconque ;
• catégorie 3 : l’invalide est absolument incapable d’exercer une activité
professionnelle quelconque et, en outre, dans l’obligation d’avoir
recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes
ordinaires de la vie.
Avantages rattachés à la pension d’invalidité
• Pension d’invalidité : elle est calculée sur la base du salaire annuel
moyen ; pour la 1re catégorie : 30 % du salaire moyen, 2e catégorie :
50 % ; et pour la 3e : à la pension de la 2e catégorie se rajoute la majora-
tion pour tierce personne (MTP)
• Remboursement des soins (exonération du ticket modérateur)
• Versement d’indemnités journalières (maladie, maternité) en cas de
reprise de l’activité
• Reclassement professionnel et rééducation professionnelle (reconnais-
sance de la qualité de travailleur handicapé)
• Allocation de logement social (sous conditions de ressources)
Bénéfices de la reconnaissance
en tant que salarié handicapé
• Orientation par la CDAPH vers une entreprise adaptée, un établisse-
ment ou un service d’aide par le travail (ESAT)
• Stages de préformation professionnelle ou de rééducation profession-
nelle
• Soutien du réseau de placement spécialisé Cap Emploi
• Obligation d’emploi à laquelle sont soumis les employeurs du secteur
privé et du secteur publique
• Aides de l’Agefiph (association nationale de gestion du fonds pour
l’insertion professionnelle des personnes handicapées)
• Aide à l’insertion, aide à la formation…

DIABÈTE ET TRAVAIL
Diabète & Obésité • Juin 2011 • vol. 6 • numéro 50 213
bilités d’obtenir ou de conserver
un emploi sont réduites du fait
de sa pathologie peut prétendre
à une reconnaissance en qualité
de travailleur handicapé (3). Ce
statut est reconnu sur décision
de la commission des droits et
de l’autonomie des personnes
handicapées (CDAPH), après
l’examen du dossier. Cette com-
mission est créée au sein de la
maison départementale des per-
sonnes handicapées (MDPH).
DIABÈTE ET DISCRIMINATION
En droit du travail, la discrimi-
nation est le traitement inégal et
téisme important, une incapa-
cité au travail, une invalidité
et une mise en inaptitude qui
jouent un rôle important dans
l’évolution du bien-être d’un sa-
larié diabétique.
❚Le cas médiatique de Nathalie
La médiatisation d’un cas de dis-
crimination au travail lié à l’état
de santé a mis en question des
injustices au travail en ce qui
concerne les sujets diabétiques.
Nathalie B., jeune aide soignante
de 25 ans à Rennes se voit refu-
ser après 3 ans et onze contrats
en CDD sa prochaine titularisa-
❚L’impact des discriminations
Les discriminations au travail
liées à l’état de santé, souvent
méconnues et difficiles à prou-
ver, existent : refus d’embauche,
licenciement, etc. Plusieurs
études concernant l’impact de la
discrimination sur la santé men-
tale et physique des patients
diabétiques ont été réalisées.
En Suisse, les risques d’hypo-
glycémies et obésité semblent
des facteurs favorisant pour le
refus d’embauche (8). Une autre
étude aux Etats-Unis (San Fran-
cisco) a démontré que 14 % de
810 patients diabétiques ont
expérimenté la discrimination
au travail à cause de leur état de
santé ainsi que d’autres facteurs
comme race, âge ou sexe (9).
Une autre enquête a étudié l’im-
portance des conséquences psy-
cho-sociales de la discrimina-
tion au travail pour les patients
diabétiques (10).
La discrimination au travail des
patients diabétiques est un fait
réel, démontré avec des consé-
quences importantes sur l’ave-
nir professionnel, psychique et
social des salariés diabétiques.
DIABÈTE ET RÉFORME
DES RETRAITES
La loi (n° 2010-1330) du 9 no-
vembre 2010 portant sur la ré-
forme des retraites a été publiée
au Journal Officiel le 10 no-
vembre (1). Des dispositions
liées à la pénibilité ont été adop-
tées. La loi prévoit certaines me-
sures spécifiques de « compen-
sation de la pénibilité » au travail.
A ce titre, le texte précise que la
prise en compte de la pénibilité
repose sur un certain pourcen-
tage d’incapacité des salariés.
Des décrets relatifs à la pénibilité
au travail et au droit à la retraite
anticipée pour pénibilité ont été
publiés au Journal Officiel du
défavorable appliqué à certaines
personnes en raison notamment,
de leur origine, de leur nom, de
leur sexe, de leur apparence phy-
sique ou de leur appartenance à
un mouvement philosophique,
syndical ou politique (1). La loi
no 2001-1066 du 16 novembre
2001 relative à la lutte contre les
discriminations a interdit une
telle pratique à tous les niveaux
de la vie professionnelle (1).
La discrimination des personnes
diabétiques au travail est un su-
jet délicat. Les diabétiques attri-
buent souvent les injustices ou
les inégalités dont ils souffrent
au travail à leur maladie. On
peut aussi penser que la maladie
pourrait être utilisée par les em-
ployeurs avertis pour exclure les
diabétiques de certains postes
ou limiter leur ascension hiérar-
chique.
Les complications du diabète
peuvent déterminer un absen-
tion selon le motif que « le dia-
bète insulinodépendant entraî-
nait inéluctablement un congé
de longue maladie dans les an-
nées à venir incompatible avec
une activité professionnelle sa-
lariée dans la fonction publique.
Conclusion : inaptitude aux
fonctions d’aide soignante sala-
riée dans la fonction publique ».
La patiente avait pourtant un
diabète bien équilibré et n’avait
jamais été en arrêt maladie. Elle
a décidé donc de saisir le tribu-
nal administratif. Le tribunal a
jugé que la décision de ne pas
titulariser Mlle B. se fonde « sur
les développements ultérieurs
probables de cette pathologie
et non sur ses manifestations
actuelles » et conclut à « l’ab-
sence de contre-indication d’un
emploi d’aide soignante dans la
fonction publique, compte tenu
d’un diabète stable et bien équi-
libré » (7).
Tout diabétique dont les possibilités d’obtenir
ou de conserver un emploi sont réduites du
fait de sa pathologie peut prétendre à une
reconnaissance en qualité de travailleur
handicapé.
 6
6
1
/
6
100%