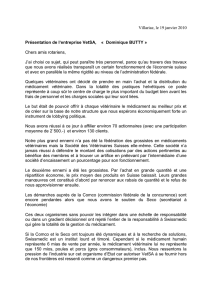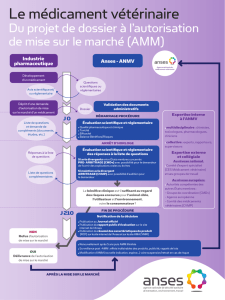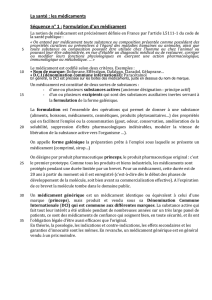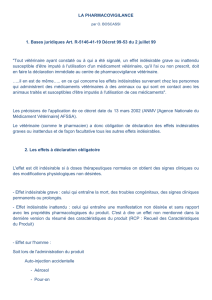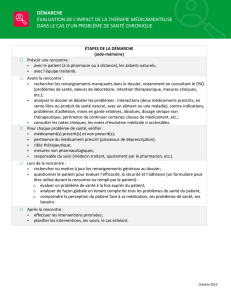l`usage hors notice des médicaments et son influence sur le temps d

L’USAGE HORS NOTICE DES MÉDICAMENTS ET SON INFLUENCE
SUR LE TEMPS D’ATTENTE
Les médicaments utilisés chez les animaux producteurs de denrées alimentaires peuvent y
générer des résidus. Ces traces de substances actives peuvent causer des effets divers et
nuisibles pour la santé humaine, par exemple des troubles de la reproduction, des allergies,
de la cancérogenèse… La prise en compte de la sécurité alimentaire constitue donc un
élément important dans la procédure d’enregistrement d’un médicament à usage vétérinaire
destiné aux animaux producteurs de denrées alimentaires. Lorsqu’un médicament est utilisé
selon le RCP1, c’est-à-dire chez les espèces cibles, pour les indications validées et les doses
mentionnées, ainsi qu’en respectant les temps d’attente, les risques pour l’homme devraient
être négligeables. L’usage hors notice2 d’un médicament, à savoir un usage s’écartant des
recommandations du RCP, est autorisé dans la communauté européenne sous certaines
conditions déterminées par le « système de la cascade »3.
Après avoir rappelé comment est déterminé le temps d’attente d’un médicament à usage
vétérinaire, le présent article montre en quoi un usage hors notice peut influencer ce
paramètre.
Le temps d’attente
Le temps d’attente d’un médicament est déterminé en fonction de la valeur LMR (Limite
Maximale de Résidus) de la substance pharmacologiquement active du médicament, définie
pour l’espèce cible. Dans l’Union européenne, les LMR sont définies par Règlement
(Règlement CEE n° 2377/90). Les médicaments à usage vétérinaire destinés aux animaux
producteurs de denrées alimentaires ne peuvent être enregistrés en Europe que si leur(s)
substance(s) active(s) est (sont) reprise(s) dans les annexes I, II ou III de ce Règlement4.
La LMR d’une substance active est déterminée en fonction:
- d’études toxicologiques et pharmacologiques examinant la toxicité de la substance et
de ses métabolites => « safety file » ;
- d’études de déplétion examinant le comportement de la substance et de ses
métabolites dans l’animal cible => « residue file » (European Commission 2005)
Ces dernières études identifient les résidus importants, en particulier le résidu marqueur
servant aux recherches en cas de contrôle.
Les études toxicologiques et pharmacologiques déterminent notamment. un niveau NOEL
(No Observed Effect Level) ou LOEL (Lowest Observed Effect Level). Il s’agit de la dose
située juste en dessous du seuil de toxicité chez l’animal d’expérience et pour le paramètre
les plus sensibles. Pour l’extrapolation des animaux d’expérience vers l’homme, le NOEL ou
LOEL est divisé par un facteur de sécurité (SF Safety Factor). Le résultat obtenu forme la
DJA5 (Dose Journalière Admissible). Il s’agit de la quantité de résidus6 pouvant être ingérée
1 Résumé des Caractéristiques du Produit, ou notice scientifique
2 Encore appelé “usage hors-RCP” ou “extralabel use”
3 Directive 2001/82/CE modifiée par la Directive 2004/28/CE, art. 10 et 11
4 Outre les substances possédant une valeur LMR (Annexes I et III), il y a celles dont on admet que le risque pour le consommateur est
tellement faible qu’elles ne nécessitent pas de LMR (Annexe II).
5 Pour la plupart des substances antimicrobiennes, la DJA est déterminée sur base de tests de sensibilité effectués sur des micro-
organismes pertinents présents dans la flore intestinale humaine.
Folia veterinaria

2
quotidiennement et sans risque par le consommateur, durant toute la durée de sa vie, tenant
compte des données connues à ce jour. La somme de tous les résidus ingérés
quotidiennement par l’homme via la ration alimentaire ne peut donc pas dépasser la DJA.
C’est la raison pour laquelle la DJA est répartie dans les différentes denrées (viande ou
poisson, lait, œuf, miel), tenant compte de la quantité7 ingérée quotidiennement pour chacune
d’elles. La concentration ainsi obtenue constitue ce que l’on appelle la LMR (Limite
Maximale de Résidus) (voir aussi Volume 8 Notice to applicants and guideline Veterinary
medicinal products: Establishment of maximum residu limits (MRL) for residues of
veterinary medicinal products in foodstuffs of animal origin. (October 2005))
Ce paramètre sert de base pour le calcul du temps d’attente. Ce dernier est la période séparant
la dernière administration du médicament vétérinaire de l'obtention des denrées alimentaires
provenant du sujet traité (viande, lait, œufs, miel) afin de garantir qu'elles ne contiennent pas
de résidus en quantités supérieures aux LMR. Pratiquement, après l’administration d’un
médicament à des animaux cibles, l’évolution chronologique de la teneur en résidus dans les
différents tissus est déterminée. L’analyse statistique de ces données aboutit au calcul du
temps d’attente (méthode de régression linéaire) (EMEA 1995).
Le temps d’attente, repris dans le RCP d’un médicament, est spécifique de cette préparation
et a été calculé pour les tissus de l’espèce cible et tenant compte de la dose, de la voie
d’administration et de la durée du traitement mentionnées dans le RCP.
Les valeurs LMR sont également utilisées pour le contrôle des denrées alimentaires d’origine
animale, afin de garantir qu'elles ne contiennent pas de quantités dangereuses de résidus de
médicaments avant d’être introduites dans la chaîne alimentaire.
Facteurs influençant la durée des temps d’attente
Le temps d’attente nécessaire pour faire baisser la teneur en substance active et/ou de ses
métabolites dans les tissus d’animaux producteurs d’aliments jusqu’à des concentrations
jugées sûres pour le consommateur, dépend de la dose, de la voie d’administration, de la
formulation, de la vitesse à laquelle ces substances sont éliminées du corps de l’animal et de
la LMR (Gehring R. et al., 2006). Un usage hors notice du médicament, s’écartant des
spécifications mentionnées dans le RCP, modifie en conséquence un ou plusieurs des
facteurs précités et peut donc influencer le temps d’attente.
Usage du médicament pour une indication non reprise dans la notice
Des facteurs physiologiques, comme l’âge ou le stade de lactation, ou pathologiques peuvent
modifier la vitesse de déplétion d’une substance et influencer ainsi le temps d’attente.
L’analyse des mécanismes pouvant conduire à cette situation sort du cadre de cet article. Par
exemple, les infections ou les inflammations peuvent conduire à l’inhibition ou l’induction
d’enzymes hépatiques (Morgan ET, 2001). Les variations du métabolisme qui peuvent en
découler modifient la demi-vie tissulaire, ce qui n’est pas sans conséquences pour le temps
d’attente (Riviere JE et al. 1998). On ne peut définir avec précision dans quelle mesure la
demi-vie tissulaire pourrait être prolongée (Gehring R. et al., 2006). Riviere et al. (1998)
6 La teneur en résidus dans les tissus est mesurée selon une méthode d’analyse standardisée et validée se basant sur un résidu
marqueur. Il peut s’agir de la substance active elle-même (molécule-mère ou parent drug), d’un ou plusieurs de ses métabolites, ou
encore d’une combinaison de ces derniers.
7 Ces quantités sont fixées arbitrairement et répartissent ainsi la consommation quotidienne : 500 g de viande (tissu musculaire, graisse,
foie, rein) ou 300 g de poisson + 1,5 kg de lait + 100 g d’œufs + 20 g de miel.

3
précisent que la plupart des infractions aux valeurs de LMR résultent de l’utilisation d’un
médicament chez des animaux souffrant d’une maladie n’étant pas reprise dans les
indications du RCP. On peut se demander si la conclusion de Rivière et al. est pertinente dans
tous les cas. En effet, il faut noter que les temps d’attente sont déterminés chez des animaux
sains et que la composante pathologique n’est pas prise en compte lors de leur détermination.
D’une manière générale, une nouvelle indication aura un impact majeur sur le temps
d’attente, tout particulièrement lorsque la maladie visée altère la distribution et l’élimination
du principe actif.
Cet écart par rapport au RCP est accepté dans le cadre du système de la cascade moyennant
une adaptation des temps d’attente minimaux dont les principes sont repris dans la
conclusion.
Administration d’un médicament à une espèce non cible
Au sein de l’Union européenne, une substance active ne peut être administrée à un animal
producteur d’aliments qu’à la condition qu’elle soit reprise dans les annexes I, II ou III du
Règlement CEE/2377/90 évoqué ci-dessus. Ainsi, on ne peut administrer un médicament
enregistré exclusivement pour des animaux de compagnie sans avoir vérifié préalablement
que toutes les substances actives soient bien reprises dans l’une des annexes précitées. La
nature des denrées alimentaires produites doit aussi être prise en compte. Ainsi, lorsque des
médicaments destinés à des bovins ou des poussins de chair sont administrés respectivement
à des bovins producteurs de lait ou des poules pondeuses, il est nécessaire de vérifier que les
substances actives peuvent effectivement être administrées à des animaux produisant
respectivement du lait et des œufs destinés à la consommation humaine, c’est-à-dire que des
valeurs de LMR existent pour ce type de denrées alimentaires. Il semblerait que ces règles
strictes, applicables aux nouveaux médicaments au moment de la demande de mise sur le
marché par le laboratoire pharmaceutique, puissent être assouplies dans le cadre de la
cascade étant donné son caractère exceptionnel. Le fait de disposer d’une LMR chez une
espèce destinée à la consommation pourrait suffire pour justifier l’usage d’un médicament
chez d’autres espèces. Il s’agit néanmoins d’une interprétation qui mériterait d’être clarifiée
par les autorités. Les particularités métaboliques des diverses espèces justifient cette attitude.
Selon l’espèce animale, une substance peut être métabolisée via diverses voies métaboliques,
ce qui entraîne des résidus de nature différente. La présence imprévue d’un métabolite
toxique spécifique chez une espèce animale serait relativement rare (Craigmill AL et al.,
2004; EMEA 1997) mais des particularités métaboliques pourraient engendrer des résidus
marqueurs différents, spécifiques des espèces animales étudiées. Aux Etats-Unis, l’utilisation
d’ivermectine est notamment autorisée chez le cheval, le bovin, le porc, le mouton, la chèvre
et la dinde. Le résidu marqueur pour les mammifères cités est l’ivermectine (parent drug ou
molécule-mère) alors que le résidu marqueur pour la dinde est le sulfone (métabolite)
(Craigmill AL et al., 2004). Il est cependant rare que des résidus marqueurs de substances
dont l’usage est autorisé chez des animaux destinés à la consommation diffèrent selon
l’espèce (Craigmill AL et al., 2004; EMEA 1997). Craigmill AL et al. (2004) imputent ceci
au fait que les substances donnant lieu à des marqueurs différant selon l’espèce ne sont pas
développées car cela exigerait des études toxicologiques supplémentaires et hausserait
considérablement le coût du développement du médicament.

4
La variabilité de la pharmacocinétique d’un principe actif chez diverses espèces explique que
le temps d’attente varie en fonction du type d’animal traité (Craigmill AL et al., 2004). Ainsi,
bien que les LMR pour le foie, la graisse et les reins chez le bovin et le porc soient
identiques, la différence des temps d’attente établis chez ces deux espèces après une injection
sous-cutanée d’ivermectine est liée à la différence des volumes de distribution
(concentrations initiales au niveau des tissus), alors que les demi-vies tissulaires chez ces
deux espèces animales sont du même ordre de grandeur (Craigmill AL et al., 2004).
L’information fournie par la littérature scientifique et l’extrapolation entre les différentes
espèces basée sur des paramètres allométriques8 donnent une idée des paramètres
pharmacocinétiques (Craigmill AL, 2004). Par exemple, dans le cas des substances éliminées
principalement par filtration glomérulaire, la demi-vie d’élimination présente de fortes
similitudes allométriques quelle que soit la taille du corps (Craigmill AL, 2004, Lin JH.,
1998). En revanche, les substances métabolisées par le foie montrent des cinétiques très
différentes en fonction de l’espèce. Les demi-vies sont en général plus courtes chez les
espèces cibles plus petites (Riviere J. E. et al., 1998 ). Par conséquent, l’application à un
mouton d’un temps d’attente mentionné dans le RCP pour un bovin aurait théoriquement peu
de chances d’entraîner des résidus, à moins que ces deux espèces ne métabolisent
différemment la substance (Riviere J. E. et al., 1998).
Ces considérations permettent de formuler des recommandations dans le cadre de la cascade
thérapeutique. Etant donné que les circonstances physiologiques ou pathologiques
influencent moins les paramètres pharmacocinétiques que l’espèce cible, il serait préférable,
si possible, d’opter en premier lieu pour des médicaments ayant été enregistrés pour l’espèce
cible à traiter mais éventuellement pour une indication différente plutôt que de se tourner
d’emblée vers des préparations destinées à d’autres espèces (Gehring, 2006).
Modification de la dose prescrite dans le RCP
L’augmentation de la dose, la modification de l’intervalle de dosage ou de la durée de
traitement peuvent engendrer une concentration plus élevée de la substance active ou de ses
métabolites dans les tissus comestibles. Lorsque les paramètres cinétiques se déroulent selon
une réaction linéaire et non saturable, la vitesse de déplétion de la substance reste inchangée.
La valeur LMR demeure, quant à elle, évidemment identique. Néanmoins, la quantité de
substances à éliminer étant plus grande, le temps d’attente sera plus long. Prenons comme
point de référence la demi-vie d’élimination (t1/2). Lorsqu’une dose est doublée, la
concentration tissulaire initiale sera également deux fois plus importante que celle obtenue
lorsque la posologie normale est respectée. Cette dernière concentration sera atteinte après
une période égale à la t1/2 dans le compartiment tissulaire. Ensuite, la cinétique devient
identique, indépendamment de la dose administrée. Ceci signifie que le temps d’attente devra
être augmenté d’une t1/2 tissulaire, sous condition de la linéarité de la cinétique (temps
d’attente adapté = temps d’attente de la notice + t1/2 tissulaire) (Riviere et al., 1998). Il est à
noter que cette condition n’est pas systématiquement respectée et est à évaluer au cas par cas.
Le temps d’attente dans le RCP équivaut généralement à 5 à 10 fois la demi-vie tissulaire. Le
doublement d’une dose signifie donc l’augmentation de 10 à 20% du temps d’attente (Riviere
et al., 1997).
L’administration d’une dose, par conséquent d’un volume plus important que celui
recommandé modifie également la cinétique d’absorption au niveau du site d’injection.
(Gehring et al., 2006). En augmentant le rapport entre le volume injecté et la surface en
8 L’étude allométrique peut aussi servir à déterminer une dose par ex.

5
contact avec les tissus de l’animal, la vitesse d’absorption devient plus faible ce qui favorise
une plus longue rémanence des résidus au niveau du site d’injection. C’est pourquoi le
volume injecté ne peut pas dépasser le volume maximal équivalant à la dose du RCP. Il est
préférable de multiplier les sites d’injection.
La littérature et les RCP (Résumé des Caractéristiques du produit, ou notices scientifiques)
peuvent éventuellement fournir les connaissances pharmacocinétiques nécessaires à
l’ajustement d’un temps d’attente. Néanmoins, la modification de la posologie n’est pas
reprise telle quelle dans le système de la cascade réglant l’usage hors notice des médicaments
dans l’Union européenne, même si, dans de nombreux cas, une indication différente que celle
mentionnée dans la notice nécessitera l’ajustement de la dose.
Modification d’une voie d’administration
La modification de la voie d’administration peut modifier l’évolution de la concentration
plasmatique et tissulaire. Des réactions tissulaires et des différences d’irrigation sanguine
peuvent influencer l’absorption. Une absorption plus lente ou plus rapide modifiera la
présence de résidus dans les tissus (Gehring et al., 2006). Un médicament est d’ailleurs plus
qu’une simple substance active. La forme galénique et la composition qualitative et
quantitative peuvent influencer la déplétion tissulaire et le temps d’attente en fonction de la
voie d’administration choisie (Baynes et al., 2000). Le résultat d’une modification de la voie
d’administration est variable et imprévisible (Gehring et al., 2006).
Le système de la cascade ne fait pas mention d’une telle déviation par rapport au RCP. Celle-
ci n’est donc pas autorisée en principe.
Usage simultané de plusieurs médicaments
L’usage simultané de médicaments ou leur ingestion en même temps que certaines
composantes alimentaires (p. ex. le lait avec de la doxycycline) peuvent engendrer des
interactions dont les effets peuvent être pharmacocinétiques ou pharmacodynamiques.
Les substances actives sont liées, à des degrés divers, à des protéines plasmatiques. Seule la
molécule non liée diffuse vers les tissus. La diminution de la liaison protéique d’une
substance par une autre molécule, pourrait engendrer une distribution tissulaire plus élevée et
éventuellement une déplétion plus lente et un temps d’attente plus long. Le degré de liaison
protéique dans le plasma influence la clairance des substances à faible coefficient
d’extraction (rapport entre la concentration de la substance dans le sang artériel et sa
concentration dans le sang veineux) (Hoener B., 2003). Si la réduction de la liaison protéique
n’influençait que la clairance, elle entraînerait une déplétion plus rapide et un temps d’attente
plus court.
De nombreuses interactions pharmacocinétiques se situent au niveau de la métabolisation
hépatique, le plus souvent via l’induction ou l’inhibition d’enzymes, en particulier les iso-
enzymes du cytochrome P450 (CYP). L’inhibition des enzymes CYP par des contaminants
environnementaux ou des substances issues de médicaments peut ralentir le métabolisme
d’autres principes actifs. Inversement, certains médicaments peuvent accélérer la
biotransformation d’autres substances actives (Cribb A., 2003). Il existe peu d’études sur les
CYP chez les animaux destinés à la consommation humaine, en comparaison avec les études
effectuées chez le chien, les rongeurs et l’homme. L’extrapolation de ces espèces vers une
autre espèce cible est difficile étant donné que l’induction ou l’inhibition des CYP diffère
beaucoup en fonction des espèces, aussi bien qualitativement que quantitativement (Cribb,
2003).
 6
6
 7
7
1
/
7
100%