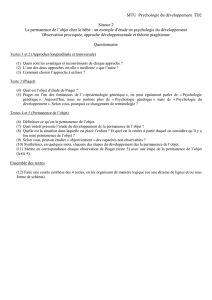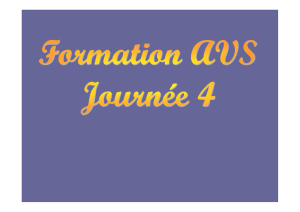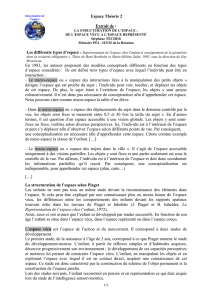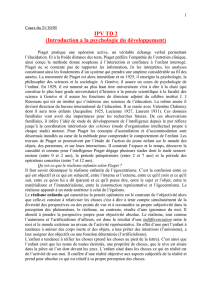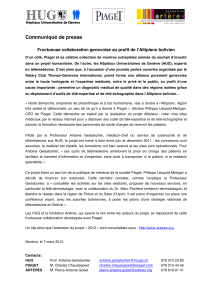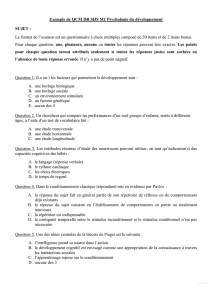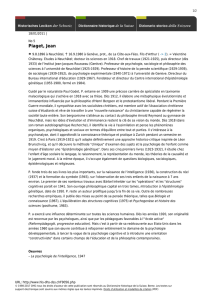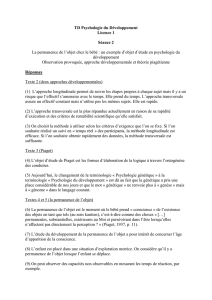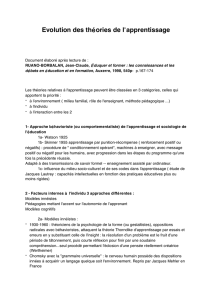à propos du centième anniversaire de la naissance de piaget

1
À PROPOS DU CENTIÈME
ANNIVERSAIRE DE LA
NAISSANCE DE PIAGET
Pierre MOESSINGER
Publié dans Aspects sociologiques, Vol. 5, no 1, novembre 1996, pp. 20-22.
Résumé
L’œuvre de Piaget vise essentiellement à marquer la continuité entre la vie et la pen-
sée, à relier biologie et psychologie, mais aussi — bien que dans une moindre mesure
— à relier psychologie et sciences sociales, en particulier psychologie et sociologie.
Son épistémologie génétique est à situer dans une vision, non pas pyramidale, mais
circulaire, des sciences. Par exemple, la pensée est à comprendre à partir de la bio-
logie, mais dans un cadre social (qui est aussi naturel).
titre préliminaire, observons qu'il
y a toujours chez Piaget un travail
de systématisation du savoir, qui
s'appuie sur une confrontation avec le réel,
et un travail plus philosophique orienté par
la question de savoir ce qu'est une bonne
explication. Certes, ces deux entreprises sont
indissociables — et Piaget a tout fait pour
ramener la seconde à la première —, mais
tournées vers des préoccupations différentes.
La tentative de systématisation du savoir a
conduit Piaget à chercher « les lois générales
de la coordination des actions », tandis que
son travail plus philosophique l'a conduit à
s'intéresser à des questions telles que le « pa-
rallélisme psychophysiologique », la corres-
pondance entre les mathématiques et la ré-
alité, ou les liens micro/macro.
Dans le domaine des sciences socia-
les, le travail portant sur la coordination des
actions s'oriente vers la coordination inter-
personnelle des actions (et des valeurs), dont
Piaget retient surtout l'aspect coopératif.
Quant aux questions plus philosophiques, ou
plus proprement épistémologiques, elles
concernent essentiellement la question de la
« totalité sociale ».
LA COORDINATION INTERPER-
SONNELLE DES VALEURS
Le problème des valeurs constitue
une préoccupation constante et centrale de
Piaget. Les actions sont orientées par des
valeurs, et la coordination des valeurs —
surtout la coordination raisonnée des valeurs
— l'intéresse depuis l'activisme protestant de
sa jeunesse jusqu'à son travail sur l'équilibra-
tion et l'abstraction réfléchissante, en passant
par Le jugement moral chez l'enfant ou Sa-
gesse et illusions de la philosophie, par
exemple.
À

2
Les valeurs sont des propriétés des
actions ou des systèmes (Piaget parle de
« coordinations ») d'actions. Les valeurs
sont articulées par des opérations, ou par des
règles ou des normes (en particulier socia-
les), qui, dans une certaine mesure, les dé-
terminent. Les valeurs et les règles ou les
normes se communiquent par des signes.
Valeurs, règles, et signes, constituent, pour
Piaget (1965, 1970), la référence principale
des sciences sociales. Sans doute accorde-t-
il une primauté ontologique aux valeurs.
Dans le contexte qui nous occupe
ici, l'hypothèse centrale de Piaget est que les
lois de la coordination intrapersonnelle des
valeurs (ou les opérations propres au travail
intellectuel) se retrouvent au niveau inter-
personnel. Il y a une analogie entre l'équili-
bration des structures cognitives et les équi-
libres coopératifs interpersonnels. « Coopé-
rer, c'est opérer en commun », dit-il.
Piaget porte un intérêt particulier
aux échanges et aux équilibres « synchroni-
ques » des valeurs, et un moindre intérêt aux
règles et aux valeurs qui apparaissent et
disparaissent au cours de l'histoire. Il pense
que les équilibres synchroniques, parce
qu'ils sont peu liés aux circonstances, sont
assez généraux et varient peu d'une société à
l'autre. Sa notion d'équilibre interpersonnel
repose sur une idée assez simple mais peu
banale, qui est restée presque complètement
ignorée des économistes et des sociologues :
« Généralement parlant, toute action ou ré-
action d'un individu, évaluée selon son
échelle personnelle, retentit nécessairement
sur les autres individus; elle leur est utile,
nuisible, ou indifférente, c’est-à-dire qu'elle
marque un accroissement de leurs valeurs,
une diminution, ou une différence nulle »
(Piaget, 1965:104).
Soit une interaction entre deux indi-
vidus, a et b. Les valeurs qui entrent en jeu
sont ici le coût de l'action (disons pour a) ra,
la satisfaction de b, sb, la valorisation de a
par b (distincte de sa satisfaction) et la dette
que b éprouve envers a. Vu que b agit et
échange aussi des valeurs avec a, b se trouve
dans une situation réciproque. Il y a équili-
bre interpersonnel lorsque r + s = 0 pour
chaque individu. Une des dimensions de
l'équilibre qui intéresse Piaget réside dans le
fait que les dettes se détachent des valorisa-
tions pour acquérir un caractère normatif.
« Cette obligation propre à la réci-
procité normative s’explique par le fait que
ni a ni b ne sauraient sans contradiction
valoriser l'autre tout en agissant de manière
à être soi-même dévalorisé. Par exemple, a
ne peut à la fois estimer b et lui mentir, par-
ce qu'alors b cessera de l'estimer et il ne
restera dans ce cas à a qu'à renoncer soit à
estimer b soit à s'estimer lui-même » (Piaget
1965:129).
Dans une interprétation plus socio-
logique, on pourrait dire que l'équilibre so-
cial (ici entre deux personnes) s'accompagne
d'une norme de réciprocité qui est à la fois
sociale (équilibre) et individuelle (obliga-
tion, dette), et que l'équilibre social émerge
des interactions sociales et détermine l'obli-
gation dans les consciences individuelles.
C'est dans cette même perspective
que Piaget analyse les équilibres juridiques
et les équilibres moraux. Certes, tous les
équilibres juridiques ne présentent pas ces
propriétés d'équilibre statique : les règles se
sont souvent cristallisées au cours de l'histoi-
re sous l'effet de contraintes, de rapports
inégaux, non réciproques, et présentent, par
rapport à la société, un caractère extrinsè-
que. Les normes morales, en revanche,
émergent davantage, d'après Piaget (qui est
ici un peu kantien) d'équilibres statiques, et
sont par là-même plus universelles, plus
impersonnelles, et plus intemporelles.
LE PROBLÈME DE LA TOTALITÉ
SOCIALE
Dans les sciences sociales, on re-
connaît traditionnellement deux pôles ex-
trêmes, le réductionnisme radical et le ho-
lisme radical (ou dualiste). Selon le
réductionnisme radical — et selon Margaret
Thatcher —, « there is no such thing as soci-
ety, there are only individuals ». Selon
l’holisme radical, la société transcende les
individus, et ne saurait être comprise à partir
des conduites individuelles. Bien que les
sociologues adoptent rarement des positions
aussi extrêmes, il reste qu'on peut les distin-
guer selon qu'ils mettent l'accent sur l'indi-
vidu ou sur des propriétés microsociales
pour expliquer les faits sociaux.

3
Piaget adopte, dans ce débat — et
avec une belle constance, cf. Piaget, 1917 —
une position intermédiaire. Pour lui, la tota-
lité sociale, qui a des propriétés nouvelles,
(c'est-à-dire qui ne sont pas des propriétés
des individus) modifie en retour les indivi-
dus. En situation d'équilibre, les interactions
interindividuelles font émerger le tout social
qui, en retour, conserve les individus. C'est
ce qu'il appelle « la conservation réciproque
du tout et des parties ». Un tel équilibre cor-
respond, au niveau des individus, à des
« états de conscience normatifs », c'est-à-
dire à des dettes et des obligations, comme
on l'a vu ci-dessus.
« L'équilibre idéal (la conservation
réciproque du tout et des parties) relève ici
de la coopération entre individus qui de-
viennent autonomes en vertu de cette coopé-
ration même. L'équilibre imparfait caractéri-
sé par la modification des parties par la tota-
lité apparaît ici sous la forme de contraintes
sociales... L'équilibre imparfait caractérisé
par la modification de la totalité par les par-
ties apparaît sous la forme d'égocentrisme
inconscient de l'individu, analogue à l'attitu-
de mentale des jeunes enfants qui ne savent
pas encore collaborer, ni coordonner leurs
points de vue » (Piaget, 1966:140).
Ce que Piaget appelle l'équilibre
« idéal », avec cette idée de conservation
réciproque du tout et des parties, renvoie
sans doute à la biologie. Dans les sciences
sociales, cependant, il n'y a pas vraiment de
raisons de privilégier cette conservation
réciproque par rapport aux équilibres qui ne
sont que structurels (la structure est stable,
mais les composantes — les individus —
peuvent changer). On peut même concevoir
des individus irrationnels (loin des « états de
conscience normatifs »), dont les interac-
tions sociales font émerger de l'ordre social
(Moessinger, 1996).
C'est bien parce que Piaget privilé-
gie la stabilité sociale par cohésion, par rap-
port à la stabilité uniquement structurelle,
qu’il est conduit à insister sur l'équilibre des
valeurs et de leur encadrement normatif. Un
tel point de vue le conduit à occulter les
conflits et à mettre l'accent sur la coopéra-
tion interpersonnelle et sur l'intégration so-
ciale.
Pierre MOESSINGER
Chargé de cours au
département de sociologie
de l'Université de Genève.
BIBLIOGRAPHIE
VALEURS, RÈGLES ET SIGNES, CONSTI-
TUENT, POUR PIAGET, LA RÉFÉRENCE
PRINCIPALE DES SCIENCES SOCIALES.
SANS DOUTE ACCORDE-T-IL UNE PRI-
MAUTÉ ONTOLOGIQUE AUX VALEURS.
C’EST BIEN PARCE QUE PIAGET PRIVI-
LÉGIE LA STABILITÉ SOCIALE, […]
QU’IL EST CONDUIT À INSISTER SUR
L’ÉQUILIBRE DES VALEURS ET DE
LEUR ENCADREMENT NORMATIF.

4
Piaget, J. (1917), Recherche, Lausanne : Édition la Concorde.
Piaget, J. (1965) Études sociologiques, Genève : Librairie Droz.
Piaget, J. (1966), Autobiographie, dans Jean Piaget et les sciences sociales (Cahier Vil-
fredo Pareto, 10), Genève : Librairie Droz.
Paiget, J. (1970), Épistémologie des sciences de l’homme, Paris : Gallimard.
Moessinger, P. (1996), Irrationalité individuelle et ordre social. Genève : librairie Droz.
1
/
4
100%