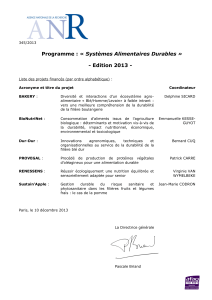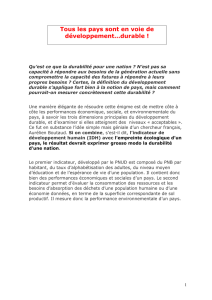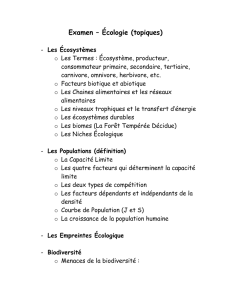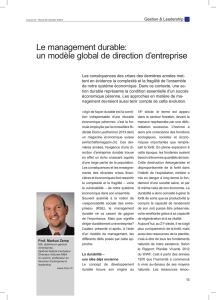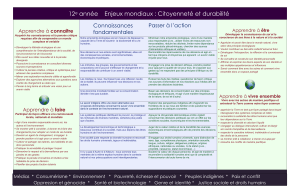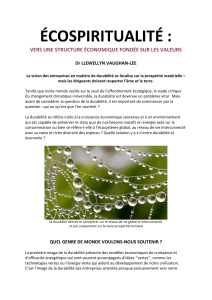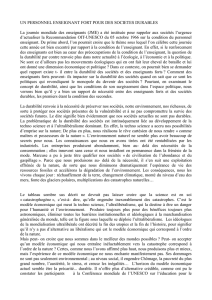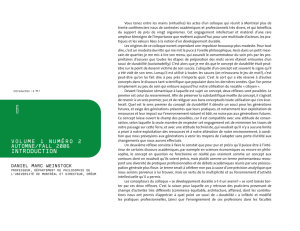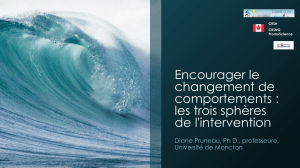Durabilité des services et productivité dans les services

1
Durabilité des services et productivité dans les
services : des notions difficilement
compatibles
Céline Merlin-Brogniart1
1 CLERSE, Université de Lille 1
Les services sont au cœur de nos économies modernes. Ils sont les prin-
cipaux contributeurs de l'emploi, du PIB et de la production d'innovation.
La problématique de développement durable, quant à elle, est devenue
progressivement un véritable projet de société. Cette communication
cherche à montrer que les activités de service, grâce à la proximité de
leurs caractéristiques avec certaines finalités du développement durable,
stimuleraient une dynamique de passage vers une société durable. Ces
activités jouent un rôle important dans le nécessaire renouvellement des
pratiques économiques et sociales. Cette société de service, construite
sur les bases d’une société industrielle, conserve cependant des caracté-
ristiques productivistes, en particulier pour la mesure de la performance.
Les mesures traditionnelles de productivité ne permettent pas de rendre
compte des performances multidimensionnelles des services, ni de la du-
rabilité des activités. L’utilisation d’un cadre d’évaluation de la perfor-
mance multicritère mettrait en évidence la performance des services et la
durabilité de ces activités, et serait en accord avec le projet de construc-
tion d’une société durable.
Les services sont au cœur de nos économies modernes. Ils sont les prin-
cipaux contributeurs de l'emploi, du PIB et de la production d'innovation.
Ils participent, de manière plus générale, à la performance du système
productif global. Ils forment en quelque sorte, la “nouvelle richesse des na-
tions” (Djellal, Gallouj, 2007).
Par ailleurs, plus de vingt ans après la parution du rapport « Brundtland »,
la problématique de développement durable s’est largement répandue,
elle est devenue un véritable projet de société sur lequel un grand nombre
d’acteurs travaille.
L’objectif de cette communication est de s’interroger sur la capacité des
activités de service à diriger la société vers un développement durable. Si
les caractéristiques des services tendent à rapprocher ces activités de la
notion de durabilité (Djellal, Gallouj, 2009), est-ce suffisant pour que la
croissance tertiaire soit favorable au développement durable ? Les activi-
tés de service sont-elles capables de prendre en compte les besoins pré-
sents mais aussi les besoins futurs ? Existe-t-il parmi les activités de ser-
vice, des services davantage susceptibles de stimuler une dynamique de
passage vers un développement durable, tout en favorisant la création de
valeur ?
Réfléchir sur l’économie des services conduit à parcourir d’autres disci-
plines. La question du développement durable amène les acteurs à dé-

2
placer les expériences innovantes dans les services aux frontières de la
sphère sociale, de la sphère économique et de la sphère politique (Land-
rieu, 2007). Dans la mesure où c’est l’usage qui crée la valeur d’un ser-
vice, il conviendra de croiser l’univers de la production et celui des usag-
es. Cette communication intègre une réflexion sur l’évolution des modes
de consommation des acteurs, vers de nouvelles manières d’agir, et ques-
tionne les modes de production des activités. Cette réflexion nous con-
duira à réfléchir sur les typologies existantes traitant de la durabilité des
services.
La société de service s’est construite progressivement autour d’un modèle
de société bâti sur une logique industrialiste. Elle a donc emprunté aux en-
treprises manufacturières les modes de mesures de la performance. Ces
mesures se sont basées sur les techniques productivistes appliquées à
cette période. Confrontés aux spécificités des services, de plus en plus
d’auteurs mettent en avant la difficulté de ces techniques de mesure à
rendre compte de la spécificité des services ? (Gadrey, 1989 ; Djellal, Gal-
louj, 2007). Par ailleurs, les besoins susceptibles d’être satisfaits par les
services sont pluriels, ils intègrent par nature ou par prise de conscience,
de multiples facettes (économiques, sociales et écologiques). Ces outils
de mesure nous permettent-ils d’appréhender la durabilité sous toutes ces
formes? Faut-il repenser le cadre analytique de la performance ?
L’utilisation d’un cadre d’analytique multicritère permettrait par exemple de
prendre en compte l’ensemble des dimensions du service durable.
Notre communication ne prétend pas donner une réponse définitive à ces
questions, mais cherche plutôt à présenter des pistes de réflexion à partir
des travaux réalisés sur ce sujet. Ces pistes amèneront à des recherches
futures.
Afin d’étudier le lien entre les activités de services et la durabilité, nous
proposons, une fois la notion de durabilité analysée, d’articuler les carac-
téristiques des activités de service avec la problématique de durabilité et
d’étudier les typologies existantes sur la durabilité des services. Dans une
deuxième partie, nous réfléchirons à la pertinence du type de performance
des services qui est actuellement mesuré. Cette mesure de la perfor-
mance est-elle en accord avec les projets de société existants ?
1. L’analogie entre les activités de service et la
problématique du développement durable
Avant d’étudier les analogies entre les services et la problématique du développe-
ment durable, revenons sur la notion de durabilité.
Le terme « durable » est utilisé par opposition à « l’éphémère » qui caractérise en-
core aujourd’hui nos sociétés de consommation. Ce terme, associé à la notion de «
développement durable », traduit de l’anglais sustainable development, peut prêter à
confusion. Le terme durable met plutôt l’accent sur la cohérence entre les besoins et
les ressources globales de la planète sur le long terme. Il insiste moins sur les chan-
gements de société rendus nécessaires pour la mise en œuvre d’un développement

3
durable. Le terme « soutenable » (sustainable), quant à lui, exprime davantage la
capacité d’un phénomène à s’auto-entretenir afin d’assurer sa pérennité, plutôt qu’il
ne traduit l’état de ce qui dure. Nous emploierons ici le terme « durable » comme un
terme englobant la notion de durabilité et de soutenabilité.
Le rapport « Bundtland » définit le développement à partir d’une vision intergénéra-
tionnelle. Le développement durable est perçu comme « un développement qui ré-
pond aux besoins des générations du présent sans compromettre la capacité des
générations futures à répondre aux leurs »1. L’horizon temporel est donc fortement
étendu par rapport à l’horizon contemporain limité de la société de consommation, et
même relativement à l’horizon des préoccupations politiques. La notion de dévelop-
pement durable a conduit à élargir la notion de capital au-delà du capital économique
traditionnel. Le stock de capital comporte aussi le capital écologique (les ressources
naturelles dont hériteront les générations futures) ainsi que le capital d’équité sociale
(qui consiste en l’accès aux richesses, à la répartition de la richesse ou encore à
l’équité intergénérationnelle).
Afin de vérifier si la notion de « services durables » a un sens, nous cherchons tout
d’abord à vérifier si la transposition de la définition du développement durable aux
services est envisageable. Les services sont-ils capables de satisfaire les besoins
des générations présentes sans empêcher les générations futures de répondre à
leurs propres besoins?
1.1. Les dimensions de la durabilité et les services
En suivant la définition de G. H. Brundtland, un service durable devrait répondre à
trois séries de besoins ou d’objectifs de production. Ces objectifs peuvent être pré-
sentés sous la forme d’hypothèses qu’il conviendra par la suite de tester. Ces hypo-
thèses sont les suivantes :
• Un service serait économiquement durable s’il satisfait aux exigences de la pro-
duction à la fois présentes et futures ;
• Un service serait socialement durable s’il génère des interactions sociales et de
l’équité sociale sur longue durée ;
• Un service serait écologiquement durable s’il ne contribue pas (ou peu) à la dé-
gradation de l’environnement
Réfléchissons aux contextes dans lesquels les activités de service rencontrent ces
trois types de durabilité. Nous remarquons que la durabilité a été abordée avant tout
de manière curative ou défensive en réponse à l’apparition des externalités néga-
tives engendrées par les activités humaines. Les actions mises en œuvre dans ce
cadre relèvent de tentatives de réparation. Dans le cas des services, la durabilité
peut aussi se concevoir en actions préventives. Ces dernières seront davantage pré-
sentes dans la recherche d’une durabilité sociale que d’une durabilité écologique.
1 «development that meets the needs of the present without compromising the ability of future genera-
tions to meet their own needs» ; WCED, Our Common Future, 1987, Oxford, O.U.P., p. 43

4
Le tableau 1 reprend les objectifs des services relevant d’actions préventives et
d’actions défensives dans les trois dimensions de la durabilité (sociale, écologique et
économique).
Service et durabilité sociale
La dimension sociale des services est liée au caractère interactif des services. Une
activité de service peut être définie comme « « une « opération » visant une « trans-
formation d’état » d’une réalité C, possédée, contrôlée ou utilisée par un agent B,
réalisée par un prestataire A à la demande de B , mais n’aboutissant pas à la pro-
duction d’un bien susceptible de circuler économiquement indépendamment du sup-
port C. » (Gadrey 2008, p 13). Pour réaliser cette opération, la plupart des services
nécessitent une rencontre physique entre le prestataire de service (A) et son destina-
taire (B) afin de « rendre un service » ou de coproduire le service. Par conséquent, le
client ne peut être ignoré.
La principale valeur dégagée par les services est le lien social qu’il créé ou maintien
grâce à cette dimension d’interactivité. C’est en quelque sorte la nature même des
services qui a conduit ces activités à prendre en compte la question sociale. La di-
mension sociale participe de la qualité de service. De ce fait, la durabilité sociale
constitue par nature un objectif des activités de service.
Certains services participent à la création ou la préservation des liens sociaux par
nature, comme les services de traitement de l’individu dans ses dimensions cogni-
tives (ex : enseignement) physiologiques (ex : santé) ainsi que les services de
proximité (qui participent notamment à la dimension esthétique de l’individu).
D’autres services ont une finalité sociale et civique (les services publics marchands
ou non marchands, les associations). Ils maintiennent de la cohésion sociale.
D’autres services enfin, génèrent du progrès social car leurs règles de fonctionne-
ment impliquent l’usage d’une démocratie (participative) qui est sensée dégager da-
vantage de diversité (économie sociale et solidaire).
La durabilité sociale étant une finalité pour de nombreux services, nous considérons
qu’elle relève d’actions préventives en faveur du développement durable, même si à
l’origine leur conception relève davantage d’une durabilité économique. Ces actions
relèvent des services précédemment énoncés. Il est possible de considérer que la
maîtrise des risques introduit dans les services d’alimentation ou de santé, participe
de la dimension sociale dans la mesure où elle a un impact positif sur la santé de la
population.
D’autres actions sont menées en perspective de réparation (actions curatives). Ce
sont les prestations de service délivrées afin de rétablir la cohésion sociale, de ré-
duire le déficit de services en zone rurale, et de favoriser les mutualisations de ser-
vices permettant de continuer à délivrer les services tout en réduisant les coûts. Ces
actions peuvent se traduire en réorganisation des services publics, en ouverture de
centres d’aide (aide à la création d’entreprise par exemple) ou dans de nouvelles
solutions de délivrance du service (ex point PIMMS regroupant plusieurs services en
réseau).

5
Un autre grand objectif de la durabilité sociale est la création d’emplois. De nom-
breux auteurs soulignent la forte capacité actuelle des services à créer des emplois2.
Cette capacité a été expliquée dans un premier temps par la faiblesse des gains de
productivité dans les services (Baumol, 1966). Cette explication n’est pas suffisante.
D’une part, il semblerait que la mesure de la productivité dans les services ne reflète
pas le potentiel de performance de ces activités, car cette mesure ne correspondrait
pas à la nature des services (c’est ce que nous développerons dans la deuxième
partie) ; d’autre part, ce constat de la croissance des emplois dans les services est à
nuancer car toutes les catégories de service ne devraient pas continuer à obtenir une
telle croissance si un modèle de croissance durable est progressivement mis en
place (Gadrey, 2008). Selon cet auteur, les services les plus socialement durables
(les services qui répondent à des besoins sociaux et des besoins de proximité) de-
vraient continuer à créer des emplois. Il s’agit des services précédemment cités ré-
pondant à la durabilité sociale. En revanche, les services peu durables dans leur di-
mension écologique devraient voir leur nombre d’emplois diminuer. En effet, la
recherche d’une croissance moins consommatrice en ressources naturelles et éner-
gétiques, et moins « matérielle » créerait des emplois dans des secteurs actuelle-
ment peu créateurs d’emploi, comme l’agriculture (les produits verts étant plus exi-
geants en emploi) ; dans les métiers associés aux énergies renouvelables (comme le
bâtiment ou les services énergétiques, etc.) et dans les services précédemment cités
répondant à la durabilité sociale. Dans cet article de 2008, J. Gadrey propose une
typologie des services « perdants » et « gagnants » en emploi. Cette typologie fine3 ,
peut être considérée comme une autre typologie incluant les services durables.
Service et durabilité écologique
La question de la durabilité écologique est apparue suite à la prise de conscience
selon laquelle le rapport homme-nature s’est modifié. Avant, la nature donnait les
moyens de produire mais on ne se souciait pas ou peu des problèmes
d’irréversibilité. Aujourd’hui, les acteurs ont pris conscience des effets à long terme
de leurs prises de décisions actuelles ainsi que de l’impact à la fois local et global de
ces effets.
La réflexion sur la durabilité écologique a commencé par être appliquée à
l’agriculture et à l’industrie. L’économie écologique a d’ailleurs ignoré l’économie des
services (à l’exception des transports) (Gadrey, 2008). Le développement durable
conserve de ce fait une « connotation industrielle » (Djellal Gallouj, 2009). Les ser-
vices sont pourtant aussi porteurs d’externalités négatives.
Dans les services, l’apparition du développement durable a ainsi plutôt été un dé-
clencheur des actions en faveur de l’environnement. Par conséquent, ces actions
sont surtout curatives ou défensives. Cela se traduit dans les entreprises, par la mise
en place d’indicateurs de développement durable souvent déjà standardisés (ex :
consommation en CO2 du parc de véhicule de l’entreprise, réduction des ressources
2 En trente ans, les entreprises de services ont créé 3,5 millions d’emplois en France (solde net du
pays = 2,8 millions d’emplois) (Djellal, Gallouj, 2007)
3 Tableau non repris ici
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
1
/
27
100%