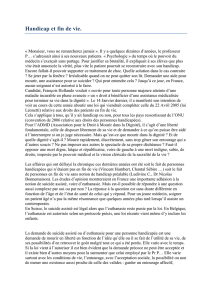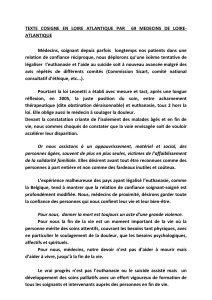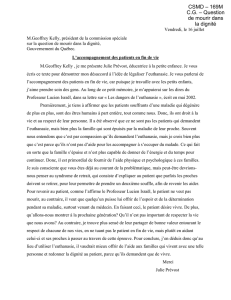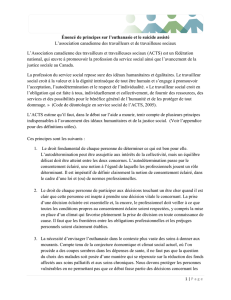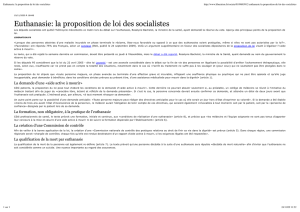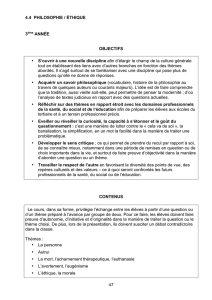l`existence et la mort

L’EXISTENCE ET LA MORT
La Jeune Fille et la Mort par Hans Baldung, XVIe siècle
JEAN-LOUIS CHEVREAU Institut Municipal Angers 2014

2
PREMIER COURS
INTRODUCTION
Vous avez constaté comme moi que dans le roman l’auteur est le double de celui
qui parle (le narrateur ou le protagoniste) et par conséquent il ne se cache pas. Il en va
tout autrement avec le philosophe qui semble se cacher dans sa philosophie. Le
discours philosophique serait impersonnel, puisqu’il est abstrait et conceptuel. Mais
c’est oublier que la philosophie est aussi un mode littéraire puisqu’elle comporte les
mêmes genres (poèmes, maximes, dialogues, sermons, leçons, conférences, traités,
commentaires, méditations, essais…) en ajoutant que la philosophie est aussi
reconnaissable au style de l’auteur . Cependant à la différence du roman, il permet à
son auteur « d’avancer masqué » comme le dit Descartes. Masqué peut-être, mais
tout en se cachant, il se révèle plus encore. C’est ce que souligne également
Nietzsche, en disant qu’il a « longtemps examiné chez les philosophes ce qu’ils
cachaient entre les lignes… » Certes le philosophe semble pudique et ne pas vouloir
s’exposer frontalement. Toutefois la pensée philosophique s’arrime nécessairement à
des expériences vécues, qui sont souvent la source de réflexions exprimées
abstraitement. Le cas de Descartes est éloquent en ce domaine, puisque toute l’œuvre
fait référence à de nombreuses expériences vécues, parfois intimes, touchantes ou
même cocasses, comme cette aventure qu’il eut alors enfant, avec une petite fille qui
louchait.
Je ne suis pas Descartes, loin delà, et je ne suis jamais tombé amoureux
d’une petite fille qui louchait, mais j’ai modestement eu mes propres expériences,
lesquelles ont été des sources importantes dans la prise de conscience de mon
existence personnelle. Cette découverte de l’originalité de mon existence, originale au
sens où je suis seul à la vivre, m’est tout d’abord venue très jeune, de mes premiers
voyages. Comme je l’ai dit au début de la série de mes cours sur « Philosophie du
voyage », ce n’est pas la philosophie qui alimente la vie, c’est la vie qui alimente la
philosophie. C’est donc à partir de ce désir de voyager depuis mon adolescence, que
je vais rechercher les éléments nourriciers ou fécondants de l’autre aventure de ma
vie : la philosophie.
Cette découverte de l’originalité de mon existence s’est établie très tôt sur la
reconnaissance du caractère indépassable et contingent de mon existence (pourquoi
j’existe ?), mais aussi de ma subjectivité mortelle. J’ai vécu toute ma vie avec la
certitude de ma finitude. Ce fut pour moi l’expérience marquante du caractère tragique
de l’existence. Ce qui ne s’opposait pas à un sentiment de quiétude, de bien-être, et

3
pour tout dire de joie devant la vie heureuse et paisible que j’avais la chance de vivre.
Nous verrons pourquoi par ailleurs, penser à la mort, c’est penser à la vie.
Comme tout à chacun, j’ai eu à vivre aussi la tragédie de la mort de mes proches,
de mes parents, ce qui m’a beaucoup appris sur certaines idéologies du monde
médical, expérience qui est aussi à l’origine de mon questionnement sur la fin de vie
lorsqu’elle est dramatique. Mais cette douloureuse expérience n’a jamais effacé ma
joie d’exister (je rappelle que la joie ce n’est pas toujours le plaisir, mais le sentiment
qui se dégage de l’acceptation sereine de la nature, pour parler comme Spinoza).
En somme, cette prise de conscience du caractère tragique de l’existence,
c’est la reconnaissance de ce qu’est en elle-même l’existence, c’est-à-dire de sa
propre finitude (désigne le caractère de l’homme en tant qu’il est mortel). C’est en cela
que la tragédie grecque est reconnaissance de l’irrémédiable et du même coup, elle
donne aux passions humaines toute leur force. Seule la conscience de notre finitude
alimente cet élan créateur (parfois déraisonnable et terrifiant) que sont les passions.
Les animaux n’ont pas de passion, car ils n’ont pas cette conscience de leur finitude :
ils vivent. Ils vivent dans l’immédiateté selon des processus instinctifs qui n’évolueront
guère avec le temps. À contrario de la vie animale, nous verrons que la question du
temps est centrale pour comprendre le sens de l’existence humaine. Exister, n’est-ce
pas s’ouvrir au temps ?
Questions que nous devons nous poser :
Première question : Problèmes de définitions. Définition du concept d’ « être »,
puis distinction et définition du concept d’existence, que nous aurons aussi à distinguer
de celui de « vivre » ou « être vivant » ou « le vivant ».
Deuxième question : Suffit-il d’être pour exister ?
Troisième question : Exister est-ce seulement se contenter de vivre ?
L’homme n’est-il pas l’être qui risque sa vie pour donner du sens à son existence ?
N’est-il pas l’être capable de refuser la vie si son existence n’a plus de sens ?
Quatrième question : Quelle est donc cette temporalité propre à l’existence
humaine ?
Donc il y a quelque chose de spécifiquement humain dans cette notion
d’existence qu’il nous faudra approfondir, et conjointement, l’autre notion attenante : la
mort.
Mais nous verrons aussi que cette notion d’existence pose problème pour la
philosophie. En effet, si l’existence relève de ce sentiment propre à chacun, d’être un

4
existant unique, singulier donc absolument différent, comment le penser
philosophiquement ? Je rappelle que la philosophie c’est un discours conceptuel ;
comment alors saisir avec un concept, qui n’est qu’une idée abstraite forgée par
l’esprit, ce qui est le contraire du singulier, du particulier ? Il est aisé de définir avec un
concept un triangle ou un mammifère, car nous avons affaire en tout premier lieu à des
essences. L’existence, tout au contraire, c’est ce qui est propre à ma subjectivité et qui
peut faire, pour parler comme Kant, l’objet d’une intuition sensible.
Il nous faudra donc en première partie, nous interroger sur ce qui sépare,
l’existence de l’être, l’existence de la vie, mais aussi l’essence de l’existence. Nous
verrons ensuite comment une philosophie de l’existence (l’existentialisme) définit le
sens de l’existence, son rapport au temps, et la morale de l’action qui s’en dégage.
Puis en deuxième partie de nos cours, nous rentrerons dans la pensée de ce
qui fût, depuis les Grecs, le socle de la philosophie : la mort. Deux perspectives
opposées semblent se dégager des philosophies de l’existence : soit pour certains, la
mort devient le sens de la vie, soit pour d’autres, la mort finit la vie, mais ne la définit
pas.
« La mort est un phénomène humain, c’est le phénomène ultime de la vie » (…) par
là je deviens responsable de ma mort comme de ma vie » dit Sartre.
Deux points semblent intéressants à propos de cette question de vivre avec la
mort : premièrement il faut situer cette question dans son rapport historique. Nous
pouvons constater une grande évolution dans notre représentation de la mort. Au
Moyen Âge les représentations et les comportements face à la mort diffèrent
totalement de ce qu’ils sont aujourd’hui. Comme le disait La Rochefoucauld : « Ni la
mort ni le soleil ne peuvent se regarder en face », il semble qu’au XIXe siècle en
Occident, ni la mort, ni le sexe ne peuvent se regarder en face. Aujourd’hui le sexe
peut se dire et se regarder en face, mais qu’en est-il de la mort, et pourquoi est-elle
devenue un « tabou » ?
Deuxièmement nous pouvons remarquer une certaine évolution des mentalités
en Occident concernant la fin de vie. Nous interrogerons, d’une part cette manière de
vivre philosophique qui depuis les Stoïciens jusqu’à aujourd’hui, pense la philosophie
comme support possible pour « apprendre à vivre » donc également pour « apprendre
à mourir ». Nous verrons comment une « philo-thérapie » contemporaine semble
possible, qui propose des approches intéressantes. Et d’autre part, nous interrogerons
également, le difficile problème que pose le suicide et les réactions qu’il suscite, et
enfin, les nouvelles conceptions sur notre fin de vie, et une demande d’assistance à
mourir dans certaines situations.
Nous poserons donc la question très actuelle de la mort volontaire, de l’euthanasie
et du suicide assisté, ce qu’une association l’ADMD appelle « le droit de mourir dans la
dignité ». Pourquoi faut-il légiférer dans ce domaine ? La question de l’euthanasie et

5
du suicide assisté, pose des problèmes délicats, selon des points de vue opposés qu’il
faudra analyser. Tout problème existentiel qui engage la morale ou l’éthique, suppose
un choix libre, pas toujours facile, mais que chacun, et lui seul, doit faire.
Quelques problèmes qui se posent :
- Qu’en est-il de la vie, lorsque la qualité de la vie s’est enfuie ?
- Même si la vie est une valeur, doit-elle être maintenue à tout prix ?
- Si l’on peut douter de la sacralité de la vie, faut-il pour autant refuser la
passivité et la vulnérabilité de notre condition humaine ?
- La fin de la vie n’est-elle pas aussi la vie ?
- Qu’en est-il de la fin de vie en détresse et en souffrance ?
- La question de l’euthanasie est-elle seulement une question éthique et morale,
n’est-elle pas avant tout une question de droit, puisqu’elle se pratique
clandestinement ?
- N’est-il pas absurde d’établir une exception d’euthanasie (loi de 2005) sans
une loi sur l’euthanasie selon des conditions définies ?
- Enfin il nous faudra comprendre avec des paléontologues comme Leroi-
Gourhan et des historiens comme Philippe Ariès comment l’ évolution de notre
humanité et nos représentations de la mort ont évolué avec le temps : depuis
les premières inhumations à la mort apprivoisée en pensant par la mort
interdite.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
 90
90
 91
91
 92
92
 93
93
 94
94
 95
95
 96
96
 97
97
 98
98
 99
99
 100
100
 101
101
 102
102
 103
103
 104
104
 105
105
 106
106
 107
107
 108
108
 109
109
 110
110
 111
111
 112
112
 113
113
 114
114
 115
115
 116
116
 117
117
 118
118
 119
119
 120
120
 121
121
 122
122
 123
123
 124
124
 125
125
 126
126
1
/
126
100%