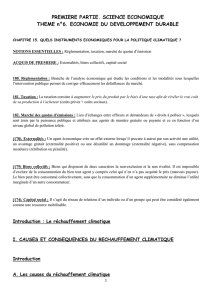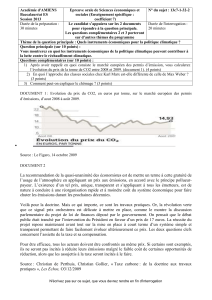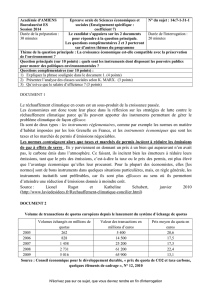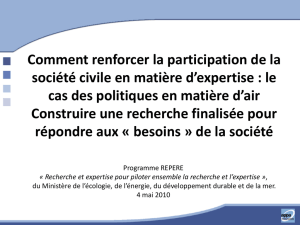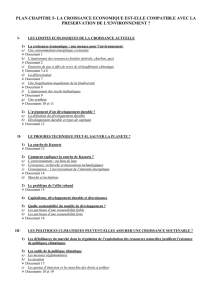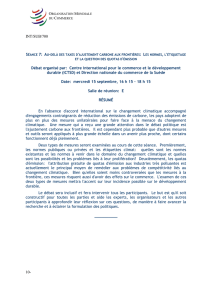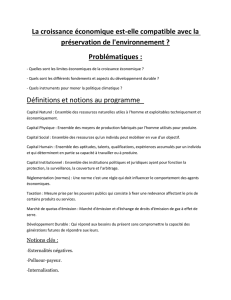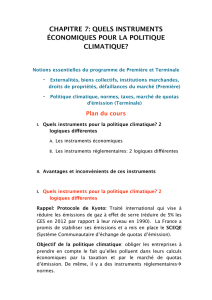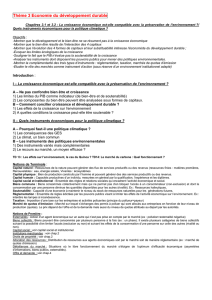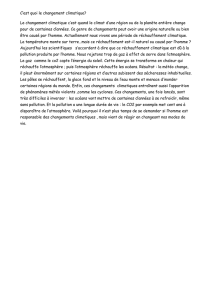Bilan : le film souligne les limites écologiques de la croissance

Chapitre 2 : La croissance économique est-elle compatible avec la
préservation de l’environnement ?
Notions : Capital naturel, physique, humain, institutionnel, biens communs, soutenabilité,
réglementation, taxation, marché de quotas d’émission
Acquis de première : externalités, droits de propriété, offre et demande, défaillances du marché.
IC : On expliquera pourquoi l’analyse économique du développement durable, qui se fonde sur la
préservation des possibilités de développement pour les générations futures, s’intéresse au niveau et à
l’évolution des stocks de chaque type de capital (accumulation et destruction) ainsi qu’à la question
décisive du degré de substitution entre ces différents capitaux. On évoquera, à l’aide d’exemples, les
limites écologiques auxquelles se heurte la croissance économique (épuisement des ressources
énergétiques et des réserves halieutiques, déforestation, augmentation de la concentration des gaz à
effet de serre, etc.).
L’exemple de la politique climatique permettra d’analyser les instruments dont disposent les pouvoirs
publics pour mener des politiques environnementales. En lien avec le programme de première sur les
marchés et leurs défaillances, on montrera la complémentarité des trois types d’instruments que sont
la réglementation, la taxation, les marchés de quotas d’émission.
Sensibilisation : une vérité qui dérange.
Une vérité qui dérange, Al Gore (documentaire vidéo).
Premier extrait : pourquoi Al Gore s’est-il intéressé au changement climatique et les manifestations
du changement climatique : 11’15-23’50
Deuxième extrait : les manifestations du changement climatique (suite) 27’-31’30
48’
Quatrième extrait : la responsabilité humaine. : 1h03-1h06’45
Dernier extrait : la volonté politique: 1h20
1. De quand datent les premières données mettant en évidence le phénomène de réchauffement
climatique ? Des années 1960.
2. Quelles sont les causes du réchauffement climatique ? Emissions de gaz à effet de serre (CO2,
méthane, vapeur d'eau...) => corrélation concentration en CO2 et températures.
=> Hausse des émissions de CO2 depuis le 19ème siècle <=> Taux inédits dans l'histoire de la Terre :
industrialisation et développement des transports ;
<=> Usage intensif d'énergies fossiles : charbon, pétrole, gaz naturel.
3. Quelles sont les conséquences du réchauffement climatique ? Fonte des calottes glaciaires ; montée
des océans (certaines terres menacées : Maldives, Bangladesh => Réfugiés climatiques) ; multiplication
des phénomènes climatiques extrêmes : tempêtes, inondations... ; sécheresses et canicules (Cf. Europe
été 2003, USA été 2012).
=> Conséquences économiques, sociales et politiques du réchauffement climatique : famines,
maladies, déplacements de population (réfugiés climatiques), conflits...
4. Quelle est la responsabilité humaine dans le réchauffement climatique que la planète connaît
actuellement ? Ce qui fait la spécificité du réchauffement climatique actuel c’est la responsabilité des
activités humaines : Al Gore insiste sur la responsabilité des Etats-Unis dans ce processus d’une
ampleur inédite; 2007 : 4ème rapport du GIEC = 1er consensus mondial sur la responsabilité humaine
dans le réchauffement climatique
5. Comment la sphère politique réagit-elle face à ces enjeux ? Pas de réaction significative (Cf. refus
des USA de signer le protocole de Kyoto...).

Bilan : le film souligne les limites écologiques de la croissance : la croissance démographique, la
production et la consommation font subir une forte pression à l’environnement, au climat, aux
ressources naturelles et aux autres espèces animales. L’augmentation des gaz à effet de serre, la
déforestation et l’épuisement des ressources naturelles ont des conséquences écologiques mais aussi
sociales et économiques dramatiques.
http://climate.nasa.gov/interactives/climate_time_machine
Bilan introduction : La formulation du chapitre sous-entend l’existence d’une contradiction entre la
hausse continue des richesses créées et le développement durable, défini à partir de ses trois
dimensions : économique, sociale et environnementale. Ce chapitre commence donc par donner des
exemples d’externalités négatives, qui posent la question de la soutenabilité de la croissance
économique et tendent à confirmer son incompatibilité avec la préservation de l’environnement. Il se
termine en réfléchissant aux moyens de réconcilier l’une avec les autres. => Problématique : Comment
les limites écologiques de la croissance imposent-elles de modifier notre mode de production et
d’opter pour un développement durable ?
I. Quel est l’impact de la croissance économique sur
l’environnement ?
Sorte d’intro (partie plus courte)
Notions : biens communs, externalités, soutenabilité.
A. Une présentation stylisée/théorique/graphique du lien entre croissance
économique et environnement…
Doc.1 p 144 Manuel : Partie A. La courbe environnementale de Kuznets : entre théorie et observation
Question. Que montre la courbe environnementale de Kuznets? A l’aide de cette courbe, justifiez le
titre de cette double page « la croissance économique : une chance pour l’environnement ? »
La courbe environnementale de Kuznets montre une corrélation (un lien) entre deux variables : le
PIB/tête et la pollution.
Dans un premier temps, cette corrélation est positive : hausse du PIB/tête => hausse de la pollution
(économies pré-industrielles). Puis après une période de stabilisation (augmentation du PIB conduit à
une stabilisation de la pollution : pays en voie d’industrialisation ou pays émergents), la corrélation
devient négative : hausse du PIB/tête => baisse de la pollution (économies post-industrielles).
Comment l’expliquer ? Cette corrélation est-elle une causalité ?
Causalité = une variable, par exemple le PIB/hbt, explique l’autre, par exemple la pollution. Une
corrélation n’est pas toujours une causalité : il peut y avoir une variable cachée ou alors on ne sait pas
dans quel sens va la causalité. Cf Manuel p. 444.
Les auteurs de la courbe soulignent 3 effets pour expliquer la courbe et son évolution :
-l’effet d’échelle : une hausse de l’activité économique => plus forte pression sur l’environnement : +
de pollution et de déchets.
-l’effet de composition : à partir d’un certain seuil de développement économique, et le pays tend à
développer des activités « propres » : déclin du secteur secondaire intensif en énergie et produisant
d’importants rejets polluants, développement du secteur tertiaire intensif en technologie et en capital
humain => baisse de la pollution.
-l’effet technologique : à partir d’un certain niveau de développement, le pays va accroitre ses
dépenses en R&D et améliorer l’efficacité écologique de la production (produire de manière plus
propre) : rôle des innovations et de la technologie.

A partir d’un certain seuil de richesses, l’effet d’échelle est plus que compensé par l’effet de
composition et surtout par l’effet technologique.
Autre explication : statut de bien de luxe de l’environnement : plus les individus sont riches, plus ils
accordent de l’importance à la qualité de l’air qu’ils respirent.
Selon la courbe environnementale de Kuznets, les pays émergents devraient être les plus gros
pollueurs et les pays riches les pays les moins pollueurs.
Précision : La courbe de Kuznets désigne au départ la corrélation entre croissance et inégalités
représentée sous la forme d’une courbe en U inversé entre PIB/hbt et inégallités. Kuznets a reçu le prix
Nobel en 1971. Une relation similaire entre le PIB/hbt et le niveau de pollution va être démontrée et
va prendre le nom de courbe environnementale de Kuznets, et ce même si cette découverte ne
découle pas des travaux de cet économiste.
Paradoxe : Les pays les plus riches continuent de polluer voire sont les plus gros pollueurs ? Certaines
tendances défavorables à l’environnement persistent dans les pays industrialisés riches
B. …partiellement invalidée dans la réalité
1. Qui pollue ?
Doc 2 p 148 Manuel (questions modifiées) : Le PIB et l’oubli de la soutenabilité.
Q2 du manuel : que suggère le graphique ? en quoi entre-t-il en contradiction avec la courbe
environnementale de Kuznets ?
= corrélation qui contredit la courbe de Kuznets. Les pays développés sont les principaux émetteurs
de gaz à effet de serre.
Question supplémentaire : Que peut-on déduire de la comparaison entre le Canada et la Suisse sur
l’intensité carbone de la croissance dans ces deux pays ?
Même niveau de richesse mais beaucoup plus d’émissions de carbone pour le Canada.
Bilan du doc : Problèmes de pollution et de surexploitation des ressources continuent de se poser
dans les pays développés. La relation mise en évidence par la courbe environnementale de Kuznets
n’est vérifiée que pour certaines pollutions. Cf Doc 1 p 144 partie B : l’émission de polluants liée à la
consommation d’énergie suit la courbe environnementale mais ce n’est pas le cas du rejet du CO2 ou
des ordures ou même du dioxyde de souffre.
Quelle est la notion économique que l’économiste utilise pour penser la pollution ?
Rappel 1è: Externalités : conséquences positives ou négatives que l’activité d’un acteur économique
entraîne pour au moins un autre acteur dans qu’il y ait eu entre eux échange marchand et donc sans
compensation monétaire ou signature d’un contrat. Pour les questions environnementales, on est en
face d’externalités négatives générées par les activités humaines de production et de consommation.
Eventuellement : La question de l’empreinte écologique.
Doc 3 p 149 Manuel : quels indicateurs statistiques aleternatifs de développement soutenable ?
(questions modifiées)
L’empreinte écologique est un indicateur qui évalue toute la surface nécessaire pour produire ce que
consomme un individu ou une population pour son alimentation, ses déplacements, … ainsi que pour
absorber les déchets rejetés. La surface est mesurée en hectares. Quand l’empreinte écologique
dépasse la biocapacité, la terre est en situation de « dépassement écologique ». C’est un indicateur

qui permet de mesurer le caractère durable de la croissance. + = réserve écologique. - = déficit
écologique. Nous sommes actuellement en situation de dépassement écologique.
Question : quels sont les pays qui ont la plus forte empreinte écologique ? Reliez votre réponse à la
courbe environnementale de Kuznets.
Les pays à la plus forte empreinte : Amérique du nord, UE = pays riches + Moyen Orient et Asie Centrale
et Asie-Pacifique. Or on sait que ces pays sont des pays développés (pour les deux premiers). => Lien
entre la croissance économique et l’empreinte écologique.
Comment l’expliquer ? Cette corrélation correspond également à un lien de cause à effet. La
croissance du niveau de vie d’une population s’accompagne de la modification de son mode de vie :
hausse de la consommation de viande ou de poissons, hausse de la quantité de déchets, hausse des
surfaces utilisées à la construction d’infrastructures scolaires, médicales ou culturelles. La croissance
de la population, rendue possible par la croissance des richesses créées augmente aussi la part des
surfaces nécessaires à l’habitat. La croissance du niveau de vie de la population favorise donc aussi la
hausse de son empreinte écologique.
Toutefois, au-delà d’un certain niveau de croissance économique, l’intensité en ressources naturelles
de la production diminue. Des ressources financières sont dégagées pour développer des techniques
de production moins coûteuses en capital naturel. Ainsi, l’empreinte écologique de la France, bien
qu’insoutenable à long terme, n’a pas augmenté depuis 2000, malgré la hausse de son PIB par habitant.
On retrouve la prévision de Kuznets.
2. La surexploitation des biens communs
A priori tout le monde tout le monde épuise nos ressources naturelles. Aborder la question de la
surexploitation des biens communs.
Rappel 1è : Un bien commun est un bien non-exclusif (il est impossible d’interdire l’accès à cette
ressource commune ou aux services qu’elle rend) mais rival (la consommation du bien par un individu
empêche la consommation par un autre). Exemple : un banc de poisson : la capture d’un banc de
poisson par un pêcheur empêche sa capture par un autre pêcheur. A ne pas confondre avec les biens
collectifs (étudiés en 1ère) pour lesquels il n'y a ni rivalité ni exclusion par les prix. Nous avions vu que
le marché était incapable de les produire (cas de défaillance du marché).
Du fait de leurs caractéristiques, les biens communs sont menacés de surexploitation. C’est la tragédie
des biens communs soulignée par l’économiste Hardin en 1968. Hardin prend l’exemple d’un pâturage
ouvert à tous (pas de droits de propriété). Chaque éleveur va chercher à maximiser son avantage
individuel en augmentant autant qu’il le peut la taille du troupeau sur ces pâturages librement
accessibles. Le résultat est la disparition de la ressource (il n'y a plus d’herbe pour faire manger les
troupeaux).
On est confronté aujourd’hui à ce problème avec la surpêche qui conduit à ce que des espèces sont
menacées de disparition (thons rouges de Méditerranée).
Oström, prix nobel en 2010 a complété la réflexion sur la surexploitation des biens communs et ajoute
un élément d’explication : l’absence de droits de propriété combinée à l’absence de surveillance de
l’exploitation de la ressource naturelle conduit à sa surexploitation. Elle fournit de nombreux
exemples, notamment dans le secteur de la pêche. En Turquie, dans la Baie d’Izmir : il y a environ 700
pêcheurs c'est-à-dire beaucoup trop pour le nombre de poissons disponibles. Cependant, on note qu’il
n’y a eu mise en place d’aucune règle opérationnelle pour résoudre les conflits. En effet, la loi exige
qu’il y ait une licence mais ne limite pas le nombre de licences. Par ailleurs, on a bien décidé de forcer
les chalutiers à pêcher dans un périmètre bien précis, mais personne n’a été engagé pour contrôler.
La surexploitation des ressources halieutiques :

On observe ainsi une tendance générale et rationnelle à la surexploitation des ressources des
biens communs en raison de l’absence de droits de propriété et de surveillance.
On peut également évoquer la question de la surexploitation des matières premières : charbon puis
pétrole.
Eventuellement : Doc. 2 p. 146 : L’épuisement des ressources naturelles : l’exemple du pétrole
1. Le pic pétrolier est le sommet de la courbe de production d'un puits, d'un champ pétrolier ou d’une
région de production ; l’expression « pic pétrolier » (ou peak oil en anglais) désigne le plus souvent le
pic pétrolier mondial, le moment où la production mondiale de pétrole plafonne avant de commencer
à décliner du fait de l'épuisement des réserves de pétrole exploitables. Le pétrole se raréfie et la
communauté mondiale se rapproche du pic à partir duquel son exploitation va commencer à décroître
et le coût de production commencer à augmenter. L’épuisement des gisements conventionnels oblige
déjà les producteurs à se tourner vers le pétrole non conventionnel, plus coûteux.
2. La notion de pic de production renvoie au caractère épuisable des ressources pétrolières. C’est parce
que la ressource n’est pas renouvelable qu’un tel pic existe. Au-delà, la notion de pic de pétrole pose
la question de l’après-pétrole.
3. Le pic de production est établi sur la base des ressources connues en pétrole. Or l’estimation de ces
réserves est sujette à caution. Par ailleurs, la notion de pic de pétrole exige également une estimation
de l’évolution de la consommation de pétrole, elle aussi incertaine (cf. doc. 4, p. 145).
Bilan du doc : Une des contraintes qui repose sur la croissance économique est l’épuisement
programmé des réserves de pétrole, puis de gaz. Selon l’AIE, le pic pétrolier est derrière nous : il a été
atteint en 2006. Cas de surexploitation des biens communs.
Bilan : les premières prises de conscience des effets néfastes de la croissance sur notre
environnement datent des années 1960-70 (CF Al Gore). La croissance économique présente des
limites écologiques de deux ordres :
-la croissance économique génère des externalités négatives sur l’environnement. La croissance
a été jusqu’ici essentiellement basée sur l’utilisation d’énergies fossiles dont la combustion émet
des gaz à effet de serre à l’origine du réchauffement climatique. Ces émissions sont actuellement
plus importantes dans les pays industrialisés que dans les pays émergents, mais la croissance
soutenue des pays émergents inquiète les scientifiques. Ce constat contredit la courbe
environnementale de Kuznets.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
1
/
14
100%