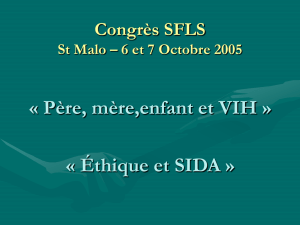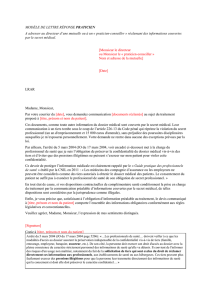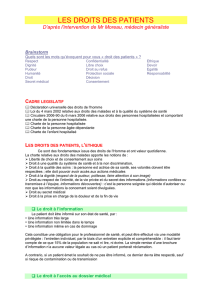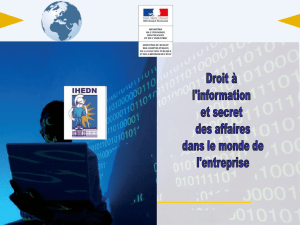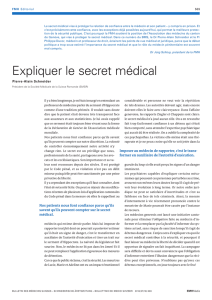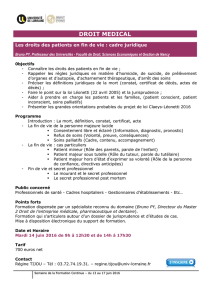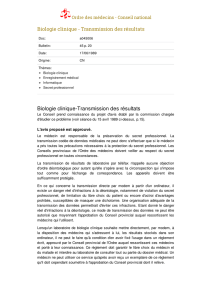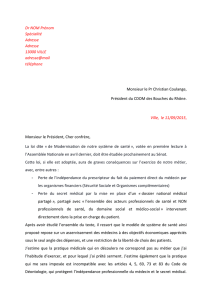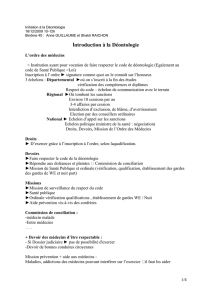Secret Médical

1
LE SECRET MEDICAL
Jean VALCARCEL
I. L’acception du terme « secret »
II. Histoire du secret :
III. Le principe du « secret médical » :
IV. Obligation du secret médical :
IV. 1. Obligation légale :
IV. 2. Obligation déontologique :
IV. 3. Obligation morale :
V. Les champs du secret médical :
V.1. Les personnes tenues au secret :
V.2. Les informations concernées par le secret :
VI. Les dérogations légales du Secret Médical :
VI. 1. Révélations obligatoires :
VI. 2. Révélations facultatives :
VI. 3. Cas particuliers :
VII. Secret médical et informatique :
VIII. Protection des données médicales : La CNIL
Université Montpellier 1
UFR ODONTOLOGIE
D2
Année Universitaire 2012- 2013

2
I. L’acception du terme « secret »
Le mot secret vient du latin « secretus » a pour origine le verbe secernere qui veut dire
« séparer de, isoler de » et par extension « que l’on tient caché » ou que « l’on dérobe à la
connaissance ».
Ce terme simple peut prendre plusieurs acceptions selon l’importance que l’on donne au
secret : « qui n’est pas divulgué », « ce que l’on tient caché »(Littré), « ce qui est ou doit être
tenu caché des autres, du public » (Robert)
Dans le langage idiomatique, le secret s’articule autour des axes : cacher-montrer, fermer-
ouvrir, contrôler-relâcher.
Le secret est aussi une notion polysémique par excellence qui de surcroît investit tous les
champs de l’activité humaine allant de l’intimité des personnes à la politique des Etats.
De plus au niveau éthique, le secret est différent selon les civilisations, les cultures et les
mentalités : la tendance actuelle est de dévoiler, de traquer le secret partout, et ce d’autant
plus qu’il est intime, personnel et caché.
II. Histoire du secret :
Les civilisations de l’antiquité ne connaissaient pas le secret car la résolution des conflits
dépendait de la communauté.
Le premier secret a apparaître est celui défini par Hippocrate vers 400 avant J-C qui établit
un code de déontologie pour les soignants médecins interdisant la divulgation
d’informations dans la relation au malade : « Les choses que dans l’exercice, ou même hors
de l’exercice de mon art, je pourrais voir ou entendre sur l’existence des hommes et qui ne
doivent pas être divulguées en dehors, je les tairai ».
Le second secret à apparaître est celui issu du christianisme et du pouvoir du prêtre dans le
cadre de la confession capable de remettre les péchés par le pardon accordé aux
confidences des fidèles. Ce secret professionnel apparaît comme inaliénable pour la
première fois car même le prêtre doit le conserver par devers lui dans toutes les situations.
A partir de là, u moyen-âge et sous l’ancien régime, le secret est introduit en droit dans les
procédures. L’ordonnance de 1498 prescrit aux juges de mener « secrètement » leurs
enquêtes lorsqu’il s’agit d’affaires criminelles. De même, en 1599, un apothicaire est
condamné par la chambre de la Tournelle suite à la divulgation du caractère honteux d’une
maladie touchant un de ses patients, mauvais payeur.
Enfin l’ordonnance de 1670 introduit en droit l’appel à témoin par le fait que le juge pour
réunir des preuves fasse contre un accusé face appel à la publication d’avis pour avoir des
renseignements de tout témoin public sans citer le nom de l’accusé seulement le cadre de
l’affaire. Le prêtre étant en charge de recueillir le témoignage pour le transmettre au juge
(début du secret partagé).
La révolution française s’attaque à la notion de secret rendant les débats, les plaidoyers et
les jugements publics avec dès 1791 la prononciation publique du jugement par chaque juré
à voix haute la main sur le cœur.
Le Code d’instruction criminelle de Napoléon en 1808 rétablit le secret dans les décisions
judiciaires, pendant l’instruction pendant les interrogatoires des accusés jusqu’à la veille du
procès.

3
Le secret a ainsi évolué au cours du temps pour venir aujourd’hui se partager en deux
formes complémentaires et parfois conflictuelles, entre le secret médical dans l’intérêt du
malade versus le secret dans l’intérêt général (de la société).
Il s’agit de savoir s’il faut mettre en avant l’intérêt de l’individu ou celui de la société.
Ainsi le secret médical n’est amenuisé actuellement, non pas dans son principe, mais dans
les obligations de dénonciation des maladies susceptibles de causer un dommage aux
populations (endémies).
Cette dualité est régit dans le principe de précaution, le principe d’assistance, le principe de
perte de chance qui contrebalance le caractère absolu du secret médical.
III. Le principe du « secret médical » :
La responsabilité pénale du chirurgien-dentiste par assimilation à celle du médecin peut être
engagée sur cinq points pour :
Non assistance à personne en danger
Coups et blessures involontaires
Homicide involontaire
Faux certificats
Secret médical
Il est possible toutefois que plusieurs responsabilités soient mises en jeu simultanément
pour une même affaire. Parmi ces responsabilités le secret médical est une responsabilité
morale et contractuelle importante entre le patient et le soignant.
La reconnaissance d'un droit au secret professionnel pour les professions médicales exprimé
sous la forme du secret médical est un élément majeur concourant à l'établissement d'une
relation de confiance entre le médecin et le malade et à la protection du malade.
Il est généralement considéré que le secret n'existe pas entre le médecin et son patient.
En droit le secret est une exception, prévue et réglementée par la loi, au principe
fondamental que la justice doit être rendue publiquement.
IV. Obligation du secret médical :
IV. 1. Obligation légale :
La responsabilité engagée et le principe même du secret médical comme secret
professionnel sont une obligation légale énoncée à l’article 226-13 du Code Pénal :
« La révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est le
dépositaire, de part son état ou sa profession, en raison de sa fonction ou d’un mission
temporaire, est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.»
La loi pénale ne précise ni la liste des professions ni la nature de l'information à caractère
secret, elle se contente d'établir l'interdiction de leur révélation.
Pour la violation du secret professionnel, l’intention coupable est inutile.
Deux arrêts de principe du 9 mai 1913 et du 27 juin 1967 de la Chambre Criminelle de la
Cour de Cassation l’ont établi : “ Le délit existe dès que la révélation a été faite, avec
connaissance, indépendamment de toute intention spéciale de nuire. ”
L’élément moral de l’infraction consiste en la volonté du détenteur du secret de le révéler en
toute connaissance de cause ; la violation du secret professionnel reste un délit
intentionnel.

4
Cet article n’est pas applicable (article 226-14 du Code Pénal) :
- à celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de sévices ou
privations dont il a eu connaissance et qui ont été infligés à un mineur ou à une
personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état
physique ou psychique.
- au médecin qui, avec l’accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la
République les sévices qu’il a constatés dans l’exercice de sa profession et qui lui
permettent de présumer que des violences sexuelles de toute nature ont été commises.
Lorsque la victime est un mineur ou une personne qui n'est pas en mesure de se
protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique, son accord
n'est pas nécessaire.
- aux professionnels de la santé ou de l'action sociale qui informent le préfet et, à Paris,
le préfet de police du caractère dangereux pour elles-mêmes ou pour autrui des
personnes qui les consultent et dont ils savent qu'elles détiennent une arme ou qu'elles
ont manifesté leur intention d'en acquérir une.
Le signalement aux autorités compétentes effectué dans les conditions prévues au
présent article ne peut faire l'objet d'aucune sanction disciplinaire.
IV. 2. Obligation déontologique :
Le Code de déontologie et la Santé publique précise :
Article R4127-206 du Code de la Santé Publique et du code de déontologie :
« Le secret professionnel s’impose à tout chirurgien-dentiste, sauf dérogations prévues par la
loi. Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du chirurgien-dentiste dans
l’exercice de sa profession, c’est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce
qu’il a vu, entendu ou compris. »
Le secret médical est institué dans l’intérêt du malade et pour protéger la personne malade.
Le secret médical est donc global et absolu.
Global car il concerne ce qui a été confié, vu, entendu ou compris et pas seulement les
confidences du patient.
Absolu parce qu’il s’impose au chirurgien-dentiste qui en est le dépositaire et ne peut en
être délié que par la loi. Il s’impose même après le décès du patient.
Le Code de déontologie précise des éléments importants :
- Le contenu de l'information à caractère secret qui concerne tout ce qui a été confié au
médecin mais aussi, ce qu'il a vu, entendu ou compris.
- Le mode d'acquisition de ces informations qui est lié à l'exercice de la profession.
IV. 3. Obligation morale :
Le secret professionnel est la conséquence directe de la confiance du malade en son
médecin.
Lorsque le droit national prévoit des exceptions à l’obligation du secret médical, le
médecin pourra recueillir l’avis préalable de son Ordre ou de l’organisme professionnel
de compétence similaire.
Toute banque de données médicales informatisée devrait être placée, pour le respect de
l’éthique professionnelle, sous la responsabilité d’un médecin nommément désigné. Les
banques de données médicales ne peuvent avoir aucun lien avec d’autres banques de
données.

5
V. Les champs du secret médical :
V.1. Les personnes tenues au secret :
Le secret concerne toute personne qui de part son état ou sa profession, en raison de ses
fonctions ou d’une mission temporaire, a reçu des informations auxquelles la loi accorde le
caractère secret.
Les médecins, pharmaciens, chirurgiens-dentistes sont tenus au secret médical mais aussi
l’ensemble du personnel qui travaille avec eux.
Article R4127-207 du Code de la Santé Publique et du code de déontologie :
« Le chirurgien-dentiste doit veiller à ce que les personnes qui l’assistent dans son travail,
soient instruites de leurs obligations en matière de secret professionnel et s’y conforment »
V.2. Les informations concernées par le secret :
Le secret médical est absolu et son obligation touche non seulement les informations
proprement médicales, mais aussi administratives et personnelles concernant le patient.
Article R4127-208 du Code de la Santé Publique et du code de déontologie :
« Le chirurgien-dentiste doit veiller à la protection contre toute indiscrétion de ses fiches
cliniques et des documents qu’il peut détenir concernant ses patients.
Lorsqu’il se sert, pour des publications scientifiques, de ses observations médicales, il doit
faire en sorte que l’identification des malades ne soit pas possible. »
VI. Les dérogations légales du Secret Médical :
Les dérogations au secret médical au cours de laquelle le professionnel de santé est autorisé
à révéler une information confidentielle sont très encadrées par la primauté des situations
d’intérêt général sur l’intérêt de la confidentialité individuelle.
Dans le cadre des dérogations qui s’imposent en matière de santé et d’information à
destination de la communauté certaines déclarations obligatoires positionnent déjà le sens
de la notion « d’intérêt général ».
VI. 1. Révélations obligatoires :
La déclaration de naissance (Article 56 et suivant du Code Civil)
La déclaration de décès (Article 78 et suivant du Code Civil)
La déclaration des maladies contagieuses à déclaration obligatoire :
o L’article L.3113-1 du Code de la Santé Publique stipule qu’il peut être dérogé
au secret professionnel en cas de révélation des maladies infectieuses.
o Plus spécifiquement pour les chirurgiens-dentistes, le secret médical peut
également être levé en cas d’enquêtes transfusionnelles (Article L.3122-6 du
Code de la Santé Publique)
La déclaration des maladies vénériennes
Législation sociale :
o accidents du travail - Article L.441-6 du Code de Sécurité Sociale.
o maladies professionnelles – Article L.461-5 du Code de la Sécurité Sociale.
Pensions civiles et militaires
Protection des incapables majeurs :
 6
6
 7
7
1
/
7
100%