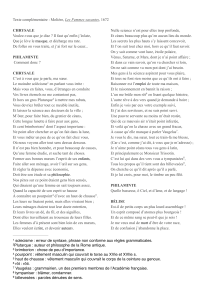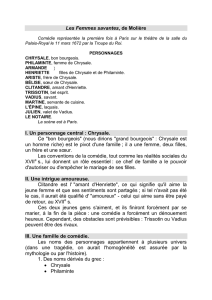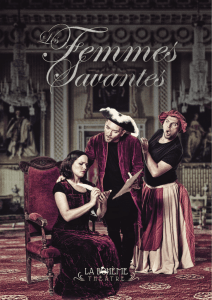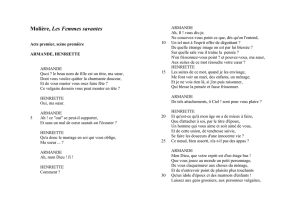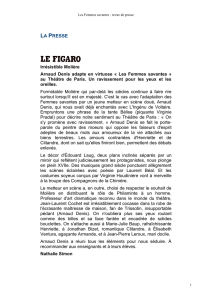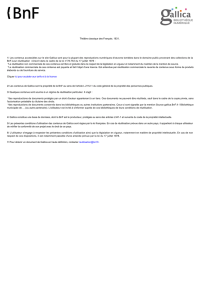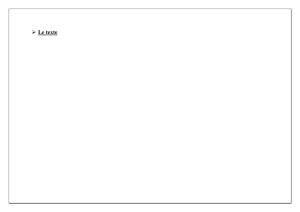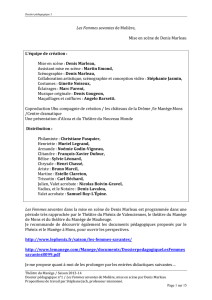Les Femmes savantes - biblio

Les Femmes savantes
Molière
L i v r e t p é d a g o g i q u e
correspondant au livre élève n° 33
établi par Gertrude Bing,
professeur certifié de
Lettres classiques

Sommaire – 2
SO M M A I R E
AVANT-PRO POS ............................................................................................ 3
TABL E DES COR PUS ........................................................................................ 4
RÉPO NSES AUX QUESTIONS ................................................................................ 5
Bilan de première lecture (p.178)...................................................................................................................................................................5
Acte I, scène 1 (pp.9 à 14) ...............................................................................................................................................................................6
◆ Lecture analytique de la scène (pp.15-16).................................................................................................................................6
◆ Lectures croisées et travaux d’écriture (pp.17 à 24) ................................................................................................................10
Acte II, scène 7 (pp.50 à 56)..........................................................................................................................................................................14
◆ Lecture analytique de la scène (pp.57-58)...............................................................................................................................14
◆ Lectures croisées et travaux d’écriture (pp.59 à 68) ................................................................................................................18
Acte III, scène 3 (pp.91 à 98).........................................................................................................................................................................23
◆ Lecture analytique de la scène (pp.99-100).............................................................................................................................23
◆ Lectures croisées et travaux d’écriture (pp.101 à 109)............................................................................................................26
Acte IV, scène 2 (pp.116 à 122).....................................................................................................................................................................30
◆ Lecture analytique de la scène (pp.123-124)...........................................................................................................................30
◆ Lectures croisées et travaux d’écriture (pp.125 à 133)............................................................................................................32
Acte V, scène 3 (pp.153 à 160)......................................................................................................................................................................38
◆ Lecture analytique de la scène (pp.161-162)...........................................................................................................................38
◆ Lectures croisées et travaux d’écriture (pp.163 à 170)............................................................................................................42
COMP LÉMENTS AUX LECTU RES D’I MA GE S .................................................................47
COMP LÉMENTS AUX MISES EN SCÈ NE .....................................................................51
BIBLIOGRAP HIE COM PLÉMENTAI RE .......................................................................54
Tous droits de traduction, de représentation et d’adaptation réservés pour tous pays.
© Hachette Livre, 2005.
43, quai de Grenelle, 75905 Paris Cedex 15.
www.hachette-education.com

Les Femmes savantes – 3
AV A N T -P R O P O S
Les programmes de français au lycée sont ambitieux. Pour les mettre en œuvre, il est demandé à la
fois de conduire des lectures qui éclairent les différents objets d’étude au programme et, par ces
lectures, de préparer les élèves aux techniques de l’épreuve écrite (lecture efficace d’un corpus de
textes, analyse d’une ou deux questions préliminaires, techniques du commentaire, de la dissertation,
de l’argumentation contextualisée, de l’imitation…).
Ainsi, l’étude d’une même œuvre peut répondre à plusieurs objectifs. L’étude de L’École des femmes
permettra d’aborder l’esthétique d’une grande comédie classique, mais aussi l’évolution de la
préciosité dans la seconde moitié du XVIIesiècle, sous l’influence de la science et de la philosophie.
Elle sera aussi l’occasion de s’interroger, à travers cinq groupements de textes, sur la polysémie d’un
texte théâtral qui met en œuvre une satire sociale, mais également une réflexion sur le lien
qu’entretiennent les femmes –et les hommes– avec le corps et avec l’esprit.
Dans ce contexte, il nous a semblé opportun de concevoir une nouvelle collection d’œuvres
classiques, Bibliolycée, qui puisse à la fois:
–motiver les élèves en leur offrant une nouvelle présentation du texte, moderne et aérée, qui facilite
la lecture de l’œuvre grâce à des notes claires et quelques repères fondamentaux;
–vous aider à mettre en œuvre les programmes et à préparer les élèves aux travaux d’écriture.
Cette double perspective a présidé aux choix suivants:
•Le texte de l’œuvre est annoté très précisément, en bas de page, afin d’en favoriser la pleine
compréhension.
•Il est accompagné de documents iconographiques visant à rendre la lecture attrayante et
enrichissante, la plupart des reproductions pouvant donner lieu à une exploitation en classe,
notamment au travers des lectures d’images proposées dans les questionnaires des corpus.
•En fin d’ouvrage, le «dossier Bibliolycée» propose des études synthétiques et des tableaux qui
donnent à l’élève les repères indispensables: biographie de l’auteur, contexte historique, liens de
l’œuvre avec son époque, genres et registres du texte…
• Enfin, chaque Bibliolycée offre un appareil pédagogique destiné à faciliter l’analyse de l’œuvre
intégrale en classe. Présenté sur des pages de couleur bleue afin de ne pas nuire à la cohérence du
texte (sur fond blanc), il comprend:
–Un bilan de première lecture qui peut être proposé à la classe après un parcours cursif de l’œuvre. Il
se compose de questions courtes qui permettent de s’assurer que les élèves ont bien saisi le sens
général de l’œuvre.
–Des questionnaires raisonnés en accompagnement des extraits les plus représentatifs de l’œuvre:
l’élève est invité à observer et à analyser le passage. On pourra procéder en classe à une correction du
questionnaire ou interroger les élèves pour construire avec eux l’analyse du texte.
–Des corpus de textes (accompagnés le plus souvent d’un document iconographique) pour éclairer
chacun des extraits ayant fait l’objet d’un questionnaire; ces corpus sont suivis d’un questionnaire
d’analyse des textes (et éventuellement de lecture d’image) et de travaux d’écriture pouvant constituer
un entraînement à l’épreuve écrite du bac. Ils peuvent aussi figurer, pour la classe de Première, sur le
«descriptif des lectures et activités» à titre de groupement de textes en rapport avec un objet d’étude
ou de documents complémentaires.
Nous espérons ainsi que la collection Bibliolycée sera, pour vous et vos élèves, un outil de travail
efficace, favorisant le plaisir de la lecture et la réflexion.

Table des corpus – 4
TA B L E D E S C O R P U S
Corpus
Composition du corpus
Objet(s) d’étude
et niveau
Compléments aux
travaux d’écriture destinés
aux séries technologiques
Comment mettre en scène
Les Femmes savantes ?
(p. 17)
Texte A : Scène1 de l’acteI des Femmes savantes
de Molière (pp.9-14).
Texte B : Extrait de Quarante Ans de théâtre de
Francisque Sarcey (pp.17-19).
Texte C : Extrait du Journal de Jacques Copeau
(pp.19-21).
Texte D : Extrait de Molière et la Comédie
classique de Louis Jouvet (pp.21-22).
Document : Mise en scène des Femmes savantes
par Catherine Hiégel (p.23).
Le théâtre: texte
et représentation
(Première).
Persuader, convaincre,
délibérer
(Première).
Question préliminaire
Quelles conceptions du jeu des comédiens se
dessinent dans les documents présentés dans
le corpus?
Commentaire
Après avoir souligné l’importance accordée au
texte de théâtre dans les extraits donnés,
vous montrerez en quoi ces deux auteurs
expriment une même passion du théâtre.
L’instruction des femmes
(p. 59)
Texte A : Scène7 de l’acteII des Femmes
savantes de Molière (pp.50-56).
Texte B : Extrait du Roman bourgeois d’Antoine
Furetière (pp.59-60).
Texte C : Extrait du Traité de l’éducation des filles
de Fénelon. (pp.60-62)
Texte D : Extrait du Discours sur le bonheur
d’Émilie du Châtelet (pp.62-63).
Texte E : Extrait de Madame Bovary de Gustave
Flaubert (pp.63-64).
Texte F : Extrait du Deuxième Sexe de Simone de
Beauvoir (pp.64-65).
Document : Honoré Daumier, Le Roman (p.66).
Démontrer, convaincre,
persuader
(Seconde).
Persuader, convaincre,
délibérer
(Première).
Question préliminaire
Résumez, en une phrase ou deux, la thèse de
chacun des documents du corpus.
Commentaire
Vous montrerez comment Gustave Flaubert
dépeint l’enfermement physique et mental
des jeunes filles, tout en faisant une satire du
romantisme.
Figures du pédantisme au
XVIIe siècle
(p. 101)
Texte A : Scène3 de l’acteIII des Femmes
savantes de Molière (pp.91-98).
Texte B : Extrait de Artamène ou le Grand Cyrus
de Madeleine de Scudéry (pp.101-102).
Texte C : Extrait de la scène2 de l’acteIII du
Pédant joué de Savinien de Cyrano de Bergerac
(pp.103-104).
Texte D : Extrait des Caractères de Jean de La
Bruyère (pp.104-105).
Texte E : «L’écolier, le pédant, et le maître d’un
jardin» de Jean de La Fontaine (pp.105-106).
Document : Illustration de la fable «L’écolier, le
pédant, et le maître d’un jardin» par Grandville
(p.107).
L’éloge et le blâme
(Seconde).
Persuader, convaincre,
délibérer: formes et fonctions
du dialogue, de l’essai,
de l’apologue
(Première).
Mouvements littéraires
et culturels: baroque,
préciosité et classicisme
(Première).
Question préliminaire
Les personnages de pédants présentés dans le
corpus sont-ils interchangeables ou chacun se
distingue-t-il par une personnalité
particulière?
Commentaire
Vous montrerez comment la théâtralité de ce
texte est au service de la caricature et de la
satire.
Corps et âme
(p. 125)
Texte A : Scène2 de l’acteIV des Femmes
savantes de Molière (pp.116-122).
Texte B : Extrait des Méditations métaphysiques de
René Descartes (pp.125-127).
Texte C : Extrait du Procès en séparation de l’âme
et du corps de Calderón (pp.127-128).
Texte D : Extrait de la scène6 de l’acteIV du Dom
Juan de Molière (pp.128-129).
Texte E : Article «Les Femmes savantes» du
Dictionnaire des grandes œuvres de la littérature
française (pp.129-131).
Document : Mise en scène du Procès en séparation
de l’âme et du corps par Christian Schiaretti (p.131).
Le théâtre: genres et registres
(Seconde).
Le théâtre: texte et
représentation
(Première).
Persuader, convaincre,
délibérer
(Première).
Un mouvement littéraire
et culturel: le classicisme
(Première).
Question préliminaire
À la lumière des textes du corpus, montrez
l’influence du dualisme cartésien sur le
sentiment amoureux.
Commentaire
Vous montrerez en quoi ces textes se
rapprochent par leur thématique, mais se
distinguent dans le traitement des
personnages.
La surdité des maîtres
(p. 163)
Texte A : Scène3 de l’acteV des Femmes
savantes de Molière (pp.153-160).
Texte B : Extrait de la scène3 de L’Île des esclaves
de Marivaux (pp.163-165).
Texte C : Extrait de la scène2 de l’acteI du
Barbier de Séville de Beaumarchais (pp.165-166).
Texte D : Extrait des Bonnes de Jean Genet
(pp.166-168).
Document : Plan du film La Règle du jeu de Jean
Renoir (p.169).
Le théâtre: genres et registres
(Seconde).
Le théâtre: texte et
représentation
(Première).
Persuader, convaincre,
délibérer
(Première).
Question préliminaire
Quelles images des valets apparaissent dans
les documents du corpus?
Commentaire
Vous montrerez l’ambiguïté des relations
entre Madame et Claire.

Les Femmes savantes – 5
RÉ P O N S E S A U X Q U E S T I O N S
B i l a n d e p r e m i è r e l e c t u r e ( p . 1 7 8 )
! Armande et Henriette sont les filles de Philaminte et de Chrysale. Armande, l’aînée, est jalouse car
Clitandre, après l’avoir vainement courtisée, s’est tourné vers sa cadette qui ne semble pas rebutée par
le mariage.
" Trois femmes savantes sont présentes chez Chrysale: sa femme, sa sœur et sa fille aînée.
Philaminte, son épouse, se caractérise par son autoritarisme. C’est elle qui porte «le haut-de-chausse».
Bélise est persuadée qu’un homme ne peut la croiser sans tomber amoureux d’elle. Armande enfin est
une prude qui rejette l’idée de mariage. Toutes trois, par ailleurs, au-delà des différences de leurs
tempéraments, sont véritablement férues de science et de philosophie, mais le désir d’être reconnues
leur fait perdre toute mesure et tout discernement.
# Ariste est le frère de Chrysale et de Bélise. Il est plus intelligent que son frère et beaucoup plus
sensé que sa sœur. Il tente de favoriser les amours d’Henriette et de Clitandre.
$ Chrysale a peur de sa femme et trouve son autoritarisme insupportable. Il préfère cependant s’y
soumettre que de tenter de l’affronter. Son penchant pour le savoir lui semble une lubie ridicule.
% Clitandre désire épouser Henriette. Plus simple et moins froide que sa sœur, elle a fait bon accueil
à des vœux dédaignés par Armande. Le désir de se marier et d’avoir des enfants lui semble naturel.
Elle est une personne de bon sens, comme Clitandre, dont elle partage la tempérance.
& Philaminte renvoie Martine en raison de son langage. Elle souhaite éduquer toute sa maisonnée et
fait la guerre aux «solécismes» et aux «vices d’oraison» du langage populaire.
' Trissotin entre en scène au moment où Philaminte tient salon, en compagnie de Bélise et
d’Armande. Toutes trois attendent ardemment ce moment, qui doit être consacré à la lecture des
poèmes de leur visiteur et à de savants entretiens. Henriette, présente aussi, tente de s’éclipser, mais sa
mère l’en empêche.
( Trissotin souhaite profiter de la situation pour devenir le mari d’Henriette et empocher la dot. Il
feint de l’aimer mais renoncera à l’épouser lorsqu’il croira la famille ruinée.
) Les deux pédants commencent par se congratuler mutuellement sur leurs qualités littéraires. Vadius
souhaite ensuite lire un poème de sa composition. Trissotin l’interrompt à plusieurs reprises et finit
par lui demander ce qu’il pense du sonnet «sur la fièvre qui tient la princesse Uranie», sans révéler qu’il
en est l’auteur. Vadius porte un jugement très sévère sur ce poème, qui lui a été lu en société. La
conversation s’envenime et les deux pseudo-poètes finissent par se quereller comme des chiffonniers.
*+ Vadius fait porter chez Philaminte les ouvrages de quatre auteurs latins, dans lesquels elle verra
«notés en marge tous les endroits qu’il [Trissotin] a pillés». Philaminte, tout à son aveuglement, renvoie
le messager et décide de précipiter les noces d’Henriette et de Trissotin.
*, Armande ne refuse pas d’être aimée mais exige, comme sa tante, «une espèce d’amour / Qui doit être
épuré comme l’astre du jour» (v.1683-1684). Elle propose pourtant à Clitandre de devenir sa femme,
lorsqu’elle se rend compte que, lassé de ses froideurs, il s’apprête à épouser Henriette.
*- Henriette veut faire comprendre à Trissotin qu’elle ne l’aime pas et qu’elle voit clair dans son jeu. Elle
lui fait part de son amour pour Clitandre et tente de le détourner d’elle. Son prétendant reste inflexible.
Après s’être montré doucereux, il révèle sa véritable nature: «Pourvu que je vous aie, il n’importe comment.»
*. Le notaire ne sait pas où donner de la tête: le père et la mère d’Henriette proposent un mari
différent. L’un penche pour Clitandre, tandis que l’autre opte pour Trissotin. Le notaire ne sait qui
écouter et ne peut accorder à la jeune fille «deux époux».
*/ Ariste intervient dans la dernière scène, porteur de deux lettres annonçant l’une la banqueroute de
Chrysale et l’autre l’issue malheureuse du procès de Philaminte. La famille se croit alors ruinée.
Trissotin change brusquement d’avis et renonce à épouser Henriette. Dessillée, Philaminte accepte
enfin d’accorder la main de sa cadette à Clitandre, qui ne s’offusque pas de la débâcle familiale. Sa
promise refuse alors de lui imposer une union devenue peu avantageuse pour lui, mais Ariste révèle
que les lettres étaient des faux, destinés à mettre au jour la cupidité de Trissotin.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
1
/
54
100%