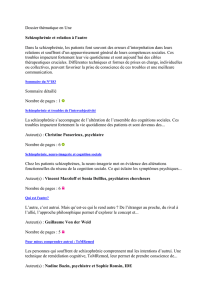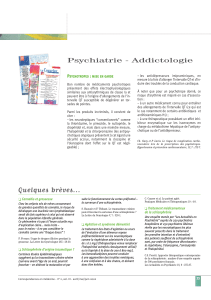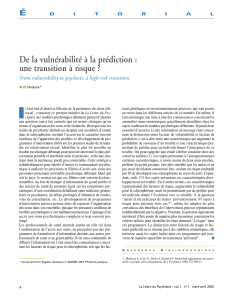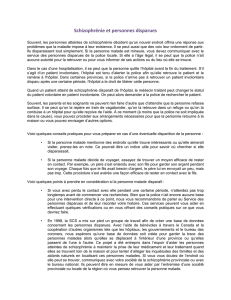au travail - Service Central d`Authentification (CAS) Lille2

UNIVERSITÉ DU DROIT ET DE LA SANTÉ - LILLE 2
FACULTÉ DE MÉDECINE HENRI WAREMBOURG
Année : 2013
THÈSE POUR LE DIPLÔME D'ÉTAT
DE DOCTEUR EN MÉDECINE
Travail des patients souffrant de schizophrénie :
Modèles théoriques et place du psychiatre
Présentée et soutenue publiquement le vendredi 8 mars 2013
Au Pôle Recherche de la Faculté de Médecine
Par Irène TISSERANT
Jury
Président :
Monsieur le Professeur Pierre THOMAS
Assesseurs :
Madame le Professeur Annie SOBASZEK
Monsieur le Professeur Guillaume VAÏVA
Directeur de Thèse :
Monsieur le Docteur Michel MARON

iv
« La parole et l’action sont les modes sous lesquels
les êtres humains apparaissent les uns aux autres. »
(Hannah Arendt,
Condition de l’homme moderne)

v
Sommaire
Chapitre 1. Introduction : De l’intérêt de la question du travail des patients souffrant de
schizophrénie ................................................................................................................................................ 1
1. Une question clinique récurrente ...................................................................................................... 1
2. Une problématique d’actualité ......................................................................................................... 2
3. Quel abord théorique ? ..................................................................................................................... 3
Chapitre 2. Repères historiques : Des liens unissant la psychiatrie au travail ...................... 5
1. La préhistoire de l’utilisation du travail en psychiatrie : des sociétés non fondées sur le travail, des
malades qui ne relèvent pas d’une psychiatrie encore inexistante ................................................ 6
2. De la fin du 18ème siècle à la 2nde Guerre mondiale : des sociétés qui s’organisent autour du travail,
une toute jeune psychiatrie qui fait du travail une thérapeutique ............................................... 10
3. De 1945 à nos jours : des sociétés où le travail est la norme, une psychiatrie moderne qui n’y
échappe pas .............................................................................................................................. 17
4. Quelques éléments de discussion ................................................................................................... 24
Chapitre 3. Schizophrénie(s) et travail : Comment le trouble psychiatrique entraîne-t-il
une incapacité au travail ? .................................................................................................................... 27
1. Du trouble psychiatrique… ............................................................................................................ 27
2. … à l’incapacité… ......................................................................................................................... 41
3. … au travail ................................................................................................................................... 55
4. Quelques éléments de discussion ................................................................................................... 75
Chapitre 4. Subjectivité et travail : Pour une prise en compte de la subjectivité du
travailleur face à l’activité de travail ................................................................................................ 81
1ère partie : Facteurs personnels subjectifs ......................................................................................................... 82
1. Les capacités métacognitives : un tremplin vers la prise en compte des facteurs subjectifs ............. 82
2. À propos des facteurs subjectifs ..................................................................................................... 83
3. Au final, un nouveau cadre théorique ? .......................................................................................... 89
2ème partie : Apports de la psychopathologie du travail ...................................................................................... 93
1. Prémices de la psychopathologie du travail .................................................................................... 93
2. Apports de la clinique de l’activité ................................................................................................. 97
3. Quelques éléments de discussion ................................................................................................. 103
Chapitre 5. Environnement et travail : Quels déterminants en situation de travail et
quels modèles de réinsertion professionnelle ? ............................................................................ 108
1. Influence de l’environnement social et économique ..................................................................... 108
2. Influence de l’environnement professionnel ................................................................................. 114
3. Services d’aide à la réinsertion professionnelle ............................................................................ 122
4. Quelques éléments de discussion ................................................................................................. 130
Chapitre 6. Discussion : Quelle place pour le psychiatre face au travail des patients
souffrant de schizophrénie ?............................................................................................................... 135
1. Une demande de travail équivoque ? ............................................................................................ 136
2. Cette demande concerne-t-elle le psychiatre ? .............................................................................. 141
3. Quel rôle pour le psychiatre ? ....................................................................................................... 152
Chapitre 7. Conclusion : Au-delà de la question du travail des patients souffrant de
schizophrénie : pour une articulation théorico-clinique interdisciplinaire ........................ 161
1. De la question du travail des patients souffrant de schizophrénie .................................................. 161
2. Pour une articulation théorico-clinique interdisciplinaire .............................................................. 165
Bibliographie ........................................................................................................................................... 168
Figures ....................................................................................................................................................... 175
Sigles et Abréviations ............................................................................................................................ 176
Table des matières ................................................................................................................................. 177

1
Chapitre 1. Introduction :
De l’intérêt de la question du travail des patients
souffrant de schizophrénie
1. Une question clinique récurrente
Je reçois un jour en consultation au CMP7 Monsieur A., 26 ans, que je connais depuis quelques mois.
Il a présenté peu de temps auparavant un premier épisode psychotique assorti de troubles du
comportement et avait dû alors être hospitalisé en psychiatrie. En réalité les troubles évoluaient à bas
bruit depuis de nombreuses années, comme en témoignaient un arrêt précoce de la scolarité, une
réduction progressive de ses centres d’intérêts, une tendance apragmatique bien installée et un
appauvrissement des relations sociales chez un patient par ailleurs consommateur chronique de
cannabis. À l’hôpital, la symptomatologie dissociative était majeure, associée à quelques éléments
délirants peu construits, sans franche participation thymique. Un traitement antipsychotique d’action
prolongée avait été mis en place, sur l’hypothèse hautement probable d’une schizophrénie ayant
débuté insidieusement, permettant alors une amélioration progressive des troubles. Lorsque je le
rencontre ce jour-là au CMP, Monsieur A. est presque en rémission symptomatique. Il ne délire plus
mais on note encore quelques éléments dissociatifs discrets. L’adhésion au traitement est correcte
même s’il a très peu conscience de sa maladie. Il accepte de participer à un groupe cuisine au CATTP8
mais l’insertion sociale reste précaire. Une demande d’AAH9 est en cours. Et puis ce jour-là, Monsieur
A. me dit qu’il voudrait travailler. Quand je l’interroge plus avant, il m’explique avoir déjà travaillé,
au noir, comme manutentionnaire, et en Algérie, sur les marchés. Il ne semble d’ailleurs pas douter de
sa capacité à occuper un emploi. Et pourtant, les questions se bousculent dans ma tête.
La question du travail, que Monsieur A. aborde alors, me met réellement dans l’embarras. Qu’est-ce
que cela implique, qu’il me dise vouloir travailler ? D’ailleurs est-il capable, ou non, de travailler ? Sur
quels arguments s’appuyer pour répondre ? Est-ce au psychiatre, d’évaluer sa capacité à travailler ? En
quoi les troubles qu’il présente l’empêchent-ils précisément de travailler ? Le travail est-t-il pathogène
ou thérapeutique? Autrement dit, en quoi consiste l’activité de travail, au-delà de la simple réalisation
d’une tâche ? Qu’est-ce que cela signifie, de travailler ? Et puis, dans un contexte de crise économique
et de chômage de longue durée, la question du travail est-elle vraiment prioritaire ? En quoi nos
représentations du travail influencent-elles le devenir de ces patients ? Et aussi, en tant que psychiatre,
7 CMP : Centre Médico-Psychologique
8 CATTP : Centre d’Accueil Thérapeutique à Temps Partiel
9 AAH : Allocation pour Adulte Handicapé

2
ou futur psychiatre, qu’attend-on de moi face à cette question du travail ? Est-ce vraiment une question
médicale ? Quelle prise en charge proposer ? A qui dois-je éventuellement adresser Monsieur A. ?
Quelle légitimité ai-je à intervenir sur cette question ? Comment travailler avec la médecine du travail,
avec la MDPH10, avec les autres partenaires ? Les dispositifs existants sont-ils adaptés à la
vulnérabilité de ces patients ? Et puis, peut-il bénéficier de l’AAH, s’il travaille ? Sur quels critères ?
Dans quel but ? Enfin, à plus long terme, quel devenir peut-on espérer pour Monsieur A. ? …
Monsieur A. est loin d’être le premier patient que je rencontre pour qui la vie professionnelle est un
des motifs de consultation, mais mon expérience clinique reste pauvre sur ce sujet. À la recherche d’un
espace pour approfondir la réflexion, je rencontre le Dr Maron, qui travaille au CLRP11. Il m’offre la
possibilité de réaliser une étude sur l’employabilité et le devenir professionnel de patients souffrant de
schizophrénie, en partenariat avec le CLRP, qui expérimente depuis 2009 un dispositif spécifique à
destination des personnes en situation de handicap d’origine psychique. Nombre de questions que je
me pose avec chaque nouveau stagiaire restent cependant sans réponse, soulignant la nécessité d’une
réflexion théorique plus aboutie face à une question qui m’apparaît chaque jour plus complexe.
2. Une problématique d’actualité
Cette réflexion théorique approfondie est d’autant plus nécessaire que la question du travail des
patients souffrant de schizophrénie est une problématique d’actualité (2).
En effet, la schizophrénie est une pathologie chronique invalidante qui peut affecter sévèrement les
capacités d’insertion socioprofessionnelle des patients. Les limitations d’autonomie induites dans la
vie quotidienne sont très variables d’un patient à l’autre, mais la schizophrénie reste une cause
importante de handicap fonctionnel et de « restriction de participation à la vie sociale » (3). Selon une
étude européenne récente, 79% des patients souffrant de schizophrénie seraient sans emploi (4). La
plupart des sujets souffrant de troubles psychiques sévères et notamment de schizophrénie exprimerait
d’ailleurs un souhait de retravailler et d’avoir un emploi rémunéré (5,6).
De plus, du fait des progrès réalisés dans les thérapeutiques tant biologiques, psychologiques, que
sociales, l’évolution de la schizophrénie n’est plus inexorablement déficitaire. Sur le plan
pharmacologique, la nouvelle génération d’antipsychotiques est plus respectueuse des capacités
cognitives des patients que la précédente. Les patients bénéficient alors de périodes de rémission au
cours desquelles la reprise d’une activité professionnelle devient plus facilement envisageable (2).
Par ailleurs, le paradigme actuel de la prise en charge au long cours des patients souffrant de
schizophrénie est celui de la réhabilitation psychosociale, qui consiste à « améliorer le fonctionnement
10 MDPH : Maison Départementale des Personnes Handicapées
11 CLRP : Centre Lillois de préorientation et de Rééducation Professionnelle. Etablissement médico-social ayant
pour mission de favoriser la réinsertion professionnelle des travailleurs reconnus handicapés par la MDPH.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
 90
90
 91
91
 92
92
 93
93
 94
94
 95
95
 96
96
 97
97
 98
98
 99
99
 100
100
 101
101
 102
102
 103
103
 104
104
 105
105
 106
106
 107
107
 108
108
 109
109
 110
110
 111
111
 112
112
 113
113
 114
114
 115
115
 116
116
 117
117
 118
118
 119
119
 120
120
 121
121
 122
122
 123
123
 124
124
 125
125
 126
126
 127
127
 128
128
 129
129
 130
130
 131
131
 132
132
 133
133
 134
134
 135
135
 136
136
 137
137
 138
138
 139
139
 140
140
 141
141
 142
142
 143
143
 144
144
 145
145
 146
146
 147
147
 148
148
 149
149
 150
150
 151
151
 152
152
 153
153
 154
154
 155
155
 156
156
 157
157
 158
158
 159
159
 160
160
 161
161
 162
162
 163
163
 164
164
 165
165
 166
166
 167
167
 168
168
 169
169
 170
170
 171
171
 172
172
 173
173
 174
174
 175
175
 176
176
 177
177
 178
178
 179
179
 180
180
 181
181
 182
182
 183
183
 184
184
1
/
184
100%