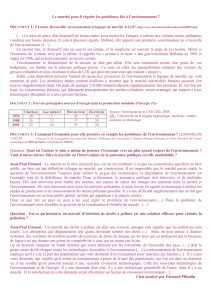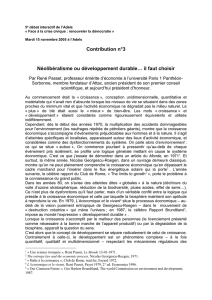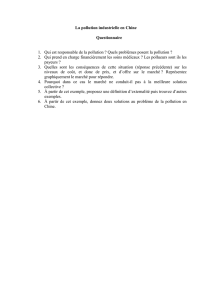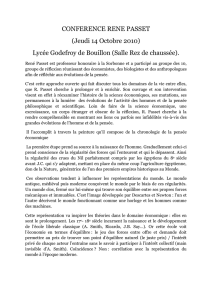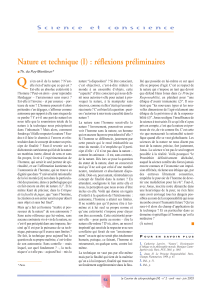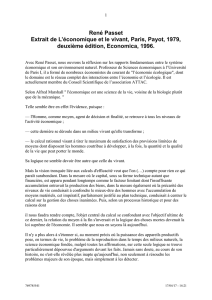L`écologie de marché, un mythe dangereux

78
Courrier de l'environnement de l'INRA n°29, décembre 1996
L'écologie de marché, un mythe dangereux
par Jean-Paul Maréchal
Chaque nouveau désastre écologique semble
démontrer que les dégradations de l'environne-
ment peuvent à la fois coûter cher à la collecti-
vité et rapporter gros aux individus ou entrepri-
ses qui en sont coupables. Pour répondre à cette
objection, les partisans de l'orthodoxie mar-
chande ont envisagé de calculer le prix de cha-
que dégradation, et de faire payer les pollueurs.
Mais, dans une telle arithmétique, n'oublie-t-on
pas un peu vite des dégâts irréversibles ?
Comme, par exemple, le délitement du sens de
la responsabilité et de l'éthique collective.
Une nouvelle marée noire en février 1996, cette fois sur les
côtes du Pays de Galles ; un rapport qui confirme la
contamination radioactive des alentours du site industriel
nucléaire de La Hague ; un autre qui attribue à la pollution
de l'air à Paris et à Lyon la responsabilité de plusieurs
centaines de décès prématurés chaque année ; l'affaire de
l'amiante et la crise de la »vache folle », qui pourraient bien
dépasser en gravité la catastrophe du sang contaminé, etc.
Extrapolée à l'ensemble de la planète, la liste des atteintes
peut-être irréversibles au milieu naturel et à la santé
publique serait interminable...
Pourtant, si la question de l'environnement continue de
mobiliser les scientifiques et une multitude d'organisations
non gouvernementales dans tous les pays, elle ne préoccupe
pas excessivement les dirigeants. Certains économistes leur
ont en effet soufflé la solution miracle : le marché ! Ils ne
pouvaient qu'être très réceptifs à une réponse tellement
cohérente avec les politiques qu'ils mènent dans tous les
autres domaines. Dans la théorie standard, dite néoclas-
sique, le libre fonctionnement du marché conduit l'économie
dans son ensemble à un état optimal. Etat qui se caractérise
par le fait qu'il est impossible, lorsqu'on l'a atteint,
d'améliorer la situation d'une personne sans détériorer celle
d'une autre. Or il existe de nombreux cas où l'activité d'un
agent a des conséquences sur celle d'autres agents, sans pour
autant que celles-ci soient prises en compte par le marché.
C'est, par exemple, ce qui arrive lorsqu'un industriel a
pollue une rivière et contraint de ce fait un homologue b
installé en aval à épurer l'eau avant de s'en servir. Une telle
situation correspond, en fait, à un transfert de charges dont
la conséquence saute aux yeux : les coûts de production de b
sont trop élevés, et ceux de a trop faibles par rapport à ce
qu'ils seraient en l'absence de pollution. En d'autres termes,
a produit plus et b moins qu'ils ne le devraient si le marché
reflétait tous les coûts. Ces dommages non compensés sont
appelés « effets externes »: ils prouvent que le libre jeu du
marché ne conduit pas automatiquement à un état efficient
de l'économie. Pour surmonter cet obstacle, la théorie
avance une idée simple : il suffit d'évaluer en monnaie le
montant des dommages causés, de façon à déterminer un
niveau de pollution compatible avec l'équilibre du marché,
puis, à l'aide d'un système de taxes, d'intégrer ce coût dans
les comptes du pollueur et donc de l'inciter à réduire sa
production ou à épurer de manière à restaurer cet
équilibre1 (*) C'est la formule dite de l'internalisation,
fondement du principe « pollueur = payeur ».
De nombreux experts croient pouvoir ainsi régler les pro-
blèmes d'environnement. C'est en particulier le cas du
consultant californien Paul Hawken, qui, dans un ouvrage
au titre significatif, L'Ecologie de marché
2
, ne tarit pas
d'éloges sur l'« internalisation »: « La solution de bien des
problèmes évoqués dans ce livre est aussi simple (et aussi
compliquée) que cela. »
Pour ce qui est de l'épuisement des ressources et, corrélati-
vement, de l'objectif de développement durable, satisfaire
les besoins de la génération présente sans compromettre la
capacité des générations futures de couvrir les leurs, l'éco-
nomie standard a aussi une recette : ajouter au prix des
matières premières une somme appelée « rente de rareté »,
dont le montant s'accroît à mesure que le stock diminue, de
telle sorte qu'à son épuisement le prix de la ressource en
question soit si élevé que la demande s'annule. La ressource
n'en sera pas moins épuisée, objectera-t-on. Certes, mais le
prélèvement de la rente ne constitue que la première moitié
du programme. La seconde consiste à investir cette rente en
« capital reproductible » (machines) et donc à compenser
l'épuisement du capital naturel par la création de capital
technique. Ces pseudo-réponses de l'économisme possèdent,
aux yeux de certains, un avantage décisif : elles peuvent être
exprimées sous forme mathématique, et le sont le plus
souvent dans des articles écrits en anglais. Cette double
marque de respectabilité dissimule mal, cependant, une
faille béante : leur totale inadéquation à la réalité.
L'approche libérale ignore en effet que le réel forme un
système, c'est-à-dire un ensemble d'éléments en interaction,
dont l'économie ne constitue qu'un sous-système.
Ainsi que le démontrait René Passet il y a déjà presque
vingt ans, la sphère des activités économiques est incluse
dans celle des activités humaines, elle-même incluse dans la
biosphère
3
. La conséquence de cette relation d'inclusion est
que l'activité économique ne saurait durer et encore moins
(*) Les notes sont reportées en fin d'article.

Courrier de l'environnement de l'INRA n°29, décembre 1996
79
se développer sur le long terme si la nature qui lui fournit
gratuitement des ressources matérielles et énergétiques,
ainsi que des capacités épuratrices que l'on a longtemps cru
illimitées venait à être trop gravement endommagée.
A partir de cette nouvelle lecture, le plus élémentaire bon
sens conduit à estimer qu'en matière d'atteintes à l'environ-
nement la norme ne saurait être imposée par le marché,
agressif à l'égard de la biosphère, mais qu'elle doit au
contraire être fondée sur la logique de reproduction du
milieu naturel. C'est donc à une réforme radicale des no-
tions si intimement liées d'efficacité et de rationalité éco-
nomiques que nous sommes conviés.
En effet, l'efficacité d'un système ne peut plus être mesurée
par le seul critère des gains de productivité, mais par sa
capacité à satisfaire les besoins des hommes au moindre
coût écologique et humain. Et, comme le souligne Henri
Bartoli, « il est impossible de parler de la rationalité d'ac-
tions économiques destructrices d'êtres humains, voire de
certaines dimensions du
milieu
naturel
[...].
La rareté ne se
limite pas à ce qu'expriment le marché et les prix. Elle est
fondamentalement 'sociale', entendons déterminée par les
données naturelles et la connaissance que l'on en a, la
technologie, les institutions, les règles du jeu, les us et
coutumes, la hiérarchie des valeurs 4 ». Une véritable
rationalité économique se doit donc d'intégrer le savoir
écologique et la préoccupation éthique.
L'incapacité du marché à prendre en compte les conditions
de reproduction du milieu, ainsi que certains besoins fon-
damentaux des hommes nés ou à naître, appelle donc la
mise en place d'un nouveau système de régulation. Ce ne
peut être, comme le montre René Passet, que la « gestion
normative sous contrainte », stratégie qui consiste non pas à
supprimer le marché, dont l'efficacité est souvent remar-
quable, mais à en cantonner le libre fonctionnement à l'in-
térieur de contraintes écologiques quantitatives (rythmes de
prélèvement...) et qualitatives (beauté d'un paysage...) dont
le dépassement mettrait en péril la survie de la nature et de
la société .
Ce qui oppose cette démarche à celle de l'« écologie de
marché », ce n'est pas la nature de l'instrument d'interven-
tion (qui peut fort bien prendre, par exemple, la forme d'une
redevance), mais l'origine extra-économique de la norme,
celle-ci devant être fondée sur des considérations
écologiques et éthiques. Et il y a urgence à changer de cap,
comme le rappelle Lester R. Brown, président du
Worldwatch Institute de Washington : « Nous sommes
parvenus à un tel point d'augmentation des besoins humains
que nous avons atteint les limites des ressources disponibles
pour les satisfaire. Cette collision avec les limites du
développement provoque une déstabilisation majeure de nos
sociétés
6
. » Le rôle des pouvoirs publics et des citoyens s'en
trouve du même coup réaffirmé.
C'est en effet aux Etats, séparément ou collectivement,
qu'incombe prioritairement le devoir de mener des inter-
ventions qui se situent à l'échelle des problèmes posés.
Celles-ci peuvent revêtir des formes diverses allant, par
exemple, de la loi sur l'eau du 16 décembre 1964
(remplacée par celle du 3 janvier 1992), qui a découpé la
France en six agences financières de bassin, au protocole de
Madrid de 1991, qui fait de l'Antarctique une «réserve
naturelle consacrée à la paix et à la science », en passant par
la convention de Bruxelles du 29 novembre 1969 sur la
responsabilité civile pour des dommages dus à la pollution
par les hydrocarbures.
Le commerce international ne saurait faire exception à une
« gestion normative sous contrainte ». D'où la nécessité d'en
subordonner la liberté non seulement à des « clauses
sociales », mais également à des « clauses écologiques » se
traduisant par le prélèvement de droits compensatoires sur
les produits en provenance de pays peu respectueux d'un
environnement qui n'est plus seulement le leur, mais celui
de la planète tout entière. Ces prélèvements devraient être
reversés aux pays exportateurs sous forme d'avoirs utilisa-
bles uniquement pour le financement de projets favorables à
l'écologie
7
.
Les citoyens aussi ont leurs responsabilités. Dans un bref
mais remarquable ouvrage,- Philippe Van Parijs rappelle en
effet que « si l'éthique des ménages conduit au triomphe de
la vertu, l'éthique des entreprises conduit au triomphe du
vice 8». De fait, si une entreprise est seule à refuser, pour
des raisons éthiques, de se soumettre à l'implacable logique
du marché, elle met sa survie en péril. En revanche, si les
ménages décidaient de boycotter les firmes fabriquant des
produits polluants ou ne menant aucune action favorable à
l'environnement, le jeu même du marché conduirait celles-ci
soit à disparaître, soit, par intérêt bien compris, à adopter
une conduite « morale ». S'il est donc possible de concevoir
des cadres et des méthodes d'intervention, encore faut-il
disposer de
bases
pour déterminer, au cas par cas, les
limi-
tes de la « gestion normative sous contrainte ». Le meilleur
fondement possible est, bien sûr, la science, lorsque celle-ci
permet, par exemple, de fixer avec certitude un plafond de
pollution à ne pas dépasser.
Malheureusement, beaucoup de décisions doivent être prises
en situation d'incertitude scientifique. Dans ces cas, seule la
peur est en mesure de dresser un rempart contre les abus de
notre propre pouvoir. La peur, écrit le philosophe allemand
Hans Jonas, « devient donc la première obligation
préliminaire d'une éthique de la responsabilité historique 5 ».
Cette exigence, qui doit conduire à toujours « faire prévaloir
le mauvais pronostic sur le bon
10
» et donc à ériger la
prudence en règle d'action, trouve sa traduction politique
dans le « principe de précaution ». Ce principe, qu'il
convient de bien distinguer de l'immobilisme, prescrit que,
« lorsque existe une menace de dommage grave ou
irréversible, l'absence de certitude complète au plan scien-
tifique ne devrait pas être utilisée pour reporter à plus tard
les mesures de prévention de la dégradation de l'environ-
nement 11 ». La Charte de la Terre, adoptée lors de la confé-
rence des Nations unies sur l'environnement et le dévelop-
pement tenue à Rio en 1992
12
, ne dit pas autre chose
lorsqu'elle proclame que, « pour protéger l'environnement,
des mesures de précaution doivent être largement appli-

80
Courrier de l'environnement de l'INRA n°29, décembre 1996
quées par les Etats selon leurs capacités. En cas de risque
de dommages graves ou irréversibles, l'absence de certitude
scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte pour
remettre à plus tard l'adoption de mesures effectives visant
à prévenir la dégradation de l'environnement ». Malheureu-
sement, le recours à ce principe reste pour le moment très
limité. Une exception notable mérite cependant d'être men-
tionnée : le protocole sur les substances qui appauvrissent
la couche d'ozone, signé à Montréal en 1987, premier traité
à avoir été adopté alors même que les connaissances scien-
tifiques sur la destruction de l'ozone étaient loin d'être
exhaustives
13
.
Face à une économie standard imbue de sa puissance et qui
préfère contempler ses modèles plutôt que d'affronter la
complexité du monde, il convient d'exiger des solutions ne
relevant pas de la logique marchande et, corrélativement,
de montrer la pertinence d'une autre voie. Celle d'une éco-
nomie que l'on pourrait qualifier de néoréaliste, au sens de
l'horizon programmatique que s'était donné le cinéma ita-
lien d'après-guerre : celui d'un retour vers « l'invention de
la réalité ».
Notes
1. Lire Jean-Paul Maréchal, Le Prix du risque. Presses du CNRS,
Paris, 1991.
2. Paul Hawken, L'Ecologie de marché, Le Souffle d'or, 05300
Barret-le-Bas, 1995.
3. René Passet, L'Economique et le Vivant, Payot, Paris, 1979.
Une nouvelle édition actualisée de cet ouvrage devenu classique
vient d'être publiée (Economica, Paris, 1996, 291 pages).
4. Henri Bartoli, L'Economie multidimensionnelle, Economica,
Paris, 1991.
5. René Passet, « L'Economie : des choses mortes au vivant »,
Encyclopaedia Universalis, symposium « Les enjeux », Paris,
1984.
6. Lire Le Monde, 27 février 1996.
7. Lire Bernard Cassen, « La clause sociale, un moyen de
mondialiser la justice », Le Monde diplomatique, février 1996.
8. PhilippeVan Parijs, Sauver la solidarité, Cerf,
coll.« Humanités », Paris, 1995.
9. Hans Jonas, Le Principe de responsabilité, Cerf, Paris, 1990.
Lire aussi de Jacques Decornoy « L'exigence deresponsabilité »,
Le Monde diplomatique, septembre 1990.
10. Hans Jonas, op. cit.
11. Jean-Philippe Barde, Economie et politique de
l'environnement, PUF, coll. « L'économiste », Paris, 1992.
12. Lire « Une Terre en renaissance », Savoirs, n°2, 1993,
publications du Monde diplomatique.
13. Lire Winfried Lang et Christian Manahl, « L'avenir de la
couche d'ozone : le rôle du protocole de Montréal », in Stratégies
énergétiques, biosphère et société, Georg, Genève, 1996.
Article paru dans Le Monde diplomatique, octobre
1996, pages 26 et 27, reproduit avec l'aimable
autorisation du Journal.
1
/
3
100%