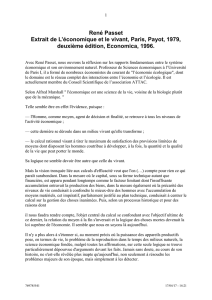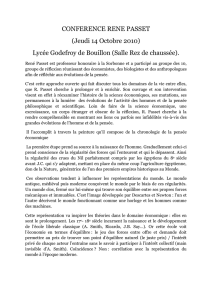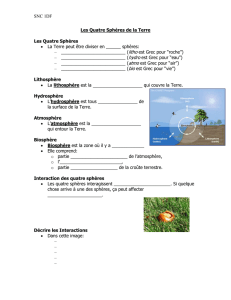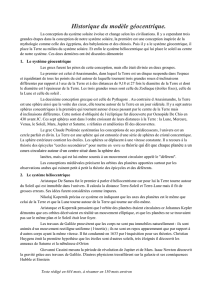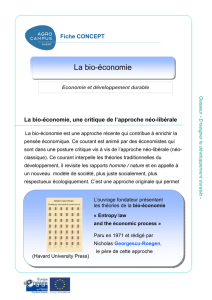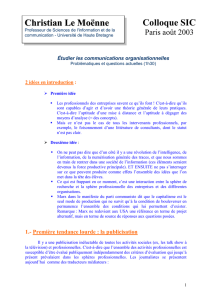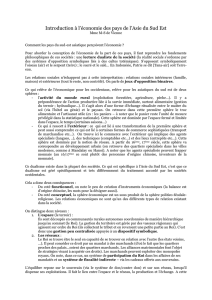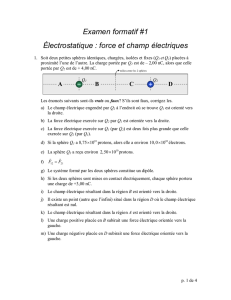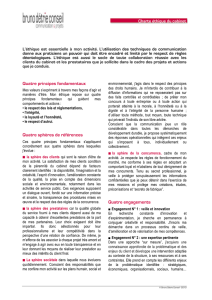03- Néolibéralisme ou développement durable... il faut choisir

5e débat interactif de l’Adels
« Face à la crise civique : renouveler la démocratie »
Mardi 15 novembre 2005 à l’Adels
Contribution n°3
Néolibéralisme ou développement durable… il faut choisir
Par René Passet, professeur émérite d’économie à l’université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne, membre fondateur d’Attac, ancien président de son premier conseil
scientifique, et aujourd’hui président d’honneur.
Au commencement était la « croissance », conception unidimensionnelle, quantitative et
matérialiste qui n’avait rien d’absurde lorsque les niveaux de vie se situaient dans des zones
proches du minimum vital et que l’activité économique ne dégradait pas le milieu naturel. Le
« plus » de blé était aussi le « mieux » de bien-être. Les mots « croissance » et
« développement » étaient considérés comme rigoureusement équivalents et utilisés
indifféremment.
Cependant, dès le début des années 1970, la multiplication des accidents dommageables
pour l’environnement (les naufrages répétés de pétroliers géants), montre que la croissance
économique s’accompagne d’événements préjudiciables aux hommes et à la nature. Il s’agit
d’atteintes spécifiques et localisées, apparaissant autour des lieux d’activité économique, et
considérées comme des dysfonctionnements du système. On parle alors d’environnement :
ce qui se situe « autour ». On commence pourtant à pressentir qu’au-delà de chaque
événement pris isolément, se profile une logique générale mettant en cause le système
économique. C’est ce que j’essaie de démontrer dans un article du Monde, en 1971
1
. Et
surtout, la même année, Nicolas Georgescu-Roegen, dans un ouvrage demeuré classique,
montre qu’on ne peut pleinement comprendre la croissance économique qu’en dépassant le
cadre marchand pour l’insérer dans le flux énergétique solaire qui la porte
2
. L’année
suivante, le célèbre rapport du Club de Rome, « The limits to growth
3
», porte le problème à
la connaissance du grand public.
Dans les années 80, on s’avise des atteintes dites « globales » à la nature (déchirure du
voile d’ozone stratosphérique, réduction de la biodiversité, pluies acides, effet de serre…).
Ce n’est plus de dysfonctions qu’il faut parler, mais d’un véritable conflit entre la logique qui
préside à la croissance économique et celle par laquelle la biosphère maintient son aptitude
à reproduire la vie. En 1979, L’économique et le vivant
4
situe le processus économique – au-
delà de la vision purement entropique de Georgescu-Roegen – dans le mouvement de
« destruction créatrice » qui mène l’univers ; en 1987, le célèbre Rapport Brundtland
5
,
impose au monde l’expression « développement durable » .
Lorsque la croissance s’accomplit par le malheur des personnes (le licenciement présenté
comme nécessaire à la bonne marche de l’appareil productif) ou par la dégradation de la
biosphère, apparaît la question du sens.
C’est alors que le concept de développement se sépare radicalement de celui de croissance.
Contrairement à celle-ci, le développement est un phénomène complexe – à la fois
quantitatif, qualitatif et multidimensionnel – respectant les mécanismes régulateurs des
1
« Une science tronquée », René Passet, Le Monde 12-01-1971.
2
The entropy law and the economic process, Nicolas Georgescu-Roegen, 1971.
3
« Halte à la croissance », Club de Rome, trad.fse, Fayard 1972.
4
L’économique et le vivant, René Passet, Payot 1979, 2° ed. Economica 1996.
5
« Our Common Future », Gro Harlem Brundtland, The world Commission on environment and development,
1987.

sphères humaine et naturelle dans lesquelles il s’accomplit. Par définition il est donc
« durable
6
» . C’est évidemment d’un objectif qu’il est question ici et non de la réalité
effectivement observée.
Le développement ainsi défini comporte un triple impératif d’ouverture de l’économie sur les
sphères sociale et économique qui l’englobent, d’interdépendance avec ces dernières et de
soumission à des valeurs que l’économie, en raison de son statut de moyen – et non de
finalité –, ne sait pas produire.
La logique de la mondialisation néo-libérale s’oppose aux impératifs d’un authentique
développement.
Disons, pour faire très bref, que de la suppression des contrôles étatiques sur les
mouvements de capitaux – initiée dans les années 80 par le tandem Reagan-Thatcher –
résulte la concentration de ces derniers à l’échelle mondiale et le déplacement des lieux du
pouvoir économique de la sphère publique des États nationaux à la sphère privée des
intérêts financiers internationaux. Cette sphère – par son volume comme par l’importance
des flux (notamment spéculatifs) qu’elle brasse – possède désormais « la puissance de feu »
lui permettant d’imposer sa loi. Or, sa logique se situe aux antipodes du développement .
À l’interdépendance, elle substitue la domination d’un groupe d’intérêts particuliers au
détriment de tous les autres. Sa logique n’est pas de création de richesses, de mise en
valeur des territoires ou de satisfaction des besoins humains, mais de fructification rapide
des patrimoines financiers. Au cercle « vertueux » fordiste par lequel la croissance du profit
et celle du salaire se nourrissaient mutuellement, elle substitue un cercle foncièrement
« vicieux » dans la mesure où le dividende du capital se nourrit de la régression de tous les
autres revenus.
De là résulte une triple fracture : sociale, dans la mesure où le licenciement des travailleurs,
la misère, l’exclusion deviennent les moyens de réserver au seul capital financier les gains
de productivité du système ; mondiale, dans la mesure où les capitaux affluant vers les
zones de hautes rentabilité que sont les pays riches et délaissant les autres, creusent les
inégalités ; environnementale enfin, dans la mesure où la mise en valeur rapide du capital
financier et la course productiviste qui en découlent provoquent l’épuisement, la pollution et
le dérèglement de la biosphère.
À l’ouverture sur les sphères humaine et naturelle elle substitue le repliement sur un sous-
système de la plus étroite des trois sphères. De là découle l’absorption de celles-ci par celle
de la finance. Au regard de la finance, tout devient marchandise : le vivant que l’on s’attache
à breveter pour se l’approprier ; la culture, l’art, le spectacle qui, de finalités deviennent les
instruments de l’appareil qui devrait les servir comme en témoigne notamment la pratique de
l’audimat ; la vie humaine appréciée à sa Life Time Value (LTV), c’est-à-dire la capacité
potentielle d’achat qu’une personne représente pour l’appareil commercial.
À l’ouverture sur les valeurs socioculturelles enfin, elle substitue la prééminence du marché
proclamé neutre, donc objectif et universel. Prétention insoutenable : dès lors que l’appareil
productif a réglé, en moyenne et globalement, le problème de la couverture des besoins
fondamentaux à l’échelle du monde et que l’inégale distribution des richesses maintient
cependant des portions entières de l’humanité dans la misère et la détresse, le problème
n’est plus de production mais de partage ; or, le marché ne sait pas faire cela ; il n’y a
6
Si nous utilisons, comme tout le monde, l’expression « développement durable » c’est donc pour nous
soumettre à l’usage commun plus que par nécessité. Rappelons, à toutes fins utiles, la célèbre définition du
Rapport Brundtland : « Un développement qui permet de satisfaire les besoins du présent sans compromettre la
capacité des générations futures de satisfaire leurs propres besoins. »

aucune théorie de l’optimum en matière de répartition. La question se pose donc dans le
champ des valeurs en termes de justice distributive. Dès lors que l’activité productive des
hommes menace l’existence même de la vie sur la planète, se pose le problème de la
solidarité intergénérationnelle. La réponse n’est pas dans le champ de l’économie mais, une
fois encore dans celui des valeurs. S’en remettre au marché, ce n’est pas être neutre et
objectif, c’est proclamer la loi marchande valeur suprême, au-dessus des droits de l’homme
et des valeurs de la vie.
L’économie néo-libérale ne peut donc s’approprier le développement durable qu’en le
mutilant et le dénaturant. Toute sa stratégie consiste à réduire la reproduction des trois
sphères à celle d’un seul facteur, le capital qui entre dans son univers conceptuel. La nature,
nous dit-on, n’est productive que par le travail humain qui s’y trouve incorporé : elle ne
représente que de la matière première transformée par le travail …c’est-à-dire un capital.
Nature et capital technique ne sont donc que deux formes différentes d’un même facteur : le
capital productif. De telle sorte que, lorsque la première, s’épuise on peut compenser sa
réduction par l’augmentation du second, de façon à maintenir constant le flux de production
découlant d’un capital total inchangé. Le développement durable se joue donc au niveau du
seul capital technique, c’est-à-dire au sein de la sphère économique, selon les bonnes lois
de la seule économie…néo-libérale évidemment.
Vision absurde : lorsque le « capital naturel » s’amenuise c’est que les prélèvements qu’il
subit sont supérieurs à ses rythmes de reconstitution. Maintenir – provisoirement – le flux en
intensifiant les prélèvements revient à accélérer la destruction du « capital naturel ».
Jusqu’au jour où il aura totalement disparu. Quand le flux des lapins s’amenuise, on peut
maintenir un temps les prélèvements en intensifiant la puissance de feu des chasseurs…
jusqu’au jour où il n’y a plus de lapins. C’est ce concept mutilé et dénaturé qui inspire la
mondialisation néo-libérale. Et c’est sur lui que devraient se focaliser les critiques portées au
nom des impératifs d’un authentique développement.
Toute logique économique est le produit d’un système de pouvoirs. Quoi que l’on dise ou
que l’on fasse, aussi longtemps que l’on ne s’attaquera pas aux racines du pouvoir dont les
intérêts dominants détruisent progressivement la capacité de notre planète à porter la vie,
rien ne changera fondamentalement. Attaquer le mal en ses racines, telle est la stratégie que
l’on a qualifiée de « réformisme radical », bien avant que certains hommes politiques ne
s’approprient l’expression pour – une fois de plus – en dénaturer le sens… Il s’agit
clairement de remettre la société sur ses pieds en assurant, à l’échelle mondiale, la
suprématie du pouvoir politique où se définissent les finalités, sur celui de la finance relevant
seulement de la sphère des moyens. Ce que les mesures néfastes de libération des
mouvements de capitaux ont fait dans les années 80… d’autres mesures peuvent le défaire.
C’est une question de rationalité économique autant que de volonté politique. René Passet,
Rennes 27 novembre 2003.
1
/
3
100%