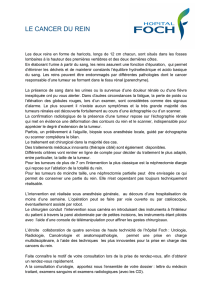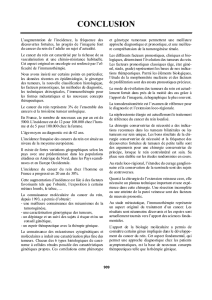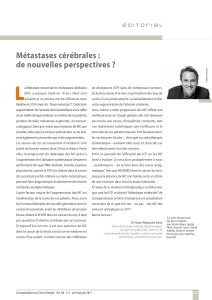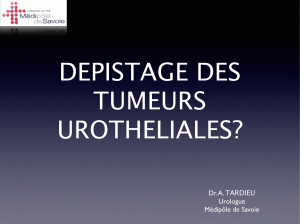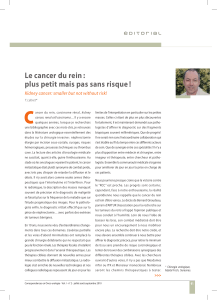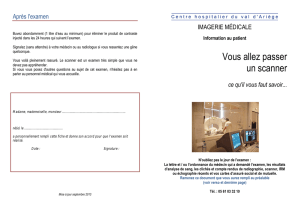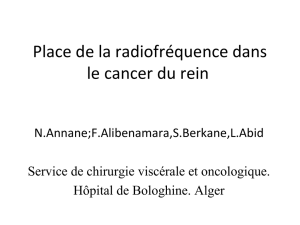Imagerie des petites tumeurs rénales

Progrès en Urologie (1997), 7, 484-495
484
Imagerie des petites tumeurs rénales
Emmanuel CHALLIER (1), Marie-France BELLIN (1), Yasmina FADEL (1), François RICHARD (2),
Lotfi GHEBONTNI (1), Jacques GRELLET (1)
(1) Service de Radiologie, (2) Service d’Urologie, Hôpital Pitié-Salpêtrière, Paris
RESUME
L’augmentation de l’incidence de découverte des
petites tumeurs rénales, de taille inférieure ou égale
à 3 cm, est liée à la généralisation et à l’amélioration
des techniques radiologiques. De nombre u s e s
tumeurs rénales asymptomatiques sont découvertes
par échographie et tomodensitométrie.
Actuellement, l’imagerie permet de reconnaître les
kystes simples (caractères morphologiques, absence
de vascularisation), les angiomyolipomes (mise en
évidence de contingent graisseux) et les autre s
tumeurs rénales solides (rehaussement tumoral en
tomodensitométrie).Dans ce but, un scanner réalisé
sans, puis avec injection à la recherche d’un rehaus-
sement de densité lésionnelle est l’examen de choix.
En cas d’incertitude, une IRM avec injection de
Gadolinium à la re c h e rche d’un re h a u s s e m e n t
tumoral peut être utile. L’imagerie permet avec une
bonne fiabilité de démontrer le caractère vasculari-
sé des lésions solides mais ne permet pas de fair
e la
distinction entre un cancer du rein, un oncocytome
ou une autre tumeur solide bénigne.L’imagerie
permet de réaliser une cartographie pré-opératoire
précise lorsqu’une néphrectomie partielle est envi-
sagée.
Mots clés :Petites tumeurs rénales, TDM et IRM.
Progrès en Urologie (1997), 7, 484-495.
Les progrès techniques en imagerie et la généralisation
des prescriptions radiologiques induisent la découverte
fortuite de plus en plus fréquente de petites tumeurs
rénales de taille inférieure ou égale à 3 cm, souvent
asymptomatiques.De ce fait, la découverte de ces
lésions pose à la fois un problème de diagnostic (natu-
re des lésions) et de stratégie thérapeutique (abstention,
surveillance, néphrectomie totale ou partielle).
Le but de cet article est :
• de revoir les différents moyens d’investigation radio-
logiques et leurs performances dans le diagnostic des
petites tumeurs rénales.
• de passer en revue les caractères sémiologiques des
différents types de petites tumeurs rénales qu’elles
soient solides, kystiques ou secondaires. Nous envisa-
gerons les diagnostics différentiels. Certains points de
sémiologie permettent de caractériser la nature des
lésions, d’autres permettent d’orienter le clinicien dans
la prise en charge thérapeutique.
LES DIFFERENTES METHODES D’IMAGERIE
SEMIOLOGIE. APPORT DIAGNOSTIQUE
L’urographie intra-veineuse
Pour les tumeurs de 3 cm, la sensibilité de cet examen
est faible, de l’ordre de 60% [1]. Elle chute rapidement
pour les tumeurs de plus petite taille. La localisation de
la tumeur est un paramètre important; seules les
tumeurs tangentes aux rayons incidents et déformant
les contours rénaux sont dépistées. En général, l’effet
de masse des petites tumeurs sur les cavités pyélo-cali-
cielles est insuffisant pour induire leur déformation et
leur désorganisation. L’intérêt de l’urographie intra-
veineuse pour le diagnostic et le bilan des petites
tumeurs rénales est donc très limité.
L’échographie
L’étude systématique des reins lors de l’exploration
échographique de l’abdomen est souvent à l’origine de
la découverte fortuite d’une petite tumeur rénale. La
sensibilité de l’échographie varie entre 60 et 80% en
fonction de la taille de la tumeur, de la performance de
l’appareil utilisé, de l’échogénicité du patient et de
l’expérience de l’opérateur [1].
Contrairement aux grosses tumeurs rénales, les petites
tumeurs solides du rein sont plus souvent homogènes
qu’hétérogènes et plus souvent hyperéchogènes qu’hy-
po ou isoéchogènes. YAMASHITAet al. [25] ont observé
que 61% des petites tumeurs rénales étaient hyper-
échogènes. Les confrontations histologiques montrent
que les tumeurs hyperéchogènes sont d’organisation
architecturale papillaire, tubulaire ou multiloculaire.
De nombreuses interfaces échographiques sont à l’ori-
gine de l’hyperéchogénicité. Les tumeurs hypoécho-
gènes ont une organisation cellulaire plus compacte,
nécrosée ou hémorragique. Dans d’autres séries [12,
Manuscrit reçu le 4 septembre 1995, accepté : janvier 1996
Adresse pour correspondance : Dr. E. Challier, Service de Radiologie, Hôpital Pitié-
Salpêtrière, 47-83, Bd. de l’Hôpital, 75651 Paris Cedex 13.

485
22], le pourcentage des tumeurs hypoéchogènes domi-
ne. La présence d’un halo hypoéchogène péri-tumoral
serait liée à la compression du parenchyme sain au
contact de la tumeur.
L’échographie reste un examen fiable dans le diagnos-
tic des kystes rénaux simples. Les critères sémiolo-
giques en échographie doivent être stricts : une lésion
ronde, bien limitée, transsonore accompagnée d’un
renforcement postérieur des échos, homogène et sans
paroi visible est spécifique d’un kyste rénal bénin [7].
Dans cette situation, l’échographie permet de résoudre
définitivement le problème diagnostique. Pour les
lésions kystiques ne répondant pas à toutes ces caracté-
ristiques, il est interdit de porter le diagnostic de kyste
simple et une exploration tomodensitométrique devient
alors nécessaire.
Le Doppler couleur
Les Dopplers pulsé et couleur permettent de détecter
une néovascularisation tumorale [6, 15, 20]. Les résul-
tats qui semblent intéressants pour les masses tumo-
rales d’un certain volume restent à évaluer pour les
masses de petit volume en sachant que la mobilité du
rein et leur profondeur sont des obstacles.
La tomodensitométrie
Aspects techniques
Les petites tumeurs rénales asymptomatiques sont fré-
quemment découvertes fortuitement au cours d’un exa-
men tomodensitométrique de l’abdomen (réalisé pour
une cause non urologique). Dans ces conditions, dans
la majorité des cas, les coupes sont d’épaisseur centi-
métrique et le produit de contraste est injecté d’emblée
au patient. Un tel protocole d’exploration ne permet
pas de recueillir tous les caractères sémiologiques
nécessaires à l’étude correcte d’une lésion tumorale
rénale. Par conséquent, un examen tomodensitomé-
trique orienté doit être programmé à nouveau.
L’examen tomodensitométrique doit être réalisé avec
une grande rigueur. Il a trois objectifs essentiels:
• Premier objectif: Etudier le rein en totalité afin de ne
pas méconnaître une zone pathologique.
• Deuxième objectif: Affirmer la présence ou l’absence
significative d’un rehaussement de la densité (mesurée
en unités Hounsfield) de la lésion suspecte après injec-
tion de produit de contraste iodé.
• Troisième objectif: Préciser le site exact de la lésion
notamment par rapport au hile rénal si une tumorecto-
mie ou une chirurgie partielle est envisagée.
Le premier objectif est toujours obtenu quand l’examen
est réalisé sur un appareil à rotation continue et acqui-
sition volumique. Dans ces conditions, l’ensemble des
coupes explorant la totalité du rein est effectué au cours
d’une apnée unique du patient et le problème de la
mobilité respiratoire du rein ne se pose pas. Sur les
appareils où les coupes sont obtenues une par une, à
chaque apnée du patient, la mobilité du rein ne permet
pas d’affirmer avec certitude l’exploration complète du
rein. Des coupes semi-centimétriques réalisées au
même temps respiratoire sont nécessaires pour dimi-
nuer le risque de méconnaître une zone pathologique
du rein examiné.
Le deuxième objectif nécessite également une tech-
nique d’examen irréprochable: les paramètres d’image-
rie (calibrage de la machine, matrice, constantes d’ac-
quisition) doivent être identiques entre les deux acqui-
sitions réalisées sans et après injection de produit de
contraste. En effet:
• L’épaisseur des coupes doit être inférieure ou égale à
5 mm voire 1 ou 2 mm suivant la taille de la lésion à
explorer, de façon à éviter les problèmes d’interpréta-
tion liés au phénomène de volume partiel.
• L’examen nécessite une quantité d’iode suffisante (au
moins 40 grammes) et une bonne qualité d’injection
(débit élevé et constant).
• L’acquisition doit se faire idéalement à un temps pré-
coce (temps artériel) et à un temps plus tardif (temps
néphrographique) sur la lésion de façon à apprécier la
cinétique vasculaire de cette lésion.
• Les fenêtres doivent être correctement choisies par
l’opérateur; les prises de densité doivent être réalisées
aux mêmes localisations avant et après injection de
produit de contraste.
• Enfin, la tumeur doit mesurer au moins un centimètre
pour permettre des mesures de densité fiable.
Dans ces conditions optimales, l’examen tomodensito-
métrique devient très sensible (sensibilité supérieure à
90%), et peut être considéré comme l’examen de réfé-
rence pour le diagnostic des petites tumeurs rénales [1].
Une différence de 10 unités Hounsfield élimine une
lésion kystique simple car elle traduit une lésion vas-
cularisée sans pouvoir déterminer la nature de cette
vascularisation qui peut être d’origine tumorale ou
infectieuse[4]. Une lésion qui se rehausse de plus de 40
unités Hounsfield après injection de produit de contras-
te est un bon signe d’appel en faveur d’une lésion
tumorale [21].
Aspects sémiologiques
En contraste spontané, les petites tumeurs rénales
solides sont souvent hypodenses au parenchyme sain,
parfois iso-denses et rarement hyperdenses.
Une hémorragie récente intra-tumorale ou des petites cal-
cifications rehaussent la densité spontanée de la tumeur.

Après injection du produit de contraste, au temps pré-
coce (artériel), la lésion a une densité élevée par rapport
au parenchyme sain puis cette différence de contraste
s’inverse et la lésion devient moins dense que le paren-
chyme adjacent [19]. Cette cinétique reflète ce que l’on
observe en artériographie : une prise de contraste inten-
se et précoce par la néovascularisation tumorale de la
lésion puis à un temps un peu plus tardif, le parenchy-
me rénal sain adjacent se rehausse en densité tandis que
le tissu tumoral (qui n’est pas le siège d’une sécrétion
tubulaire) apparaît moins dense.
L’examen tomodensitométrique permet également un
bilan d’extension loco-régionale et détecte les adénopa-
thies sous forme de masse tissulaire se rehaussant peu
après contraste [19]. Un éventuel bourgeon veineux
rénal ou cave engendre une image lacunaire intra-vas-
culaire au cours de l’opacification des veines rénales ou
de la veine cave.
Des reconstructions en 2 voire en 3 dimensions sont
possibles à partir du traitement informatique des don-
nées brutes.
L’imagerie par résonance magnétique
L’exploration des reins en IRM a longtemps été limitée
techniquement par les artefacts liés aux mouvements
respiratoires. Les performances de l’IRM se sont consi-
dérablement améliorées grâce à l’utilisation de
séquences rapides (pouvant être réalisées en apnée), à
des antennes plus adaptées à l'étude des reins et à l’uti-
lisation de produit de contraste para-magnétique
[10,11, 23].
Une petite tumeur solide, non hémorragique, se traduit
en règle par une lésion de même signal légèrement
moins intense que le parenchyme sain en pondération
Tl. Si elles ne déforment pas les contours du rein, elles
peuvent passer inaperçues. La différence de contraste
entre les tissus sains et pathologiques s'exprime mieux
en pondération T2 et en pondération Tl après injection
de produit de contraste para-magnétique (chelate de
gadolinium). En pondération T2, le signal d'une petite
tumeur rénale est variable mais habituellement diffé-
rent de celui du parenchyme sain avoisinant, plus sou-
vent en hyposignal quand il s’agit d’une petite tumeur
solide compacte.
Les portions vascularisées des tumeurs se rehaussent
après injection de chelate de gadolinium.
Les zones hémorragiques ont un signal élevé en pondé-
ration Tl, les zones nécrotiques ont un hyposignal en Tl
et un hypersignal en T2.
La graisse a un hypersignal en Tl qui diminue si on réa-
lise des séquences avec suppression de graisse (ces
caractéristiques sémiologiques propres à la graisse per-
mettent le diagnostic des angiomyolipomes). Le liqui-
de pur et non circulant a un signal homogène, très
faible en Tl et très intense en T2. Ainsi le diagnostic de
kyste cortical simple peut aussi être fait en IRM sur ces
critères.
L’artériographie
L’artériographie présente peu d’intérêt dans le dia-
gnostic des petites tumeurs rénales. Sa sensibilité se
situe autour de 70%. Cette mauvaise sensibilité résul-
te du caractère modérément vasculaire de certaines
tumeurs. Les signes sémiologiques en faveur d'une
lésion tumorale maligne sont une néo-vascularisation
tumorale caractérisée par des vaisseaux dysmor-
phiques, désorganisés et parfois des shunts artério-vei-
neux. Les petites tumeurs de localisation intra-paren-
chymateuse peuvent être masquées par le parenchyme
sain adjacent. L’artériographie peut être intéressante
lorsqu’une chirurgie conservatrice est envisagée dans
l’objectif de réaliser une cartographie artérielle pré-
opératoire.
DIAGNOSTIC ETIOLOGIQUE DES
DIFFERENTES TUMEURS
La sémiologie radiologique permet d’orienter la
démarche diagnostique devant la découverte d’une
petite tumeur rénale. Nous distinguerons dans cette dis-
cussion le groupe des tumeurs kystiques, le groupe des
tumeurs solides primitives et le groupe des tumeurs
secondaires.
Nous discuterons également les diagnostics différen-
tiels : les infarctus rénaux, les infections focales et les
pseudo-tumeurs (hypertrophie d'une colonne de Bertin,
lobulations congénitales et hypertrophie compensatri-
ce).
Les tumeurs kystiques du rein
La découverte d’une lésion kystique du rein est parti-
culièrement fréquente. 50% des sujets de plus de 50 ans
sont porteurs d’un ou de plusieurs kystes rénaux
bénins. Le problème qui se pose est que par ailleurs 10
à 15% des tumeurs malignes du rein peuvent se pré-
senter sous une forme kystique. Il faut donc définir des
signes sémiologiques radiologiques dont la valeur pré-
dictive positive soit suffisamment intéressante pour, en
pratique, différencier les kystes sûrement bénins de
ceux qui présentent une malignité incertaine.
Pour répondre à cette question, la démarche radiolo-
gique proposé par BOSNIAK [71 est claire et précise. Il
différencie quatre types de lésions kystiques selon des
critères sémiologiques précis en tomodensitométrie :
des critères morphologiques d’une part et d’autre part
la recherche d’une vascularisation tumorale.
486

Catégorie I
Il s’agit de kyste simple, bénin, situation fréquente qui
pose peu de problème de diagnostic.
En échographie, la lésion est ronde ou ovalaire, à
contours nets et bien définis, sans paroi visible, de
contenu anéchogène accompagné d’un renforcement
postérieur des échos.
En TDM, les caractères morphologiques sont iden-
tiques. Les mesures de densité confirment leur caractè-
re liquidien (densité spontanée < à 20 UH). Après
injection de produit de contraste, la densité de la lésion
ne se rehausse pas et reste inférieure à 20 unités
Hounsfield (UH). (Autrement dit, une lésion dont la
densité après injection est mesurée inférieure à 20 UH
peut être considérée comme non vascularisée). Cet
ar
gument autorise le diagnostic de kyste simple sur un
scanner réalisé d’emblée avec injection de produit de
contraste.
Pour les lésions de moins de 1 cm, la fiabilité diagnos-
tique diminue essentiellement par majoration des arte-
facts de volume partiel en tomodensitométrie et par
manque de résolution en échographie. Le contexte cli-
nique, l’âge des patients, la possibilité de surveiller la
lésion et la confrontation des résultats TDM et écho-
graphiques sont des éléments décisifs.
Catégorie II
Ces lésions regroupent des kystes atypiques : ce sont
des kystes qui présentent moins de deux fines septa-
tions, de fines calcifications pariétales ou septales ou
des anomalies de densité spontanée. L’élévation de
densité spontanée au delà de 20 UH (30 jusqu'à 60 UH)
traduit la présence d’un liquide riche en protide ou d’un
contenu hémorragique (Figure 1).
En échographie, le caractère parfaitement transsonore
du kyste n’est plus retrouvé et le renforcement posté-
rieur des échos est moins marqué. Dans ce cas, le dia-
gnostic de bénignité, synonyme d’abstention thérapeu-
tique, est plus difficile à porter. Le recours à un examen
tomodensitométrique est nécessaire. La discussion
sémiologique s’organise autour de la présence ou de
l’absence de rehaussement de la lésion après injection
de produit de contraste. Cette situation impose de réa-
liser un scanner sans et avec injection d’iode. Pour
BOSNIAK, un rehaussement de plus de 10 UH est syno-
nyme d’une vascularisation de la lésion.
En l’absence de prise de contraste, le kyste est classé
catégorie II, il est bénin. En cas de prise de contraste, il
devient suspect et classé catégorie III.
Catégorie III
Elle représente le groupe des lésions pour lesquelles
certains caractères morphologiques sont suspects (cal-
cifications irrégulières, parois épaisses et nombreuses,
septa vascularisés se rehaussant après injection de
contraste, kystes multi-loculaires).
Ces lésions peuvent correspondre à des kystes bénins
inflammatoires ou des tumeurs kystiques bénignes ou
malignes du rein.
La discussion étiologique est radio-clinique centrée sur
l’existence d’une vascularisation de la lésion. Un
rehaussement de 10 UH après injection de produit de
contraste iodé authentifie en TDM une vascularisation.
Dans certains cas, le rehaussement de la lésion peut
être douteux en TDM, c’est alors l’indication à réaliser
une IRM du rein à la recherche d’un rehaussement du
signal tumoral après l’injection de chelate de gadoli-
nium. L’IRM grâce à sa résolution en contraste supé-
rieur permet de résoudre les cas difficiles où la TDM
seule ne pouvait conclure.
Catégorie IV
Ce sont les lésions kystiques qui présentent des signes
francs de malignité, rehaussement de contraste en
TDM ou rehaussement du signal en IRM ainsi que des
critères morphologiques suspects (végétations vascula-
risées, irrégularités des parois qui sont épaissies,
nodules muraux). Ces lésions sont considérées comme
des lésions malignes du rein [13].
En définitive, il apparaît que les lésions kystiques de
type I sont de diagnostic facile, une simple échographie
ou l’absence de prise de contraste (lésions inférieures à
20 UH donc avasculaires) sur une TDM réalisée avec
injection de produit de contraste d’emblée permettent
en général de conclure [7].
Le moindre doute sur une lésion de type II, III ou IV
nécessite un examen TDM orienté, réalisé sans et avec
injection de produit de contraste à la recherche d’une
vascularisation anormale de la lésion. L'IRM est indi-
quée dès lors que l’examen TDM ne permet pas de
conclure avec confiance sur l’absence de prise de
contraste. En imagerie, les lésions de type III ou IV ne
peuvent être différenciées d’une forme kystique de
cancer rénal et par conséquent doivent être considérées
comme telle.
Les angiomyolipomes
Les angiomyolipomes méritent d'être traités à part car
il s’agit de tumeurs solides ayant une composante
graisseuse dont l'étude tomodensitométrique permet la
caractérisation. Cet aspect diagnostique est essentiel
car de nombreux angiomyolipomes de taille inférieure
à 4 cm ne sont pas opérés et sont surveillés en image-
rie.
La plupart des petits angiomyolipomes ont une écho-
structure homogène, hyperéchogène (Figure 2). Cet
aspect n’est toutefois pas spécifique et se retrouve éga-
487

lement pour les petits adénocarcinomes du rein. Toute
suspicion échographique d’angiomyolipome (masse
homogène et hyperéchogène) doit être vérifiée par
tomodensitométrie. En effet, le contingent graisseux de
l’angiomyolipome est caractérisé en tomodensitométrie
par une densité spontanée inférieure à moins 10 UH
(Figure 3) et l’absence de calcification. Afin que les
mesures de densité ne soient pas erronées, il est essen-
tiel de rechercher le contingent graisseux sur des
coupes sans injection de produit de contraste, de faible
épaisseur (5 voire 2 mm) et de réaliser les mesures sur
des zones d’intérêt peu étendues. En cas de doute, un
histogramme des densités peut être réalisé en tomoden-
sitométrie [8, 9]. Il s’agit d’un traitement informatique
de l’image qui permet après un fin quadrillage de cette
image de calculer la densité au sein de chaque zone
quadrillée.
En théorie, l’IRM permet également d'apporter des
arguments diagnostiques supplémentaires en faveur
d'un angiomyolipome, la graisse se caractérisant par un
hypersignal intense en pondération T1, bien visible par
rapport au parenchyme sain lui-même en hyposignal [4,
5]; l’hypersignal diminue lorsque l’on utilise une tech-
nique de suppression de graisse en pondération T1.
Enfin, l’aspect de la graisse en T2 est celui d’un contin-
gent de signal intermédiaire peu spécifique. Mais il faut
retenir que le diagnostic se fait en tomodensitométrie.
Les tumeurs solides du rein
Les petites tumeurs rénales inférieures à 3 cm sont fré-
quentes et sont bénignes dans 20% des cas.
Le diagnostic de tumeur tissulaire du rein repose sur la
mise en évidence d’une vascularisation tumorale [7,
17]. Quatre méthodes d’imagerie permettent d’y parve-
nir:
En pratique, le scanner joue un rôle prépondérant.
• L’artériographie détecte la néo-vascularisation tumo-
rale dans 70% des cas. Mais, c'est une méthode invasi-
ve qui n’est plus pratiquée dans cet optique.
• L’échographie couplée au Doppler couleur peut détec-
ter des flux vasculaires intra-tumoraux, mais ses per-
formances n’ont pas été évaluées pour les petites
tumeurs rénales.
• La tomodensitométrie est la méthode d’imagerie de
référence. Une augmentation de 10 unités Hounsfield
de la densité tumorale après injection de produit de
contraste caractérise le caractère vascularisé de la
lésion [7] (Figure 4).
• Le rehaussement du signal après injection de chélate
de gadolinium d’une lésion tumorale a la même signi-
fication.
Toutefois, aucune de ces techniques d’imagerie ne per-
met de caractériser avec confiance la nature histolo-
gique de la lésion, un petit oncocytome peut se présen-
ter comme une tumeur maligne du rein (Figure 5).
Quant à la distinction entre adénome et adénocarcino-
me à cellules claires, elle repose uniquement sur des
arguments histologiques (taille de la tumeur, atypies
cellulaires).
Dans le cadre de la pathologie tumorale, l’imagerie
permet un bilan d'extension loco-régionale mais sur-
tout un bilan pré-opératoire précis dans le cas où une
néphrectomie partielle est envisagée. La tomodensito-
métrie permet de rechercher des tumeurs rénales mul-
tiples, uni ou contro-latérales. Elle permet de recher-
cher des adénopathies, se présentant sous la forme de
masse solide plus ou moins vascularisée. Le caractère
pathologique des ganglions rétro-péritonéaux est
reconnu lorsque leur diamètre excède 15 mm. Cette
taille-seuil de 15 mm est un compromis permettant une
sensibilité et une spécificité satisfaisantes. La tomo-
densitométrie permet également de rechercher une
extension veineuse rénale, beaucoup plus rarement
cave inférieure. La tomodensitométrie en mode héli-
coïdal permet de suivre l’opacification de la veine
rénale puis de la veine cave inférieure et d’y déceler la
présence de bourgeons tumoraux.
Enfin, l’imagerie permet d’aider le chirurgien dans le
choix de l’intervention (néphrectomie, tumorectomie
ou néphrectomie partielle). La topographie de la lésion,
sa position par rapport au hile et aux contours du rein,
son caractère peu infiltrant sont des informations que
peuvent apporter l’IRM et les reconstructions bi et tri-
dimensionnelles en tomodensitométrie
Les tumeurs secondaires rénales
Les métastases rénales sont souvent multiples. C’est le
premier diagnostic à retenir chez un patient ayant un
cancer du sein ou du poumon déjà connu. Elles sont
souvent associées à des adénopathies rétro-péritonéales
dont la présence renforce le diagnostic [18]. Leurs
caractères sémiologiques sont aspécifiques (Figure 6).
En cas de doute diagnostique, une ponction biopsie
percutanée peut être légitimement proposée. Leur
régression sous traitement chimiothérapique est un bon
argument en faveur du diagnostic.
Le lymphome
Le lymphome primitif du rein est exceptionnel car le
rein ne contient pas de tissu lymphoïde [3].
Généralement, les lésions rénales lymphomateuses
sont multiples, de taille variable, situées dans le cortex.
La forme isolée, nodulaire est rare (moins de 10%).
Dans la grande majorité des cas, il s’agit de lésions
secondaires par dissémination hématogène ou par
contiguïté à partir de localisations rétro-péritonéales.
Les lymphomes non hodgkiniens prédominent.
488
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
1
/
12
100%