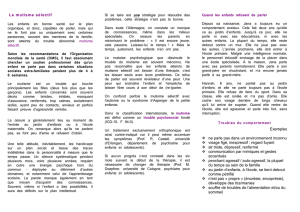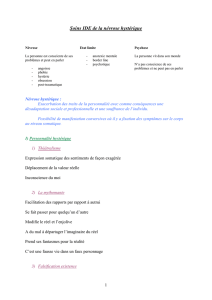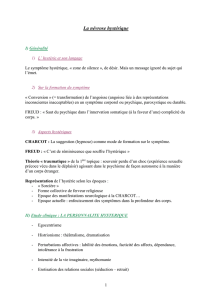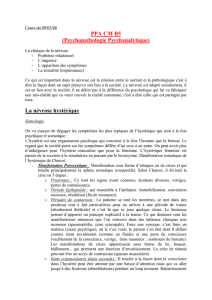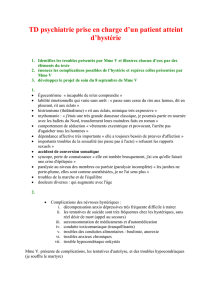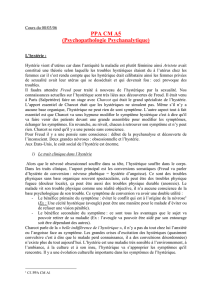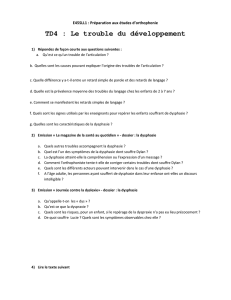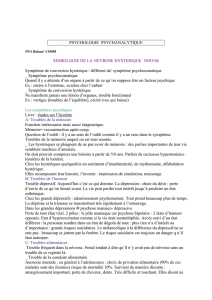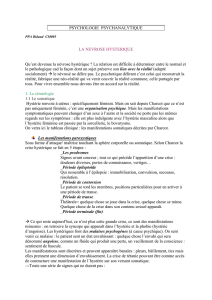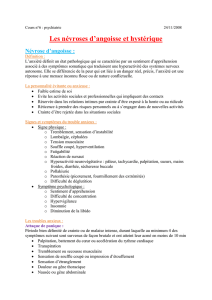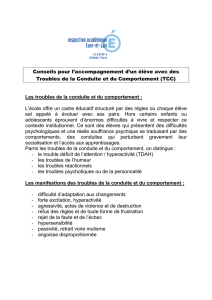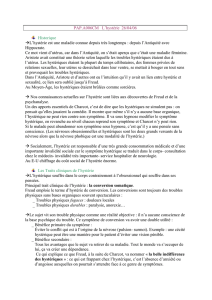Télécharger l`article au format PDF

L’Encéphale (2011) 37, 339—344
Disponible en ligne sur www.sciencedirect.com
journal homepage: www.em-consulte.com/produit/ENCEP
CLINIQUE
Le mutisme hystérique
Hysterical mutism
J.-P. Schustera,∗, S. Mouchabacb,Y.LeStrat
c, F. Limosina,c
aService universitaire de psychiatrie, hôpital Corentin-Celton, assistance publique—hôpitaux de Paris,
université Paris Descartes, 4, Parvis-Corentin-Celton, 92130 Issy-les-Moulineaux, France
bDépartement de psychiatrie et de psychologie médicale, CHU Saint-Antoine, 184, rue du Faubourg-Saint-Antoine,
75012 Paris, France
cInserm U894, centre de psychiatrie et neurosciences, hôpital Sainte-Anne, 75014 Paris, France
Rec¸u le 9 octobre 2009 ; accepté le 21 septembre 2010
Disponible sur Internet le 2 février 2011
MOTS CLÉS
Mutisme ;
Trouble de
conversion ;
Hystérie
Résumé Identifié de tout temps, le mutisme hystérique est rentré dans le champ médical
sous l’impulsion de Jean-Martin Charcot. Depuis, même si ce trouble s’est imposé comme entité
clinique, il reste peu connu. À travers la revue de la littérature, se dessine un trouble rare, envi-
ron 5 % des dysphonies fonctionnelles, et concernant principalement les femmes âgées de 30à
40 ans. L’existence d’une comorbidité psychiatrique ne semble pas être la règle. L’histoire natu-
relle de ce trouble est peu connue, rendant délicate l’évaluation de l’efficacité des nombreuses
thérapies proposées. Aujourd’hui, le terme de mutisme hystérique n’apparaît pas en tant
qu’entité propre dans les classifications internationales. Repéré en tant que trouble médical et
décrit par l’école de la Salpêtrière, ce trouble bruyant n’a soulevé que peu d’intérêt, rendant
sa connaissance aujourd’hui imprécise. Sa prise en charge est particulièrement complexe. La
médicalisation de cette affection reste toutefois difficile du fait de l’importance de la stigma-
tisation qui lui est associée, qui contribue au rejet plutôt qu’à la prise en charge des patients
souffrant de mutisme. Afin de mieux comprendre ce trouble et d’améliorer la prise en charge
des patients qui en souffrent, un regain d’intérêt paraît souhaitable.
© L’Encéphale, Paris, 2010.
KEYWORDS
Mutism;
Conversion disorder;
Hysteria
Summary
Background. — Conversion disorders comprise many clinical pictures, including hysterical
mutism. Hysterical mutism has emerged as a clinical entity that remains difficult to diagnose,
and whose treatment is poorly codified. Hysterical mutism is a disorder of the vocal function
without changing the integrity of the body, resulting in loss of voice. Identified at all times,
hysterical mutism entered the medical field in the late nineteenth century, under the direction
of Jean-Martin Charcot (Salpêtrière School). Since then, although the disorder has emerged as
a clinical entity, it remains little known.
∗Auteur correspondant.
Adresse e-mail : [email protected] (J.-P. Schuster).
0013-7006/$ — see front matter © L’Encéphale, Paris, 2010.
doi:10.1016/j.encep.2010.12.006

340 J.-P. Schuster et al.
Method. — A systematic review of the literature. We performed electronic literatures search of
relevant studies using Medline, SUDOC, and BIUM. Search terms used were mutism, functional
aphonia, conversion disorder, hysteria.
Results. — The epidemiology of hysterical mutism is difficult to assess. The first limitation is
the lack of consensensual diagnostic criteria. An estimate of its frequency may be advanced
through registries consultation of otolaryngology-head and neck surgery. Through a literature
review, emerges a rare disorder, about 5% of functional dysphonia. The sex-ratio is in favour of
women. Regarding age of onset of disorder, functional aphonia mainly concerns adults with an
average around the age of 30—40 years. The onset of the disorder typically involves a sudden
onset and a recent stressful event. The duration of the disorder is difficult to specify. It appears
that this dysfunction is rapidly reversible and that the majority of patients are in remission of
this disorder within three months. The recurrence of dysfunction seems to be frequent. The
existence of psychiatric comorbidity did not appear to be the rule. The natural history of this
disorder is not known making it tricky to evaluate the efficiency of therapeutic approaches.
Conclusion. — Today the term hysterical mutism does not appear as an entity in either inter-
national classification. It belongs to the category of conversion disorder in the Diagnostic and
Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-IV-TR). Identified as a medical entity described
by the school of the Salpêtrière, this disorder has raised little interest. The medicalization of
the condition remains difficult because of the importance of stigma associated with it, which
contributes to the rejection rather than support of patients with mutism. To better understand
this disorder and improve the care of patients who suffer, renewed interest is warranted.
© L’Encéphale, Paris, 2010.
«Tous les symptômes du mutisme hystérique, (...) symp-
tomatologie si complexe et si spéciale à la fois. »
J.-M. Charcot [15].
Introduction
Les troubles de conversion recouvrent de nombreux tableaux
cliniques, dont le mutisme hystérique. Existant dans
l’imaginaire populaire sous l’expression «avoir perdu sa
langue », le mutisme hystérique s’est imposé comme entité
clinique qui reste cependant difficile à diagnostiquer et dont
le traitement est mal codifié.
Le mutisme hystérique est une atteinte de la fonc-
tion phonatoire sans modification de l’intégrité organique,
entraînant une disparition de la voix. La terminolo-
gie utilisée dans la littérature concernant les troubles
de la voix non organique est restée imprécise pendant
de nombreuses années, avec l’usage du terme aphonie
psychogène ou fonctionnelle qualifiée de perte plus ou
moins complète de la voix [19]. Le terme de mutisme
ne souffre pas de cet imprécision, il est défini par
l’absence de l’expression verbale, les centres du langage
et ses organes d’expression étant indemnes de lésions.
Ce mutisme peut s’inscrire dans le cadre d’un syndrome
mélancolique, d’une confusion mentale, d’un syndrome
délirant ou, classiquement, dans un syndrome de conversion
[3].
Dans ce dernier cadre, le terme de mutisme fonctionnel
ou hystérique semble plus approprié que le terme d’aphonie
hystérique pour définir la disparition totale du langage
oral sans participation organique. Il correspond au trouble
fonctionnel psychogénique de la voix de type 1 selon la clas-
sification proposée par Baker et al. [5].
Historique
Dans l’antiquité, les auteurs classiques rapportent des cas de
recouvrements inattendus de l’usage de la parole préalable-
ment perdue. La lecture de ces récits évoque la possibilité
de cas de mutisme hystérique. Le plus célèbre est rapporté
par Hérodote et concerne le fils de Crésus. Lors de la prise de
Sardes par les armées de Cyrus victorieuses, un Perse allait
tuer Crésus sans le reconnaître. Le fils muet du roi défait,
à la vue du Perse qui se jetait sur son père, saisi d’effroi,
s’écria alors : «Soldat, ne tue pas Crésus ! »Tels furent ses
premiers mots ; et il conserva la faculté de parler le reste
de sa vie [27].
Les exemples historiques se succèdent. Il est à noter que
cette symptomatologie sans cause organique évidente s’est
placée à la fin du Moyen Âge sous l’autorité du sacré et du
mystérieux, tout à la fois signes de stigmates religieux ou
de sorcellerie.
C’est à la fin du XIXesiècle que le mutisme hystérique
est étudié en tant que trouble médical, sous l’impulsion de
Jean-Martin Charcot et l’école de la Salpêtrière. En 1886,
Cartaz consigne des observations de mutisme et d’aphonie
hystérique dans son mémoire Du mutisme hystérique cité
par Biolet [10]. Ces troubles se différencient par leur fré-
quence, rare pour le premier et élevée pour la seconde, et
par la possibilité d’émission sonore, celle-ci restant possible
dans l’aphonie quoique effectuée de fac¸on chuchotée.
Un an plus tard, Bouchaud, médecin chef de l’asile de
Lommelet près de Lille, à propos d’une observation [11]
rappelle l’enseignement de Charcot en décrivant les carac-
téristiques essentielles du trouble le distinguant de l’aphasie
motrice d’origine organique. Il replace notamment la symp-
tomatologie dans le cadre de l’hystérie. Pour Bouchaud, «la
perte de la parole est une manifestation assez fréquente de

Le mutisme hystérique 341
l’hystérie. Elle est signalée sous le nom de mutisme hysté-
rique, (et) si l’affection hystérique se montre le plus souvent
polymorphe, elle peut se trouver, en revanche, réduite à un
seul élément symptomatique. Il en est ainsi du syndrome
mutisme hystérique. Il se montre quelquefois parfaitement
isolé, seul témoin de la maladie ».
Dans une de ses Lec¸ons, Charcot présente le cas d’un
jeune patient de 21 ans, mac¸on, qui dans l’exercice de son
métier est tombé d’un échafaudage de trois étages. Suite
à ce traumatisme professionnel, ce patient est devenu «le
héros de toute une Iliade de phénomènes hystériques »et
en particulier un mutisme hystérique, défini par une aphasie
motrice sans accompagnement d’agraphie [16].
En 1891, dans la droite ligne de l’enseignement du maître
de la Salpêtrière, Biolet [10] soutient sa thèse pour le doc-
torat en médecine, intitulée Quelques considérations sur
le mutisme hystérique. Celle-ci s’articule autour de vingt-
six observations, vingt issues du mémoire de Cartaz, trois
des lec¸ons du mardi du Pr Charcot, et trois de l’expérience
de l’auteur. Le tableau clinique du mutisme hystérique est
ainsi décrit : «Dans la grande majorité des cas le mutisme
hystérique débute brusquement. Il survient à la suite d’une
grande frayeur, d’une émotion vive de nature quelconque,
on le voit se produire parfois au sortir d’une attaque hys-
térique ; ou bien sans cause provocatrice apparente dans le
cours de l’aphonie hystérique. La durée est extrêmement
variable : tantôt de quelques heures, de quelques jours à
peine, on l’a vu s’étendre à des mois, à des années même.
La guérison est constante et la disparition du mutisme est le
plus souvent aussi soudaine qu’en avait été l’apparition. Elle
survient donc brusquement, et, comme devant, à la suite
d’une vive émotion. Les récidives sont fréquentes. »[10].
Biolet, rapportant un postulat de Charcot, souligne que
«si l’individu muet ne peut chuchoter, (...) c’est parce qu’il
lui manque désormais la possibilité d’exécuter les mouve-
ments propres, spécialisés, pour l’articulation des mots ; il
est privé en d’autres termes des représentations motrices
nécessaires pour la mise en jeu du mécanisme de la parole
articulée »[10].
Il est à noter, qu’à cette même période en Autriche-
Hongrie, Arthur Schnitzler, plus connu pour son œuvre
littéraire, s’intéresse à ce trouble de la parole dans
le service d’oto-rhino-laryngologie dirigé par son père à
l’université de Vienne. Influencé par la lecture de Bern-
heim (traduite par Freud [7]), Schnitzler rapporte six cas
d’aphonie hystérique traités par hypnose [36]. Il propose
d’écarter le terme d’hystérie, trop stigmatisé, pour qualifier
ce trouble de fonctionnel.
Au début du XXesiècle, Janet, dans Les névroses [30], fixe
le tableau clinique du mutisme hystérique. Il est décrit dans
les symptômes de la névrose hystérique et plus particuliè-
rement dans le troisième chapitre concernant les troubles
du langage. Dans ce cadre, il est traité de fac¸on liée aux
agitations verbales hystériques, crises de «logorrhée dans
lesquelles le sujet parle indéfiniment, à tort et à travers, de
toute espèce de chose sans pouvoir s’arrêter ».
Pour Janet, le mutisme hystérique survient chez des
sujets hystériques avérés qui ont déjà présenté beaucoup
de symptômes névrotiques, à la suite d’une grande émo-
tion assez subite ou d’un somnambulisme, mais il peut aussi
survenir chez des personnes sans antécédents particuliers
notables.
À la phase d’état, le patient a une compréhension conser-
vée sans altération intellectuelle. Il n’a pas l’«air hébété,
il semble, au contraire, intelligent et vif ». Selon Janet,
un fait caractéristique est que le patient ne semble pas
essayer de répondre oralement aux questions : «Il ne fait
pas ces efforts que fait un individu aphasique ou que fait
tout simplement un étranger qui cherche à s’exprimer dans
une langue qu’il connaît mal. Il n’a pas l’air de croire que
l’on puisse répondre par la parole, il n’ouvre pas la bouche,
ne fait entendre aucun son, il répond par écrit. En un mot,
il n’y a pas là une parole imparfaite, il n’y a pas là de parole
du tout et il semble même que ce malade n’a plus l’idée ni
le désir de la parole. Le sujet semble avoir oublié cet usage
qu’à tort ou à raison les hommes ont fait de leur bouche »
[30].
Janet indique l’absence à peu près totale de phénomène
paralytique. Il existe de petits troubles du mouvement loca-
lisés, qui ne rendent pas compte de la paralysie du langage.
Dans un cadre dépassant la description clinique des phé-
nomènes hystériques, Janet propose une théorisation de ces
phénomènes. Pour lui, «[...] les choses se passent comme
si la fonction du langage cessait d’être à la disposition de
la conscience personnelle qui ne sait plus ni l’arrêter ni la
provoquer. La fonction du langage subsiste, mais elle est sim-
plement diminuée en ce sens qu’elle n’est plus consciente
ni personnelle. (...) c’est une dissociation des fonctions »
[30].
Données actuelles
Si l’entité «mutisme hystérique »est reconnue depuis plus
d’un siècle, peu d’études récentes s’y sont intéressées.
L’épidémiologie du mutisme hystérique est difficile
à évaluer. Une estimation de sa fréquence peut être
avancée grâces aux registres de consultation d’oto-
rhino-laryngologie. En 1969, Brodnitz indique que sur
2087 consultations, 1677 patients présentaient un trouble de
la voix qui n’était pas en lien avec un handicap organique.
Parmi ceux-ci, 74, soit 4,4 %, avaient une aphonie fonc-
tionnelle totale [13]. Ces chiffres sont comparables à ceux
avancés par Le Huche et Yana. Dans un rapport de la Société
franc¸aise de phoniatrie en 1974, ils indiquent que les apho-
nies concernent 5 % de l’ensemble des cas de dysphonies
dysfonctionnelles [32].
Parmi les 109 patients présentant un trouble fonctionnel
de la voix répertorié entre 1977 et 1981 dans un centre spé-
cialisé du Middlesex Hospital à Londres, neuf présentaient
une aphonie totale [39]. Le mutisme hystérique reste rare,
ainsi House et al. ne rapportent aucun cas parmi 71 patients
présentant un trouble fonctionnel de la voix [28].
Le sex-ratio est en faveur d’une prédominance fémi-
nine de l’aphonie fonctionnelle (Tableau 1). Il existe
cependant des exceptions notables à cette prédomi-
nance : lors des conflits armés, le mutisme fonctionnel
semble être relativement fréquent parmi les soldats
ayant vécu d’importants traumatismes [23]. Ainsi, pen-
dant le premier conflit mondial, Carl Otto Von Eicken
avait créé une section spéciale à Berlin pour porter soins
aux soldats présentant une aphonie psychogène. Head
note que durant ce conflit les troubles de la parole
étaient parmi les accidents hystériques les plus fréquents,

342 J.-P. Schuster et al.
Tableau 1 Sex-ratio de l’aphonie fonctionnelle.
Étude Année Nombre de sujets inclus Proportion de femmes (%)
Barton [6] 1960 20 100
Cornut [18] 1965 25 88
Aronson et al. [4] 1966 27 88
Brodnitz [13] 1969 62 80,6
Bridger et al. [12] 1983 109 68
Gerritsma [22] 1991 82 91,5
Gunther et al. [24] 1996 49 93,9
Tsunoda et al. [38] 1996 10 90
White et al. [39] 1997 19 95
Shen [37] 1998 27 96,3
House et al. [28] 1987 71 86
et que parfois ces patients présentaient un mutisme
[26].
Concernant l’âge de survenue des troubles, l’aphonie
fonctionnelle concerne essentiellement l’adulte entre 20 et
50 ans, avec une moyenne autour de l’âge de 40 ans
[12,13,32,40], ou de 30 ans selon les études [18,22,37,38].
Bridger et al. [12] rapportent le cas d’un patient âgé de
79 ans. Il s’agit à notre connaissance du patient le plus âgé
parmi les études concernant les aphonies fonctionnelles.
Harris et al. [25] publient un article s’intéressant spécifi-
quement à une population pédiatrique, le plus jeune patient
étant âgé de six ans. Froese et al. [21] publient en 1987 une
revue de la littérature ne retrouvant qu’une douzaine de cas
de dysphonie psychogène survenant avant l’âge de 16 ans.
L’apparition du trouble associe classiquement un début
brutal et un événement récent stressant [2]. L’existence
d’un facteur déclenchant anxiogène est en effet le plus
souvent retrouvée mais ne semble pas systématique. Ainsi,
Bathia et al. n’identifient pas de cause dans 20 % des cas
[8]. Les facteurs déclenchants les plus fréquents sont les
périodes de stress en relation avec un examen, les conflits
familiaux et les deuils [8]. Un événement traumatique n’est
rapporté dans l’anamnèse des troubles sur une période de un
an, que dans 23 % des cas dans l’étude de House et Andrews
[29].
La durée des troubles est difficile à préciser. Il semble que
ce trouble fonctionnel soit rapidement réversible et que la
majorité des patients présente une rémission des troubles
en moins de trois mois [12,25,37].
Les modes de reprise de la fonction langagière sont
variables : progressif, brutal, ou progressif puis brutal [25].
La reprise ad integrum du langage oral est la règle générale
[12].
La récurrence du trouble fonctionnel semble fréquente.
Toutefois, peu d’études ont évalué ce risque. Günther et al.
ont mis en place un suivi prospectif de 40 femmes sur une
période de cinq ans [24]. Vingt et une de ces patientes ont
présenté une récidive du trouble sur cette période, soit
une prévalence de 52 %. La durée moyenne de ces récur-
rences était de 17 jours. Les patientes qui ont présenté des
rechutes du trouble fonctionnel se différentiaient signifi-
cativement des patientes avec un unique épisode par des
scores plus élevés sur l’échelle d’anxiété-trait de Spiel-
berger et par l’existence de problèmes dans le domaine
de la vie privée plus fréquents. Elles présentaient un plus
grand respect des normes sociales, traduisant une plus faible
assertivité.
House et Andrews indiquent, parmi leur échantillon étu-
dié, que l’épisode évalué est une récurrence pour 27 % des
patients [28], et dans la série de patients recrutés par Shen,
33 % des patients sont traités pour une récidive [37]. Ger-
ritsma observe, au sein d’une population de 82 patients,
que les patients ont présenté entre deux et trois épisodes
similaires dans le passé [22].
Peu de données concernent les comorbidités psychia-
triques du mutisme hystérique. Willinger et al. évaluent
61 sujets présentant une dysphonie fonctionnelle [40]. Dans
cette population, plus d’un tiers des patients présentent un
trouble de l’humeur et 20 % souffrent d’un trouble anxieux.
Toutefois, pour House et al. la majorité des patients
ne présente pas de diagnostic psychiatrique [28]. Ainsi,
parmi 71 patients présentant une dysphonie fonctionnelle,
48 n’ont présenté aucun trouble psychiatrique le mois précé-
dant le trouble, tandis que 11 avaient un trouble thymique,
et 11 un trouble anxieux [28].
Butcher confirme ce résultat, et n’observe pas de
troubles psychiatriques graves parmi les patients inclus dans
son étude. Toutefois, les patients présentaient des niveaux
considérables de stress et une difficulté marquée à expri-
mer leurs sentiments [14]. Dans le même registre, Kinzl
et al. indiquent que 36 % des patients présentent des traits
alexithymiques, et 18 % une structure de personnalité his-
trionique [31]. Gerritsma indique que, parmi les 82 patients
de son étude, trois présentent une personnalité histrionique
[22]. Aronson et al. [4] évaluent 27 patients présentant une
aphonie psychogène à l’aide du Minnesota Multiphasic Per-
sonality Inventory : huit évaluations indiquent des traits
histrioniques.
Millar et al. [34] comparent des patients présentant des
dysphonies organiques et fonctionnelles, ces deux popu-
lations se différencient uniquement sur les scores de la
dimension extraversion du questionnaire de personnalité
d’Eysenck, elles sont semblables sur l’ensemble des autres
évaluations concernant les troubles thymiques et anxieux.
On constate, à la lumière des recherches concernant
l’étude des personnalités chez les patients présentant un
trouble de conversion mutique, le faible lien entre person-
nalité histrionique et mutisme hystérique [20].
De nombreux thérapeutes ont proposé des techniques
pour accélérer la guérison. On peut noter une variabilité

Le mutisme hystérique 343
importante des thérapies : de la suffocation à l’hypnose [33],
de l’acupuncture [37] à la technique du karaoké [38],et
de la faradisation endolaryngée [9] à l’injection intracaro-
tidienne [1] ou encore à la «thérapie prokalétique »[35].
Cette dernière est une psychothérapie basée sur un lien
fort entre le patient et le thérapeute, permettant à ce der-
nier de placer le patient dans une situation inconfortable
de défi (prokalesis en grec) par rapport aux interprétations
possibles de son symptôme. Il est également à noter un cas
de guérison attribuée à la stimulation magnétique transcra-
nienne [17].
L’absence de données sur l’évolution naturelle du trouble
et le caractère non contrôlé de l’évaluation des thérapies
proposées invitent à une grande prudence quant à la vali-
dation des effets thérapeutiques des techniques proposées.
Concernant les traitements, Charcot notait avec un certain
recul : «Quant au traitement il ne saurait être que psy-
chique. La suggestion des malades, la démonstration qu’ils
peuvent, qu’ils doivent parler, toutes les ressources enfin
de l’influence morale seront mises en jeu mais le plus sou-
vent le mutisme cesse brusquement à un moment où l’on s’y
attend le moins »[15].
Conclusion
Aujourd’hui, le terme de mutisme hystérique n’apparaît pas
en tant qu’entité propre dans les classifications internatio-
nales. Il fait partie de la catégorie «trouble de conversion »
dans le manuel diagnostique et statistique des troubles men-
taux, quatrième édition, texte révisé (DSM-IV-TR). Repéré
en tant que trouble médical et décrit par l’École de la Sal-
pêtrière, ce trouble bruyant n’a soulevé que peu d’intérêt
rendant sa connaissance aujourd’hui imprécise. Sa prise
en charge est particulièrement complexe. La médicalisa-
tion de cette affection reste toutefois difficile du fait de
l’importance de la stigmatisation qui lui est associée, qui
contribue au rejet plutôt qu’à la prise en charge des patients
souffrant de mutisme.
Conflit d’intérêt
Aucun conflit d’intérêt.
Références
[1] Adeloye A. Hysterical deaf-mutism in a Nigerian soldier. Lancet
1972;2(7788):1200—1.
[2] Akhtar S, Buckman J. The differential diagnosis of mutism:
a review and a report of three unusual cases. Dis Nerv Syst
1977;38(7):558—63.
[3] Altshuler LL, Cummings JL, Mills MJ. Mutism: review, dif-
ferential diagnosis, and report of 22 cases. Am J Psychiatry
1986;143(11):1409—14.
[4] Aronson AE, Peterson Jr HW, Litin EM. Psychiatric symptomato-
logy in functional dysphonia and aphonia. J Speech Hear Disord
1966;31(2):115—27.
[5] Baker J, Ben-Tovim D, Butcher A. Development of a modified
diagnostic classification system for voice disorders with inter-
rater reliability study. Logoped Phoniatr Vocol 2007;32:99—112.
[6] Barton RT. The whispering syndrome of hysterical dysphonia.
Ann Otol Rhinol Laryngol 1960;69:156—64.
[7] Bernheim H. De la suggestion et de son application à la théra-
peutique (1886). Paris: L’Harmattan; 2005.
[8] Bhatia MS, Vaid L. Hysterical aphonia -an analysis of 25 cases.
Indian J Med Sci 2000;54(8):335—8.
[9] Bigenzahn W, Hofler H. Therapy of psychogenic aphonias
using endolaryngeal faradization. Laryngol Rhinol Otol (Stuttg)
1986;65(11):659—61.
[10] Biolet F. Quelques considérations sur le mutisme hystérique.
Paris: Henri Jouve; 1891.
[11] Bouchaud. Aliénation mentale et mutisme hystérique. Ann Med
Psychol (Paris) 1887;6.
[12] Bridger MW, Epstein R. Functional voice disorders. A review of
109 patients. J Laryngol Otol 1983;97(12):1145—8.
[13] Brodnitz FS. Functional aphonia. Ann Otol Rhinol Laryngol
1969;78(6):1244—53.
[14] Butcher P. Psychological processes in psychogenic voice disor-
der. Eur J Disord Commun 1995;30(4):467—74.
[15] Charcot JM. Œuvre complète, vol. 3. Paris: Delahaye; 1887.
[16] Charcot JM. Cours du mardi 24 avril 1888. Archives de
l’Assistance publique de Paris, Archives de la Salpêtrière. Paris,
1888.
[17] Chastan N, Parain D, Vérin E, et al. Psychogenic aphonia:
spectacular recovery after motor cortex transcranial magnetic
stimulation. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2009;80:94.
[18] Cornut G. Les aphonies psychogènes. J Fr Otorhinolaryngol Chir
Maxillofac 1965;14(7):721—5.
[19] Delamare V, Garnier M, Delamare J, et al. Dictionnaire des
termes techniques de médecine. Paris: Maloine; 1985.
[20] Eitinger L. Aphonia ; is aphonia always a hysterical symptom?
Acta Psychiatr Neurol Scand 1953;28(1):27—34.
[21] Froese AP, Sims P. Functional dysphonia in adolescence: two
case reports. Can J Psychiatry 1987;32(5):389—92.
[22] Gerritsma EJ. An investigation into some personality charac-
teristics of patients with psychogenic aphonia and dysphonia.
Folia Phoniatr (Basel) 1991;43(1):13—20.
[23] Grafton E. Shell shock an its lessons. Manchester University
Press; 1917.
[24] Gunther V, Mayr-Graft A, Miller C, et al. A comparative study of
psychological aspects of recurring and non-recurring functional
aphonias. Eur Arch Otorhinolaryngol 1996;253(4—5):240—4.
[25] Harris C, Richards C. Functional aphonia in young people. J
Laryngol Otol 1992;106(7):610—2.
[26] Head H. The diagnosis of hysteria. British Med J 1922:827—9.
[27] Hérodote. Histoire. Livre I., Clio. Paris: Les Belles Lettres;
1964.
[28] House A, Andrews HB. The psychiatric and social characteris-
tics of patients with functional dysphonia. J Psychosom Res
1987;31(4):483—90.
[29] House AO, Andrews HB. Life events and difficulties prece-
ding the onset of functional dysphonia. J Psychosom Res
1988;32(3):311—9.
[30] Janet P. Les névroses. Paris: Ernest Flammarion; 1909.
[31] Kinzl J, Biebl W, Rauchegger H. Functional aphonia. A
conversion symptom as defensive mechanism against anxiety.
Psychother Psychosom 1988;49(1):31—6.
[32] Le Huche F, Yana M. Aphonies et dysphonies par inhibi-
tion vocale. Rapport présenté au 31econgrès de la Société
franc¸aise de phoniatrie. Bulletin d’audiophonologie 1974:
53—144.
[33] McCue EC, McCue PA. Hypnosis in the elucidation of hys-
terical aphonia: a case report. Am J Clin Hypn 1988;30(3):
178—82.
[34] Millar A, Deary IJ, Wilson JA, et al. Is an organic/functional dis-
tinction psychologically meaningful in patients with dysphonia?
J Psychosom Res 1999;46(6):497—505.
[35] Neeleman J, Mann AH. Treatment of hysterical apho-
nia with hypnosis and prokaletic therapy. Br J Psychiatry
1993;163:816—9.
 6
6
1
/
6
100%