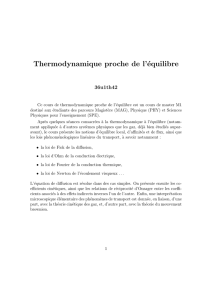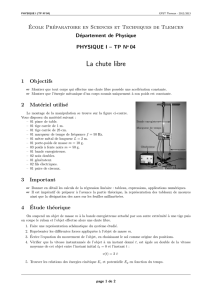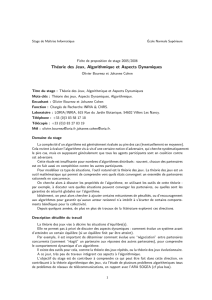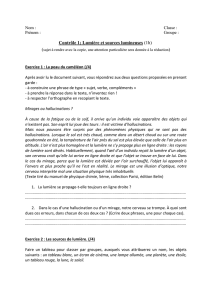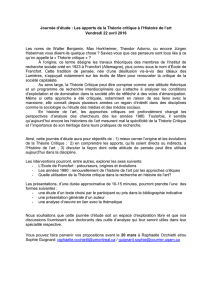CONTINU ET DISCONTINU en Physique moderne

CONTINU ET DISCONTINU
en
Physique moderne
Louis de Broglie
Membre de l’institut, Prix Nobel
Professeur `a la Facult´e des Sciences de Paris
1941

2

i
Pr´eface
Dans un pr´ec´edent volume de cette collection 1, nous avions r´euni un certain
nombre d’ ´etudes sur la Physique contemporaine dans l’intention de mettre en
´evidence l’ originalit´e des conceptions nouvelles qui y ont ´et´e r´ecemment introduites
et l’importance des cons´equences philosophiques qui en d´ecoulent. L’id´ee centrale
de ce premier volume ´etait de montrer comment les th´eories corpusculaires et les
th´eories ondulatoires de la Physique classique ´etaient venues se rejoindre et se
fondre au sein de la M´ecanique ondulatoire. Grˆace `a cette fusion, toute diff´erence
essentielle s’´etait trouu´ee abolie entre la Mati`ere et la Lumi`ere, toutes deux dou´ees
d’un double aspect corpusculaire et ondulatoire : ainsi se trouvait justifi´e le titre
sous lequel cette premi`ere s´erie d’´etudes avait ´et´e rassembl´ee.
Dans le present ouvrage, nous offrons aux lecteurs une nouvelle s´erie de mo-
nographies consacr´ees, elles aussi, presque toutes `a diverses questions de Physique
quantique et de M´ecanique ondulatoire. Ici l’id´ee centrale `a laquelle se peut rat-
tacher cet ensenible d’essais, c’est l’aspect vraiment nouveau que prennent dans
la Physique d’aujourd’hui le traditionnel dilemme «continu ou discontinu », la
classique opposition de l’´el´ement simple et indivisible avec le continu ´etendu et di-
sible. Dans la science moderne, l’´el´ement simple et indivisible, c’est le grain, grain
de mati`ere ou grain de lumi`ere, neutron, ´electron ou photon. Ce grain se mani-
feste `a nous comme une entit´e physique indivisible, susceptible de produire tantˆot
une action localis´ee en une r´egion quasi ponctuelle de l’espace, tantˆot un ´echange
d’´energie ou d’impulsion o`u apparaˆıt son caract`ere d’unite dynamique autonome :
il est l’´el´ement discontinu qui dans les profondeurs de l’infiniment petit paraˆıt bien
constituer la r´ealit´e ultime. Par contre, dans les th´eories nouvelles comme dans les
anciennes, l’ ´etendue continue et divisible, c’ est essentiellement le champ, c’est-
`a-dire l’ensemble des propiri´et´es physiques qui caracterisent `a chaque instant les
divers points de l’espace et qui s’expriment par des jonctions g´en´eralement conti-
nues des coordonn´ees d’espace et de temps. Au premier abord, on pourrait ˆetre
tent´e de consid´erer l’espace et le temps (ou l’espace-temps relativiste) comme un
cadre donn´e `a priori : le champ viendrait remplir ce cadre vide en exprimant ses
propri´et´es locales. Cependant, il paraˆıt plus juste (la relativit´e g´en´eralis´ee nous a
d’ailleurs habitu´es `a cette id´ee) de renverser l’ordre des pr´es´eances et de dire au
contraire : c’est le champ qui est la r´ealit´e premi`ere et c’est lui qui cr´ee et qui
mod`ele l’espace et le temps en leur donnant un contenu physique.
Mais les conceptions antinomiques de grain et de champ doivent n´ecessairement
1. Mati`ere et Lumi`ere, Albin Michel, 1937

ii
en fin de compte venir `a la rencontre l’une de l’autre puisqu’ elles doivent trouver
leur place cˆote a cˆote dans le cadre de la Physique totale. Comment les concilier ?
Longtemps on a pens´e que les grains devaient se d´ecrire comme des objets ponc-
tuels ou quasi ponctuels ayant `a chaque instant une position dans l’espace. Eux
aussi ils se trouveraient ins´er´es dans le cadre de l’espace et du temps et viendraient
se situer au sein du «champ ». Il ´etait alors tout naturel de consid´erer les grains
comme des sortes de points singuliers du champ. Il ne semble pas que les tenta-
tives faites pour pr´eciser cette s´eduisante conception aient ´et´e tr`es heureuses et les
th´eories quantiques actuelles nous font entrevoir une solution de ce probl`eme bien
autrement profonde et int´eressante. Esquissons la rapidement.
La discontinuit´e symbolis´ee par le grain est sans doute la r´ealit´e ultime. Mais
les grains ne sont pas v´eritablement localisables dans le cadre de l’espace et du
temps comme on le supposait autrefois. C’est le d´eveloppement de la th´eorie des
quanta qui nous a amen´es a cette surprenante conclusion : les incertitudes d’Hei-
senberg s’opposent en effet a ce que nous puissions leur attribuer constamment une
position et une vitesse bien d´eterminˆees dans l’espace. Nous ne devons pas trop
nous en ´etonner. Qu’est-ce, en effet, que l’espace et le temps ? Ce sont des cadres
qui nous sont sugg´eres par l’interpr´etation de nos perceptions usuelles, c’ est-`a-dire
des cadres o`u peuvent se loger les ph´enom`enes essentiellement statistiques et ma-
croscopiques que nos perceptions nous r´ev`elent. Pourquoi alors ˆetre surpris de voir
le grain, r´ealit´e discontinue essentiellement ´el´ementaire et microscopique, refuser
de s’ins´erer exactement dans ce cadre grossier bon seulement pour repr´esenter des
moyennes ? Ce n’est pas l’ espace et le temps, concepts statistiques, qui peuvent
nous permettre de d´ecrire les propri´et´es des entit´es ˆel´ementaires, des grains ; c’est
au contraire `a partir de moyennes statistiques faites sur les manifestations des
entit´es ´el´ementaires qu’une th´eorie suffisamment habile devrait pouvoir d´egager
ce cadre de nos perceptions macroscopique que forment l’espace et le temps. Les
nouvelles th´eories quantiques semblent nous indiquer assez nettement la voie dans
laquelle il faudrait s’ engager pour r´ealiser ce programme. Elles nous montrent, en
effet, que si les grains ne sont pas constamment localisables dans notre cadre usuel
de l’espace et du temps, par contre les probabilit´es de leurs localisations possibles
dans ce cadre sont represent´ees par des fonctions g´en´eralement continues ayant le
caract`ere de grandeurs de champ : ces «champs de probabilit´e »sont les ondes de
la M´ecanique ondulatoire ou du moins des grandeurs se calculant `a partir de ces
ondes. La dualit´e corpuscule-onde, qui avait ´et´e le leitmotiv de Mati`ere et Lumi`ere,
nous apparaˆıt ici sous un autre jour : l’onde ´etendue de la M´ecanique ondulatoire,
onde ψassoci´ee `a l’ ´electron ou onde ´electro-magn´etique associ´ee au photon, c’est
comme le reflet dans notre espace et notre temps macroscopiques de l’impossibilit´e
de localiser les corpuscules ´el´ementaires, les grains, dans un cadre moyen qui n’ est
pas adapt´e `a leur description exacte. Mais, comme pr´ec´edemment, on peut aussi

iii
renverser l’ordre des pr´es´eances et consid´erer le cadre continu constitu´e par notre
espace et notre temps comme engendr´e en quelque sorte par l’incertitude d’Heisen-
beg, la continuit´e macroscopique r´esultant alors d’ une statistique op´er´ee sur des
´el´ements discontinus affect´es d’incertudes . Il n’ est probablement pas facile de de
d´evelopper ces id´ees sous une forme pr´ecise et logiquement satisfaisante. Mais il est
certain qu’ en nous montrant comment l’existence des champs correspond `a la non
localisation des grains, la M´ecanique ondulatoire et les th´eories quantiques nous
ouvrent de remarquables perspectives nouvelles sur le vieux probl`eme du continu
et du discontinu.
∴
Passons rapidement en revue les diverses ´etudes r´eunies dans ce livre.
Les deux premi`eres ont un caract`ere d’introduction : elles ont pour but de
bien pr´eciser l’une dans le cas de la Lumi`ere, l’autre dans le cas des ´electrons, le
sens tr`es nouveau que l’on doit en, M´ecanique ondulatoire attribuer `a la notion
de corpuscule et le lien subtil qu’il y faut ´etablir entre ce corpuscule et son onde
associ´ee. Viennent ensuite quatre etudes `a caract`ere philosophique g´en´eral. Dans
l’ une on trouvera ´enonc´e sous la Iorme la plus objective possible ce que l’on doit
appeler l’ind´eterminisme de la Physique quantique. Dans une autre sont expos´es
certains aspects philosophiques des progr`es r´ecents de la Physique et on y trou-
vera d´ej`a le d´eveloppement de quelques-unes des id´ees qui ont ´et´e esquiss´ees plus
haut. Une troisi`eme ´etude plus psychologique que proprement scientifique porte
sur les conditions de l’invention dans les th´eories physiques. Enfin, la quatri`eme
et derni`ere ´etude expose le long duel qui a mis aux prises dans le d´eveloppement
de la Physique moderne les physiciens `a esprit abstrait et formel et les intuitifs
amateurs de repr´esentations concr`etes et s’efforce de rendre justice `a tous.
Dans une troisi`eme partie dont le contenu correspond au titre mˆeme de l’ou-
vrage, nous avons rassembl´e quatre expos´es qui, bien qu’´ecrits sans faire usage
d’algorithmes math´ematiques, ont d´ej`a un caract`ere un peu plus technique. Apr`es
avoir attir´e l’attention sur l’aspect si original et si suggestif qu’ont prises dans la
Physique contemporaine les notions d’individualit´e physique et d’interaction, nous
avons abord´e de front le probl`emes des grains et des champs en traitant d’abord la
question sous une forme g´en´erale, puis en prenant comme exemple la th´eorie quan-
tique du rayonnement. Prolongeant cette derni`ere ´etude, nous avons ´et´e amen´e `a
parler de la th´eorie g´en´erale des particules ´el´ementaires actuellement en plein d´e-
veloppement et des r´ecentes th´eories du noyau de l’atome o`u l’´electron lourd ou
«m´esoton »d´ecouvert dans les rayons cosmiques joue un rˆole essentiel .
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
 90
90
 91
91
 92
92
 93
93
 94
94
 95
95
 96
96
 97
97
 98
98
 99
99
 100
100
 101
101
 102
102
 103
103
 104
104
 105
105
 106
106
 107
107
 108
108
 109
109
 110
110
 111
111
 112
112
 113
113
 114
114
 115
115
 116
116
 117
117
 118
118
 119
119
 120
120
 121
121
 122
122
 123
123
 124
124
 125
125
 126
126
 127
127
 128
128
 129
129
 130
130
 131
131
 132
132
 133
133
 134
134
 135
135
 136
136
 137
137
 138
138
 139
139
 140
140
 141
141
 142
142
 143
143
 144
144
 145
145
 146
146
 147
147
 148
148
 149
149
 150
150
 151
151
 152
152
 153
153
 154
154
 155
155
 156
156
 157
157
 158
158
 159
159
 160
160
 161
161
 162
162
 163
163
 164
164
 165
165
 166
166
 167
167
 168
168
 169
169
 170
170
 171
171
 172
172
 173
173
 174
174
 175
175
 176
176
 177
177
 178
178
 179
179
 180
180
 181
181
 182
182
1
/
182
100%