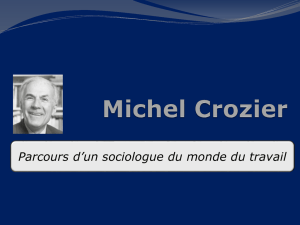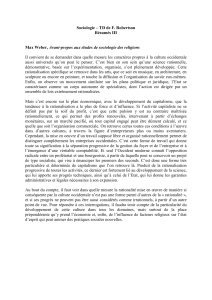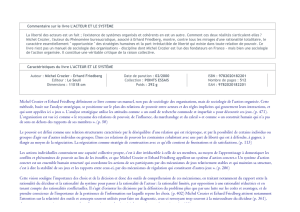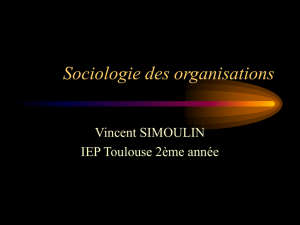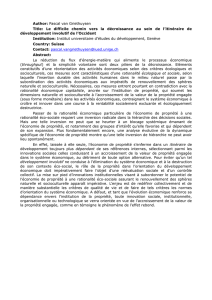Cours socio 1

1
Faculté des sciences économiques et de gestion,
Université de la Méditerranée
Cours de Sociologie des organisations
Licence EM/AGES, L2
Emmanuel Le Masson
Bibliographie indicative
Initiation
• Askenazy Ph. (2004), Les désordres du travail. Enquête sur le nouveau productivisme,
coll La République des Idées, seuil.
• Bagla L.(2003), Sociologie des organisations, La Découverte, Coll. Repères.
• Durand J .P. (2004), La Chaîne invisible, Travailler aujourd’hui : flux tendu et servitude
volontaire, Seuil.
• Lafaye C., (1996) La sociologie des organisations, Nathan, Coll. 128.
• Linhart D., (2004), La modernisation des entreprises, La Découverte, Coll. Repères, .
• Pérez R. (2003), La gouvernance de l’entreprise, La découverte, coll Repères.
• Thuderoz Ch.(1997), La sociologie des entreprises, La Découverte, Coll. Repères, 1997.
Approfondissement
• Alter N.(1996), Sociologie de l’entreprise et de l’innovation, PUF.
• Amblard H., Bernoux Ph., Frédéric-Livian Y., Herreros G.(1996), Les nouvelles
approches sociologiques des organisations, Seuil.
• Bernoux Ph.(1985), La Sociologie des organisations, Seuil, Coll. Points.
• Bernoux Ph.(1995), La Sociologie des entreprises, Seuil, Coll. Points.
• Boltanski L., Chiapello E. (1999), Le nouvel esprit du capitalisme, Gallimard.
• Coriat B., Weinstein O.(1995) – Les nouvelles théories de l’entreprise, L.G.F, .
• Crozier M., Friedberg E.(1977) – L’acteur et le système, Seuil.
• D’Iribarne Ph.(1989), – La logique de l’honneur, Seuil.
• Friedberg E.(1993) – Le pouvoir et la règle, Seuil.
• Le Joly K., Moingeon B. (2001), Gouvernement d’entreprise : débats théoriques et
pratiques, Ellipses.
• Paugam S. (2000), Le salarié de la précarité, PUF.
• Plihon D. (2003), Le nouveau Capitalisme, La Découverte, coll Repères.
• Ramanantsoa B., Reitter R.(1990), Pouvoir et politique. Au-delà de la culture
d’entreprise, FNSP.
• Reynaud J.-D.(1997) – Les règles du jeu, A. Colin, Coll. U.
• Sainsaulieu R.(1997) – Sociologie de l’entreprise. Organisation, culture et
développement, F.N.S.P & Dalloz.
• Sainsaulieu R Ollivier R (dir) (2001), L’entreprise en débat dans la société
démocratique, Presses de la FNSP.
• Sainsaulieu (R.) (dir)(1990), L’Entreprise, une affaire de société, F.N.S.P.
• Segrestin D.(1992), Sociologie de l’entreprise, A. Colin.
• Weber (H.) – Le parti des patrons, Seuil, 1986.

2
Introduction
La
sociologie des organisations
prend son essor réellement dans les années 1940-1950 aux
États-Unis, à partir de réflexions sur le phénomène bureaucratique souvent relié à l’essor du
taylorisme dans les entreprises.
On peut ici relever que le modèle taylorien se rapproche
sensiblement du type idéal (modèle bureaucratique rationnel-légal) décrit par Max Weber
(« Economie et Société") à propos des formes d'autorité et d'organisation dans la société
industrielle.
Selon Max Weber, le système d'administration bureaucratique est, en quelque sorte, le
stade ultime du capitalisme, reposant sur une légitimité de type légal-rationnel : les individus
se positionnent dans la société et dans ses organisations non en fonction de quelconques
ascendances mais en fonction de l'acquisition ou non de statuts (acquisitions s'effectuant
essentiellement par voie de concours).
Le système bureaucratique repose sur une définition de règles abstraites,
impersonnelles et appliquées aux fonctions officielles de l'organisation ; les subordonnés ne se
soumettent pas dans ce système à une autorité relevant d'une légitimité de type charismatique
mais à la nature rationnelle, formalisée (écrite), impersonnelle et légale des règles. Il délimite
les domaines de compétence de chacun par une définition précises des tâches dans
l'organisation ; la hiérarchie y est parfaitement définie : chacun dans l'organisation sait de quel
chef il dépend. L'attribution des responsabilités et l'évolution des carrières dépendent
essentiellement de statuts acquis ((diplômes, certificats).
Cependant, il convient d'effectuer certaines distinctions entre ce modèle idéal-type et
le modèle taylorien.
Tout d'abord, Max Weber, en tant que sociologue, n'a jamais voulu prescrire des
solutions pour les chefs d'entreprise, contrairement à F.W. Taylor ; il n'a jamais non plus
considéré que son modèle s'adapterait totalement à une quelconque réalité d'entreprise,
sachant pertinemment que toute réalité sociale ne peut pas s'enfermer dans un modèle
purement rationnel et être réduite en un simple lieu d'expression d'activités instrumentales.
Enfin, l'une des différences essentielles entre l'O.S.T et le système d'administration
bureaucratique réside dans la différence suivante d'appréciation de M. Weber et de F.W.
Taylor : le premier considérait comme nécessaire une distinction entre propriété et pouvoir
dans l'organisation afin d'assurer l'élaboration de décisions véritablement rationnelles ; le
second souhaitait une simple collaboration entre ingénieurs, spécialistes et chefs d'entreprises.
En ce sens, Max Weber avait une position de visionnaire, annonçant la future
séparation entre les détenteurs d'actions et les directeurs généraux. Mais, c'est également pour
cette raison, que son modèle correspond mieux à la réalité de l'institution militaire ou de
l'administration d'Etat.

3
Mais ces deux modèles – modèle taylorien et modèle bureaucratique annonce l'ère des
organisateurs et des managers qui considèreront l'entreprise en tant qu'organisation, c'est à
dire en tant que "(...) groupement autonome, crée de façon volontaire pour coordonner de la
manière la plus efficace possible des moyens en vue d'une fin particulière"
1
. C'est aussi, à
partir de la conception de ce modèle, que l'ensemble des sociologues du travail vont se
positionner.
Document n°1
Selon Denis Segrestin, "dans le contexte supposé de la conversion des entreprises au mode
de domination "légal-rationnel" décrit par Max Weber, l'idéal-type de la bureaucratie fut le
repère initial dont tout procéda objectivement, que ceci fût ou non à l'insu des intéressés. En
caricaturant à peine, on pourrait dire en effet que l'essentiel du programme de la théorie des
organisations tel qu'il se déroula par la suite fut une vaste évolution autour de l'énigme du
modèle bureaucratique. La forme bureaucratique était donnée pour la forme émergeante de
l'entreprise: il fallait la tester dans les faits, la mettre à l'épreuve, la regarder fonctionner,
élucider ce qui allait et ce qui n'allait pas, les points sur lesquels le modèle méritait d'être
corrigé, enrichi ou invalidé ... Ce qui fut fait de façon systématique, des décennies durant"
Segrestin (D.), "Sociologie de l'entreprise", A. Colin , 1992, p.77-78 .
Le modèle taylorien et le modèle de l'administration bureaucratique sont considérés
comme les bases de l'organisation du travail de nombre d'entreprises qui s'appuient :
- soit, sur une structure technique du processus de production impliquant l'absence
d'autonomie pour l'ouvrier dans son travail ;
- soit sur l'édification de règles et de normes nécessitant tout autant son obéissance ou
plutôt, le maintien de son activité dans le cadre de ce qui a été prescrit comme devant être une
conduite rationnelle au travail.
La réalité de la rationalisation du travail mêlera ces deux formes de domination,
chacune de ces formes ne recoupant pas la réalité des modèles taylorien et bureaucratique
décrit plus haut.
Plus précisément, la sociologie des organisations a pour objet l’étude des règles et de la
logique de fonctionnement de l’action collective au sein des groupements organisés tels que les
entreprises ou les administrations. Par conséquent, elle dispose d’un champ de recherche
relativement autonome et spécifique vis-à-vis de la sociologie du travail qui privilégie l’étude
de l’évolution de l’organisation du travail et de l’activité productive (analyse de la division du
travail - taylorisme, fordisme, toyotisme, etc. - et des rapports de travail). Pour le dire
autrement, si ces deux disciplines ont manifestement et globalement les mêmes champs
d’investigation, leur objet d’étude n’est cependant pas le même. Pour tenter une autre
distinction- presque d’une façon caricaturale - entre ces deux disciplines, on peut aussi penser,
que la sociologie des organisations porte son attention sur les dysfonctionnements de
l’organisation, sur son inefficacité, tendant parfois à transformer ses sociologues en
« conseillers du manager », alors, que du côté de la sociologie du travail, l’attention est
concentrée sur le dévoilement des rapports de domination ou sur – plus simplement – les
souffrances au travail.
1
Segrestin (D.), "Sociologie de l'entreprise", op-cit, p.76.

4
CHAPITRE I : LES MODELES BUREAUCRATIQUE ET TAYLORIEN
ET LEURS DYSFONCTIONNEMENTS
Nombres d’auteurs en sociologie des organisations (notamment R. K. Merton), n’ont
eu de cesse d’analyser le fonctionnement interne et d’expliciter les dysfonctionnements qui
se développent au sein de grandes organisations à la lumière du modèle-type de
l’organisation bureaucratique rationnelle-légale, défini par M. Weber (1864-1920). De
telles perspectives de recherche ont constitué les prémisses de la sociologie des
organisations.
I) Modèle wébérien de la bureaucratie et Modèle taylrorien
A) Le modèle wébérien de la bureaucratie
Pour Max Weber, l'ensemble des activités se dégagent de l'emprise de la tradition ou du
sacré (sociétés agraires) pour se définir en fonction d'une logique propre du calcul et de
l'efficacité (économie moderne) : extension de la rationalité (rationalisation) :
- droit systématique et universel et non plus coutumes locales
- rapports formels et impersonnels et non plus relation d'homme à homme du travail
artisanal (Ex : L'administration publique et les organisations militaires).
Par rationalisation, il faut entendre "l'organisation par la division et la coordination de
diverses activités sur la base d'une étude précise des rapports entre les hommes, avec leurs
instruments et milieu en vue d'une plus grande efficacité de rendement"
2
.
La rationalisation n'est pas à confondre avec une taylorisation qui impose un "one best
way" mais comme un dispositif précis et formalisé de contrôle des incertitudes.
Ce processus donne lieu à la formation de l’idéal type bureaucratique. La bureaucratie
est liée à la constitution des grands états nationaux. Elle facilite la concentration des moyens
dans les mains de l'autorité centrale. Dans cette perspective, les fonctionnaires sont « chargés
de mettre en œuvre des règlements et des procédures écrites. » . Par bureaucratisation, on
entend le processus qui tend à imposer au travail un cadre homogène dans lequel on trouve
en général la stabilité de l’emploi, la hiérarchie des traitements et des fonctions et des règles
de promotion formalisées.
Selon M. Weber, dans un système bureaucratique, l’autorité s’exerce à travers un
système normatif et par des procédures impersonnelles. Il considère que cette forme
d’organisation est la plus efficace possible du fait qu’elle élimine toute incertitude par :
– le rejet des motivations spécifiques du leader (autorité charismatique) et des coutumes et
traditions (autorité traditionnelle) ;
– la stricte répartition des rôles et des compétences de chacun dans le travail ;
– le contrôle omniprésent de la structure hiérarchique ;
– la formalisation écrite de toutes les règles dans l’organisation ;
– une revalorisation du rôle des experts ;
– une dépersonnalisation permettant de meilleurs contrôles et une meilleure coordination.
M. Weber considérait que cette forme d’organisation s’étend à toutes les sphères de l’activité
sociale, notant au passage qu’elle était déjà en place dans les entreprises, l’armée, ou encore
dans les administrations publiques. Le système bureaucratique, décrit par M. Weber, est un
idéal-type, auquel peut être comparée la réalité des formes bureaucratiques en œuvre dans la
société.
2
J. Freund, La sociologie de Max Weber, PUF, 1966.

5
Plus précisément encore, les caractéristiques du système bureaucratique sont les suivantes :
1. La subordination à une autorité impersonnelle
La bureaucratie suppose une autorité qui définit les compétences selon des règles fixes.
exemple : les attributions des fonctionnaires sont arrêtées par les lois et des règlements.
Chacun obéit à un ordre impersonnel, celui qui obéit n’obéit pas comme membre d’un
groupe mais à un règlement formel et donc pas à un chef. Exemple : un centre des impôts.
Dans cette perspective, les relations hiérarchiques seront impersonnelles : il faut supprimer
tout ce qui peut créer de l'arbitraire : évitement du face à face, centralisation.
2. La hiérarchisation des fonctions
La hiérarchie est solidement établie, ainsi la distinction entre des fonctions subalternes et
fonctions supérieures (statut, grades) est nette, mais le contrôle a des limites.
exemple : un supérieur hiérarchique n'aura pas la possibilité de supprimer des postes.
3. la gestion rationnelle et formalisée
L'administration a pour base les documents écrits, des actes (notes de services, circulaires
...). C'est à travers ces écrits que se fait la coordination. Par une formalisation des liens.
4. Technicité des fonctions
Il y a toujours un cadre technique particulier (administration préfectorale, judiciaire,
scolaire), les corps sont créées selon ces registres. Le pouvoir est fondé sur la compétence,
liée à la règle, et non pas sur la coutume.
5. La spécialisation des fonctions
Processus de sélection à partir de concours et formation professionnelle précise. Les
fonctions ont des contours méthodiquement définis. Une forme de ritualisme qui assure
protection et légitimation.
Document n°2 : Etat et Bureaucratie
“La bureaucratie (…) repose sur les principes suivants:
1°) L’existence de services définis et donc de compétences rigoureusement déterminées par
les lois ou règlements, de sorte que les fonctions sont nettement divisées et distribuées ainsi
que les pouvoirs de décision nécessaires à l’accomplissement des tâches correspondantes; 2°)
La protection des fonctionnaires dans l’exercice de leurs fonctions, en vertu d’un statut
(inamovibilité des juges par exemple). En règle général, on devient fonctionnaire pour toute
la vie, de sorte que le service de l’Etat devient une profession principale et non une
occupation secondaire, à coté d’un autre métier; 3°) La hiérarchie des fonctions, ce qui veut
dire que le système administratif est fortement structuré en services subalternes et en postes
de direction, avec possibilité de faire appel de l’instance inférieure à l’instance supérieure;
en général, cette structure est monocratique, non collégiale et manifeste une tendance vers la
plus grande centralisation; 4°) Le recrutement se fait sur concours, examens ou diplômes, ce
qui exige des candidats une formation spécialisée. En général, le fonctionnaire est nommé
(rarement élu) sur la base de la libre sélection et de l’engagement contractuel; 5°) La
rémunération régulière du fonctionnaire sous la forme d’un salaire fixe et d’une retraite
lorsqu’il quitte le service de l’Etat. Les traitements sont hiérarchisés en fonction de la
hiérarchie interne de l’administration et de l’importance des responsabilités; 6°) Le droit
qu’a l’autorité de contrôler le travail de ses subordonnés, éventuellement par l’institution
d’une commission de discipline; 7°) La possibilité d’avancement des fonctionnaires sur la
base de critères objectifs et non suivant la discrétion de l’autorité; 8°) La séparation
complète entre la fonction et l’homme qui l’occupe, car aucun fonctionnaire ne saurait être
propriétaire de sa charge ou des moyens de l’administration.
Freund (J.), “Sociologie de Max Weber”, Ed PUF, 1968, pp.205-209, “La bureaucratie,
le patrimonialisme et les difficultés du charisme”.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
 90
90
 91
91
 92
92
 93
93
 94
94
 95
95
 96
96
 97
97
 98
98
 99
99
 100
100
 101
101
 102
102
 103
103
 104
104
 105
105
 106
106
 107
107
 108
108
 109
109
 110
110
 111
111
 112
112
 113
113
 114
114
 115
115
 116
116
 117
117
 118
118
 119
119
 120
120
 121
121
 122
122
 123
123
 124
124
 125
125
1
/
125
100%