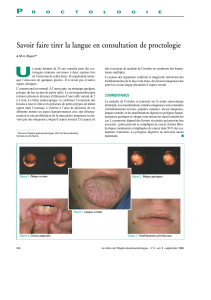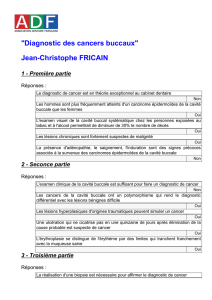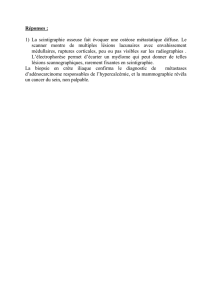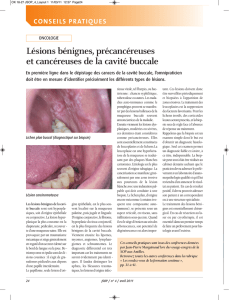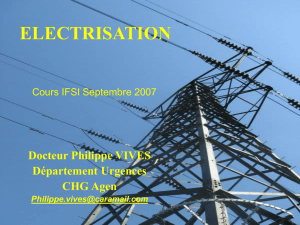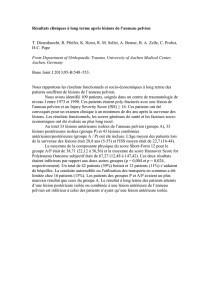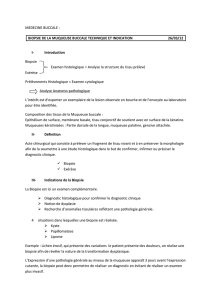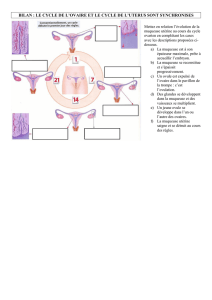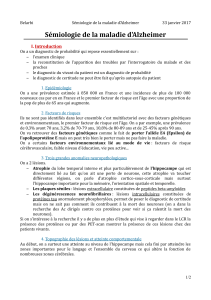Guide pour le diagnostic clinique différentiel des

1
Crest® Oral-B®
et dentalcare.ca Cours de formation continue, 25 juil., 2013
Guide pour le diagnostic clinique différentiel
des lésions de la muqueuse buccale
Cours en ligne : www.dentalcare.ca/fr-CA/dental-education/continuing-education/ce110/ce110.aspx
Avis de non-responsabilité : Les participants doivent être conscients des dangers de mettre en pratique de nouvelles techniques
ou procédures sur la base de connaissances limitées. Seuls les principes de dentisterie éprouvés devraient être utilisés pour
soigner les patients.
Cette formation vise à vous aider à comprendre le processus de diagnostic clinique différentiel
des pathologies et des lésions de la muqueuse buccale. La première étape d’une prise en charge
thérapeutique réussie d’un patient présentant une pathologie ou une lésion de la muqueuse buccale repose
sur l’établissement d’un diagnostic différentiel. Cette formation comprend un arbre décisionnel interactif
ainsi qu’une version téléchargeable pour vous aider à poser un diagnostic.
Déclaration de conflit d’intérêts
• Le regretté Dr Finkelstein n’a signalé aucun conflit d’intérêts associé à ce cours lors de sa dernière mise
à jour. Le personnel de P&G souhaite exprimer ses condoléances suite au décès du Dr Finkelstein
survenu le 28 décembre 2013. Il a su inculquer avec ferveur, sa passion et ses connaissances dans
le domaine de la pathologie buccale auprès de milliers d’étudiants et de patients durant sa fructueuse
carrière de plus de 30 ans à l’Université de l’Iowa..
PROGRAMME CERP DE L’ADA
La Société Procter and Gamble est un fournisseur reconnu du programme CERP de l’ADA.
Le programme CERP est un service offert par l’Association dentaire américaine (ADA) en vue d’aider les
professionnels des soins dentaires à identifier les fournisseurs de qualité en matière de formation continue
en soins dentaires. Le programme CERP de l’ADA n’approuve ni ne parraine aucun cours ou instructeur
individuel, et ne garantit pas que les heures de formation seront créditées par l’ordre des dentistes.
Toute préoccupation ou plainte à propos d’un prestataire de formation continue peut être directement
adressée au prestataire ou au programme CERP de l’ADA à l’adresse
suivante : http://www.ada.org/cerp (en anglais)
Fournisseur reconnu du programme PACE
La Société Procter & Gamble est désignée comme un fournisseur approuvé du programme PACE
par l’Academy of General Dentistry. Les programmes formels de formation continue
de ce fournisseur de programmes sont reconnus par l’AGD pour des crédits d’études
postdoctorales, de maîtrise et de maintien de l’adhésion. L’approbation n’implique aucune
acceptation par un conseil provincial ou d’État de dentisterie et ne constitue pas un appui de
l’AGD. Les modalités de l’approbation couvrent la période du 1er août 2013 au 31 juillet 2017.
No identification fournisseur 211886
Michael W. Finkelstein, DDS, MS
Unités de formation continue en dentisterie : 4 heures

2
Crest® Oral-B®
et dentalcare.ca Cours de formation continue, 25 juil., 2013
Aperçu
Étant donné que la pathologie buccale est une spécialité visuelle, les images cliniques peuvent faciliter
l’apprentissage des caractéristiques cliniques des lésions de la muqueuse buccale. Plusieurs ouvrages vous
sont proposés dans la section Ressources supplémentaires à la fin de cette formation. Le contenu de cette
formation a été conçu pour être utilisé en parallèle avec le siteThe Oral Pathology Image Database (Atlas).
Prenez note que les lésions ou les pathologies marquées d’un astérisque (*) sont imagées sur le site The
Oral Pathology Image Database.
Objectifs d’apprentissage
À la fin du présent cours, le professionnel de la dentisterie sera en mesure de :
• Classer les lésions buccales et déterminer s’il s’agit d’une lésion de surface ou d’une hypertrophie des
tissus mous à l’aide d’un arbre décisionnel (organigramme).
• Décrire les caractéristiques cliniques de chaque type de lésion des muqueuses buccales dans l’arbre
décisionnel, notamment :
Les lésions de surface blanches’: épaississements épithéliaux, débris de surface et modifications
sous-épithéliales
Les lésions de surface pigmentées généralisées
Les lésions de surface pigmentées localisées’: lésions sanguines intravasculaires ou extravasculaires,
pigments mélaniques, tatouages
Les lésions de surface vésiculaires-ulcérées-érythémateuses’: lésions héréditaires, auto-immunes,
virales, mycosiques et idiopathiques
Les hypertrophies réactives des tissus mous de la muqueuse buccale
Les tumeurs bénignes de la muqueuse buccale : tumeurs épithéliales, mésenchymateuses et des
glandes salivaires
Les tumeurs malignes de la muqueuse buccale
Les kystes de la muqueuse buccale
• Décrire les caractéristiques ou les aspects cliniques particuliers des pathologies les plus courantes ou
les plus importantes de la muqueuse buccale.
• Établir un diagnostic clinique différentiel étape par étape, à l’aide de l’arbre décisionnel, pour les patients
présentant des lésions des muqueuses buccales.mucosal lesions.
Contenu du cours
• Partie I : Introduction au diagnostic clinique
différentiel
Comment utiliser l’arbre décisionnel
Tumeurs bénignes et malignes
• Partie II : Lésions de surface de la muqueuse
buccale
Lésions de surface blanches
Lésions blanches avec débris de surface
Lésions blanches causées par une
modification sous-épithéliale
Lésions de surface pigmentées de la
muqueuse buccale
Lésions de surface pigmentées localisées de
la muqueuse buccale
Lésions sanguines extravasculaires
Lésions mélanocytaires
Tatouages
Lésions de surface vésiculaires-ulcérées-
érythémateuses de la muqueuse buccale
Maladies héréditaires : Épidermolyse bulleuse
Maladies auto-immunes
Maladies idiopathiques
Maladies virales
Maladies mycosiques : Candidose (candidiase)
• Partie III : Hypertrophies des tissus mous de la
muqueuse buccale
Hypertrophies réactives des tissus mous
Tumeurs des tissus mous
Tumeurs épithéliales bénignes de la muqueuse
buccale
Tumeurs mésenchymateuses bénignes de la
muqueuse buccale
Tumeurs bénignes des glandes salivaires de la
muqueuse buccale
Kystes de la muqueuse buccale
Néoplasmes malins de la muqueuse buccale

3
Crest® Oral-B®
et dentalcare.ca Cours de formation continue, 25 juil., 2013
• Partie IV : Hypertrophies des tissus mous de la
muqueuse buccale
Tableau 1. Lésions de surface blanches de la
muqueuse buccale
Tableau 2. Lésions de surface pigmentées
localisées de la muqueuse buccale
Tableau 3. Lésions de surface vésiculaires-
ulcérées-érythémateuses de la muqueuse
buccale
Tableau 4. Hypertrophies des tissus mous
Tableau 5. Tumeurs épithéliales bénignes
Tableau 6. Tumeurs mésenchymateuses
bénignes
Tableau 7. Tumeurs bénignes des glandes
salivaires
Tableau 8. Kystes des tissus mous
• Conclusion
• Aperçu de l’examen
• Références
• Au sujet de l’auteur
Partie I : Introduction au diagnostic
clinique différentiel
Le diagnostic des lésions de la muqueuse buccale
est nécessaire pour prendre correctement en
charge les patients. Le diagnostic clinique
différentiel est un processus cognitif qui se base
sur la logique et les connaissances et qui, à l’aide
d’une série de décisions progressives, permet
d’établir une liste de diagnostics possibles. Ce
type de diagnostic repose sur un processus
d’exclusion. Toutes les lésions qui ne peuvent
être exclues constituent le diagnostic différentiel
initial et motivent les tests et les procédures
subséquentes qui permettront de préciser le
diagnostic définitif. Jouer aux devinettes au sujet
du meilleur diagnostic d’une lésion buccale peut
être dangereux pour le patient, car de graves
affections pourraient être écartées.
Il est donc utile pour les praticiens d’organiser
leurs connaissances sur les pathologies buccales à
l’aide d’un système qui simule l’apparence clinique
des lésions buccales. Un arbre décisionnel est un
organigramme qui organise l’information afin que
l’utilisateur puisse prendre une série de décisions
progressives et parvenir à une conclusion logique
(Figure 1).
Comment utiliser l’arbre décisionnel
Pour utiliser l’arbre décisionnel, le praticien prend
une première décision à la gauche de l’arbre, puis
continue vers la droite. Les noms de chacune
des lésions sont énumérés à la droite de l’arbre.
Toute lésion ou tout ensemble de lésions qui ne
peut être exclu fera partie du diagnostic clinique
différentiel.
Le praticien doit d’abord savoir si la lésion est une
lésion de surface ou une hypertrophie des tissus
mous.
Les lésions de surface sont des lésions qui
touchent l’épithélium et le tissu conjonctif
superficiel de la muqueuse et de la peau. Elles
n’excèdent pas 2 à 3 mm d’épaisseur. Les
lésions de surface se répartissent en trois
catégories en fonction de leur apparence clinique :
blanches, pigmentées ou vésiculaires-ulcérées-
érythémateuses. Chacune de ces catégories se
subdivise ensuite en sous-catégories, comme
indiqué dans les tableaux 1 à 3.
Les hypertrophies des tissus mous sont des
inflammations ou des masses qui se répartissent
en deux catégories : les lésions réactives et
les tumeurs du tableau 4. Le terme tumeur
est utilisé au sens clinique d’hypertrophie et
ne repose pas sur des critères microscopiques
ou des processus pathologiques de base.
Ainsi, un fibrome d’irritation est considéré
une tumeur, car cette lésion est persistante et
grossit progressivement, même si la plupart des
spécialistes s’entendent pour dire que la véritable
pathogenèsepathogénèse est un processus réactif
secondaire à une irritation chronique.
Les hypertrophies réactives des tissus mous
peuvent croître et décroître (taille fluctuante),
et finissent en général par régresser. Les
hypertrophies réactives sont souvent, mais pas
toujours, sensibles ou douloureuses et présentent
généralement un taux de croissance plus rapide
(allant de quelques heures à quelques semaines)
que les tumeurs. Certaines hypertrophies
réactives commencent comme des lésions
diffuses et deviennent plus localisées au fil du
temps. Les lésions réactives s’accompagnent
parfois de ganglions lymphatiques sensibles et de
manifestations systémiques, comme de la fièvre
et des malaises. Une fois que le caractère réactif
de l’hypertrophie des tissus mous est établi,
l’étape suivante consiste à déterminer ce qui a
provoqué l’apparition de la lésion : il peut s’agir
d’une infection bactérienne, virale ou fongique, ou
d’une blessure chimique ou physique.

4
Crest® Oral-B®
et dentalcare.ca Cours de formation continue, 25 juil., 2013
Figure 1. Arbre décisionnel pour les lésions de la muqueuse buccale.
Pour voir l’arbre de décision interactive pour orale muqueuse lésions, cliquez ici.
Grossesse
Médication
Dysplasie fibreuse polyostotique
Ingestion de métaux lourds
Lésions héréditaires
Maladie d'Addison
Mélanose tabagique
Neurofibromatose
Syndrome de Peutz-Jeghers
Impression
clinique
Hypertrophies
des tissus mous
Lésions
blanches
Lésions
pigmentées
Lésions
vésiculaires-ulcérées-
érythémateuses
Épaississement épithélial
Lésions sous
épithéliales
Candidose
Brûlure
Kystes kératosiques congénitaux
Cicatrice
Grains de Fordyce
Carcinome à cellules squameuses
Carcinome in situ
Dysplasie épithéliale
Hyperkératose
Hyperplasie épithéliale familiale
Langue géographique
Langue pileuse
Leucoplasie chevelue
Leucœdème
Lichen plan
Stomatite nicotinique
Herpès primaire
Herpès récurrent
Lupus érythémateux
Pemphigoïde bulleuse
Pemphigoïde des muqueuses
Pemphigus vulgaire
Carcinome à cellules squameuses
Carcinome in situ
Dysplasie épithéliale
Lésions
localisées
Lésions
généralisées
Lésions
intravasculaires
Lésions sanguines
extravasculaires
Lésions
mélanocytaires
Tatouage
Hématome
Ecchymose
Pétéchies
Hémangiome
Varice
Sarcome de Kaposi
Macule mélanique buccale
Naevus
Mélanome
Éphélide
Herpès simplex
Herpangine
Herpès zoster
Mononucléose infectieuse
Syndrome mains-pieds-bouche
Varicelle
Épidermolyse bulleuse
Lichen plan érosif
Erythroplasia
Mucosite médicamenteuse
Stomatite de contact
Candidose
Lésions
héréditaires
Lésions
virales
Lésions
auto-immunes
Idiopathique
Mycosique
Lésions de
surface de la
muqueuse buccale
Arbre décisionnel pour les lésions de la muqueuse buccale
(Revised 10/14)
Débris de surface
Hypertrophies
réactives
Tumeur ou
néoplasme
Tumeurs et
néoplasmes
bénins
Kystes
Tumeurs et
néoplasmes
malins
Épulis fissuratum
Fibrome causé par une irritation
Papillome
Verrue vulgaire
Condylome acuminé
Fibrome
Épulis congénital
Fibrome ossifiant périphérique
Granulome périphérique à cellules géantes
Granulome pyogénique
Hémangiome
Léiomyome
Lipome
Lymphangiome
Neurofibrome
Névrome
Rhabdomyome
Schwannome
Tumeur à cellules granuleuses
Adénocarcinome à cellules acineuses
Adénome monomorphe
Adénome polymorphe
Carcinome adénoïde kystique
Carcinome muco-épidermoïde d'évolution lente
Cystadénolymphome papillaire
Adénocarcinome polymorphe d’évolution lente
Gingival cyst of adult
Lymphoepithelial cyst
Epidermoid/dermoid cyst
Thyroglossal tract cyst
Carcinome à cellules squameuses
Carcinome verruqueux
Carcinomes métastatiques
Lymphome
Mélanome
Sarcome
Adénocarcinome des glandes
salivaires
A
Adénocarcinome à cellules acineuses
Adénocarcinome polymorphe d’évolution lente
Carcinome adénoïde kystique
Carcinome muco-épidermoïde
Épithéliaux
Mésenchymateux
Glande salivaire
©2008 University of Iowa, College of Dentistry
Lentigo
Ulcères aphteux
Érythème polymorphe

5
Crest® Oral-B®
et dentalcare.ca Cours de formation continue, 25 juil., 2013
Les tumeurs des tissus mous se caractérisent
par leur persistance et leur progressivité; elles
ne se résorbent pas sans traitement. En règle
générale, elles ne sont pas douloureuses aux
premiers stades de leur développement, et leur
rythme de croissance va de quelques semaines à
quelques années.
Tumeurs bénignes et malignes
Si une hypertrophie des tissus mous semble être
une tumeur, le praticien doit déterminer si elle
est bénigne ou maligne. Les tumeurs bénignes
sont généralement mieux définies ou circonscrites
et présentent un rythme de croissance plus lent,
de quelques mois à quelques années, que les
néoplasmes malins. Les néoplasmes malins
sont plus susceptibles d’être douloureux et
d’entraîner des ulcérations de l’épithélium sus-
jacent que les lésions bénignes. Puisque les
néoplasmes malins envahissent ou infiltrent les
muscles, les nerfs, les vaisseaux sanguins et les
tissus conjonctifs environnants, ils se fixent ou
adhèrent aux structures qui les entourent durant
la palpation. Certaines tumeurs bénignes se
fixent également aux structures qui les entourent,
mais d’autres sont enveloppées d’une capsule de
tissu conjonctif fibreux, qui peut permettre de faire
bouger la lésion dans le tissu, indépendamment
des structures environnantes.
Les tumeurs bénignes peuvent se diviser en
quatre catégories : les tumeurs épithéliales,
les tumeurs mésenchymales, les tumeurs des
glandes salivaires et les kystes des tissus mous.
Bien que les kystes des tissus mous ne soient pas
des tumeurs, leurs caractéristiques historiques et
cliniques sont semblables à celles des tumeurs
bénignes. Chacune de ces catégories possède
à son tour des sous-catégories, comme indiqué
dans les tableaux 5 à 8.
Il faut souligner que les descriptions cliniques
ci-dessus sont des lignes directrices générales,
et que des exceptions existent. L’ablation de
la lésion et l’examen au microscope du tissu
sont souvent les seuls moyens de parvenir à un
diagnostic définitif.
Partie II : Lésions de surface de la
muqueuse buccale
Il ne faut pas oublier que les lésions de surface
de la muqueuse buccale sont des lésions qui
touchent l’épithélium ou les tissus conjonctifs
superficiels. Elles n’excèdent pas 2 à 3 mm
d’épaisseur. Sur le plan clinique, les lésions de
surface sont plates ou peu épaisses, mais ne sont
pas des inflammations ni des hypertrophies.
Les lésions de surface se divisent habituellement
en trois catégories en fonction de leur apparence
clinique : blanches, pigmentées, ou vésiculaires-
ulcérées-érythémateuses.
Lésions de surface blanches de la muqueuse
buccale
Les lésions de surface de la muqueuse buccale
qui présentent un aspect blanc, brun ou jaune
pâle sont divisées en trois groupes en fonction de
leurs caractéristiques cliniques :
1. Les lésions blanches causées par un
épaississement épithélial.
2. Les lésions blanches causées par
l’accumulation de débris nécrotiques sur la
surface muqueuse.
3. Les lésions blanches causées par des
modifications sous-épithéliales du tissu
conjonctif.
Les lésions blanches causées par un
épaississement épithélial présentent un aspec
blanc parce que la coloration rosâtre et rougeâtre
des vaisseaux sanguins sous le tissu conjonctif
est masquée par l’épaississement de l’épithélium.
Ces lésions sont asymptomatiques, rugueuses à
la palpation et ne s’enlèvent pas en les frottant
avec une gaze. Elles sont plates et blanches
lorsqu’elles sont sèches.
Trois des lésions blanches avec épaississement
épithélial se produisent sur la langue : la langue
pileuse, la leucoplasie chevelue et la langue
géographique (érythème migrateur).
La langue pileuse* est le résultat de
l’accumulation de kératine sur la surface dorsale
de la langue. De nombreuses causes ont été
envisagées, mais les plus probables sont le
manque de stimulation mécanique de la face
dorsale de la langue lié à une mauvaise hygiène
buccodentaire ou à un régime alimentaire de
consistance molle. La lésion se présente sous la
forme de papilles filiformes allongées ressemblant
à des poils. Les papilles se teintent généralement
de brun, de noir ou d’autres couleurs en fonction
du régime alimentaire et des habitudes du
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
1
/
46
100%