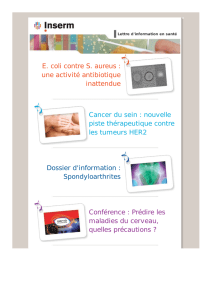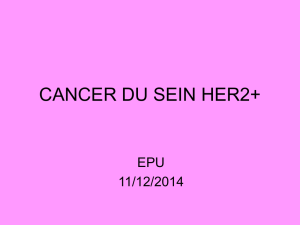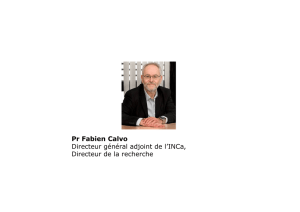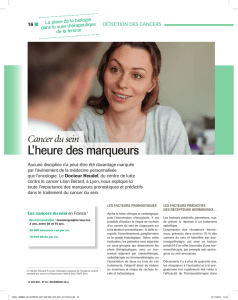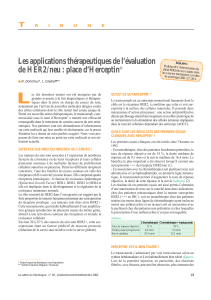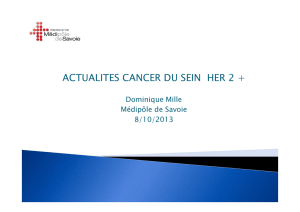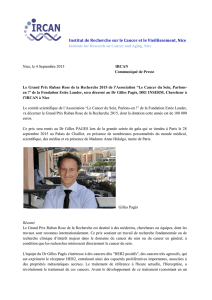HER-2 et trastuzumab : un nouveau paradigme biologique et

HER- et trastuzumab : un nouveau paradigme biologique et thérapeutique dans le cancer du sein
Médecine Nucléaire - Imagerie fonctionnelle et métabolique - 2002 - vol.26 - n°1
46
Résumé
L’oncogène HER2/neu code pour une protéine transmembranaire douée d’une activité
tyrosine kinase intrinsèque, la protéine HER2. Il intervient dans la cancérogenèse mammaire par
amplification génique et/ou surexpression de son produit, la protéine HER2 devenant protéine
oncogénique parce que surexprimée. La PCR quantitative représente une méthode simple et fia-
ble pour l’évaluation de l’activation HER2. En routine, une méthode immunoenzymatique per-
met le dosage quantitatif de la protéine au niveau tissulaire et sérique. L’amplification et/ou la
surexpression du gène est un facteur de mauvais pronostic dans le cancer du sein et serait, de
plus, utile dans la prédiction de la réponse thérapeutique. HER2 prend une importance considé-
rable en tant que cible thérapeutique potentielle dans le cadre d’une thérapie antitumorale spéci-
fique, le trastuzumab.
Cancer du sein / HER2 / Marqueurs tumoraux / Trastuzumab
Correspondance : Pierre-Jean Lamy - Laboratoire d’Oncobiologie - Centre Régional de Lutte contre le Cancer Val d’Aurelle-
Paul Lamarque - 34298 Montpellier Cedex 05
Tél. : 04 67 61 31 47 - Fax : 04 67 63 28 73 - email : pjlamy@valdorel.fnclcc.fr
HER-2 et trastuzumab : un nouveau paradigme biologique
et thérapeutique dans le cancer du sein
Pierre-Jean Lamy Laboratoire d’oncobiologie
Centre Régional de Lutte contre le Cancer Val d’Aurelle-Paul Lamarque
Montpellier.
INTRODUCTION
ðLe cancer du sein a longtemps été
le seul cancer à bénéficier de mar-
queurs prédictifs de la réponse à un
traitement adjuvant. En effet, les récep-
teurs hormonaux ont permis de défi-
nir une population de cancers du
sein, les cancers dits hormono-dé-
pendants, répondeurs à un traitement
anti-hormonal. Facteurs prédictifs de
la réponse au tamoxifène, le taux de
récepteurs aux estrogènes et à la pro-
gestérone est devenu un paramètre
incontournable de la pratique clini-
que. Mais ce paramètre fonctionne
par défaut pour les cancers du sein
non hormonodépendants, ne don-
nant comme option thérapeutique
que l’alternative non ciblée d’une chi-
miothérapie vis à vis de laquelle la
tumeur est peut être résistante. La dé-
couverte d’un facteur pronostic pé-
joratif, proche du récepteur à l’Epider-
mal Growth Factor (EGF), HER2 palie
à ce déficit d’information. Son hyper-
expression est lié à une évolutivité
agressive de la maladie mais aussi à

Médecine Nucléaire - Imagerie fonctionnelle et métabolique - 2002 - vol.26 - n°1 47
P.J. Lamy
l’efficacité d’une thérapeutique origi-
nale, le trastuzumab. Le rôle exact de
HER2 se doit d’être encore précisé
pour améliorer la prise en charge du
cancer du sein. Un vaste champ de
travail s’ouvre aussi aux biologistes
pour standardiser le dosage de ce
marqueur. Un dosage qui se devra
d’être simple, rapide, reproductible et
fournissant une information précise
en relation avec les traitements asso-
ciés, une condition sine qua non de
son utilisation optimisée comme fac-
teur pronostic et prédictif de la ré-
ponse au traitement. HER2 et anticorps
anti HER2 se présentent ainsi comme
un nouveau modèle en oncologie,
comme le furent en leur temps les
récepteurs hormonaux et le tamoxifè-
ne : un marqueur spécifique et une
thérapeutique ciblée sur un type pré-
cis de tumeur. L’accès aux mécanis-
mes moléculaires de l’action de HER2
devrait permettre de comprendre son
rôle dans la tumorigenèse et d’affiner
la réponse thérapeutique à mettre en
place. Deux décennies après sa dé-
couverte, HER2 est en train de modi-
fier le concept même de chimiothé-
rapie et confirme l’importance des
informations qu’apportent les mar-
queurs de sensibilité aux traitements.
HER2 :
un facteur de croissance cellulaire
ðHER2 est le récepteur d’un facteur
de croissance de la famille des récep-
teurs erbb tyrosine kinase[1]. Cette
famille comporte 4 types de récep-
teurs : le récepteur de l’epidermal
growth factor (erbb1 ou EGFr), erbb2
(HER2),erbb3 (HER3) et erbb4 (HER4).
Ces récepteurs transmembranaires
possèdent tous une activité tyrosine
kinase dans leur partie intracytoplas-
mique. Le domaine extracellulaire
forme la partie récepteur de liaison
aux ligands, l’EGF et les neurégulines.
Leur action intervient dans la crois-
sance cellulaire normale aux diffé-
rents stades du développement de la
glande[2,3]. Le gène qui code pour la
protéine HER2 est un proto-oncogène
appelé c-erbb2 ou HER2/neu. Il est
situé sur le chromosome 17q21. Il
code pour la protéine HER2 de 185
kDa. Il existe 2 copies du gène par
cellule mais son expression est va-
riable d’un tissu à l’autre.
Aucun ligand n’a encore été identi-
fié pour HER2. HER2 existe sous forme
d’hétérodimères avec un autre mem-
bre de la famille des récepteurs erbb
tyrosine kinase[4]. Cette dimérisation
nécessite l’action d’un ligand spéci-
fique. Ainsi l’action de l’EGF conduira
à la formation d’un hétérodimère
HER1/HER2. La liaison des neuréguli-
nes spécifiques de HER3 et 4 formera
des dimères HER3/HER2 ou HER4/
HER2. Ces dimères présentent une
grande affinité au ligand dont le mo-
nomère autre que HER2 est spéci-
fique. Cette liaison entraîne une émis-
sion très forte de signaux dans la cel-
lule. HER2 se comporte comme un
amplificateur des signaux de crois-
sance cellulaire des récepteurs erbb.
On comprend ainsi mieux son rôle
dans la cancérogenèse par un méca-
nisme d’amplification de la crois-
sance cellulaire [5].
CANCERS ET SUREXPRESSION
DE HER2
ðDes études in vitro et in vivo ont
démontré le rôle de HER2 dans la pro-
lifération cellulaire, la transformation
maligne de lignées en culture et la
mobilité cellulaire intervenant dans
le potentiel métastatique [6]. L’ampli-
fication et l’hyperexpression du gène
sont en cause dans le processus de
transformation cancéreuse. On parle
d’amplification avec un nombre de
copie du gène supérieur à 5 ou 10.
Cette amplification entraîne une aug-
mentation de la production d’ARNm
et une synthèse accrue de HER2 pro-
téine. A la surface des cellules, le nom-
bre de HER2 est alors multiplié par
100 et la forme homodimérique HER2-
HER2 prédomine. Celle-ci induit une
dérégulation du cycle cellulaire pou-
vant amener à la cancérisation de la
cellule [7].
L’amplification et la surexpression de
HER2 ont été retrouvées dans de nom-
breux cancers chez l’homme. Les lo-
calisations retrouvées sont le sein, les
ovaires, l’endomètre, le col de l’uté-
rus, les poumons, le colon, les tissus
mous, l’œsophage, la vessie, le rein,
le pancréas, les glandes salivaires, et
la thyroïde. Il a été montré une am-
plification ou une surexpression dans
les lésions précancéreuses au niveau
du sein (carcinomes in situ peu dif-
férenciés) ou du colon. L’amplifica-
tion génique est toujours moins fré-
quente que l’hyperexpression et se
situe entre 15 et 30% en fonction des
cancers. Amplification et surexpres-
sion ne sont pas synonymes, bien
que dans le cancer du sein les 2 phé-
nomènes soient le plus souvent
corrélés. 25 à 30 % des cancers du
sein présentent une amplification et/
ou surexpression de HER2.
Une élévation isolée de la protéine
HER2 a des significations encore non
élucidées et résulterait d’une dérégu-
lation transcriptionnelle ou post trans-
criptionnelle. Il est à noter que quelle
que soit la cause de l’hyper-expres-
sion, la protéine des cellules cancé-
reuses est analogue à la protéine des
cellules normales, aucune mutation
de HER2 n’ayant été encore décrite.
MÉTHODES DE DÉTECTION
ET DE DOSAGE
ðIl existe un grand nombre de mé-
thodes de détection et de dosage de
HER2. L’immunohistochimie sur
coupe de tissu frais ou congelé ou
inclus en paraffine et la technique
ELISA dans le sérum ou le cytosol des
tumeurs, permettent de détecter une
surexpression de la protéine. Les tech-
niques d’hybridation par fluores-
cence in situ (FISH) et le Southern blot
ciblent l’amplification du gène.
D’autres techniques comme la RT
PCR permettent d’accéder à l’ARNm.
Une positivité à l’un ou l’autre de ces
tests ne recouvre pas forcément la
même réalité clinique. Il y a un be-
soin de standardisation de la méthode
de détermination du statut HER2.
L’immunohistochimie couple la fixa-
tion d’anticorps spécifiques à une
coloration pour distinguer les cellu-
les carcinomateuses avec hyperex-
pression de HER2 des cellules sans
hyperexpression (ces cellules pré-
sentent un taux faible de HER2 dé-

HER- et trastuzumab : un nouveau paradigme biologique et thérapeutique dans le cancer du sein
Médecine Nucléaire - Imagerie fonctionnelle et métabolique - 2002 - vol.26 - n°1
48
tecté par l’immunohistologie). Une
forte coloration apparaît dans les cel-
lules HER2+. Il est à noter qu’une
technique trop sensible peut amener
une coloration dans des cellules sans
amplification et donner des faux po-
sitifs. L’autre problème de cette tech-
nique est que la coloration est peu
stable dans le temps. Sa décroissance
varie selon la nature et le temps de
fixation, l’anticorps, le temps d’expo-
sition, la durée de conservation. Les
anticorps utilisés induisent aussi une
variabilité des résultats obtenus [8].
La technique FISH, très sensible, ci-
ble par des sondes marquées antisens
les régions de l’ADN spécifiques de
HER2. Elle reste la technique de réfé-
rence. Un anticorps fluorescent dirigé
contre le marqueur de la sonde per-
met de visualiser la fixation de celle-
ci. Cette technique peut être appli-
quée sur des cellules tumorales ou
des métaphases et permet de quanti-
fier l’amplification du gène et non
l’expression de protéine HER2. Néan-
moins sa réalisation est délicate et
longue et ne permet de l’utiliser que
comme technique complémentaire
de confirmation [9].
Le test ELISA, simple et automatisable,
est adaptable au cytosol tumoral ou
au sérum. Dans le premier cas, la na-
ture tumorale du tissu utilisé pour
l’obtention du cytosol doit être ab-
solument confirmée pour ne pas di-
minuer la sensibilité et la spécificité
du dosage par "dilution" avec du tissu
sain. Le dosage sérique permet de
détecter un fragment de HER2 libéré
par la tumeur [10]. Or il n’y a pas de
corrélation entre l’expression de
HER2 et la libération de fragment dans
la circulation. Ceci explique les di-
vergences observées entre l’immuno-
histochimie ou le FISH et les taux
sériques de HER2.
La quantification par PCR ou RT PCR
de l’ADN ou des ARNm de HER2 pour-
rait devenir une méthode de substi-
tution au FISH dont la sophistication
l’éloigne des laboratoires de routine
[11]. Les techniques de PCR quantita-
tive en temps réel permettent d’ac-
céder à l’amplification du gène de
façon automatisable, reproductible et
rapide. La corrélation avec la techni-
que FISH semble se confirmer.
UN FACTEUR PRONOSTIC ET
UN FACTEUR PRÉDICTIF
de la réponse au traitement
ðLa positivité de HER2 est de mau-
vais pronostic dans les cancers et en
particulier dans le cancer du sein. Ce
qui a été démontré pour la première
fois par Salmon et al en 1987[12].
D’autres études confirmèrent le résul-
tat et la méta analyse de Ross et Flet-
cher[13] regroupant les résultats de
47 études incluant 15000 patientes
montre que l’amplification HER2 est
un paramètre indépendant des autres
facteurs pronostics. Il signe un rac-
courcissement de la survie globale et
de la survie sans échec.
Le risque métastatique paraît aussi
plus élevé chez les patientes sans at-
teinte ganglionnaire montrant une
amplification de HER2. Néanmoins
rien n’indique pour l’instant que cette
augmentation du risque nécessite
une thérapie anti-HER2 adjuvante.
HER2 est aussi un facteur prédictif de
la réponse au traitement. Dans le cas
de l’hormonothérapie, il faut consi-
dérer les femmes HER2+ comme se
rapprochant d’un phénotype récep-
teur estrogénique négatif. L’induction
du gène HER2 permet en effet la pos-
sibilité d’une croissance cellulaire
indépendante des estrogènes. Le
tamoxifène semble par ailleurs être
moins efficace chez les HER2 + [14].
En revanche les cancers HER2+ sem-
blent plus sensibles à la chimiothé-
rapie adjuvante. Le traitement par FAC
(5fu, doxorubicine, cyclophospha-
mide), améliore la survie sans échec
des patientes HER2 +. Celles-ci retrou-
vent même un pronostic comparable
aux femmes HER2- [15]. Si des étu-
des à faible puissance statistique ont
montré des résultats contraires,
aucune n’a pu montrer de relation
entre résistance aux antracyclines et
positivité pour HER2.
HER2 :
une thérapeutique ciblée
ðCompte tenu du nombre élevé de
cancers HER2+ et du mauvais pronos-
tic de ce marqueur, de nombreuses
thérapeutiques ont été essayées dans
des phases de développement
précliniques. L’absence naturelle de
ligand à HER2 a conduit à l’utilisation
d’un certain type de molécules.
Des anticorps monoclonaux spécifi-
ques de HER2 murins ou humains,
des oligonucléotides antisens, des
peptides inhibiteurs de la diméri-
sation et des composés inhibiteurs
de l’activité tyrosine kinase, située au
niveau intramembranaire de la pro-
téine, ont été testés avec des répon-
ses antitumorales variables.
La méthode actuellement la plus avan-
cée est basée sur le concept de l’in-
hibition d’HER2 par un anticorps
monoclonal spécifique des régions
hypervariables du site de liaison.. Le
trastuzumab (ou rhumabHER2 dont la
spécialité est commercialisée par les
laboratoires Roche sous le nom
d’Herceptin) est un anticorps mono-
clonal recombinant humain obtenu
à partir d’un anticorps murin huma-
nisé à 95 %. La caractéristique hu-
maine de l’immunoglobuline permet
d’augmenter la réponse immunitaire
et d’éviter la synthèse d’auto-anti-
corps antisouris. Cet anticorps se lie
spécifiquement au domaine extra-
cellulaire de la protéine inhibant la
prolifération de cellules exprimant
HER2 [16]. Des modèles animaux ont
montré le fort potentiel antitumoral
de trastuzumab sur des tumeurs
transfectées par HER2 [17]. L’anti-
corps permet aussi de potentialiser
les chimiothérapies comme cela a été
démontré avec le cisplatine, le métho-
trexate, la doxorubicine ou le cyclo-
phosphamide dans des modèles de
cancer du sein.
Les mécanismes d’action sont :
- l’antagonisme de la transduction du
signal de croissance cellulaire,
- la stimulation de la dégradation du
récepteur,

Médecine Nucléaire - Imagerie fonctionnelle et métabolique - 2002 - vol.26 - n°1 49
P.J. Lamy
- le recrutement et la stimulation de
cellules cytotoxiques dépendantes
des anticorps,
- la diminution des facteurs angiogé-
niques.
Les premières études sur des patien-
tes métastatiques multitraitées ont
montré un taux de réponse objective
à l’Herceptin de 11.6 % et 26.7 % en
association avec le cisplatine et ce,
avec une relativement bonne tolé-
rance en comparaison avec les effets
indésirables des chimiothérapies ha-
bituelles.
L’ensemble des essais de phase II et
III a conduit à l’usage de Herceptin
- en monothérapies chez les patien-
tes métastatiques HER2+ en échec de
2 protocoles de chimiothérapie clas-
sique ayant inclus au moins une
anthracycline et un taxane,
- ou en association avec le paclitaxel
pour les patientes non prétraitées et
chez lesquelles les antracyclines sont
inenvisageables.
L’autorisation de mise sur le marché
reste actuellement restreinte à ces in-
dications mais des essais sont en
cours pour déterminer les bénéfices
d’une administration adjuvante
d’Herceptin chez les patientes
HER2+ non métastatiques avec atteinte
ganglionnaire isolée.
Les effets indésirables les plus fré-
quents sont la fièvre, les frissons, les
douleurs musculaires, des syndromes
grippaux et ceux liés à la chimiothé-
rapie associée. Le traitement est donc
bien toléré. En revanche, le produit
présente une toxicité cardiaque qui
se manifeste dans 5 % des cas (myo-
cardiopathie, insuffisance cardiaque
congestive, baisse de la fraction
d’éjection supérieure à 10 %) et dont
la gestion doit tenir compte des chi-
miothérapies aux antracyclines
préalablement administrées.
CONCLUSION
ðLa découverte d’un proto-oncogène
a rarement abouti à l’utilisation d’un
test prédictif à la réponse d’un traite-
ment ciblé sur le gène. C’est le cas
avec HER2, facteur de mauvais pro-
nostic du cancer du sein qui pour-
rait s’avérer devenir un élément de
pronostic bénéfique si l’on considère
qu’il ouvre la voie à une thérapeuti-
que efficace. HER2 est un modèle
pour l’étude des altérations d’autres
oncogènes permettant de développer
des outils tant diagnostics que théra-
peutiques. Le développement d’anti-
corps anti-HER2 vecteurs de molécu-
les cytotoxiques ou radioactives ou
la mise au point d’anticorps bi-spéci-
fiques anti-HER2/anti-cellules effectri-
ces de l’immunité antitumorale est la
prochaine étape dans l’obtention de
thérapeutiques plus sélectives et plus
efficaces.
HER-2 and trastuzumab :
new one biologic and therapeutic paradigm for breast cancer
The HER2/neu oncogene codes for a membrane protein HER2 with a tyrosine kinase
activity. It is involved in the development of breast cancer by amplification and/or overexpression
of its product, the HER2 protein. The quantitative PCR represents a simple and reliable method
for the evaluation of the activation of HER2. In practice, an immunoenzymatic assay allows the
quantitative dosage of the protein level in tumor tissus or in plasma. The amplification and/or the
overexpression of the gene is a bad prognostic factor for breast cancer and would be, furthermore,
useful in the prediction of response to treatments. HER2 takes a considerable importance as a
potential therapeutic target with a specific antitumoral therapy called trastuzumab.
Breast cancer / HER2 / Tumors markers / Trastuzumab,

HER- et trastuzumab : un nouveau paradigme biologique et thérapeutique dans le cancer du sein
Médecine Nucléaire - Imagerie fonctionnelle et métabolique - 2002 - vol.26 - n°1
50
RÉFÉRENCES
1. Gullick WJ, Berger MS, Bennett PL,
Rothbard JB, Waterfield MD. Expres-
sion of the c-erbb-2 protein in nor-
mal and transformed cells.Int J
Cancer. 1987 ; 40(2):246-54.
2. Carraway 3rd KL, Weber JL, Unger
MJ et al. Neuregulin-2, a new ligand
of erbb3/erbb4-réceptor tyrosine ki-
nases. Nature 1997 ; 387 :512-6.
3. Schroeder W, Lee DC. Dynamic ex-
pression and activation of erbb
receptors in the developing mouse
mammary gland. Cell growth differ.
1998 ;9 :451-64.
4. Karunagaran D, Tzahar E, Beerli RR
et al. Erbb-2 is a common auxiliary
subunit of NDF and EGF receptors :
implication for breast cancer. Embo
J 1996 ; 15 : 254-64.
5. Schroeder W, Biesterfeld S, Zillessen
S, Rath W. Epidermal growth factor
receptor-immunohistochemical
detection and clinical significance
for treatment of primary breast can-
cer. Anticancer Res 1997 ;17 :2799-
802.
6. Di Fiore PP, Pierce JH, Kraus MH.
Erbb-2 is a a potent oncogene when
overexpressed in NIH/3T3 cells.
Science 1987 ; 237 : 178-82.
7. Kraus MH, Popescu NC, Amsbaugh
SC, King CR,. Overexpression of the
EGF receptor related proto-
oncogene erbb-2 in human
mammary tumor cell lines by
different molecular mechanisms.
Embo J 1987 ; 6 : 605-10.
8. Jacobs TW, Gown AM, Yaziji H,
Barnes MJ, Schnitt SJ.Comparison
of fluorescence in situ hybridization
and immunohistochemistry for the
evaluation of HER-2/neu in breast
cancer. J Clin Oncol. 1999 ;17:1974-
82.
9. Ratcliffe N, Wells W, Wheeler K,
Memoli V. The combination of in situ
hybridization and immunohisto-
chemical analysis: an evaluation of
Her2/neu expression in paraffin-
embedded breast carcinomas and
adjacent normal-appearing breast
epithelium. Mod Pathol 1997 ; 10 :
1247-52.
10. Zabrecky JR, Lam T, McKenzie SJ,
Carney W. The extracellular domain
of p185/neu is released from the
surface of human breast carcinoma
cells, SK-BR-3.J Biol Chem. 1991 ;
266 :1716-20.
11. Fina F, Vuaroqueau V, Romain S,
Ouafik L’H, Martin PM. Developpe-
ment d’un dosage permettant la
mesure d’amplification génique du
gène HER2 par PCR quantitative en
temps réel dans des cancers du sein.
2 ièmes rencontres Light cycler. Ins-
titut Pasteur de Paris. 4 oct 2001.
12. Slamon DJ, Clark GM, Wong SG,
Levin WJ, Ullrich A, McGuire WL.
Human breast cancer : correlation
of relapse and survival with am-
plification of the HER-2/neu onco-
gene. Science 1987; 235 (4785): 177-
82.
13. Ross JS, Fletcher JA. The HER-2/neu
oncogene in breast cancer :
prognostic factor, predictive factor,
and target for therapy. Stem Cells
1998 ; 16 : 413-28.
14. Newby JC, Johnson SRD, Smith IE,
Dowset M. Expression of epidermal
growth factor receptor and c-erb B2
during the development of
tamoxifen resistance in human
breast cancer. Clin Cancer Res 1997 ;
3 : 1643-51.
15. Paik S, Bryant J, Park C et al. erbB-
2 and response to doxorubicin in
patients with axillary lymph node-
positive, hormone receptor negative
breast cancer. J Natl Cancer Inst
1998 ; 90 : 1361-70.
16. Lewis GD, Figari I, Fendly B, Wong
WL, Carter P, Gorman C, Shepard
HM. Differential responses of
human tumor cell lines to anti-
p185HER2 monoclonal antibodies.
Cancer Immunol Immunother.
1993 4 : 255-63.
17. Pegram M, Hsu S, Lewis G, Pietras
R, Beryt M, Sliwkowski M, Coombs
D, Baly D, Kabbinavar F, Slamon
D. Inhibitory effects of combina-
tions of HER-2/neu antibody and
chemotherapeutic agents used for
treatment of human breast
cancers.Oncogene. 1999 ; 18:2241-
51.
1
/
5
100%