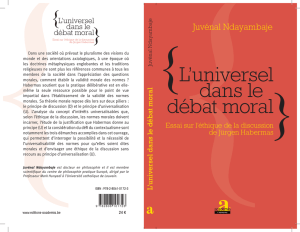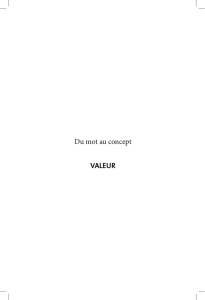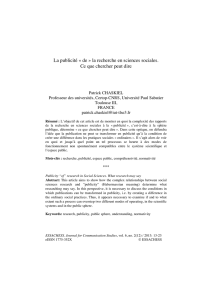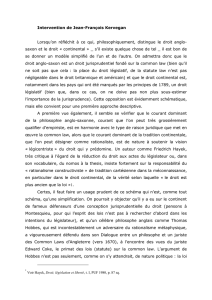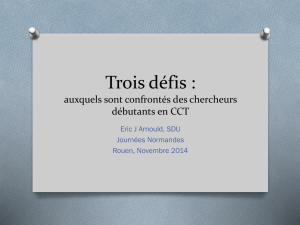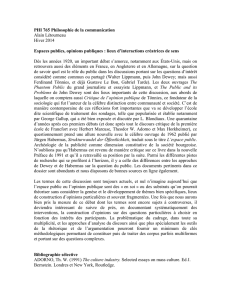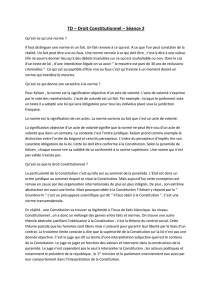Droit et axiologie : la question de la place des « valeurs » dans le

1
Hugues Rabault
Professeur de droit public
Université Paul Verlaine – Metz
[rabault@univ-metz.fr]
Droit et axiologie : la question de la place des « valeurs » dans le
système juridique
ans les définitions philosophiques du concept d’axiologie on trouve les
formules suivantes : « Etude ou théorie de tel ou tel type de valeur », ou
« théorie critique de la notion de valeur » (Lalande1), ou encore « science et
théorie des valeurs (morales) » (Robert). On peut désigner l’axiologie comme la
théorie des valeurs. La notion d’axiologie semble assez récente (1902, selon le
Robert et Lalande), à la différence de l’idée d’éthique ou de celle de morale. Le
concept d’axiologie est dérivé du grec axios, qui signifie « qui vaut, qui a de la
valeur ». On peut poser l’hypothèse que la notion d’axiologie se développe à
partir d’une certaine crise de la morale ou de la rationalité, à partir du moment
où l’on conçoit le monde des valeurs comme pluraliste, comme impliquant des
« systèmes de valeurs ». Dans un monde où les valeurs sont univoques, comme
dans celui de la théologie scolastique, il n’y a pas besoin d’axiologie. C’est
précisément parce que nous vivons dans un monde régi par une certaine
relativité des valeurs que se développe la théorie des valeurs. L’axiologie
apparaît de la sorte comme la discipline qui se consacre à l’étude des valeurs
dans un monde où règne la pluralité des valeurs.
La notion de valeurs a une histoire. Le terme est ancien, mais à l’origine,
c’est-à-dire dans le français médiéval, dérivé du verbe latin valere, il renvoie
habituellement à l’évaluation, au prix. Il est traditionnellement décliné dans
différents registres de la vie humaine : principalement la valeur vénale ou la
valeur militaire. Les théories de la valeur, au sens du prix, sont, comme on sait,
au centre de l’économie classique. Le terme de valeurs dans un sens juridique
n’apparaît pas, semble-t-il, avant la seconde moitié du dix-neuvième siècle.
D’une façon générale, « une valeur » renvoie à « ce qui est vrai, beau, bien,
selon un jugement personnel plus ou moins en accord avec celui de la société de
l’époque » (Robert). On parle alors des « valeurs d’une société », de « système
de valeurs » (Robert, citant Malraux et Sartre). Les valeurs peuvent être morales,
esthétiques, ou autres. Elles changent d’un individu à l’autre, d’une société à
l’autre. C’est ce qu’on appelle les systèmes de valeurs. Ici encore, on se trouve
renvoyé à l’idée de la relativité du monde des valeurs. On peut se mouvoir entre
les systèmes de valeurs : être individualiste ou collectiviste, idéaliste ou réaliste,
de droite ou de gauche, etc. La notion de valeurs correspond à la démocratie, à
un système politique où les partis représentent des systèmes de valeurs. Dans la
1 André Lalande, Vocabulaire technique et critique de la philosophie [1926], 2 volume, PUF, Paris, 1997. Le
terme est emprunté à la philosophie allemande où il apparaît vers 1887.
D

2
société démocratique, c’est le propre des programmes des partis politiques que
de mettre en avant un système de valeurs. On peut donc dire, pour résumer, que
la sémantique des valeurs est le produit d’une évolution historique par laquelle
on part d’un monde unifié autour d’un ordre axiologique commun et largement
implicite, qui forme ce qu’on peut appeler l’éthique ou la morale. Dans ce
contexte, il est inutile de parler d’axiologie, l’idée d’éthique est suffisante. On
aboutit à un monde éclaté entre des systèmes de valeurs, qui peuvent être
propres à un individu, à une société, etc. Sans doute un auteur particulièrement
significatif en la matière est-il Nietzsche, qui parle de « l’inversion de toutes les
valeurs » (« Umwertung aller Werte ») et qui développe une théorie qui
substitue à la vérité une « interprétation du monde » (« Welt-Auslegung, Welt-
Ausdeutung »2). Le concept de « Weltanschauung », qui vient du romantisme, en
deviendra une version popularisée3. Relativisme, perspectivisme, scepticisme,
voilà des concepts qui résument les nouvelles théories qui se développent dans
le contexte de la philosophie des valeurs.
En droit, la notion de valeur se développe, sous l’influence de la
philosophie des valeurs, au vingtième siècle. C’est d’abord une notion qui relève
de la théorie4, puis qu’on retrouve dans la pratique juridique. Le droit
constitutionnel allemand utilise la notion de « valeur » essentiellement dans
deux hypothèses. Premièrement, en posant que l’ordre constitutionnel implique
une axiologie. Selon la Cour constitutionnelle fédérale, la notion de « dignité de
l’homme » est « la valeur suprême » de la Loi fondamentale5. La Loi
fondamentale contient des « décisions en termes de valeurs »6. La notion de
valeur renvoie ici à une axiologie, qui doit orienter l’interprétation. On peut dire
qu’on a affaire à un principe herméneutique. En même temps, le juge utilise la
notion de valeur pour reconnaître le pluralisme des valeurs. Par exemple, la
2 Le succès de la philosophie de Nietzsche illustre cette transformation. Voir surtout Friedrich Nietzsche,
Jenseits von Gut und Böse [Par-delà le bien et le mal, 1886] et Zur Genealogie der Moral [Généalogie de la
morale, 1887], Kröner, Stuttgart, 1976. L’ouvrage posthume, fortement contesté par les exégètes de Nietzsche,
Der Wille zur Macht [La volonté de puissance, 1906], Kröner, Stuttgart, 1980, comporte cet intérêt qu’il se
présente à travers son sous-titre comme une « tentative de renversement de toutes les valeurs ». Voir notamment,
p.420 et s.
3 La notion de « Weltanschauung » est utilisée par la jurisprudence sous le national-socialisme, de la même façon
que le droit contemporain se réfère aux « valeurs ». On peut parler d’une irruption de l’idéologie dans le droit,
d’une « idéologisation du droit ». Voir Hugues Rabault, L’interprétation des normes : l’objectivité de la méthode
herméneutique, L’Harmattan, Paris, 1997, p.229 et s.
4 Le problème du relativisme axiologique en droit est référée à deux figures de la théorie juridique, Hans Kelsen
(voir infra I B) et Gustav Radbruch. Les écrits de ce dernier sont les plus significatifs d’une intrusion soudaine
de l’axiologie dans le droit. Radbruch met en avant le fait que les conflits de valeurs au sein de la société
produisent des antinomies, des contradictions, dans le fonctionnement juridique. C’est ce qu’on peut appeler le
« paradoxe des valeurs ». Voir Erik Wolf, Grosse Rechtsdenker [Grands penseurs du droit], J. C. B. Mohr,
Tübingen, 1963, p.754 et s. Voir encore Gustav Radbruch, Einführung in die Rechtswissenschaft [Introduction à
la science du droit, dont la première édition remonte à 1910], Koehler, Stuttgart, 1964, p.41 : « Les [systèmes de
valeurs] se nécessitent les uns les autres, mais se contredisent en même temps, ce qui entraîne une contradiction
entre justice et sécurité juridique ».
5 Voir par exemple, Hans D. Jarass, Bodo Pieroth, Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland. Kommentar
[Loi fondamentale de la République fédérale d’Allemagne. Commentaire], München, C. H. Beck, 2004, p.43.
6 Ibid., p.19.

3
liberté d’opinion couvre les « jugements de valeur »7. L’idée du pluralisme des
valeurs concerne la politique, la morale, la religion aussi bien que l’esthétique.
La notion de dignité de l’homme comme valeur objectivée dans la norme
juridique peut intervenir pour limiter le pluralisme des valeurs dérivant de la
liberté. L’appréciation du juge vient ici régler un conflit de valeurs
constitutionnelles8.
Le droit apparaît donc affecté par l’émergence d’une sémantique des
valeurs. Cependant, la notion de valeur n’est pas inhérente au droit. On voudrait
montrer ici que le droit a plutôt tendance à exclure l’idée de valeur et à n’y
recourir que pour ce qu’on peut désigner comme les « cas limite ». La notion de
valeur exprime des situations où l’on se trouve à la frontière entre droit et
politique. Les valeurs ne permettent pas le traitement juridique des cas du fait de
leur caractère vague et indéfinissable9. On ne se réfère en droit aux valeurs que
lorsqu’on ne peut pas décider sur la base de règles juridiques formelles10.
On évoquera, en termes de théorie du droit, la relation entre les valeurs et
les écoles classiques de la théorie juridique (I) puis la théorisation du problème
des valeurs par les théories de la communication (II).
I. – Les théories juridiques classiques
On peut dire que la théorie du droit naturel s’enracine dans une tradition
qui précède largement l’apparition de la sémantique des valeurs (A). On peut
donc interpréter les théories positivistes du droit comme une réaction du droit à
l’apparition de la sémantique des valeurs (B).
A. Le jusnaturalisme : le droit comme émanation absolue de la Raison. –
On a pu parler de la notion de valeurs comme d’un « ersatz de droit naturel »11.
Le succès de la notion de valeurs en droit s’explique par le déclin de la théorie
du droit naturel. On a dit que le droit positif se réfère désormais à la notion de
valeurs. Or la question de la relation entre droit et valeurs est extrêmement
problématique lorsqu’elle est envisagée sous l’angle de la théorie juridique. Ce
phénomène n’est pas le propre du droit. La question de l’axiologie concerne
aussi bien le problème de la politique que celui du droit. Du point de vue de la
politique les choses sont assez simples, puisqu’on se trouve renvoyé à la
question classique de la relation entre éthique et politique. On sait que dans la
tradition politique on connaît en la matière différentes étapes. Si l’on se place du
point de vue de la philosophie scolastique médiévale, on dispose d’un univers
7 Ibid., p.192.
8 Voir ibid., p.235 et s., la jurisprudence en matière artistique, révélatrice de ce qu’on peut désigner comme la
collision des valeurs, esthétiques, morales, etc.
9 Voir, par exemple, Hans-Martin Pawlowski, Methodenlehre für Juristen. Theorie der Norm und des Gesetzes
[Méthodologie pour juristes. Théorie de la norme et de la loi], C. F. Müller, Heidelberg, 1991, p.381.
10 Ibid., p.383.
11 Ibid., p.378.

4
unifié, où cohabitent en pleine harmonie la théologie, l’éthique, le droit et la
politique. Le système de Thomas d’Aquin est la parfaite image de l’ordre unifié
du monde médiéval12. L’unité du monde médiéval est d’abord cosmologique.
C’est l’ordre d’une création issue d’un Dieu unique. C’est aussi l’ordre d’une
histoire régie par la providence et orientée vers le salut de l’homme. L’univers
constitue un ordre cohérent à tout point de vue, spatial, temporel, moral, etc.
Cette structure du monde se reflète dans la morale et dans le droit.
Dieu est la finalité de la vie humaine, dans le sens où les hommes
recherchent la vie éternelle, la béatitude, la félicité, etc.13 Tel est le fondement de
l’éthique. On peut distinguer le bien du mal, l’homme est doué du libre arbitre,
etc.14 De cela résulte la théorie des vertus, qui correspond à la capacité de
l’homme à s’orienter vers le bien15, etc. Le droit s’emboîte harmonieusement
dans ce système16. Le droit17 est un produit de la raison. Il a pour objectif la
satisfaction du bien commun, le bonheur au sein de la cité. C’est seulement dans
la mesure où le droit est établi par la raison qu’il a force de loi. Thomas d’Aquin
aboutit à la description d’un véritable système juridique, conforme tout à la fois
à la raison et à la téléologie divine. La communauté de l’univers dans son entier
est gouvernée par la raison divine. Le plan régissant le gouvernement cosmique
constitue du droit au plein sens du terme. Le droit divin, conçu de toute éternité,
droit éternel, régit les hommes et les choses. Ce droit est promulgué par le verbe
éternel et le livre de vie. Le droit naturel est subordonné au droit divin, et les
gentils, quoiqu’ils ne disposent pas du droit divin dûment promulgué, par le
droit naturel ont une connaissance du bien et du mal.
On voit par là que le droit correspond à l’ordre moral et éthique. Le droit
est un instrument de la téléologie divine. Il permet aux hommes s’orienter dans
la vie quotidienne. Le droit le plus aléatoire reste naturellement le droit humain.
Suivant en cela saint Augustin, Thomas d’Aquin distingue le droit éternel et le
droit temporel. Le droit humain relève de cette seconde catégorie. La possibilité
pour les hommes d’élaborer un droit réside dans la capacité de la raison humaine
de partager le plan divin, bien que d’une façon imparfaite. L’ordre juridique
humain s’emboîte ici encore dans l’harmonie de la création divine. L’optimisme
de Thomas d’Aquin le conduit à envisager la nature humaine comme
globalement positive. De même que, d’une façon générale, l’homme est orienté
positivement au plan moral, il tend à élaborer un droit adéquat à l’ordre
juridique divin, avec plus ou moins d’approximations. Naturellement, de même
que le mal existe dans l’univers, de même que l’homme peut chuter, des régimes
politiques tyranniques et impies peuvent surgir. Cela explique la fameuse théorie
12 Ici, on se réfère à Aquinas, Selected Philosophical Writings, Oxford University Press, 1993
13 Ibid., p.315 et s.
14 Ibid., p.342 et s.
15 Ibid., p.390 et s.
16 Ibid., p.409 et s.
17 Voir encore, Aquinas, Political Writings, Cambridge University Press, 2002, p.76-157.

5
du droit de résistance de Thomas d’Aquin18. Il existe une faculté raisonnable qui
se trouve au fondement même du droit et qui permet, d’une façon générale, de
percevoir en quoi le droit temporel viole les règles issues du droit divin. Le droit
de résistance chez Thomas d’Aquin correspond à un véritable contrôle de
constitutionnalité opéré par le peuple. Cette conception peut nous choquer car
elle nous semble signifier que tout un chacun peut sous cet angle juger que le
droit promulgué par les autorités est non conforme au droit divin. Mais il faut
réaliser que Thomas d’Aquin écrit à une époque où ne règne pas
l’individualisme d’aujourd’hui. Le droit de résistance est conçu comme exercé
par une communauté raisonnable.
Pourquoi se fonder ici sur Thomas d’Aquin ? Premièrement, parce qu’il
est un auteur canonique. Sa conception a été à partir du 14ème siècle reçue par
l’Eglise catholique, à une époque où celle-ci régnait sur toute la chrétienté. La
théorie thomiste représente l’état d’esprit ambiant en termes de théorie juridique
sous l’ancien régime. Elle a profondément imprégné, par exemple, l’idéologie
des monarchies absolues, des républiques urbaines, etc. Les historiens de la
philosophie du moyen âge auront tendance à insister sur les différences entre les
écoles de la scolastiques, entre les réalistes et les nominalistes, etc. Mais si l’on
se contente, comme cela vient d’être fait, d’une synthèse très rapide, on
s’aperçoit que la pensée de Thomas d’Aquin est représentative de l’état d’esprit
médiéval, au-delà des divergences entre les écoles. Enfin, si l’on se réfère aux
écoles ultérieures du droit naturel, on s’aperçoit qu’elles opèrent une
sécularisation et une rationalisation de l’esprit du thomisme19. Le droit divin
disparaît au profit du droit naturel. Mais l’idée d’un droit « suprapositif »,
rationnel, éternel, etc., demeure dérivée des conceptions thomistes. On peut dire
que les jusnaturalistes modernes recyclent des schémas qu’on trouve dans le
thomisme pour résoudre les problèmes de leur époque, c’est-à-dire pour
rationaliser le droit. Le rationalisme et l’optimisme des jusnaturalistes s’inscrit
dans la continuité de la tradition thomiste. Le rationalisme et l’universalisme de
la Déclaration de 1789 n’est pas non plus en rupture avec cette tradition. En
France, le thomisme restera influent dans la théorie juridique jusque dans les
années soixante-dix environ, avant d’être détrôné par le kelsénisme20.
B. Le juspositivisme : le droit comme pur fait. – Que peut-on déduire de
ce qui vient d’être dit concernant la question des valeurs ? Paradoxalement, le
jusnaturalisme sous sa forme théologique ou sécularisée ne pose pas la question
du droit sous l’angle des valeurs, mais sous celui de la justice et de la raison.
18 Ibid., p.72 et s.
19 Carl Joachim Friedrich, The Philosophy of Law in Historical Perspective, The University of Chicago Press,
1963, p.112, évoque cette immanence du thomisme et du néo-thomiste dans le développement de la théorie du
droit naturel au 17ème et au 18ème siècle.
20 Voir Michel Villey, Philosophie du droit II. Les moyens du droit, Dalloz, Paris, 1984, notamment, p.233. Il ne
faut pas oublier la grande tradition française du néo-thomisme, dont Villey fut un représentant parmi les juristes,
et qui connut un rayonnement international.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
1
/
13
100%