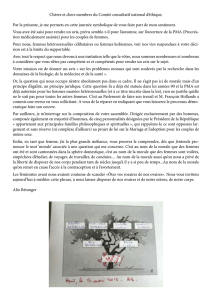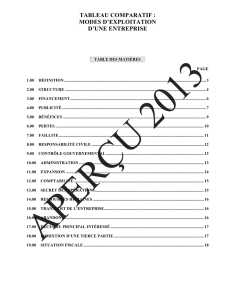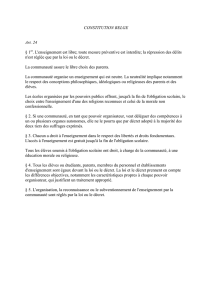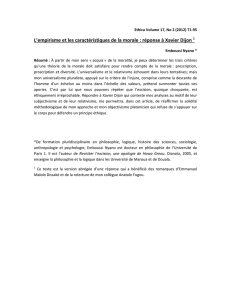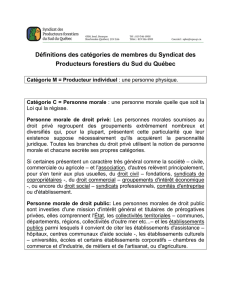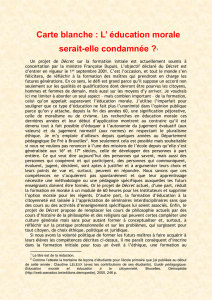Extrait

Du mot au concept
VALEUR

Envoi
Il est fait grand usage, dans le verbe contemporain – qu’il soit politique, écono-
mique, social, éducatif, juridique, sportif, religieux, technique et scientifique – du
mot valeur. L’invocation de « valeur », plus souvent pour en déplorer l’abaisse-
ment que pour en célébrer l’empreinte positive, intéresse une très grande variété
de domaines. Reste à savoir si l’usage du mot valeur réfléchit sa polysémie ou si
la plus grande diversité de contextes peut se subsumer sous une acception unique
de ce même mot. Sans trop la solliciter, cette alternative désigne toutefois les deux
polarités entre lesquelles oscille le sens de valeur : le relativisme et l’universalisme
qui, à l’image de bien des opposés, trouvent toujours à se renforcer réciproquement.
Aujourd’hui, en nos contrées, le relativisme semble s’imposer dans le discours
moral courant. Ce n’est pas pour rien que le mot valeur prend si aisément le
pluriel pour distinguer les régimes politiques, les activités et les conduites
humaines. Pour s’en tenir aux seuls jugements, sous la forclusion du « nous
n’avons pas les mêmes valeurs », l’universel le cède aux particularismes en sorte
que, faute d’un examen scrupuleux des contenus, le constat d’indiscutables diffé-
rences pousse à la sous-estimation, au dédain, au désintérêt ou, ce qui finalement
revient au même, incite à un culte de l’altérité, trop claironné pour être sincère.
Souvent, les conflits entre ces deux genres de valeurs – les abstraites universelles
et les concrètes particulières – dont parlait Camus, se concluent par de faciles
accommodements. Qu’importent les enjeux, chacun finit par dégoter dans son
trousseau moral quelques bonnes raisons de hisser l’indifférence à ses prochains
– la clôture du chacun chez soi – au rang de sage et prudente protection de valeurs
présumées menacées, le plus souvent en ignorant d’où elles procèdent, de quoi
elles sont faites et surtout, à quoi elles engagent.
Pareilles bonnes raisons restent étrangères à cette antique acception de valeur qui,
chez l’humain se partage entre l’audace, le mérite et le courage. Parler d’un homme,
d’une femme de valeur, dire d’une personne qu’elle a de la valeur, revient à en
distinguer le caractère, les dispositions physiques et cognitives et à célébrer son
« génie propre » selon la formule de Lavelle. Qu’en est-il aujourd’hui ? Qui peut
encore croire que toutes les machineries de l’évaluation qui s’installent partout
aient pour seul objet la mise en valeur du génie propre ? Précisément, lorsque le
management des compétences s’allie à la quête obstinée de productivité qui semble
le propre des sociétés postmodernes, gestionnaires et contrôlées, la valeur s’ab-
sorbe dans une évaluation comparative stimulant une mimésis envieuse et

agonique (Girard) dont diverses doctrines nous assurent qu’elle constitue le
moteur de la dynamique sociale dans la Cité, à l’école comme dans la vie laborieuse.
L’extension de l’évaluation-gestion à toutes les sphères du politique favorise le
pullulement de consultants et d’experts, bref le déploiement d’un nouveau clergé
en charge d’indiquer le meilleur dans des interventions supposées motivantes,
voire dans des sermons élaborés à partir d’un lexique spécialisé, lequel déborde
de termes « incontournables » parmi lesquels on va croiser : « concept » (en un
sens galvaudé), « gouvernance », « complexe », « flexible », « réactif », « perfor-
mant », jusqu’à « éthique » (en substitut fautif de morale). Ce lexique, pour peu
qu’il prenne sa part dans la glorification de quelques « miracles économiques » et
intègre ces formules jargonnantes où domine un anglais dit de spécialité, parti-
cipe du prononcé du mystère, comme il en allait du latin pour l’humble chrétien
d’avant Vatican2. Mais l’impact de cette novlangue reste aisément repérable et ne
manque jamais de ranimer l’esprit de Molière devant la docte fatuité.
L’affaire devient plus sérieuse lorsque l’appétit contemporain de l’évaluation
porte le procédé calculatoire à asservir l’interprétation aux seuls critères formels
de cohérence. L’esprit de magie, excité par l’apparat sémiotique propre aux tech-
niques modernes de communication, suffit alors à conférer aux valeurs numé-
riques une valeur indue d’explication. S’agit-il d’un avatar du « gestionnisme »
qui, du chiffre, fait sa « nouvelle référence souveraine » comme le proclame
Legendre ? Il s’agit d’abord d’une vieille question de rationalité scientifique ou
comment tirer d’un calcul sur une échelle appropriée à la nature des données, un
jugement de valeur propre à orienter « concrètement » l’action ? En amont des
prescriptions, encore faut-il s’assurer que les critères de validité des traitements
soient bien identifiés et respectés.
En effet, les résultats restent bien contingents et, pour tout dire, rationnellement
injustifiés si l’on omet de les référer simultanément à la théorie qui pilote chacun
des formalismes (algébriques, probabilistes, logiques ou autres) et au système
d’idées d’où émane le contenu conceptuel des jugements. Mais, bien que cette
démarche participe de la construction de variables, on ne saurait se satisfaire de
la superposition de deux ensembles théoriques incommensurables. Comment
associer le beau, le bien, le devoir, autrement dit des valeurs, à des calculs logiques
ou à des calculs probabilistes, sans en dégrader l’ontologie ? Le calcul peut-il esti-
mer la manière dont se répartissent, dans l’incorporation des valeurs, les
conduites individuelles délibératives et celles mécaniquement adhésives ?
L’enquête, comme on pouvait le prévoir, va alors s’ancrer dans l’examen du
rapport entre validité (Geltung) et valeur (Wert) ; examen déjà conduit par Lotze

et repris par les néokantiens jusqu’à Habermas. En peu de mots, il s’agit de consi-
dérer la relation d’une épistémologie à une axiologie qui confirme le primat de la
raison pratique conduisant, conjointement, à une critique de la morale et à l’affir-
mation de ce qui « vaut » en tant que savoir non empirique, hors toute considéra-
tion de temps. Un tel schéma, s’il doit se garder du naturalisme, doit aussi se
garder d’un ciel exclusivement peuplé de notions éthiques abstraites.
L’émergence du droit positif (Kelsen) répond à cette double menace en fixant la
norme au fondement du droit et en laissant les valeurs (dont la justice) du côté de
la morale. Sans sous-estimer les critiques (dont celle de Hayek) relatives à la
coupure entre le juste (valeur incertaine) et le légal (fondé sur la norme), la façon
dont Kelsen, en forme de développement logique de cette distinction, relève la
présence du droit dans le régime nazi, ne manque pas de mettre en question le
poids de la référence morale dans le jugement politique, en l’occurrence dans la
condamnation d’un régime monstrueux. La question du retrait des valeurs
morales n’est pas insignifiante : il suffit, pour s’en rendre compte, de remonter à
la Constitution de la RFA ou à la présence, dans la France actuelle, de règles et de
dispositifs légaux issus du régime de Vichy. On peut poursuivre dans cette voie,
d’une part en confrontant les conceptions du droit, de l’État et de la morale de
Kelsen avec celle d’Arendt et de Schmitt et, d’autre part, en s’interrogeant sur la
fondation du droit international contemporain. Comment instaurer un « devoir
être » (Sollen) planétaire à partir des valeurs qui, opportunément, deviendraient
universelles, si l’on considère que l’État de droit repose sur une norme fondamen-
tale ? Certainement, en osant poser le cadre mondial comme restrictif sur le plan
des valeurs, en l’assurant du primat d’un principe d’imputation non axiologique
et, cela va de soi, non-naturaliste, pour orienter les procédures de sanction. On
comprend mieux la difficulté à instaurer ce droit positif et l’implicite anti-huma-
nitaire qu’il véhicule.
Effaçant la distinction entre les valeurs et les normes par assimilation du contenu
au processus, le règne de la procédure a succédé à celui de l’impératif universel.
La norme se présente comme une règle indiquant les comportements appropriés
et partagés sur le plan des usages ; elle régit la conduite des individus en société
pris entre prescription et proscription. Mais si la norme se situe au principe de la
loi et de l’appareillage qui s’assure de la conformité des comportements à son
endroit, ne reste-t-il à la valeur que les seuls critères du désirable, ajustés aux fins
de l’action ? La question est loin d’être tranchée, pour deux raisons bien obser-
vables dans les régimes contemporains. En premier lieu, la présence des
procédures au cœur d’un régime démocratique ne le préserve pas d’actes indivi-
duels contraires à l’intérêt général, confirmant ainsi Aristote qui voyait en la

démocratie une perversion de la république. En second lieu, quand la table de la
loi finit par le céder à la table des négociations, quand le moindre événement de
la vie collective a pour seule réponse la production d’une loi spécifique, qui s’ins-
crit dans une série sans fin, situer la valeur comme source ou comme fin de tels
procédés participe d’une mystification.
Pour susciter acquiescement et engagement, suffit-il alors de tenir la norme du
« ce qui doit être » pour une valeur objective ayant son prix sous la forme d’une
durée et d’une intensité de travail, d’étude, d’effort, de persévérance, de sacrifice ?
Peut-on parler d’une hybridation norme-valeur comme produit d’une opération
de légitimation par les procédures ? Si la force des prescriptions résulte de la
conversion du concept de valeur en celui de norme dont il se distinguait aupara-
vant, cette conversion, précédée de nombreux déplacements entre les domaines
logiques, mathématiques, philosophiques ainsi qu’au sein des disciplines anthro-
posociales, atteste une plasticité que la tradition partage, de rapide façon, entre
subjectivité et objectivité.
Alors que la subjectivité associe les jugements moraux aux sentiments, aux repré-
sentations et au désir, l’objectivité vise la satisfaction d’une fin précise à l’exemple
de la « valeur documentaire », de la « valeur démonstrative », ou de la « valeur
dénotative », pouvant être affectées à toutes sortes de produits de l’art, de la
science, de la langue. Mais cette conception fonctionnaliste et objective de la
valeur n’est sans doute pas si loin du paradigme naturaliste qui confond questions
de fait et questions de morale. Une autre voie serait de considérer, avec Hare, la
sous-classe des constats fonctionnels. Ici encore, la question n’est pas que d’école :
on retrouve encore le vaste problème des normes, de leurs variations (règles de
l’immutabilité, crises et renouvellement) et aussi celui du rapport du sujet à celles-
ci (soumission et clairvoyance). Avec son système de buts, l’analyse fonctionnelle
indique comment l’objet ou la situation fonctionnent, normalement ou non, au
regard du résultat attendu. De fait, elle réinstalle la technique dans la probléma-
tique de la valeur, en particulier dans le champ du rapport de l’invention à l’inno-
vation. Il reste que les énoncés fonctionnels réinstallent le langage dans une
relation aux valeurs qui revêtira une grande portée dans un cadre anglais qui
inaugure, avec Hume, la réfutation du passage des faits aux normes.
Ce qui « doit-être » n’a rien à voir avec le monde naturel selon Moore. Pour lui
l’erreur naturaliste (naturalistic fallacy) s’incarne dans l’éthique évolutionniste de
Spencer (hédonisme plus évolution) qui connaît de nos jours une sorte de
renaissance (à travers l’animalisme par exemple). Mais une autre raison détache
l’éthique du « sophisme naturaliste » : elle concerne, à propos du bien, la séman-
tique, donc la cognition. Le prédicat « bien » reste pour Moore indéterminable
 6
6
 7
7
1
/
7
100%