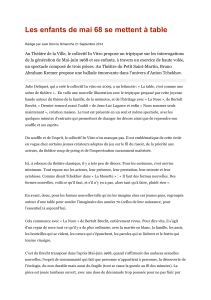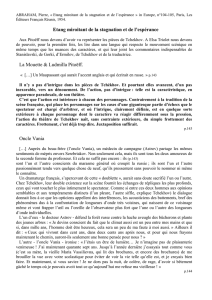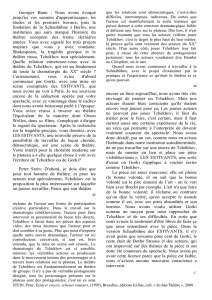"Tchekhov serait de nos jours un militant des droits de l`homme"

"Tchekhov serait de nos jours un militant des
droits de l’homme"
Propos recueillis par Fabienne Arvers et Patrick Sourd le 11 Mars 2016-05-23
La Mouette est-elle la première pièce d’Anton Tchekhov que vous mettez en
scène ?
Thomas Ostermeier – C’est effectivement la première fois que je monte une pièce
de Tchekhov en français, mais s’agissant de La Mouette, je l’ai déjà mise en scène en
néerlandais à Amsterdam. On ne fait jamais le tour d’une pièce en la mettant une fois en
scène, je trouve très agréable de pouvoir ainsi la remettre sur le métier. Cela me permet
aussi de mettre en perspective ce que l’on sait de l’auteur et ce que fut sa vie d’homme
dans la société. Tchekhov était un citoyen très engagé dans le domaine social. Il a
fondé des écoles et des bibliothèques. Comme citoyen, Tchekhov serait un militant des
droits de l’homme.Comme médecin, il ferait de nos jours partie d’une ONG. Son
voyage en 1890 et le séjour qu’il fait dans l’île de Sakhaline où il découvre l’enfer des
conditions de vie des bagnards le marque à jamais. Six ans plus tard il écrit la Mouette.
Mettez-vous l’accent sur cet engagement social de Tchekhov?
Ce n’est pas le but, mais cela me permet d’inscrire la pièce dans un contexte. De
relativiser les problèmes amoureux vécus par ce petit groupe de gens proche des
milieux artistiques. Avec une forme d’ironie, Tchekhov sous-titre sa pièce en la nommant
“comédie”. Savoir l’expérience qu’il vient de vivre à Sakhaline nous aide à comprendre
pourquoi il désigne ainsi le sujet de sa pièce comme quelque chose qui peut paraître
futile. Il n’est pas question pour lui de se moquer de ces chassés-croisés amoureux,
mais en même temps, savoir que l’auteur est concerné par la misère, les injustices
et les épidémies qui sont le lot des plus pauvres dans la Russie de son époque nous
permet d’actualiser le texte sans le trahir au regard de ce que nous vivons aujourd’hui.
Vous avez demandé une nouvelle version française de la pièce à l’auteur
Olivier Cadiot?
C’est difficile pour moi de juger de la qualité d’une traduction. Même si je m’exprime
couramment en français, je sais que je ne maîtrise pas suffisamment les nuances de la
langue française pour savoir quel mot est juste et quelle expression ne l’est pas. C’est
pourquoi j’ai fait appel à Olivier Cadiot et lui ai proposé de partir de ma propre
adaptation du texte de la pièce en allemand pour qu’il en fasse une traduction. Cela dit,
ce que vous entendrez sur le plateau ne se limitera pas à cet exercice de réécriture
en français. Pour inscrire la pièce dans notre présent, j’ai inséré dans le cours de la
représentation des dialogues inventés par les acteurs durant le
séance d’improvisations qui leur ont permis de préciser leur manière d’aborder les
personnages. Olivier Cadiot n’y est pour rien, mais je trouvais naturel qu’ils évoquent
la crise migratoire et les réfugiés syriens. On a aussi conservé la scène où Valérie
Dreville s’était amusée à lire un passage de Plateforme de Michel Houellebecq…

Pouvez-vous nous parler de la scénographie de Jan Pappelbaum ?
Il est très simple et s’inspire de ce que dit Treplev : “C’est ça mon théâtre. Pas de
décor, le regard à l’infini sur le lac.” Alors, il n’y a pas grand-chose à part ce petit
plateau en bois où la pièce de Treplev est jouée au début et sur lequel toutes les autres
scènes de La Mouette se déroulent. J’aime beaucoup l’idée que c’est un plateau de
théâtre et qu’il le reste pendant la totalité du spectacle. Et puis, il y a une peintre sur
scène, Katharina Zemke, qui peint un paysage pendant toute la durée de la
représentation.
La play-list du spectacle est impressionnante, avec près de vingt morceaux
des années 70. C’est très “peace and love” et gros pétard…
Oui, mais pas seulement ! Il y a aussi le dernier disque de Sufjean Stevens, paru l’an
dernier. C’est le plus grand de notre époque ! Mais c’est vrai que pour moi, Tchekhov
est un auteur mélancolique et laconique, ce qu’on ne retrouve pas facilement dans le
punk! J’ai l’impression que la mélancolie des Doors a beaucoup à voir avec Tchekhov,
cette tristesse, ce “sehnsucht”, un mot allemand difficilement traduisible qui signifie
quelque chose entre le désir et la passion. On retrouve tout cela dans les balades des
grands héros du rock des années 70 : le Velvet Underground, les Doors, David Bowie,
Jimi Hendrix. Et puis, j’aime bien que ce canon de la littérature qu’est Tchekhov
appartienne à notre génération et je refuse de faire de différence entre l’art du rock’n’roll et
celui de l’écriture de Tchekhov.
C’est aussi l’idée d’une contre-culture ?
Tout à fait. Puisqu’on n’a pas l’esprit révolutionnaire, il ne nous reste que la musique.
C’est comme la méthadone qui remplace l’héroïne. Le rock remplace la révolution.
Comme dans Hamlet de Shakespeare que tu as déjà monté, La Mouette parle
des rapports entre un fils et sa mère. Comment l’as-tu abordé ?
Effectivement, c’est un conflit générationnel et je sais que Tchekhov qui avait vu, enfant,
une représentation d’Hamlet, était fasciné par Shakespeare. D’ailleurs, La Mouette en
est une sorte de variation, sauf que dans Hamlet, à la fin, ils sont tous morts. Dans La
Mouette, seul le fils meurt et les parents continuent de vivre. C’est beaucoup plus
déprimant. Je préfèrerais qu’ils soient tous morts ! (rires) Il y a un très beau livre de
l’auteur dramatique et poète Thomas Brach, Les fils meurent avant les pères. C’est le
signe d’une société décadente et mourante. La Mouette raconte cela aussi, mais
Tchekhov ne juge ni n’accuse personne et ne nous culpabilise pas non plus. Car ce n’est
pas seulement la faute de la génération parentale. Il faut aussi se demander si ce n’est
pas celle de Treplev. N’est-il pas trop faible, trop lâche ? La pièce parle aussi de la
faiblesse de la génération des fils et des filles d’aujourd’hui, un constat que je fais
également concernant le théâtre et ma génération. Même si les grands metteurs en
scène d’hier sont morts, les Peter Zadek, Claus Peymann et Peter Stein sont encore là.
Et quand ils ont commencé à faire du théâtre, la société était en révolte et en train de
changer, c’était Mai 68. Mais on vit une autre époque et si la scène théâtrale actuelle ne
bouge pas, c’est parce qu’on reflète la société. On est le miroir de l’époque.
1
/
2
100%