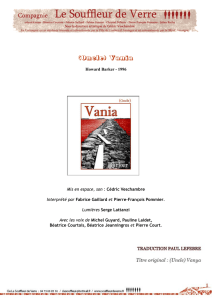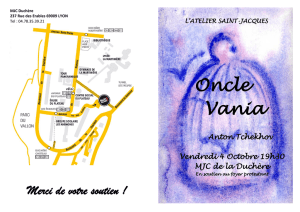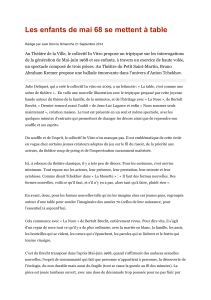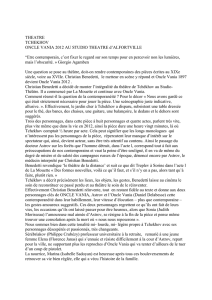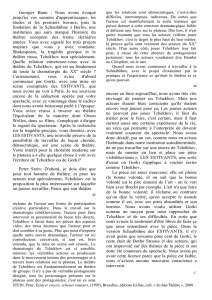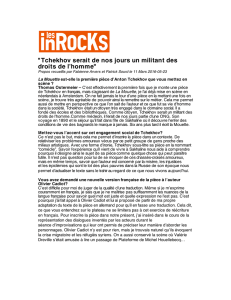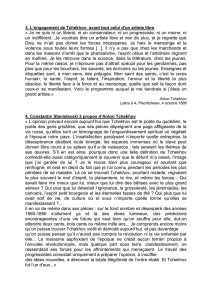Etang miroitant de la stagnation et de l`espérance - Fi

ABRAHAM, Pierre, « Etang miroitant de la stagnation et de l’espérance » in Europe, n°104-105, Paris, Les
Éditeurs Français Réunis, 1954.
Etang miroitant de la stagnation et de l’espérance
Aux Pitoëff nous devons d’avoir vu représenter les pièces de Tchekhov. A Elsa Triolet nous devons
de pouvoir, pour la première fois, les lire dans une langue qui respecte le mouvement scénique en
même temps que les nuances des caractères, et qui leur joint les commentaires indispensables de
Stanislavski, de Gorki, d’Ermilov, de Tchekhov et de la traductrice.
La Mouette & Ludmilla Pitoëff.
« […] Un Maupassant qui aurait l’accent anglais et qui écrirait en russe. » p.143
Il n’y a pas d’intrigue dans les pièces de Tchékhov. Et pourtant elles avancent, d’un pas
inexorable, vers un dénouement. De l’action, pas d’intrigue : telle est la caractéristique, en
apparence paradoxale, de son théâtre.
C’est que l’action est intérieure à chacun des personnages. Contrairement à la tradition de la
scène française, qui place les personnages sur les cases d’une gigantesque partie d’échecs que le
spectateur est chargé d’arbitrer, et où l’intrigue, clairement définie, est en quelque sorte
extérieure à chaque personnage dont le caractère va réagir différemment sous la pression,
l’action du théâtre de Tchekhov naît, sans contrainte extérieure, du simple frottement des
caractères. Frottement, c’est déjà trop dire. Juxtaposition suffirait. p.143
Oncle Vania
[…] Auprès du beau-frère (l’oncle Vania), un médecin de campagne (Astrov) partage les mêmes
sentiments de mépris envers Serebriakov. Non seulement cela, mais ils sont tous les deux amoureux de
la seconde femme du professeur. Et cela ne suffit pas encore : ils (p.143)
sont l’un et l’autre conscients du marasme général où croupit la russie ; ils sont l’un et l’autre
passionnément tendu vers quelque chose de neuf, qu’ils pressentent sans pouvoir le nommer ni même
le connaître.
Un dramaturge français, s’apercevant de cette « doublette », aurait sans doute sacrifié l’un ou l’autre.
Chez Tchekhov, leur double existence sur la scène fournit les échanges de répliques les plus profonds,
ceux qui vont toucher le plus intimement le spectateur. Comme si entre ces deux hommes aux opinions
semblables et aux tempéraments distincts (l’un pleure, l’autre siffle, explique Tchekhov) le dialogue
donnait lieu à ce que les opticiens appellent des interférences, les acousticiens des battements, bref des
phénomènes dus à la confrontation de longueurs d’onde très voisines, qui naissent de ce voisinage
même et vont frapper l’œil ou l’oreille de l’observateur plus fort que l’une ou l’autre des longueurs
d’onde individuelles.
L’un d’eux - le docteur Astrov - défend la forêt russe contre la hache aveugle des bûcherons et plante
des jeunes arbres : « Je devins conscient du fait que le climat aussi est un peu entre mes mains et que
si, dans mille ans, l’homme doit être heureux, cela sera un peu de ma faute à moi aussi. » Ailleurs il
dit : « Ceux qui vivront dans cent ans, dans deux cents ans après nous, et pour qui nous frayons
maintenant le chemin, auront-ils seulement une bonne pensée pour nous ? »
L’autre - l’oncle Vania - ironise : « J’étais un être de lumière… Je n’imagine pas de plaisanterie
venimeuse ! J’ai maintenant quarante sept ans. Jusqu’à l’année dernière j’essayais tout comme vous
(c’est sa mère, la vieille Maria Vassilievna, qui lit des brochures, et encore des brochures) de me
brouiller la vue avec votre scolastique pour éviter de voir la vie telle qu’elle est, et je croyais bien
faire. Et maintenant, si vous saviez ! Je ne dors pas la nuit, de colère, de rage, d’avoir si bêtement
gâché le temps où je pouvais avoit tout ce qu’aujourd’hui me refuse ma vieillesse ! » p.144

Les Trois Soeurs
La Cerisaie
Paru en 1897, ce n’est qu’en 1899 que L’Oncle Vania a été joué au Théâtre d’Art. Et c’est deux ans
plus tard, en 1901, que ce même théâtre jouait Les Trois Sœurs. Tchekhov croyait mordicus avoir écrit
une comédie, et même une farce. De même pour La Cerisaie, créée au Théâtre d’Art en 1904, l’année
de sa mort. Convaincu du véritable caractère de sa pièce, il consentait à baptiser drame Les Trois
sœurs, mais maintenait comédie pour La Cerisaie.
[…]
Devant ces destins de fin d’un monde - et, dans La Cerisaie, cette cerisaie merveilleuse, que doivent
vendre les propriétaires pour payer leurs dettes criardes - on pourrait être tenté de chercher le méchant,
le traître, le personnage méphistophélique qui est cause de cette cascade de malheurs. Or, dans le
théâtre de Tchekhov, il n’y a pas de traître, il n’y a pas de méchant. Il n’y a pas de cause individualisée
à la catastrophe, à l’injustice. Et même il n’y a pas d’injustice.
Le moujik enrichi qui se rend acquéreur de La Cerisaie, qui en fait abattre à la hache les cerisiers
fameux au moment où la famille des propriétaires ancestraux doit évacuer le domaine, ce moujik lui-
même est un brave homme, qui essaye, à sa manière, de se montrer serviable et bon. Il n’y a rien, dans
le théâtre de Tchékhov, que l’on puisse rapprocher de la verve acide de Jules Renard, d’Emile Augier
ou du Mirbeau des Affaires sont les affaires. Ce n’est en aucune façon comme l’est plus ou moins la
comédie française depuis Corneille, Molière et Beaumarchais, un théâtre polémique.
Dans le théâtre français, on peut souvent nommer l’accusé, ses témoins, son avocat, ses accusateurs,
son procureur : le tribunal, c’est la salle. Ainsi du « faux » dévot dans Tartuffe, ainsi des privilèges de
la noblesse dans Le Mariage de Figaro, ainsi des ministres concussionnaires dans Ruy Blas, ainsi du
dialogue entre Créon et Antigone dans les innombrables succédanés de la tragédie grecque, ainsi de
bien des comédies modernes que p.145
la tradition cartésienne transforme en débats dont le verdict doit être rendu par le public.
Rien de tel chez Tchekhov. On ne nous y propose pas un conflit entre le « bien » et le « mal »,
entre le « devoir » et l’ « amour », entre « l’art » et la richesse », que sais-je encore. On ne nous y
propose aucun conflit nommable. On nous y dépeint une famille russe vivant dans telles ou telles
conditions. Et les choses sont telles que notre verdict, à nous public, est que ces conditions
doivent cesser.
Le conflit, pour n’être pas matérialisé et personnifié sur la scène, existe donc bien. C’est en
réalité le conflit entre, d’un côté tous ces êtres vivants, ou du moins qui voudraient vivre
pleinement, se réaliser, se supporter eux-mêmes, être heureux, et d’un autre côté les conditions
de la société russe qui, au temps de Tchékhov, ne permettaient rien de semblable. Pour ne pas être
nommé sur la scène, le conflit n’en existe pas moins, et le spectateur le retrouvait en sortant, dès le
péristyle du théâtre.
C’est peut-être pourquoi le théâtre de Tchékhov reste pour nous si virulent. Le spectateur français,
en sortant de la salle, ne peut pas encore se dire, comme le spectateur soviétique : « Tout cela c’est du
passé. » Alors, comme il faut bien, n’est-ce pas, se débarrasser des poids encombrants, il se borne à
dire : « Comme c’est russe ! » trichant avec lui-même et tâchant d’esquiver une question trop directe
par une sorte de tangente géographique.
La virulence de ce théâtre, elle est encore d’une autre sorte, spécialement pour les intellectuels, plus
spécifiquement encore pour les écrivains. J’ai dit que Tchekhov ne se privait pas, dans La Mouette, de
transposer dans le personnage de Trigorine une certaine aigreur - disons, plus modérément, une
certaine inquiétude - personnelle. Même inquiétude dans la peinture du jeune poète raté Treplev,
moderne Chatterton. Et, dans L’Oncle Vania, l’égoïsme satisfait du vieux critique chargé d’honneurs
Serebriakov n’est pas sans parenté avec les précédents, ce qui fait songer à une lignée de personnages
homologues au long de son théâtre.
La Mouette p.146
C’est

C’est qu’il y a, chez Tchekhov, quelque chose non pas de venimeux, mais de vénéneux. Il ne
fait pas exprès de secréter des substances toxiques, cependant elles sont là. Si elles sont là, ce
n’est pas qu’il les fabrique : il les transmet. Elles existent dans la vie de son temps, et par
conséquent dans les pièces qui la traduisent devant le public. A la façon dont un arbre puise la
sève dans un terreau malsain, Tchekhov porte des fruits amers.
Rien de plus significatif que l’étonnement de Tchekhov quand on lui écrit qu’on a pleuré en écoutant
une de ses pièces. Il s’indigne, il tempête qu’il a fait une pièce gaie, qu’on aurait dû rire, qu’il a
été trahi par l’interprétation… Cet homme parfaitement conscient de son art, et des moindres
détails du dialogue qu’il met dans la bouche de ses personnages, est finalement inconscient de
l’effet que la pièce doit avoir sur le spectateur. Il écrit une comédie : il accouche d’un drame.
Comme une femme enceinte qui rêve d’une fille et qui met au monde un garçon. C’est que le
germe vient de loin, sur quoi il n’a pas de prise : des tréfonds de la société lui arrivent les êtres et
les situations qu’il s’imagine pouvoir traiter en comiques, tourner en ridicules, mais qui lui
résistent de toute leur réalité vivante, et qui le traversent pour ressortir, enrichis de son génie
mais intacts dans leur comportement naturel, en personnages tragiques.
A regarder son visage, vingt fois reproduit dans ce numéro d’Europe, à scruter son regard derrière le
binocle, au-dessus de la barbiche, on finit par déceler une parenté, qui n’est pas seulement d’époque,
avec le visage de Zola. Même attention scrupuleuse au spectacle du monde, même souci de le traduire
avec une véracité totale, même conscience de travailleur honnête : livrer au client l’objet fini, poli,
huilé, prêt à l’usage. Peut-être un brin de lourdeur scientifique chez Zola, peut-être un brin de
causticité ironique chez Tchekhov. Si je pense à Zola en parlant de Tchékhov, c’est d’abord parce que
les images m’y forcent. C’est aussi parce que Tchekhov me permet de comprendre pourquoi les
générations bourgeoises ont rechigné devant les romans de zola.
Si elles ont fait - et continuent à faire - la moue, ce n’est pas tant à cause de la crudité du langage ou
des mœurs. Dieu sait que, depuis cinquante ans, le roman français, précédé par le roman décadent en
provenance des Etats-Unis, a fait du chemin dans cette voie ! C’est parce que les parents craignent
pour leurs enfants la confrontation avec certains personnages ou certaines situations des romans de
Zola. p.147
[…] c’est que les deux écrivains, malaxant la matière première qu’offrait la société de leur époque,
ont parallèlement abouti à des œuvres où cette société s’étale avec ses tares, ses sursauts de bonne
volonté, les efforts touchants des uns, maladroits des autres, inutiles de tous, pour aboutir finalement à
la constatation de l’échec.
L’échec, c’est le mot clef du théâtre de Tchekhov. Encore une fois, ce n’est pas lui qui en est
clairement, volontairement responsable. Je ne crois pas qu’il soit jamais parti dans la
composition d’une pièce avec l’intention de démontrer un échec. Ce sont les personnages qui
comptaient pour lui, l’affection tendre et quelque peu ironique qu’il nourrissait pour eux, le
désir de les voir se mouvoir et parler dans leur cadre. Pas du tout une démonstration rationnelle
préfabriquée de leur destin.
Si donc il aboutit à l’échec, c’est que, malgré sa tendresse, il ne peut incliner leur devenir. C’est que
les conditions ne permettent pas qu’il en aille autrement. C’est que l’échec est au bout de leur course à
tous, comme elle est au bout de la société bourgeoise dont ils font partie.
Le théâtre de Tchékhov est l’impérissable leçon historique que la bourgeoisie russe a léguée au
peuple soviétique. Disons plus brièvement, et tout aussi justement : la leçon d’histoire que la
bourgeoisie lègue au peuple. *
**
réflexions sur ces pièces […] point de départ d’une ère nouvelle pour le théâtre p.148
1
/
3
100%