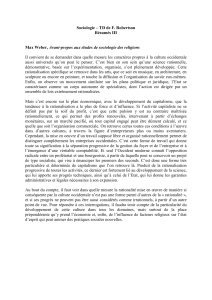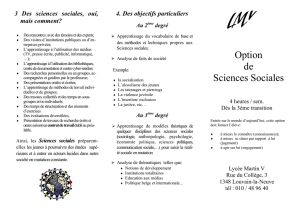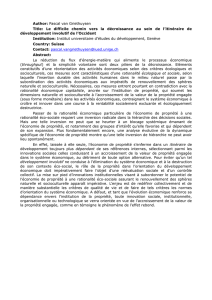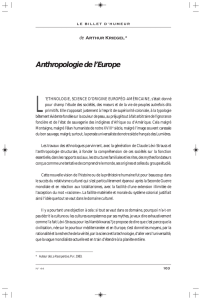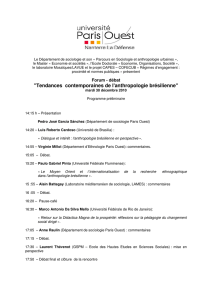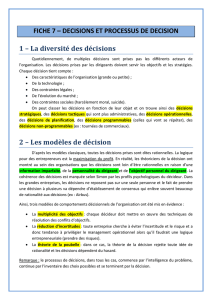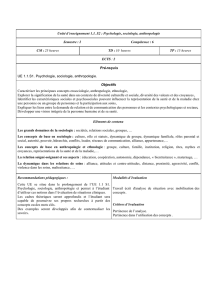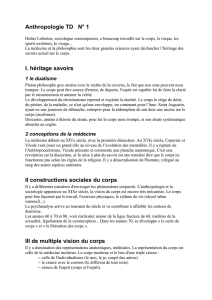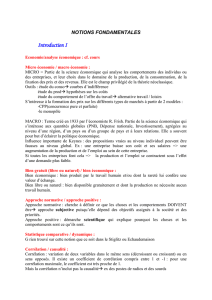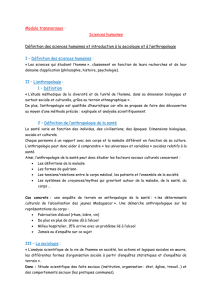table des matieres

Anthropologie et sociologie et générale
Enseignant : Madame NIKIEMA Rose
1
TABLE DES MATIERES
Durée:.........................................................................................................................................2
Objectifs spécifiques..................................................................................................................2
1. L’échange...............................................................................................................................2
1.1 Définition et types divers de l’échange............................................................................2
1.2 Les théories de l’échange en anthropologie.....................................................................3
2. La rationalité ..........................................................................................................................7
2.1 Définition et types de rationalité......................................................................................7
2.2 Les théories sociales de la rationalité- irrationalité..........................................................8
3. Les besoins.............................................................................................................................9
3.1 Définition et types de besoins ..........................................................................................9
3.2 Le caractère social du besoin .........................................................................................10

Anthropologie et sociologie et générale
Enseignant : Madame NIKIEMA Rose
2
Chapitre IV. L’apport de l’anthropologique à l’économie classique
Durée:
2 jours
Objectifs spécifiques
À l'issue de ce chapitre, les compétences acquises vous permettront de :
• Connaître les théories sociales portant sur des concepts étudiés par l’économie
classique;
• comprendre que l’éventail des choix d’un individu rationnel et maximisateur pour
les faits économiques est limité par les systèmes de valeurs du contexte
socioculturel.
1. L’échange
1.1 Définition et types divers de l’échange
Au sens général, le terme échange s’applique à tout mouvement d’intention
réciproque entre deux parties. En économie, on appelle échange les différents
modes de transferts de biens et de services exécutés en contrepartie et en
équivalence les uns aux autres : Claude Meillassoux, 1999 :141
La théorie économique tend à circonscrire l’échange à sa valeur variante
marchande qui se réalise sur le marché avec la monnaie. Or, cette variante de
l’échange est apparue il y a seulement 30 ou 40 siècles avec l’émergence des villes
en Asie et au Proche Orient. Par contre la réciprocité (don- contre don) qui est la
forme universellement répandue de l’échange est selon Claude Lévi-Strauss aussi
vieille que l’humanité dans la mesure où elle symbolise le passage de l’état de nature
à l’état de société. Il démontre en effet à travers le tabou de l’inceste que l’échange
est le lien social primordial. Le tabou de l’inceste devient échange en ce sens qu’il
m’oblige, en me refusant ma sœur, de l’offrir à un autre pour obtenir mon épouse.
L’échange, dans sa forme universelle, n’est pas réductible à sa seule variante
marchande c'est-à-dire limitée aux seuls objets matériels.
En effet, on échange d’abord et avant tout des paroles, par exemple les
salutations qui sont constituées de plusieurs répliques rapides et mécaniques sans

Anthropologie et sociologie et générale
Enseignant : Madame NIKIEMA Rose
3
rapport avec la situation réelle des personnes qui se saluent. On échange également
des personnes (les femmes), des droits sur tout et partie des personnes (prostitution,
placement des enfants, etc.). On échange aussi des coups, les guerres, les conflits
armés ou les vendettas se déclenchent toujours entre les groupes voisins qui sont
donc impliqués dans d’autres types d’échange, situation que l’on peut illustrer par les
propos de Nuer rapportés par Evans Pritchard «nous nous battons avec ceux avec
qui nous nous marrions». En d’autres termes, on ne se bat pas contre quelqu’un
qu’on ne connaît pas, avec qui on n’entretient pas un minimum de relations sociales.
Enfin, on échange des objets matériels parmi lesquels se rencontrent les
marchandises. «Une marchandise est socialement et culturellement définie comme
telle par un processus qui la soustrait à son producteur et au contexte dans lequel
elle se trouve, la dépersonnalisé et lui confère une valeur marchande». Laburthe-
Tolra et Warner, 1997 : 308. Par exemple : l’esclave est une personne qui devient
une marchandise après avoir été arraché à sa famille, changé d’identité et vendu sur
un marché comme n’importe quelle marchandise.
Pour Claude Meillassoux (1999 : 142-143), l’échange a revêtu plusieurs formes,
notamment :
- le partage dans les sociétés égalitaires (chasseurs collecteurs);
- la prestation, redistribution ou don dans les sociétés agricoles où les biens
circulent soit le long des réseaux de parenté, soit vers une autorité
(prestation) soit de l’autorité vers le bas (redistribution). Dans ce contexte,
les biens ne possèdent qu’une
- rapport avec leur origine. Ainsi par exemple, la part de récolte donnée au
chef exprime des rapports de subordination; entre les paires, l’échange
peut exprimer l’alliance lorsqu’il est réciproque, ou un défi.
- Enfin l’acceptation actuelle de l’échange qui apparaît entre des économies
complémentaires ou lors des contacts avec les représentants de
l’économie marchande et dont le terme est l’institution du marché.
En fonction de la forme, l’échange a revêtu des modalités différentes dont la
première historiquement connue est le troc. Lorsqu’une marchandise s’impose
comme l’équivalent de toutes les autres marchandises, elle acquiert une valeur de
monnaie; son apparition coïncide avec celle du commerce (il y a 30 ou 40 siècles)
La monnaie
La monnaie est un instrument qui facilite les échanges en remplissant trois
fonctions principales :
- la fonction d’intermédiaire des échanges : la monnaie permet de fractionner
l’échange en deux temps (bien contre monnaie puis monnaie contre bien), elle
est acceptée par tous les membres d’un groupe en échange de tous les autres
produits;
- la fonction d’unité de compte : tous les prix sont exprimés sous la forme
d’une quantité de monnaie;
- la fonction de réserve des valeurs : la monnaie peut donc être conservée
avant d’être échangée contre un autre produit (sans perte de valeur dans
l’hypothèse d’une inflation nulle).

Anthropologie et sociologie et générale
Enseignant : Madame NIKIEMA Rose
4
Beitoine et alls : Dictionnaire des sciences économiques, Armand Colin,
1991, p211.
1.2 Les théories de l’échange en anthropologie.
La notion de l’échange a été théorisée à partir de celle du don par Marcel Mauss
(«essai sur le don. Forme et raison de l’échange dans les sociétés archaïques» in
année sociologique, seconde série 1923-1924 T1)
Par principe, un cadeau n’est pas obligatoire; pourtant dans l’existence de
tous les jours (en campagne comme en ville), on se sent souvent dans
l’obligation de faire des «gestes» sous peine d’être indexé et traité comme avare
et égoïste. Un cadeau ne doit normalement pas être «remboursé», pourtant
celui qui reçoit et qui ne donne jamais en retour sera vite indexé et
progressivement exclu. Tel est le paradoxe du don.
Le don est pratiqué dans toutes les sociétés humaines. Il a un caractère
ambivalent dans la mesure où il est à la fois volontaire et obligatoire. En effet, toutes
les sociétés contraignent leurs membres à pratiquer l’échange. Ainsi, autant il existe
une obligation de donner, autant il pèse sur le bénéficiaire l’obligation d’accepter le
don et de le rendre.
C’est Mauss qui le premier s’intéresse à la question du don. S’appuyant sur les
travaux de Boas sur le potlatch, de Malinowski sur la kula, mais plus largement sur
les matériaux anthropologiques disponible à son époque concernant divers exemples
mélanésiens ou polynésiens, il découvrira, derrière des pratiques de générosité
apparente, un cadre sinon un carcan d’obligations sociales. En réalité Mauss
s’intéresse davantage au contre don qu’au don lui-même. La question qui sous-tend
tout son programme de recherche est la suivante : «Quelle force y a-t-il dans la
chose qu’om donne qui fait que le donataire la rend?
Pour rendre compte à la fois du caractère volontaire et obligatoire du don,
Mauss utilise une théorie Maori selon laquelle toute chose donnée possède un hau
(l’esprit du propriétaire de la chose) qui oblige à rendre tout cadeau sous peine de
malheur. Mais la théorie du hau n’explique que l’obligation de rendre et non celle de
donner et de recevoir. Selon Mauss, ces deux obligations sont à rapporter à
l’honneur, à la recherche du prestige et à la rivalité. Le don peut être interprété
comme un défi qui permet aux protagonistes d’exprimer leur supériorité en se
montrant plus généreux. C’est ce qu’illustre le potlatch dans la mesure où l’objectif de
chaque protagoniste est d’aplatir son rival. Les différents protagonistes sont engagés

Anthropologie et sociologie et générale
Enseignant : Madame NIKIEMA Rose
5
dans une bataille où l’on se bombarde de cadeaux et non de flèches et de
tomahawk. A cette occasion, même les biens les plus essentiels tels que les
couvertures, les vêtements, les maisons, sont détruits. La philosophie du potlatch
montre que, ce qui importe chez les Indiens, ce n’est pas tant la possession des
objets que l’établissement d’un certain type de relation sociale qui en l’occurrence
permet de hiérarchiser les protagonistes. Il ne s’agit donc pas de faire des échanges
économiques juteux mais d’établir un rapport de force.
Qu’il s’agisse des échanges entre groupes ou entre individus à l’intérieur d’un
même groupe, il s’agit toujours d’établir une hiérarchie entre les personnes
impliquées, de confirmer ou de redéfinir des statuts politiques et sociaux. C’est ce qui
explique que traditionnellement dans les sociétés archaïques, les privilèges
économiques du chef n’étaient pas destinés à être accumulés mais plutôt à être
redistribués pour raffermir son pouvoir.
Outre l’idée de défi et de prestige, l’obligation de donner a aussi un fondement
moral, voire religieux. En effet, la distribution des richesses ou d’une partie de celles-
ci aux nécessiteux joue le rôle d’amande ou de repentance (la recherche du salut de
l’âme après la mort).
Le code de l’honneur et le code moral qui régissent le don imposent aux
individus ou aux groupes de sacrifier leurs intérêts personnels pour parfaire l’image
qu’ils veulent se donner d’eux. C’est pourquoi «sur le plan sociologique, il va de soi
que les intérêts économiques sont plus facilement sacrifiés dans des sociétés où, en
l’absence de progrès techniques, les surplus ne peuvent être investis, de sorte que
l’usage le plus rationnel de la richesse est de le convertir soit en pouvoir politique,
soit en «bonnes actions» Pottier Richard, 1989 : 7)
Ce qui ressort de l’analyse de l’échange, c’est qu’il est au fondement de la vie
sociale. En effet, les objets échangés n’ont de valeur que parce qu’ils sont désirés ou
valorisés par autrui. Dans cette perspective, en réalité ce qui est valorisé n’est pas
l’objet lui-même, mais le type de relation avec autrui qu’il autorise. Par conséquent, la
présence de l’autre, même s’il peut être potentiellement un rival, est nécessaire dans
la mesure où pour organiser une hiérarchie, il faut être au moins deux.
Le don comme investissement stratégique
Selon Alain Marie (98/99), l’échange de dons met en jeu une logique de la dette dans
la mesure où les dons et les contre-dons s’enchaînent comme le crédit et son
remboursement ou comme le placement et son rapport.
Alain Marie commence par contester d’abord la thèse de Mauss selon laquelle c’est
le han, (c’est la force magique ou religieuse) qui justifie l’obligation de rendre, c’est
au contraire la nécessité inconsciente de l’échange qui en est le fondement. Par
conséquent, c’est la fonction de l’échange qui justifie l’obligation de rendre. Il
s’inspire ensuite de la critique de Bourdieu (1994) qui a reproché à Mauss et à Levi-
Strauss d’avoir négligé la dimension temporelle entre le don et le contre-don.
Or en prenant en considération cet intervalle-temps, l’on peut poser « le don initial
comme prise de créance, comme endettement d’autrui, donc comme investissement
social destiné à rapporter à terme, la dette comme mode de fonctionnement ordinaire
(pas seulement cérémonial)de la vie sociale » Alain Marie 1998/1999 :30
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
1
/
12
100%