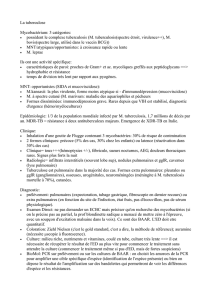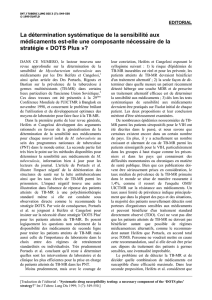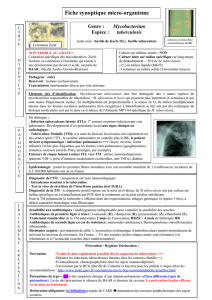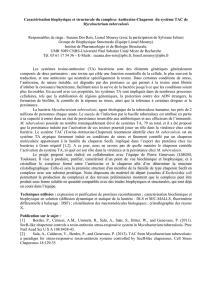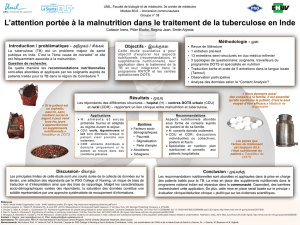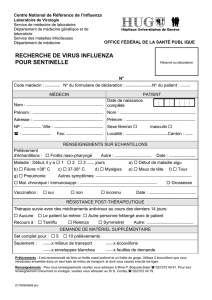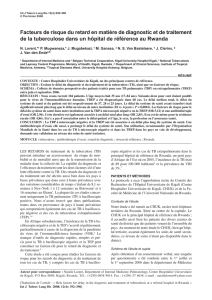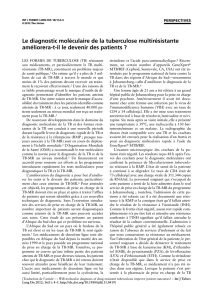Que reste-t-il de vrai du modèle de Styblo 20 ans plus tard ?

INT J TUBERC LUNG DIS 13(6):672–690
© 2009 The Union ETAT DE LA QUESTION
SERIE ETAT DE LA QUESTION
Tuberculose
Edité par I. D. Rusen
NUMERO 8 DE LA SERIE
Que reste-t-il de vrai du modèle de Styblo 20 ans plus tard ?
T. Arnadottir
Reykjavik, Iceland
Auteur pour correspondance : Thuridur Arnadottir, Hvassaleiti 30, Reykjavik 103, Iceland. Tel : (+354) 553 1086. e-mail :
Le modèle de Styblo est le résultat de collaborations internationales visant à l’expansion des programmes nationaux de
tuberculose (TB) dans les pays partenaires. Ce modèle est à la base de la stratégie DOTS lancée dans les années 1990
et est devenue une stratégie mondiale. Cet article s’adresse à l’impact et à la signi cation de cet ensemble de travail.
Les principes de base soutenant le modèle sont toujours valables. Il existe une tendance à vouloir inclure l’en-
semble des étapes lorsque l’on élabore des stratégies mondiales. Par voie de conséquence, la complexité s’accroît.
Alors qu’il est relativement facile de standardiser le diagnostic et la surveillance, il n’en est pas de même pour les soins
et le traitement des patients où, comme les expériences récentes des programmes TB le montrent, des recommandations
universelles peuvent être mises en question. Il peut ne pas être sage de mettre en avant des stratégies mondiales
lor sque le terrain est aussi varié qu’il ne l’est dans différentes parties du monde.
Depuis la conception de ce modèle, la pandémie du virus de l’immunodé cience humaine (VIH) est devenue de
plus en plus forte en Afrique. Par voie de conséquence, les efforts de lutte contre la TB sur ce continent ont été grave-
ment minés. La valeur du modèle dans ce contexte est remise en question. Alors que l’infection VIH a contribué à des
mini-épidémies de TB résistantes aux médicaments, en même temps elle a facilité le contrôle de mini-épidémies de TB
à germes multirésistants (MDR) ou ultrarésistants (XDR). Lorsque la multirésistance a atteint des proportions cri-
tiques en l’absence de VIH, elle s’est avérée dif cile à contrôler. L’évolution technologique n’a pas répondu à la néces-
sité de nouveaux outils. Alors que beaucoup d’analystes de la stratégie sont d’accord sur la nécessité d’une révision de
cette stratégie, des ouvertures convaincantes doivent encore se manifester.
MOTS-CLES : tuberculose ; maîtrise ; politique ; stratégie ; DOTS
EN 1959, L’Union Internationale Contre la Tubercu-
lose (L’Union)—par le canal de l’Organisation Mon-
diale de la Santé (OMS)—a déposé une résolution à
l’Assemblée Mondiale de la Santé (WHA) mettant en
tête des priorités l’élimination de la tuberculose (TB)
au niveau mondial. On peut argumenter que ce fut le
[Traduction de l’article : « The Styblo model 20 years later—what holds true ? » Int J Tuberc Lung Dis 2009; 13 (6):
672–690]
RÉSUMÉ
commencement de la lutte antituberculeuse dans les
pays en développement.1 Vingt ans après, en 1979,
un article du New England Journal of Medicine a
suggéré qu’en raison du fait que la TB et la lèpre exi-
geaient des traitements pendant plusieurs années et
des périodes de suivi encore plus longues pour garantir la
guérison, on pourrait mieux faire face à la TB par un
investissement dans une recherche visant à trouver
des moyens moins coûteux et plus ef cients de pré-
vention et de traitement plutôt que d’exécuter immé-
diatement sur une large échelle des programmes de
traitement.2 On a recommandé des soins de santé pri-
maires sélectifs dans les zones où les ressources étaient
limitées. Le traitement de la TB n’y a pas été inclus.
A la n des années 1970, L’Union a commencé
des activités de collaboration avec les gouvernements
de plusieurs pays en développement. L’initiative a com-
mencé en Tanzanie, à la suite d’une réunion de la
Région Afrique de L’Union en 1976, où les participants
ont souligné le fait que l’assistance aux pays devait
Les articles précédents de cette série Éditorial: Rusen I D. Tuber-
culosis State of the Art series. Int J Tuberc Lung Dis 2008; 12(11):
1223. No. 1: Davies P D O, Pai M. The diagnosis and misdiagnosis
of tuberculosis. Int J Tuberc Lung Dis 2008; 12(11): 1226–1234.
No. 2: Landry J, Menzies D. Preventive chemotherapy. Where has
it got us? Where to go next? Int J Tuberc Lung Dis 2008; 12(12):
1352–1364. No. 3: Harries A D, Zachariah R, Lawn S D. Providing
HIV care for co-infected tuberculosis patients: a perspective from
sub-Saharan Africa. Int J Tuberc Lung Dis 2009; 13(1): 6–16. No. 4:
Crampin A C, Glynn J R, Fine P E M. What has Karonga taught us?
Tuberculosis studied over three decades. Int J Tuberc Lung Dis
2009; 13(2): 153–164. No. 5: Korenromp E L, Bierrenbach A L, Wil-
liams B G, Dye C. The measurement and estimation of tuberculosis
mortality. Int J Tuberc Lung Dis 2009; 13(3): 283–303. No. 6: Frieden
T R. Lessons from tuberculosis control for public health. Int J Tuberc
Lung Dis 2009; 13(4): 421–428. No. 7: Chaisson R E, Harrington M.
How research can help control tuberculosis. Int J Tuberc Lung Dis
2009; 13(5): 558–568.

2 The International Journal of Tuberculosis and Lung Disease
re éter les besoins locaux. Lors de cette réunion, plu-
sieurs problèmes ont été soulevés, notamment la né-
cessité de disposer dans chaque pays d’un programme
moderne de TB, la nécessité d’une formation du per-
sonnel de santé et de l’obtention de prix réduits pour
les médicaments.3 La requête issue de Tanzanie était
que L’Union devait conseiller l’intégration des ser-
vices de santé de nombreux organes caritatifs dans
un réseau national de lutte contre la TB et la lèpre.
Ceci fut le point de départ d’une collaboration inter-
nationale menée par Annik Rouillon et Karel Styblo, à
l’époque respectivement Directeur Exécutif et Direc-
teur des Activités Scienti ques de L’Union.
Lorsque la TB est réapparue dans l’agenda inter-
national de la santé, on a reconnu que l’approche uti-
lisée dans les programmes de collaboration corre-
spondait à des interventions de santé dont le rapport
coût-ef cacité était le meilleur dans les pays à faibles
revenus, et en 1989, l’OMS a demandé son avis à Sty-
blo. Le modèle créé dans les programmes de collabo-
ration est devenu la base de la nouvelle stratégie de
lutte de l’OMS. En 1991, l’Assemblée Mondiale de la
Santé a adopté les cibles mondiales pour la lutte
contre la TB et le projet de la Banque Mondiale a été
mis en route en Chine ;4 au travers de celui-ci, l’OMS
avec Styblo lui-même, s’est mise a tester cette nouvelle
stratégie. Des projets ont été rapidement introduits
dans un certain nombre d’autres pays et, en 1994,
l’OMS, a lancé formellement sa stratégie DOTS. Bien
que cette stratégie ait depuis lors été introduite avec
succès dans de nombreux pays, on discute toujours
de l’adéquation du modèle dans les zones à haute pré-
valence d’infection par le virus de l’immuno-dé cience
humaine (VIH) et dans les programmes où existent des
niveaux élevés de résistance médicamenteuse.
Le modèle de Styblo comporte plusieurs strates.1
La première est l’approche globale de la lutte anti-
tuberculeuse : prise en charge des cas plutôt que traite-
ment préventif, vaccination ou d’autres approches. Il
comprend en outre les principes de base, les stratégies
de prise en charge des cas et les systèmes de soutien
opérationnel. Une dimension complémentaire du mo-
dèle est le contexte plus large dont il est issu. Finale-
ment, ce modèle constitue un exemple d’utilisation
des évidences scienti ques par les décideurs de poli-
tique. Cet article fait la revue des origines, de l’impact
et de l’adéquation de ce modèle.*
LES PROGRAMMES DE COLLABORATION
DE L’UNION
La collaboration à L’Union implique la mise en œuvre
de la lutte antituberculeuse au sein des services géné-
raux de santé des pays partenaires. Les programmes
diffèrent en fonction des caractéristiques des services
locaux de santé. Le plan directeur a poussé les pays à
augmenter progressivement le nancement de leurs
consommables au fur et à mesure de l’amélioration
de leur situation économique et de la maîtrise du pro-
blème de la TB.6 Rétrospectivement, la réalisation de
ces objectifs peut avoir été dès le début une bataille
perdue d’avance : le développement économique a
été lent ; juste au moment où cette initiative décollait,
la pandémie de VIH l’a fait également, et au milieu
des années 1980, ses effets sur la situation de la TB
ont commencé à se déployer. En 1983, les premiers
cas du syndrome d’immunodé cience humaine (SIDA)
ont été signalés en Tanzanie.7 En 1986, le Programme
National TB (PNT) a signalé un nombre croissant de
décès inexpliqués.6 Une étude des années 1990 a es-
timé que deux tiers de l’accroissement des cas de TB
étaient directement en relation avec l’infection VIH.7
Toutefois, en dépit de cet accroissement, les niveaux
de résistance aux médicaments sont restés faibles. Le
Nicaragua s’est avéré un partenaire précoce, peu af-
fecté par le VIH, et c’est dans ce contexte que l’effet
attendu a été le plus clairement réalisé.8 Par compa-
raison, au Malawi—un pays fortement atteint par le
VIH—le nombre de cas de TB déclarés a augmenté de
façon dramatique. Le PNT a failli s’effondrer et le
taux de guérison a baissé malgré le combat pour faire
face au problème.9
PRINCIPES DE BASE
Les principes de base de la lutte antituberculeuse ap-
paraissent au Tableau 1.10– 42 Ces principes sont d’ap-
plication universelle et ont résisté largement au l du
temps. Les essais contrôlés randomisés sur les médi-
caments ont commencé dans le domaine de la TB et
ont constitué la base scienti que sur laquelle repose
le traitement antituberculeux. Les essais ont testé les
régimes à médicaments multiples et à dose xe ainsi
que la durée du traitement. Cette initiative et son ap-
plication ultérieure dans les PNT ont tracé la voie de
la standardisation de la pratique clinique et dès lors, le
cas échéant, le développement de directives cliniques.
Les politiques nationales de traitement contrôlé visent
à prévenir les pratiques chaotiques qui peuvent entraî-
ner une expansion de la résistance aux médicaments.
En dépit du fait qu’aujourd’hui beaucoup de pa-
tients TB recourent aux services de santé sans avoir
être identi és ou référés correctement, l’idée d’un dé-
pistage actif des cas reste tentante. En 1998, les ana-
lystes de la politique, guidés par des modèles mathé-
matiques, ont proposé la microradiographie de masse
*
La formulation de la politique dans les programmes de TB doit
prendre en compte tous les aspects de la lutte antituberculeuse. Le
modèle de politique générique créé dans les collaborations de
L’Union est cité ici comme étant le modèle de Styblo. Ce modèle a
utilisé les évidences scienti ques disponibles au moment où il a été
formulé et dès lors chevauche d’autres modèles de politique. Les
aspects opérationnels du modèle ont été décrits pour la première
fois à l’intention d’un public plus large dans un guide publié par
L’Union en 1986 (Guide de la Tuberculose dans les pays de faibles
ressources).5 Des versions mises à jour de ce guide—en 1991, 1994,
1996 et 2000—re ètent les évolutions de cette politique.

Le modèle de Styblo 3
pour accroître la détection des cas,43 en désignant la
Chine comme l’exemple d’un pays où une telle straté-
gie pourrait fonctionner.44 D’autres ont suggéré d’ex-
plorer les méthodes de dépistage actif des cas dans les
zones à haute prévalence de VIH.45 Toutefois, une en-
quête en Afrique du Sud rurale n’a révélé qu’une frac-
tion modeste de TB non diagnostiquée.46 La plupart
des cas antérieurement inconnus détectés par l’en-
quête avaient fréquenté les services de santé à un mo-
ment quelconque au cours de leur maladie, ce qui
Tableau 1 Principes de base de la lutte antituberculeuse et les fondements du modèle de Styblo
Principes Argumentation et faits établis Commentaires
Les cas à frottis positif
sont la source la plus
puissante de
contagion
Référence classique : une enquête de 1954 examinant
les taux d’infection et les cas secondaires parmi les
patients TB au sein de la famille (1954).10 Soutenue
par des études récentes dans divers contextes :
Canada 1990–2001,11 US 1996–1997,12 République
Dominicaine 2000,13 Thaïlande 2002–2003.14 Un
degré plus élevé de positivité des frottis,12–14 les
cavités sur le CXR,12,14 et l’étroitesse des contacts14
augmentent le risque d’infection.
Des études appliquant la nouvelle technologie
semblent tout au moins soutenir la politique de
ciblage des cas à frottis positifs.15,16 Comme les cas
à frottis positif sont responsables de 80% à 90% de
la contagion, de tels cas devraient être ciblés pour la
lutte contre les maladies transmissibles. Toutefois, ce
ciblage n’exclut pas nécessairement les soins à
d’autres patients TB.
Les patients TB à frottis
positif toussent et
peuvent être
identifi és dans les
services de santé
Une enquête en Inde (1963) a trouvé que 95% des
patients TB avaient des symptômes (la toux étant le
symptôme principal).17 Une étude à Hong-Kong a
trouvé que 96% des patients TB consultant dans les
polycliniques thoraciques se plaignent de toux lors
de leur premier recours à des soins médicaux.18.
Une étude récente en Ouganda (1993–1994) : 98%
des patients TB à frottis positif (dont 91% étaient
séropositifs pour le VIH) se plaignent de toux
productive. Les symptômes cliniques ne sont pas
différents chez les patients TB séropositifs ou
séronégatifs pour le VIH.19
Le dépistage des cas
devrait être basé sur
les services, c à d les
services de santé
devraient répondre
aux initiatives prises
par les patients
Enquête en Inde (1963) : les patients se plaignant de
toux persistante ont pris contact avec les services de
santé et ont pu être reconnus par un personnel de
santé non spécialisé.17 Inde, 1966 : la plupart des
sujets recourant aux soins dans une polyclinique TB
se sont présentés dans les 3 mois après le début des
symptômes, les patients résidant à la campagne
seulement un peu plus tard que les citoyens des
villes.20 Kenya 1970–1980 : appui complémentaire
pour le dépistage passif des cas.21,22 Népal 1982,23
Inde 200324 : les patients se présentant
spontanément sont plus susceptibles d’accepter et
d’adhérer au traitement que les patients recrutés par
le dépistage actif.
Inquiétudes : Dans l’étude de 1966 en Inde, les
femmes semblaient avoir une accessibilité réduite et
comme l’étude était basée sur les services, les
patients qui ne s’étaient pas présentés n’ont pas été
étudiés. Les données d’une enquête de prévalence
aux Philippines (1997) ont suggéré que les actions
entreprises en réponse aux symptômes sont
inadéquates et lentes.25 D’autre part, le statut de
frottis positif a été un des déterminants de
l’utilisation des services de santé.
La TB pulmonaire à
frottis positifs n’est
pas un événement
tardif et devrait être
détectée avant que
ne survienne une
transmission
importante
Revue des dossiers des cas à culture positive (New York
City, 1994) : le retard du patient n’est pas en
association avec le statut du frottis ou les signes
radiologiques au moment du diagnostic.26 Dans les
études récentes, le retard-patient est très court :
Thaïlande (10 jours pour les séropositifs pour le VIH
et 15 jours pour les séronégatifs atteints de TB à
frottis positifs)27 Inde du Sud (retard moyen de
20 jours).28 Pour cette raison, la TB pulmonaire à
frottis positif n’est pas nécessairement un
événement tardif.
Une étude américaine, 2000–2001 : les retards plus
longs de diagnostic sont en association avec une
transmission plus importante et en association plus
étroite lorsque le retard dépasse 90 jours.29
L’essentiel du modèle de Styblo est de garantir que
les mesures sont prises pour évaluer correctement
les patients souffrant de symptômes respiratoires.
La réponse des services
de santé doit être
constamment
améliorée
En 1970 et 1980, il était clairement évident que les
services de santé n’étaient pas suffi samment ouverts
à la détection des patients TB, c’est-à-dire qu’ils
manquent des occasions d’identifi er ceux atteints de
TB et que des retards inutiles de diagnostic existaient
après que les patients aient pris contact.21,22
Le renforcement du dépistage des cas basé sur les
services n’est pas un problème de stratégie dépassé :
Malawi (1995),30 Inde (1999–2001),24,31 Chine
(2000),32 Burkina Faso (2001),33 Pérou et Bolivie
(2003–2005).34
Les cas de TB à frottis
négatifs ne doivent
pas être négligés
Etudes en 1960–1970 : des procédures concrètes sont
nécessaires pour le diagnostic de la TB à frottis
négatifs pour réduire les diagnostics en excès.35,36 Le
diagnostic des cas à frottis négatifs n’est pas facile :
dans l’ensemble ils sont moins contagieux que les
cas à frottis positifs, et ils éliminent leurs bacilles
moins régulièrement (la confi rmation du diagnostic
peut exiger de nombreux échantillons en série).
Si l’on néglige les cas à frottis négatifs, cela peut
réduire la crédibilité d’un programme et par
conséquent la détection des cas. De tels cas
constituent typiquement la moitié de l’ensemble des
cas traités dans les programmes du modèle, ce qui
refl ète un caractère clairement de santé publique,
qui dépasse la lutte contre les maladies
transmissibles.
Polychimiothérapie La mortalité élevée de TB à frottis positifs a été
largement réduite et la transmission interrompue
grâce à l’introduction de la chimiothérapie
antituberculeuse (années 1950). Un programme
massif de recherche internationale a abouti à
l’élaboration de la CCD.
On n’a obtenu néanmoins que 50% de succès dans
les programmes de traitement de la TB dans la
plupart des pays en développement, parce que
l’organisation nécessaire semblait au-delà des
capacités de leurs systèmes de santé.
(suite )

4 The International Journal of Tuberculosis and Lung Disease
Tableau 1 (Suite )
Principes Argumentation et faits établis Commentaires
Stratégie nationale de
traitement contrôlé Comme de multiples régimes sont devenus
disponibles, une question s’est posée, celle de savoir
si le choix du régime devrait être laissé aux praticiens
individuels ou si cette stratégie devait les obliger à
prescrire certains régimes. En 1962, Crofton a
prévenu des conséquences d’une chimiothérapie
médiocre37 qui avaient déjà été notées en Inde.38
Il a encouragé un traitement effi cient du nombre
maximum de patients et la prévention de la
résistance aux médicaments par une stratégie
nationale contrôlée de traitement (par exemple
l’algorithme de traitement de Styblo).
L’organisation d’un programme national et la
standardisation du traitement en Algérie (1967) ont
été suivies d’une diminution de la résistance aux
médicaments.39 Styblo a démontré que la CCD
pouvait être mise en œuvre en toute sécurité dans
les pays en développement. Il a été plus facile de
garantir l’adhésion grâce aux régimes de CCD, le
nombre de patients sous traitement à n’importe
quel moment a été réduit et cette chimiothérapie
s’est avérée supérieure pour le traitement des cas
résistants aux médicaments.
Focalisation sur le
résultat (ne fait pas
de tort)
En 1960–1970, les programmes TB se sont préoccupés
principalement du dépistage des cas, en portant peu
d’attention à la prévention des abandons. Cette
stratégie a été basée sur un modèle mathématique
qui ne tenait pas compte de l’impact négatif d’une
chimiothérapie médiocre. L’analyse des données
observationnelles a montré à quel point les
programmes médiocres, même s’ils sauvaient des
vies, échouaient dans leur rôle de réduire le nombre
de sources de transmission dans la collectivité.40
Styblo a présenté par la suite un modèle expliquant
l’importance de la prévention des cas.
Un traitement chaotique produit des cas résistants aux
médicaments, ce qui complique le problème TB dans
la collectivité, comme démontré par les données
coréennes (années 1960).41 La Russie et l’Europe de
l’Est constituent des exemples récents de la manière
dont un traitement TB administré dans des
circonstances défavorables entraîne la résistance aux
médicaments et actuellement la multirésistance, qui
pourrait ne pas être maîtrisée par la CCD. Un
exemple vient de Moldavie à la fi n des années
1990.42
TB = tuberculose ; CXR = cliché thoracique ; VIH = virus de l’immunodéfi cience humaine ; CCD = chimiothérapie de courte durée.
plaidait en faveur d’un appel à un renforcement du
dépistage des cas basé sur les services. En Chine, on a
signalé que la faible détection des cas était partielle-
ment due au fait que le programme basé sur le DOTS
était un programme vertical. Par suite de la pression
politique dans la tempête de la grave épidémie de
syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS), la Chine a
rendu obligatoire la déclaration de la TB en 2003.47
En 2004, le Ministère de la Santé chinois a lancé au
niveau national un système de déclaration des mala-
dies transmissibles basé sur Internet. Par voie de
conséquence, les déclarations de TB ont augmenté et
la Chine a annoncé, en 2005, qu’elle avait atteint
l’objectif de détection de 70% des cas. Un dépistage
actif des cas n’était donc pas nécessaire car de fait,
l’augmentation des cas ne résultait pas du dépistage
et ce n’était pas non plus le programme DOTS qui
l’avait obtenu. On pourrait argumenter que lorsque
des services de santé sont accessibles et que les PNT
sont de qualité, un dépistage actif des cas n’est pas
nécessaire et est peu susceptible d’avoir de grands ré-
sultats alors que, par contre, lorsque ces services et
programmes n’existent pas, un dépistage actif des cas
n’est pas la priorité immédiate.
STRATÉGIES OPÉRATIONNELLES
Les décisions des PNT devraient être standardisés
autant que possible car leur mise en œuvre repose sur
un personnel relativement peu formé. On a élaboré
diverses stratégies opérationnelles en tenant compte
de ce fait. Les stratégies opérationnelles doivent tenir
compte du contexte local qui diffère entre pays et au
l du temps au sein même des pays.
Recrutement des cas de TB
Les stratégies de recrutement sont présentées au Ta-
bleau 2.1,4,5,20,31,35,48–65 Un débat au niveau de ces
stratégies concerne le nombre d’échantillons de cra-
chats par sujet suspect de TB. Toutefois, là où le rende-
ment est faible, il existe des méthodes autres que des
modi cations du nombre d’échantillons pour aug-
menter le rendement de l’examen microscopique des
crachats. Il s’agit d’améliorer l’accompagnement pré-
test, d’améliorer le recueil des crachats (la qualité des
crachats) et d’améliorer la qualité de l’examen mi-
croscopique. De telles stratégies doivent également
être prises en considération. Finalement, on peut aug-
menter la sensibilité de l’examen microscopique des
crachats en modi ant la technique, par exemple grâce
au traitement et à la concentration des crachats pré-
alablement à l’examen microscopique.
Un autre sujet discuté concerne les cas à frottis né-
gatif. L’examen microscopique des crachats n’est pas
le seul test utilisé dans l’évaluation des sujets suspects
de TB. Même si la culture n’est pas pratiquée en rou-
tine, ceci ne signi e pas que ceux qui seraient positifs
à la culture ne sont pas détectés. On peut supposer
raisonnablement toutefois que le diagnostic de cas
autres que les cas à frottis positif est largement moins
précis que celui des cas à frottis positif, et ce à des
degrés divers selon le contexte. Sur le plan logistique
et opérationnel, il est plus dif cile de diagnostiquer
des TB à frottis négatif qu’à frottis positif, et il faut
prendre garde à éviter des erreurs de diagnostic et
des traitements non justi és. La stratégie des TB à
frottis négatif variera en fonction de la situation épi-
démiologique, de la résistance aux médicaments, des
caractéristiques des services de santé et des ressources

Le modèle de Styblo 5
Tableau 2 Stratégies opérationnelles pour le recrutement des cas dans les programmes TB
Stratégie Problèmes et faits établis Commentaires
Sélection des tousseurs
parmi les sujets
recourant aux soins
pour évaluation
par examen
microscopique des
crachats
Inde rurale, 1967 : l’examen des crachats des sujets
dont la toux dure moins de 2 semaines n’entraîne la
détection que d’une petite proportion de cas à
frottis positif.48
La sensibilité est de 98% (84%), lorsque la limite est
fi xée à 2 (3) semaines. Le modèle de Styblo a placé
la limite à 3 semaines.5 Des études récentes
suggèrent qu’une limite moins sévère pourrait
améliorer la détection des cas.31,49
Des stratégies de recrutement local peuvent envisager
la valeur limite en fonction de la prévalence de la TB,
de l’utilisation des services de santé, des
performances du service, de la charge de travail du
laboratoire et des priorités compétitives. Pour
faciliter la détection des cas, l’examen
microscopique devrait idéalement être décentralisé
afi n de garantir une bonne accessibilité des services
tout en maintenant dans des limites acceptables la
VPP de l’examen microscopique ainsi que la
compétence du laboratoire.
Examen d’une série de
frottis
de crachats
En se basant sur une étude en Inde,50 le modèle a
recommandé que trois échantillons soient recueillis
par suspect. La justifi cation de cette exigence de
trois échantillons, plutôt que de deux, fait l’objet de
discussions car le troisième frottis n’augmente que
faiblement la sensibilité. En 2000, le Guide de
L’Union a adopté la stratégie d’examen de deux
échantillons. Une revue systématique en 2007 a
signalé que le rendement de l’examen d’un
troisième échantillon se situe à 2–5%.51
Vu l’augmentation alarmante du nombre de suspects
de TB dans les zones à haute prévalence de VIH au
cours des années 1990, la charge de travail exigée
pour examiner trois échantillons a menacé de
collapsus les services de laboratoire. Une décision
selon laquelle deux échantillons suffi raient était
donc aisément justifi ée. Le rendement de l’examen
microscopique peut même augmenter lorsque cette
exigence est abaissée quand une politique
d’exigences plus élevées entraîne un examen
microscopique de faible qualité ou même l’absence
de tout examen microscopique.
Recueil des crachats
(sur place-matin-sur
place)
Lors de l’examen microscopique, le type d’échantillon
(sur place ou du matin) infl uence le rendement en
cas à frottis positif. Le modèle a recommandé que
trois échantillons soient recueillis et lorsque c’était
possible examinés dans les 3 jours,5 ce qui n’exigeait
qu’une deuxième visite par le patient. Le premier et
le troisième échantillons pouvaient être des
échantillons fournis sur place, bien qu’on ait
reconnu qu’ils puissent être de moindre qualité que
les échantillons du petit matin.
Les recommandations visaient un programme de santé
publique et non les salles d’hôpitaux. Lorsqu’on
considère les problèmes opérationnels, le compromis
en termes de rendement est considéré comme
moindre que l’avantage. On a pensé qu’il était
important qu’un échantillon soit recueilli sans délai
sur place chez tous les patients TB en contact avec
les services de santé. Actuellement, les indications
concernant le patient dans le registre du laboratoire
doivent permettre de le rechercher.
Echantillons sur place Inde (années 1960) : tous les patients TB attendaient
les résultats dans les centres bénéfi ciant de services
de microscopie, mais 71% seulement revenaient
chercher leurs résultats dans les unités de
référence.48 L’avantage d’un système dans lequel le
premier échantillon est un échantillon sur place, en
plus de permettre un examen le même jour, fait que
le patient laisse un échantillon au centre et est
enregistré et que le personnel peut observer la
production du crachat afi n d’obtenir un échantillon
de haute qualité.
Le taux de retour du patient est susceptible de
dépendre du contexte et d’une communication
effi ciente entre le travailleur de santé et le patient.
Des études anciennes à Bangalore (années 1960)
ont trouvé que 10% des patients TB ne revenaient
pas chercher leurs résultats (c’est-à-dire abandon
initial).20 La stratégie de recueil des échantillons sur
place a été récemment remise en question par des
chercheurs du Bangladesh (2002), où un très petit
nombre de personnes (1,5%) n’étaient pas revenues
avec un deuxième échantillon.52
Accompagnement
pré-test Dans l’ensemble des contextes, un accompagnement
pré-test correct peut ne pas être garanti en routine à
côté de l’examen des crachats. Ceci peut expliquer
partiellement pourquoi certains suspects de TB
n’achèvent pas le processus d’examen des crachats.
Des essais randomisés récents suggèrent qu’un
renforcement de l’accompagnement pré-test peut
améliorer le dépistage des cas.53,54
L’accompagnement pré-test vise à augmenter la
qualité et le volume des échantillons de crachats
ainsi que la chance que le patient achève le
processus (c’est-à-dire revienne avec un deuxième
échantillon). L’effet observé sur la qualité de
l’échantillon peut être plus important pour
l’échantillon sur place que pour les échantillons
du matin.54
Services décentralisés
d’examen
microscopique
des crachats
La procédure décrite comme sur place-matin-sur place
est susceptible d’être la plus valable dans les
contextes où l’accessibilité des services de santé est
bonne et l’examen microscopique des crachats
décentralisé. D’autre part, le problème de l’envoi
des échantillons dans un laboratoire et de l’attente
des résultats pose problème (le retard considérable
qu’implique ce système a été documenté tant au
Malawi5 qu’à New York56 dans les années 1990).
L’absence d’effi cience peut être expliquée par le
manque de prise de conscience du problème par le
personnel, par une appréciation insuffi sante de
l’importance de services rapides et par de mauvaises
habitudes. Occasionnellement, des diffi cultés
logistiques intrinsèques peuvent être diffi ciles à
résoudre. La lenteur des systèmes amoindrit
l’avantage d’un échantillon sur place, mais cet
avantage existe néanmoins lorsque l’échantillon sur
place est positif et même si le patient ne revient pas.
D’autre part, il se peut qu’il n’y ait aucune trace
d’un tel patient, même s’il a fréquenté les services.
(suite )
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
1
/
21
100%