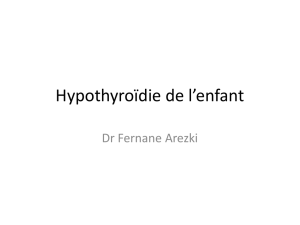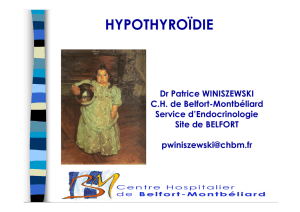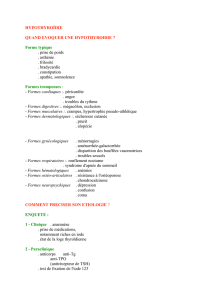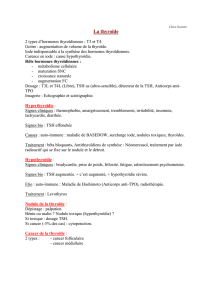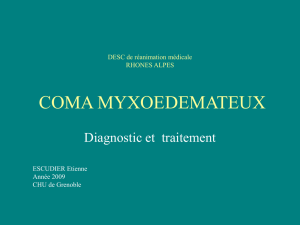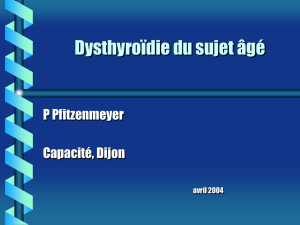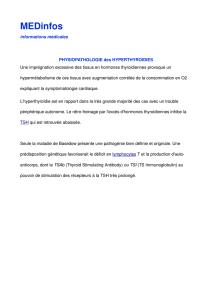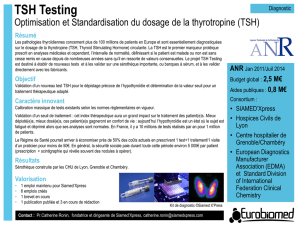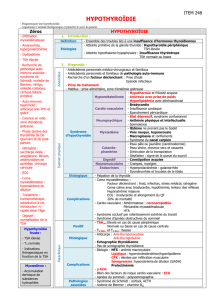Syndrome néphrotique

Disponible en ligne sur www.sciencedirect.com
La Revue de médecine interne 29 (2008) 139–144
Communications brèves
Syndrome néphrotique : penser à rechercher une hypothyroïdie associée
Nephrotic syndrome: Don’t forget to search for hypothyroidism
S. Trouillier∗, I. Delèvaux, N. Rancé, M. André, H. Voinchet, O. Aumaître
Service de médecine interne, CHU Gabriel-Montpied, 58, rue Montalembert, B.P. 69, 63001 Clermont-Ferrand cedex, France
Disponible sur Internet le 20 novembre 2007
Résumé
Introduction. – Si, au cours d’un syndrome néphrotique, des anomalies des indices fonctionnels thyroïdiens ont souvent été observées, une
hypothyroïdie n’a été qu’exceptionnellement décrite.
Exégèse. – Nous rapportons trois observations de patients adultes (1, 2, 3) qui ont eu une hypothyroïdie associée à un syndrome néphrotique
(atteinte glomérulaire minime [1], glomérulonéphrite extramembraneuse idiopathique de stade I [2] et de stade II [3]). Le traitement était celui
de la glomérulopathie et une hormonothérapie substitutive thyroïdienne. L’euthyroïdie était obtenue avec une faible substitution (1, 2) quand la
protéinurie diminuait et avec une hormonothérapie plus forte (3) lorsque le syndrome néphrotique n’était pas contrôlé.
Conclusion. – La fuite urinaire des hormones thyroïdiennes et de leurs protéines porteuses au cours du syndrome néphrotique engendre, si elle est
abondante, une diminution de la T4 libre et une augmentation de la TSH. La recherche systématique d’une hypothyroïdie associée est nécessaire,
surtout si la protéinurie est massive et prolongée.
© 2007 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
Abstract
Introduction. – If abnormal thyroid function indices have been reported in patients with nephrotic syndrome, hypothyroidism is exceptional.
Exegesis. – We report three adult patients (1, 2, 3) with hypothyroidism associated with nephrotic syndrome (minimal change glomerulonephritis
[1], idiopathic membranous nephropathy stage I [2], stage II [3]). Glomerulopathy treatment and thyroid hormon replacement therapy were both
initiated. Low replacement (1, 2) was sufficient when proteinuria decreased. It was higher when nephrotic syndrome was uncontrolled (3).
Conclusion. – Excessive thyroxine-binding protein and thyroxine urinary loss generate low rate of free thyroxine and elevated TSH. Systematic
thyroid hormonal test is necessary if nephrotic syndrome is severe and prolonged.
© 2007 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
Mots clés : Syndrome néphrotique ; Hypothyroïdie
Keywords: Nephrotic syndrome; Hypothyroidism
1. Introduction
Dès 1917, Epstein envisageait la possibilité d’une insuf-
fisance thyroïdienne chez les patients ayant un syndrome
néphrotique (SN) mais ce n’est qu’à partir de 1948 qu’une
baisse de l’activité thyroïdienne était évoquée chez ces patients
[1]. Depuis, une augmentation du taux de la TSH associée à
des signes cliniques d’hypothyroïdie a exceptionnellement été
Abréviations: T4, thyroxine ; T3, tri-iodothyronine ; TBG, thyroxine-binding
globulin ; TSH, thyroid-stimulating hormone.
∗Auteur correspondant.
Adresse e-mail : trouillier[email protected] (S. Trouillier).
décrite. Elle a surtout été constatée chez l’enfant [2–5] mais
reste très rare chez l’adulte [6]. Nous rapportons trois observa-
tions d’hypothyroïdie associée à un syndrome néphrotique et
survenant à l’âge adulte.
2. Observations
2.1. Observation 1
Un patient de 44 ans sans antécédent particulier était hospita-
lisé en octobre 2006 pour l’apparition depuis six mois d’œdèmes
des membres inférieurs. À son admission, ces œdèmes étaient
déclives, prenaient le godet et remontaient jusqu’aux fosses
0248-8663/$ – see front matter © 2007 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
doi:10.1016/j.revmed.2007.10.412

140 S. Trouillier et al. / La Revue de médecine interne 29 (2008) 139–144
Tableau 1
Caractéristiques biologiques des patients en hospitalisation avant et au cours de leur traitement
Patients
123
Âge (ans)446936
Sexe HHH
Protéinurie (g/24 h)
avant traitement 14 4,13 12,26
après traitement 6,86 0,16 11,28
Créatininémie (mol/l)
avant traitement 58 54 73
après traitement 590 75 96
Biopsie rénale Atteinte glomérulaire minime GEM type I idiopathique GEM type II idiopathique
TSH (mUI/l) [0,27–4,20]
avant traitement 5,90 5,63 9,06
après traitement 1,27 2,30 2,07
T4libre (pmol/l) [12–22]
avant traitement 12,3 10,5 11
après traitement 15,4 # #
Délai entre la première et la
dernière évaluation biologique
6 mois 11 mois 13 mois
Anticorps antithyroïdien –––
Traitements Ramipril, candésartan, furosemide,
prednisone, cyclosporine, AVK,
lévothyroxine (12,5 g/j)
Irbésartan, furosémide, nicardipine,
AVK, lévothyroxine (25 g/j)
Ramipril, candésartan, furosémide,
AVK, lévothyroxine (75 g/j)
– : négatif ; H : homme ; GEM : glomérulonéphrite extramembraneuse.
# : non disponible ; AVK : antivitamine K.
lombaires. La fréquence cardiaque était de 60 par minute et la
pression artérielle à 104/60 mm Hg. La palpation thyroïdienne
était normale. Le reste de l’examen était sans particularité.
La biologie révélait un SN pur (protéinurie à 14 g par
24 heures moyennement sélective dont 68 % albumine et 32 %
de globuline sur l’électrophorèse des protéines urinaires, pro-
tidémie à 45 g/l, albuminémie à 12,8 g/l), un pic monoclonal à
IgG lambda sans répression de synthèse des autres immunoglo-
bulines, sans cytopénie sur l’hémogramme ni hypercalcémie et
sans insuffisance rénale (créatininémie à 58 mol/l). La plas-
mocytose médullaire était à 3 %. Les radiographies osseuses
ne montraient pas de lacunes. L’analyse anatomopathologique
d’une biopsie des glandes salivaires ne retrouvait pas de dépôts
amyloïdes. La ponction biopsie rénale permettait de rattacher
le SN à des lésions glomérulaires minimes sans argument pour
une amylose. Il existait une hypothyroïdie (TSH à 4,9 mUI/l
deux semaines avant l’hospitalisation puis TSH à 5,9 mUI/l
[Normale : 0,27–4,20] et T4 libre dans les valeurs basses de
la normale à 12,3 pmol/l (Normale : 12–22). L’échographie thy-
roïdienne ne retrouvait pas d’anomalies. Le traitement initial
comprenait un diurétique (furosémide : 60 mg/j), un inhibiteur
de l’enzyme de conversion à doses progressives (ramipril jusqu’à
5 mg/j), une anticoagulation et une hormonothérapie substitutive
(lévothyroxine : 12,5 g/j). Après un mois d’évolution, la per-
sistance d’œdèmes déclives et la majoration de la protéinurie
(protéinurie à 18,94 g par 24 heures) motivaient l’introduction
d’une corticothérapie à forte dose (1 mg/kg par jour soit 80 mg/j).
Deux semaines plus tard, l’absence d’amélioration clinique
nécessitait la majoration de la posologie du furosémide à
120 mg/j, du ramipril à 10 mg/j et l’introduction d’un antago-
niste du récepteur de l’angiotensine II (candésartan : 4 mg/j).
En février 2007, au terme de trois mois de corticothérapie,
une amélioration clinique était constatée avec une diminution
des œdèmes et une perte de poids de 8 kg. Le SN persistait
malgré une diminution de la protéinurie (4,67 g par 24 heures).
L’albuminémie gardait des valeurs très basses (9 g/l). La fonc-
tion rénale restait conservée (clairance de la créatinine calculée
à 128 ml par minute). Un traitement par ciclosporine était donc
introduit mais ne permettait pas la régression du syndrome
néphrotique à six mois d’évolution. Une insuffisance rénale
aiguë survenait fin avril 2007 à l’occasion d’une déshydrata-
tion sur perte digestive (Tableau 1). L’euthyroïdie biologique
(TSH à 3,9 mUI/l) était obtenue dès la troisième semaine de
traitement (l-thyroxine, inhibiteur de l’enzyme de conversion)
et avant l’introduction des corticoïdes. La posologie de substi-
tution thyroïdienne a été maintenue à 12,5 g/j. À six mois de
traitement, la TSH était à 1,27 mUI/l.
2.2. Observation 2
Un homme de 69 ans était hospitalisé en octobre 2006 pour
une asthénie évoluant depuis six mois associée depuis deux mois
à des œdèmes généralisés déclives et depuis quelques semaines
à une fébricule. De ses antécédents, on retenait des infections
sinusiennes et pulmonaires à répétition depuis plus de 20 ans. Un
scanner abdominopelvien fait deux semaines avant son hospita-
lisation en raison des œdèmes révélait une thrombose de la veine
rénale gauche. Un traitement anticoagulant et diurétique (furo-
sémide et spironolactone) était débuté avant son hospitalisation.
Par ailleurs, une hypothyroïdie biologique était diagnostiquée
un mois avant son hospitalisation (TSH à 5,63 mUI/l, T4 libre à
10 pmol/l).
À son admission, il était hypertendu à 200/120 mmHg. Il
n’avait pas de signe d’insuffisance cardiaque. La fréquence

S. Trouillier et al. / La Revue de médecine interne 29 (2008) 139–144 141
cardiaque était de 80 par minute. La biologie révélait un
SN impur (protéinurie à 4,13 g par 24 heures, albuminémie à
12,6 g/l, protidémie à 68 g/l, hématurie à 8000 hématies/ml) ainsi
qu’un syndrome inflammatoire (CRP à 112 mg/l, VS à 98 mm à
la première heure, fibrinogénémie à 9,6 g/l). La fonction rénale
était conservée (créatininémie à 54 mol/l). La ponction biop-
sie rénale révélait une glomérulonéphrite extramembraneuse
(GEM) de type I. Aucune cause n’était retrouvée après un
bilan exhaustif (sérologie hépatite B, anticorps antinucléaires
et antithyroïdiens négatifs, scanner thoracoabdominopelvien,
fibroscopie œsogastroduodénale, coloscopie). Une hormonothé-
rapie substitutive était débutée une semaine après le traitement
du SN qui associait au diurétique (furosémide : 40 puis 80 mg/j),
un antagoniste du récepteur de l’angiotensine II à doses pro-
gressives (irbésartan jusqu’à 300 mg/j), un inhibiteur calcique
(nicardipine : 50 mg deux fois par jour) et un hypocholestéro-
lémiant (simvastatine 20 mg/j). L’hypothyroïdie biologique et
clinique se confirmait en début de traitement devant l’asthénie
et l’augmentation de la TSH à 16,2 mUI/l. La posologie de
l’hormonothérapie était de 12,5 g/j, pendant une semaine, puis
de 25 g/j. L’évolution était rapidement favorable avec dispa-
rition des œdèmes, perte de poids, correction de l’hypertension
artérielle, disparition du syndrome inflammatoire, diminution de
la protéinurie à 1,5 g par 24 heures après un mois, puis 0,47 g
par 24 heures à quatre mois et demi, puis 0,16 g par 24 heures
à 11 mois de traitement. L’albuminémie était en franche aug-
mentation à 32 g/l dès la troisième semaine de traitement (39 g/l
à quatre mois et demi de traitement). Le traitement anticoagu-
lant oral par antivitamine K était poursuivi pendant un mois,
puis arrêté devant la normalisation de l’albuminémie. La fonc-
tion rénale restait conservée. Sans modifier l’hormonothérapie,
l’euthyroïdie était obtenue trois semaines après le début du trai-
tement du SN (TSH à 3,79 mUI/l, T4 libre à 12,15 pmol/l) et
maintenue à 11 mois (TSH à 2,30 mUI/l).
2.3. Observation 3
Un homme âgé de 36 ans était hospitalisé en mars 2006
pour des œdèmes des membres inférieurs déclives, mous, pre-
nant le godet, une prise de poids de 10 kg en deux mois
associés à une protéinurie à 18 g par 24 heures et à une héma-
turie microscopique découverte un mois avant l’hospitalisation.
Neuf mois avant son hospitalisation, une protéinurie avait été
notée fortuitement à la médecine de travail sans qu’elle ait
été quantifiée. Deux mois avant son admission, une TSH était
réalisée devant la présence d’œdèmes. Elle était augmentée à
5,27 mUI/l. À son admission, il décrivait une asthénie modé-
rée. La pression artérielle était de 140/90 mm Hg pour une
fréquence cardiaque à 100 par minute. Il existait des lésions
de prurigo eczématisées localisées aux quatre membres. La
biologie montrait un SN (protéinurie à 12,26 g par 24 heures
constituée essentiellement d’albumine, albuminémie à 10,2 g/l,
protidémie à 44 g/l). Il n’y avait plus d’hématurie. La fonction
rénale était conservée (créatininémie à 69 mol/l). Il n’y avait
pas de syndrome inflammatoire. L’hypothyroïdie biologique se
confirmait (TSH modérément augmentée à 4,82 mUI/l, T4 libre
basse à 11 pmol/l). Les anticorps antinucléaires, antithyropé-
roxydases et antithyroglobulines étaient négatifs. Les sérologies
des hépatites B et C et VIH étaient négatives. Le scanner thora-
coabdominopelvien ne montrait pas d’anomalie significative. La
ponction biopsie rénale objectivait une GEM de type II avec des
lésions segmentaires et focales. Une supplémentation en lévo-
thyroxine était débutée début avril 2006, deux semaines après
l’introduction d’un traitement du SN qui associait à un inhibiteur
de l’enzyme de conversion (ramipril), une statine (pravastatine)
et un antivitamine K. L’évolution qui n’était pas favorable néces-
sitait, dés le premier mois de la prise en charge, une augmentation
de la posologie du ramipril à 10 mg/j et l’introduction d’un diuré-
tique (furosémide). À six mois, il persistait des œdèmes malgré
l’augmentation progressive du furosémide jusqu’à 40 mg/j. La
protéinurie était stabilisée mais toujours abondante à 10,4 g par
24 heures. L’albuminémie augmentait progressivement (26 g/l
à six mois) autorisant l’arrêt des anticoagulants oraux et le
relais par antiagrégant plaquettaire. La posologie du furosé-
mide était majorée à 60 mg/j et un antagoniste des récepteurs
de l’angiotensine II (candésartan : 4 mg/j) lui était associé. Au
treizième mois, on constatait toujours des œdèmes des membres
inférieurs modérés et l’albuminémie était à 34 g/l. Durant toute
la prise en charge, la fonction rénale restait satisfaisante (créati-
ninémie à 96 mol/l, clairance calculée de la créatinine à 139 ml
par minute à 13 mois). L’euthyroïdie était obtenue à deux mois
du début du traitement du SN et un mois et demi après le début
de l’hormonothérapie (TSH à 1,81 mUI/l). Cette dernière n’a
cependant pas pu être diminuée en dessous de 75 g de lévo-
thyroxine par jour durant les 13 premiers mois de la substitution
(TSH à 1,95 mUI/l à six mois, TSH à 2,07 mUI/l à 13 mois).
3. Discussion
Nous rapportons trois observations de SN associé à une hypo-
thyroïdie biologique (Tableau 1). Un des trois patients avait des
signes cliniques d’hypothyroïdie (patient n◦2). La TSH avait
été demandée dans le bilan d’œdèmes pour les deux autres.
L’hypothyroïdie biologique de nos patients ne semble pas cor-
respondre aux perturbations hormonales constatées au cours des
processus pathologiques sévères et prolongés (choc septique par
exemple). Ces perturbations sont caractérisées par la baisse des
taux de T4 et T3 libres mais également du taux de la TSH alors
que la TSH de nos patients est modérément augmentée [7].La
baisse de la T4 libre au cours de ces processus pathologiques
sévères peut être liée dans certaines conditions de dosage à une
baisse importante des protéines porteuses que sont essentiel-
lement la thyroxine-binding globulin (TBG) et l’albumine. À
l’inverse, le taux de T4 totale quelle que soit la méthode de
dosage est principalement déterminé par celui de la TBG qui
est la protéine de transport principale et la plus affine [8].Au
cours de certaines méthodes de dosage de la T4 libre (dilution du
sérum dans le milieu réactif par exemple), le taux est habituel-
lement maintenu constant par dissociation de l’hormone de sa
protéine vectrice. Lorsque les taux de protéines porteuses sont
trop abaissés, la fraction liée trop faible n’arrive plus à rétablir
cet équilibre et le dosage de la T4 libre peut être sous-estimé
[8]. La diminution de la TSH au cours des processus patho-
logiques sévères et prolongés est due à un dysfonctionnement

142 S. Trouillier et al. / La Revue de médecine interne 29 (2008) 139–144
hypothalamique. La diminution de la T4 libre dans ces condi-
tions est ainsi également liée à une stimulation thyréotrope plus
faible [7].
La fréquence de survenue des anomalies biologiques thyroï-
diennes au cours d’un SN n’est pas connue. Un bilan hormonal
thyroïdien systématique n’a en effet jamais été pratiqué dans
une large cohorte de SN. Seuls dix patients atteints de SN ont été
comparés à un groupe témoin [9]. Toutefois on sait que dès 1917
certains auteurs proposaient à des patients néphrotiques chez qui
ils avaient constaté une baisse du métabolisme basal, une hyper-
cholestérolémie, voire des signes cliniques d’hypothyroïdie,
des extraits thyroïdiens [1]. Ils notaient que de fortes doses
d’extraits thyroïdiens n’induisaient pas d’hypermétabolisme et
que des signes d’hyperthyroïdie ne survenaient qu’à des poso-
logies plus fortes que chez les patients hypothyroïdiens non
néphrotiques [1,10]. Une insuffisance de l’activité thyroïdienne
n’était évoquée qu’à partir de 1948, mais les paramètres bio-
logiques que les auteurs utilisaient, comme par exemple le
taux sérique de protéines porteuses d’iode, restaient trop impré-
cis pour tirer des conclusions définitives [1,10,11]. En fait,
chez les patients néphrotiques les perturbations du taux sérique
des hormones thyroïdiennes n’ont été décrites qu’à partir des
années 1970 [2–6,9,10,13]. Dans une étude portant sur dix
patients adultes néphrotiques euthyroïdiens, Gavin et al. ont
retrouvé chez neuf patients sur dix des taux normaux de T4
liée sérique, de TSH et de TBG. Il constatait, en revanche, une
baisse de la T3 totale sérique et une élévation significative de
la T4 libre. Seul le patient dont la protéinurie était la plus éle-
vée (24 g par 24 heures) avait une diminution du taux sérique
de T4 liée et de TBG avec une TSH normale et sans signe
d’hypothyroïdie [9]. Bien que la protéinurie moyenne de cette
cohorte (11,1 ±5,7 g par 24 heures [5,2–24]) soit sensiblement
identique à la protéinurie moyenne de nos patients, ces patients
sont difficilement comparables aux nôtres car il s’agissait pour
sept patients sur dix de glomérulopathie diabétique et leur fonc-
tion rénale était altérée (clairance moyenne de la créatinine à
43 ml par minute) [9]. En effet, certains mécanismes pathogé-
niques responsables d’hypothyroïdie semblent être propres à la
néphropathie diabétique, comme l’excès d’iode dans le sérum
[14]. Dans une cohorte de sept patients néphrotiques adultes en
euthyroïdie (protéinurie moyenne : 5,1 g par 24 heures, albumi-
némie moyenne : 25 g/l), Afrasiabi et al. ont constaté un taux
sérique normal de T4 totale, de T4 libre, de TSH et une diminu-
tion du taux sérique de T3 et de TBG. Le SN de ces patients paraît
cependant moins sévère que celui de nos patients [12]. Ito et al.
ont, quant à eux, noté sur une cohorte de sept enfants néphro-
tiques non traités une baisse significative des taux sériques de
T4, T3 et TBG avec une T4 libre et une TSH normales [13]. Ainsi
une diminution des taux plasmatiques de TBG, de T3 totale a
été constatée alors que les taux de TSH et de T4 libre restent
dans la plupart des cas normaux.
Au moment du diagnostic de l’hypothyroïdie chez nos
patients, la TSH initiale moyenne était à 5,26 mUI/l (4,89–5,63).
La TSH maximale moyenne dosée lors de l’hospitalisation
initiale était de 10,38 mUI/l [5,9–16,2]. À l’admission en hos-
pitalisation, la T4 libre initiale moyenne était à 11,27 pmol/l
[10,5–12,3]. Aucun patient n’avait d’anticorps antithyroïdiens.
Chez le patient no1, l’hypothyroïdie était mise en évidence
de fac¸on concomitante au SN. Étant donné l’apparition des
œdèmes apparus six mois auparavant, on peut supposer sans
pouvoir le certifier que le SN existait déjà avant le diagnostic de
l’hypothyroïdie. Chez le patient no2, l’hypothyroïdie était diag-
nostiquée un mois avant le SN. Ce patient était asthénique depuis
six mois sans que l’on puisse certifier que l’hypothyroïdie ait pré-
cédé l’atteinte rénale car ni la TSH ni la protéinurie n’avaient
été réalisées six mois avant l’admission du patient. Par ailleurs,
étant donné que la TSH restait inférieure à 10 mUI/l avant sa
prise en charge, l’asthénie ne pouvait pas initialement être attri-
buée à l’hypothyroïdie [15]. Chez le patient no3, l’hypothyroïdie
était diagnostiquée un mois avant le SN mais il existait une
protéinurie non quantifiée sept mois avant la découverte de
l’hypothyroïdie. L’atteinte rénale était ainsi peut-être présente
avant l’hypothyroïdie. Ainsi, tous nos patients ont une T4 libre
basse et une TSH modérément augmentée, mais un seul a une
hypothyroïdie clinique probable. Il est cependant difficile de
faire la part entre les signes cliniques dus à l’hypothyroïdie et
ceux liés au SN. Ces anomalies biologiques associées à des
signes cliniques d’hypothyroïdie restent rares. Elles ont sur-
tout été constatées chez l’enfant, notamment en cas de SN
congénital [2–5] mais parfois chez l’adulte [6]. La série la plus
importante de patients néphrotiques adultes ayant une hypothy-
roïdie a été rapportée par Fonseca et al. Elle comptait quatre
patients avec des données cliniques et biologiques et cinq autres
patients pour lesquels seuls les paramètres biologiques sont rap-
portés [6]. En se fondant sur les données biologiques initiales
de leurs patients, si les taux de protéinurie étaient sensiblement
identiques à ceux de nos patients (protéinurie moyenne : 9,3 g
par 24 heures [5,7–14,5]), trois des quatre patients avaient une
insuffisance rénale. Le taux moyen de TSH était en revanche
plus élevé que celui observé chez nos patients (12,15 mUI/l
[8,6–26] contre 10,38 mUI/l [5,9–16,2]) et un de leurs patients a
nécessité une posologie de lévothyroxine plus importante (150,
voire 300 g/j). Il est cependant impossible de comparer pour
chacun de leurs patients les posologies substitutives en fonc-
tion de la sévérité du SN. Les données cliniques concernant
l’hypothyroïdie n’étaient pas mentionnées lors de la présentation
initiale et elles n’ont pas été évaluées par la suite.
En 1956, Rasmussen a étudié la distribution, les modes
d’élimination et la demi-vie de la l-thyroxine marquée à l’iode
radioactif chez trois patients néphrotiques. Ils ont attribué le
taux sérique bas en protéines porteuses d’iode chez les patients
néphrotiques à quatre facteurs :
•la perte urinaire significative d’iode organique ;
•la perte fécale excessive d’iode ;
•la dilution de l’iode organique résultant de l’inflation hydro-
sodée du secteur extracellulaire ;
•l’inaptitude de l’axe hypophyse–thyroïde à compenser le défi-
cit en thyroxine [11].
La principale hypothèse pathogénique pour expliquer les ano-
malies thyroïdiennes biologiques sériques est en fait une perte
excessive de TBG, de T4 totale et libre et de T3 totale et libre

S. Trouillier et al. / La Revue de médecine interne 29 (2008) 139–144 143
dans les urines [3,9,12,13]. Gavin et al. et Afrasiabi et al. ont
trouvé une corrélation positive entre la protéinurie des 24 heures
et l’excrétion urinaire quotidienne de TBG et de T4 [9,12].
Certains auteurs ont pu établir une corrélation inverse entre la
quantité de T4 et de T3 urinaire excrétée et leurs taux plasma-
tiques [6]. Dans la majorité des cas, la glande thyroïde compense
l’excès de perte urinaire des hormones et de leurs protéines por-
teuses, ce qui pourrait expliquer pourquoi Gavin et al. n’avaient
pas noté de corrélation inverse entre le taux sérique de T4 totale
et l’excrétion urinaire de T4 [6,9]. Grâce à cette compensation
de la glande thyroïde, la fuite urinaire n’est que rarement à
l’origine d’une augmentation de la TSH et d’une authentique
hypothyroïdie [5,6]. De multiples observations viennent étayer
cette hypothèse pathogénique. En effet, les cas d’hypothyroïdie
rapportés dans la littérature sont apparus au décours de pro-
téinurie massive [2–5]. Pour certains auteurs, la protéinurie et
donc la perte urinaire d’hormones et de leurs protéines por-
teuses rapportées au poids corporel seraient plus importantes
chez l’enfant que chez l’adulte, ce qui expliquerait la surve-
nue plus fréquente d’hypothyroïdie dans cette classe d’âge [3].
Lorsque le SN régresse, la TSH lorsqu’elle était initialement
augmentée peut retourner à des valeurs normales sans qu’il n’y
ait besoin d’une substitution hormonale [6]. L’hormonothérapie
peut aussi être diminuée, voire arrêtée après disparition du SN
[6]. La néphrectomie bilatérale chez des enfants ayant un SN
congénital a permis de stopper la substitution [5]. À l’inverse,
une hypothyroïdie difficilement substituable avec augmentation
importante des posologies substitutives et révélant un syndrome
néphrotique a été également rapportée [16]. Pour notre cas no2
l’évolution du SN est rapidement favorable et l’hormonothérapie
substitutive était faible alors qu’elle était plus élevée chez le
patient no3 dont le SN n’était pas contrôlé et ce de fac¸on pro-
longée. Chez ce dernier, les œdèmes des membres inférieurs
n’avaient pas totalement disparu et la protéinurie était encore
à plus de 10 g par 24 heures au treizième mois de traitement.
L’albuminémie restait inférieure à 30 g/l après six mois de trai-
tement. Chez le patient no1, cette hypothèse pathogénique est
plus difficile à retenir. En effet, l’hormonothérapie permettant
d’obtenir une euthyroïdie biologique est très faible alors que le
syndrome néphrotique reste sévère. Même si les œdèmes ont
diminué avec une perte de 11 kg en six mois, la protéinurie
est restée supérieure à 3 g par 24 heures avec une albuminémie
à 13 g/l. Il est possible que le type de glomérulopathie de ce
patient soit responsable d’une perte en hormones thyroïdiennes
et en protéines porteuses plus faible. Cette hypothèse n’a pas été
vérifiée car nous n’avons pas réalisé de dosages quantitatifs uri-
naires de TBG ou de T4 pour nos patients. L’insuffisance rénale,
absente initialement chez nos patients, peut également générer
des anomalies biologiques thyroïdiennes, comme une baisse de
la T3 par le biais d’une altération de la désiodation de la T4 en
T3 [17].
La glande thyroïde des patients avec SN et perturbation du
bilan thyroïdien ne semble pas porter de caractère pathologique
[1,3,9,10]. Ainsi, l’analyse autopsique de la thyroïde quand elle
a été effectuée ne montrait pas d’anomalies franches de son
parenchyme [1]. Une thyroïdite auto-immune peut être éliminée
devant la négativité des anticorps antithyroglobuline et antithy-
ropéroxidase. Cette éventualité doit être écartée lorsque le SN
est dû à une GEM (comme pour nos patients no2 et 3). En effet,
les thyroïdites auto-immunes peuvent être associées à une GEM
et elles la précèdent souvent [18,19].
L’hormonothérapie substitutive, le traitement du syndrome
néphrotique, de la glomérulopathie, voire la néphrectomie bila-
térale dans le cadre de syndromes néphrotiques congénitaux
constituent les traitements proposés dans l’hypothyroïdie liée à
un SN [3,5]. McLean et al. ont même constaté un développement
staturopondéral normal avec une baisse de la TSH chez un enfant
atteint d’un SN congénital avec hypothyroïdie après introduction
d’une hormonothérapie substitutive [3]. Des recommandations
pour la prise en charge des SN congénitaux ont été proposées il
y a dix ans [20]. Elles consistent en une supplémentation thyroï-
dienne systématique dès la naissance, un régime hyperprotidique
et hypercalorique, un apport quotidien d’albumine et de vitamine
D2, une anticoagulation et une antibiothérapie systématique en
cas d’infection [20]. La prise en charge est beaucoup moins
codifiée chez l’adulte et le bénéfice d’une opothérapie transi-
toire est plus difficile à évaluer. La régression du SN a permis
la normalisation de la fonction thyroïdienne parfois sans sub-
stitution et l’arrêt de l’hormonothérapie après près d’un an de
traitement pour certains patients [6]. Nous n’avons pour notre
part pas encore assez de recul pour nos patients qui restaient tou-
jours substitués. Chez ces trois patients, les traitements du SN et
l’hormonothérapie ont quasiment été introduits en même temps.
L’euthyroïdie a été obtenue rapidement, trois semaines après le
début du traitement du SN chez les patients nos 1 et 2 et après
deux mois chez le patient no3. L’hormonothérapie qui a permis
d’obtenir une euthyroïdie était faible chez les patients nos 1et2
(12,5 et 25 g/j de lévothyroxine). Elle était plus élevée chez le
patient no3 (75 g/j). Après l’instauration du traitement du SN,
l’évolution clinique et biologique a été favorable en deux mois
chez le patient no2. Cette amélioration n’était peut-être pas uni-
quement le fait du traitement puisque les GEM peuvent régresser
spontanément [18]. L’évolution clinique et biologique a été plus
lente chez les patients nos 1 et 3. La sévérité du SN n’exige
pas obligatoirement une hormonothérapie forte comme chez le
patient no1. Les patients nos 1 et 3 ont nécessité l’association
à un inhibiteur de l’enzyme de conversion d’un antagoniste du
récepteur de l’angiotensine II alors que le patient no2 n’a rec¸u
qu’un antagoniste du récepteur de l’angiotensine II. L’élévation
de la TSH avec une T4 libre limite inférieure observée chez nos
patients témoignait à notre sens de l’incapacité de leur thyroïde
à compenser les pertes urinaires en raison d’un SN majeur. Nous
avons ainsi choisi d’associer au traitement de la glomérulopa-
thie une hormonothérapie thyroïdienne. Il convient de souligner
que l’hormonothérapie peut faciliter l’action de la corticothéra-
pie lorsqu’elle est introduite dans le cadre de la glomérulopathie
[13]. En effet, dans l’hypothyroïdie le nombre de récepteurs aux
glucocorticoïdes est réduit, ce qui limite leur effet [13].Uncas
de régression d’un SN résistant aux glucocorticoïdes après intro-
duction de lévothyroxine a d’ailleurs été décrit chez un enfant
qui présentait également des signes d’hypothyroïdie [13].
Ainsi, si l’on souhaite pouvoir déterminer la fréquence de
survenue d’une hypothyroïdie au cours d’un SN chez l’adulte et
savoir quels patients pourraient tirer bénéfice d’une hormono-
 6
6
1
/
6
100%