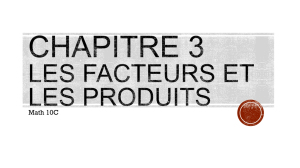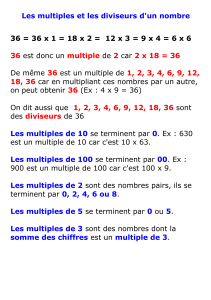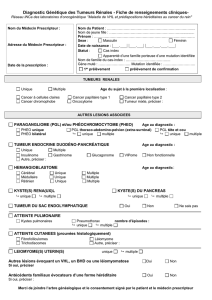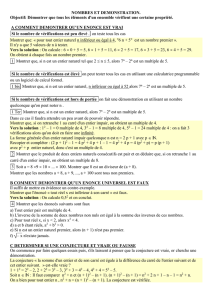Symbolisme, raison et totalité : les Fondements de toute métaphysique

Symbolisme, raison et totalité : les Fondements
de toute métaphysique
Autor(en): Ferrière, Adolphe
Objekttyp: Article
Zeitschrift: Revue de théologie et de philosophie
Band (Jahr): 31 (1943)
Heft 129
Persistenter Link: http://doi.org/10.5169/seals-380442
PDF erstellt am: 17.04.2017
Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an
den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.
Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in
Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder
Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den
korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.
Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung
der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots
auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.
Haftungsausschluss
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung
übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder
durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot
zugänglich sind.
Ein Dienst der ETH-Bibliothek
ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch
http://www.e-periodica.ch

SYMBOLISME, RAISON ET TOTALITE
(Les Fondements de toute métaphysique.)
Le titre de cet article est clair. Mais le sous-titre Un psychologue
—qui ne serait pas versé en philosophie ¦— dirait sans doute :«Etude
psychologique portant sur le subconscient de l'homme et sur diverses
attitudes qu'il adopte et qui l'orientent dans ses recherches d'ordre
métaphysique ». Les traditions les plus anciennes de l'humanité —
singulièrement les traditions religieuses de l'Inde et de la Grèce —
révèlent, en effet, la présence de ces attitudes qui sont aussi bien
des structures inhérentes àl'esprit de l'homme quand il pense.
1. Sentiment d'une Totalité-Une et de dualités, parmi lesquelles
celle du «Ciel »et de la «Terre », de l'esprit et de la matière, occupe
une place en vue. Inconscient collectif primitif.
2. Refus de la «Terre» et fuite dans le «Ciel». Mysticisme ascé¬
tique.
3. La «Terre »—¦ les données des sens —sont seules qualifiées de
réelles. Refus d'admettre le «Ciel ». Matérialisme.
4. Prise de contact avec le multiple, côté «Terre», l'Un étant admis
de façon implicite. Analyse.
5. Sur la base des données sensibles, recherche de principes et de
lois :unités hiérarchisées visant àretrouver l'Un. Synthèses.
N. B. —Rédigées en janvier 1939, ces pages auraient dû paraître dans la
Revue le métaphysique et le morale, puis dans les Cahiers lu Sui ;par deux fois,
la guerre yafait obstacle.

224 ADOLPHE FERRIÈRE
6. Connaissance de la Totalité-Une et du lien réciproque entre
l'Un et le multiple. Sagesse et sainteté.
Toutefois serait-il légitime d'intituler« Etudepsychologique», donc:
compartiment de la science et dépendant de ses principes, un exposé
de ces principes desquels dépend toute science Ce serait un cercle
vicieux. Le sous-titre donné àcet article nous semble donc meilleur.
Mais il ne faut pas oublier que «tout est dans tout »et que, vu du
point de vue sensible ou «terrestre », ce que nous rencontrons
tout d'abord, ce sont bien des attitudes d'ordre psychologique (ri.
Il est possible, en s'inspirant des postulats des philosophies antiques
de l'Egypte, de l'Inde, de la Perse et de la Grèce, de se représenter
un jeu de symboles très simple :la sphère représenterait la Totalité.
Hémisphère supérieur :le «Ciel ». Hémisphère inférieur :la «Terre ».
Spiritualistes et matérialistes se cantonnent, les uns dans le «Ciel »,
les autres sur la «Terre ». La philosophie grecque, dans son ensemble,
part de l'Un implicite pour connaître le multiple. La philosophie
moderne part du multiple implicite pour tendre du côté de l'Un.
Il me semble que ces précisions liminaires rendront plus facile
la lecture de cet article. Les pages qui suivent ont, en effet, circulé,
au cours des quatre années écoulées, de main en main, parmi des méde¬
cins, des psychologues et des philosophes. Certaines critiques ont été
formulées àson égard qui portaient àfaux. L'auteur n'a pas cherché
àfaire une étude de l'histoire de la philosophie, ni àétablir une
classification des systèmes, comme l'auraient voulu certains. Celle-ci
eût été forcément —comme me l'a fait entendre M. D. Parodi —
«trop sommaire ». On trouvera en note mes réponses àquelques
autres critiques. Au fait, les malentendus que peut susciter cet article
me paraissent écartés si l'on s'en tient àce problème initial —le
seul que j'aie voulu éclaircir (et en me limitant àquelques rares réfé¬
rences parmi des centaines d'autres) :«étude de six attitudes du
subconscient de l'homme dans son orientation ou son appréhension
—au sens étymologique du terme—des problèmes métaphysiques».
Cela dit —et en m'excusant de me répéter quelque peu (il m'a
paru utile, pour éclairer la voie, de ramasser mes conclusions dès
(¦) Il n'entre pas dans mon intention d'étudier ici la légitimité ni l'origine ou le
développement épistémologique du postulat selon lequel le Logos, ou raison consti¬
tuante, et le Cosmos, ou raison constituée sur la base du donné, seraient fonctions
l'un de l'autre et constitueraient, dans leur dualité, les deux pôles d'une seule unité
originelle, au sens absolu (et non spatio-temporel) de ce terme.

SYMBOLISME, RAISON ET TOTALITE 225
cette introduction) —voici les réflexions que je voudrais sou¬
mettre aux méditations des lecteurs de la Revue de théologie et de
philosophie. Elles me paraissent propres àéclairer aussi bien les
réactions apriori que nous constatons chez certains enfants et
adolescents, ainsi que chez certains types psychologiques primitifs
ou rationalistes, que l'attitude même du psychologue et sa façon de
prendre et de comprendre la psychologie, s'il veut demeurer fidèle
aux éléments invariables qu'implique la stricte logique de la pensée.
Quand nous pensons, nous prenons pour point de départ objectif
la réalité sensible, le donné. Nous formulons des concepts. Nous
fixons certaines normes :les idées. Fondées sur l'expérience, par la
voie de l'induction, ce sont des abstractions. Mais si, partant du
sommet de la pyramide ainsi formée, nous en prenons la pointe,
l'idée terminale, àtitre de principe, il nous arrive, de déduction en
déduction, de revenir àla réalité. Les principes d'action, àleur tour,
nous permettent d'incarner dans la réalité ce qui, un instant aupa¬
ravant, n'était qu'idée pure. C'est cette incorporation de l'idée dans
un acte donné, sa concrétisation objective, que nous constatons chez
autrui.
Mais chez les jeunes, chez les adultes inconscients de leurs proces¬
sus idéels, chez les névropathes surtout, cette marche logique ne
leur apparaît pas. Ils usent d'images-souvenirs, images qui peuvent
se fixer sous forme de symboles. Qu'est-ce que les symboles Je les
désignerais comme des «raccourcis» de la pensée infantile et primi¬
tive :images stylisées ou idées globales résumées dans un exemple
le plus souvent concret (au lieu d'employer le mot abstrait :félin,
le petit enfant désignera le tigre par l'image-souvenir d'un «gros
chat ») ;d'autre part, le symbole sert de principe d'action sommaire,
principe formé une fois pour toutes. Les religions antiques sont ainsi
nourries de symboles qui constituent la «philosophie »des simples.
Le processus initial est pourtant le même que pour la science :la
métaphysique imaginative pré-rationnelle et la métaphysique rigou¬
reusement rationnelle sont de même essence.
Les fondements de toute métaphysique peuvent donc, selon moi, se
ramener àsix points de vue essentiels. Envisager les démarches de
REV. DE THÉOL. ET DE PHIL. N. S., t, XXXI (n° 129, I943). 22

226 ADOLPHE FERRIÈRE
la pensée en ne tenant compte que de l'un de ces points de vue, à
l'exclusion des autres, c'est déformer le réel, lui faire violence et
aboutir àdes conclusions absurdes. Qu'on lise, par exemple, La
philosophie grecque de M. Charles Werner (Paris, Payot, 1938). Il
est possible, presque àchaque page, de critiquer les textes des diffé¬
rents philosophes en prenant pour critère la notion de Totalité-Une.
Toute déformation du réel consiste en une vue unilatérale des choses,
vue partiellement juste, partiellement fausse. Un des penseurs
antiques qui se rapproche le plus des conceptions modernes —¦
j'entends celles des philosophes qui, comme M. Henri-L. Miéville,
envisagent avant tout la Totalité, et non pas les empiristes et les
matérialistes —c'est Plotin. En partant de l'examen critique des
idées de Plotin, je voudrais tenter ici une synthèse une des six points
de vue qui réapparaissent propres àfaire saisir, discriminer et
pénétrer la part de vérité et la part d'erreur de toute assertion méta¬
physique ou philosophique tant antique que moderne.
Il faut pour penser prendre pour point de départ la Totalité-Une,
parce que toute autre attitude est injustifiable en raison et aboutit
àdes absurdités :regressio ad infinitum, notion de «début », injus¬
tifiée, quand il s'agit du Cosmos, autant de raisons que la raison ne
connaît pas. Car tout ce qui est —aussi bien dans le monde des
«faits »perçus ou concevables que dans le monde des idées —¦ n'existe
qu'en fonction de ce qui n'est pas cela. Cela suppose àtout le moins
une dualité. Une seule exception :l'Un et le multiple. Certes la
notion de l'Un et la notion du multiple n'existent qu'en fonction
l'une de l'autre. Mais ici, il n'y apas opposition, dualité, polarité,
exclusion de l'un des termes par l'autre. Ce sont là deux aspects du
même Etre :le multiple est dans l'Un et l'Un est dans le multiple.
La notion du multiple ne résulte pas d'un morcellement opéré par la
raison :il est donné ;comme est donnée, sur tous les plans de la
pensée, l'unité qui les englobe et sans laquelle ils seraient radicale¬
ment discrets et non concrets.
En effet, le réel nous est donné, avant toute réflexion, sous une
forme que, réflexion faite, nous devrons désigner comme «globale »,
par opposition au morcellement, aux analyses ou différenciations et
aux concentrations ou synthèses auxquels nous pouvons le sou¬
mettre après coup. L'exposé des six points de vue annoncés plus haut
permettra de s'en rendre compte.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
1
/
13
100%