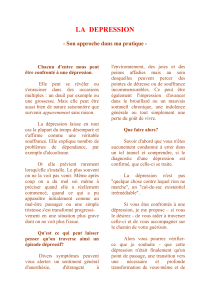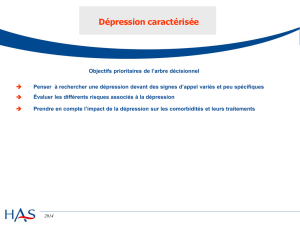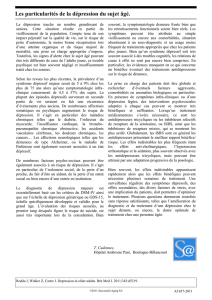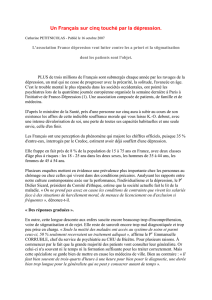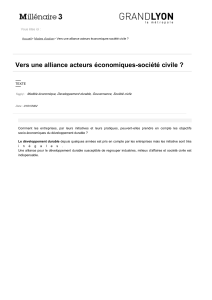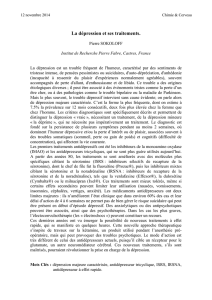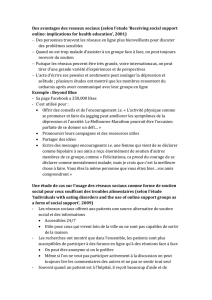L`alliance thérapeutique au début d`une prise en charge pour

L’Encéphale (2008) 34, 205—210
Disponible en ligne sur www.sciencedirect.com
journal homepage: www.elsevier.com/locate/encep
THÉRAPEUTIQUE
L’alliance thérapeutique au début d’une prise en
charge pour dépression par le généraliste
The therapeutic alliance in the initial stages
of the management of depression by the
general practitioner
P. Frémonta,∗, A. Gérardb, D. Sechterc, J.M Vanelled, M. Vidale
aCentre hospitalier de Lagny Marne-la-Vallée, 31, avenue du Général Leclerc, 77405 Lagny-sur-Marne, France
b17, rue des Marronniers, 75016 Paris, France
cHôpital Saint-Jacques, 2, place Saint Jacques, 25030 Besanc¸on cedex, France
dHôpital Saint-Jacques, 85, rue Saint-Jacques, 44093 Nantes cedex 1, France
e52, avenue du Sidobre, 81100 Castres, France
Rec¸ule8d
´
ecembre 2007 ; accepté le 21 f´
evrier 2008
Disponible sur Internet le 14 avril 2008
MOTS CLÉS
Dépression ;
Soins primaires ;
Alliance
thérapeutique ;
Observance
Résumé Dans le domaine des troubles dépressifs, le bon déroulement de la prise en charge
initiale est d’une grande importance pour la suite de la prise en charge. L’instauration d’une
relation de confiance est essentielle. Celle-ci peut être de plusieurs types : il n’existe pas «un »
mode de relation optimal. Les médecins généralistes posent plus des deux tiers des diagnos-
tics de dépression et effectuent plus des deux tiers des prescriptions d’antidépresseurs et sont
confrontés à diverses difficultés dans la prise en charge des patients déprimés : manque de
temps en consultation, formation insuffisante à la dépression et à ses traitements, absence
de marqueurs somatiques, crainte du risque suicidaire... Pour préciser ces difficultés et éla-
borer des réponses, l’enquête présentée ici a évalué en miroir, du point de vue du patient
et du point de vue du médecin, le ressenti par rapport à la maladie et à la prise en charge,
lors de consultations de médecine générale pour un tableau considéré comme dépressif par
le médecin. L’anonymat était garanti aux patients par un système d’urne et d’enveloppe
cachetée. L’enquête explorait la perception et le vécu de la pathologie par chacun des deux
acteurs, la relation du patient au médecin et l’histoire et la perception des consultations ini-
tiales. Les patients éligibles étaient des patients pour lesquels le diagnostic de dépression,
porté par le médecin généraliste, avait été communiqué au patient au cours des trois derniers
mois. En s’appuyant sur ces données, outre des informations sur la pathologie, le processus
∗Auteur correspondant.
Adresse e-mail : [email protected] (P. Frémont).
0013-7006/$ — see front matter © L’Encéphale, Paris, 2008.
doi:10.1016/j.encep.2008.03.001

206 P. Frémont et al.
d’établissement du diagnostic, les conditions de l’annonce du diagnostic et la démarche thé-
rapeutique, il a été établi une caractérisation de l’alliance constituée entre le patient et le
médecin par une combinaison des données patients et des données médecins. Des groupes
homogènes de couples patient—médecin ont ainsi été identifiés, par une analyse factorielle
en composantes multiples, puis par une classification mixte. Cette méthodologie a permis
d’identifier quatre types de binômes patient—médecin selon la nature de l’alliance entre eux,
(indépendamment d’un «effet-médecin ») : alliance clinique ; alliance fusionnelle ; alliance de
raison ; alliance difficile.
© L’Encéphale, Paris, 2008.
KEYWORDS
Depression;
Primary care;
Therapeutic alliance;
Observance
Summary In the field of depression, good initial management is crucial for the subsequent
treatment. A relationship based on trust is essential. This can be of various types: there is no
consensus on what is the ‘‘best’’ type of relationship. General practitioners diagnose more than
two-thirds of depression and write out more than one third of prescriptions for antidepressors.
Physicians are faced with various problems in the management of depressed patients: lack of
time during the consultation, insufficient training in depression and its treatment, absence of
somatic markers, fear of suicide risks... To specify the problems and elaborate responses, this
survey assessed, mirror-wise, the point of view of the patient and that of the physician, the
feelings regarding the pathology and its treatment, during consultations when the physician is
confronted with a depression syndrome. Patient anonymousness was guaranteed by the use of a
ballot box and sealed envelopes. In both parties, the survey explored the perception and expe-
rience of the pathology, the patient—physician relationship, and the history and perception of
the initial consultations. Eligible patients were those who had been diagnosed with depression
by the general practitioner and who had been informed of this during the past three months.
Based on this information, and other than the data regarding the pathology, the procedure
for establishing the diagnosis, the conditions in which the diagnosis was announced and the
treatment measures, a characterisation of the alliance between the patient and the physician
was established based on the combination of the patients’ and physicians’ data. Homogenous
patient—physician groups were thus identified using multiple component factorial analysis fol-
lowed by mixed classification. This methodology identified types of patient—physician binomials
according to the nature of their alliance (independent of any ‘‘doctor effect’’): a clinical
alliance, a united alliance, an alliance based on sense, and a difficult alliance.
© L’Encéphale, Paris, 2008.
Objectifs
En France, la prévalence de la dépression en population
générale est estimée à environ 5 % par an et de 15 à 20 %
sur la vie entière.
Diverses études ont montré des lacunes dans la prise en
charge des patients déprimés, en particulier en soins pri-
maires. Cette pathologie est insuffisamment diagnostiquée,
de nombreux patients présentant un état dépressif caracté-
risé ne bénéficient pas d’une prescription d’antidépresseur
et de nombreux patients ayant débuté un traitement
présentent une mauvaise observance médicamenteuse
[1].
La prise en charge des troubles dépressifs s’effectue
principalement par les médecins généralistes, puisqu’ils
sont à l’origine de plus des deux tiers des prescriptions
d’antidépresseurs. Les perspectives démographiques de
diminution drastique du nombre de psychiatres dans les
années à venir ne peuvent qu’amplifier cette tendance.
Or les médecins généralistes rencontrent des difficultés
diverses dans la prise en charge des patients déprimés. Ils se
sentent encore, malgré des efforts en terme de formation
initiale et d’enseignement postuniversitaire, insuffisam-
ment formés à la clinique et à la thérapeutique des troubles
dépressifs, en particulier en cas de comorbidité. La prescrip-
tion de tranquillisants benzodiazépiniques ou d’hypnotiques
reste fréquente chez les patients déprimés, en lieu et place
des antidépresseurs. Le temps de consultation nécessaire
pour une bonne prise en charge d’un patient déprimé,
surtout lors des consultations initiales, n’est pas pris en
compte par le système de soins. De plus, les médecins
généralistes ne connaissent pas toujours de fac¸on pré-
cise les possibilités pour un accès facile à une prise en
charge psychiatrique (consultations hospitalières, centres
médicopsychologiques...).
Enfin, la polémique récente sur les effets délétères des
antidépresseurs et la réactivation du risque suicidaire par
les sérotoninergiques en début de traitement ne peut que
freiner la prescription d’antidépresseur, aussi bien sous
la pression des patients que par les craintes des prati-
ciens. Or il est clair que le risque suicidaire lié à une
dépression non traitée excède de loin celui du risque sui-
cidaire lié aux antidépresseurs [2] et il a par exemple
été bien montré aux États-Unis que l’alerte de la FDA
sur le risque suicidaire chez les enfants sous traitement
antidépresseur non seulement a diminué les prescriptions
d’antidépresseurs en soins primaires, mais a également
diminué le nombre de diagnostics de dépression [3], les pra-
ticiens préférant éviter de diagnostiquer la dépression pour
ne pas s’exposer à la «tenaille »médicolégale du risque sui-
cidaire par prescription et par défaut de prescription de
l’antidépresseur...

L’alliance thérapeutique au début d’une prise en charge pour dépression par le généraliste 207
Méthode
Afin de préciser les modalités de déroulement des consulta-
tions initiales pour dépression par le médecin généraliste,
une enquête-miroir a été menée concernant la perception
et le vécu de la pathologie, la relation médecin—malade
et l’histoire et la perception des consultations initiales, en
recueillant en parallèle le point de vue du médecin et le
point de vue du patient.
Un échantillon représentatif (corrigé selon le sexe, l’âge
et la région d’exercice) de 300 médecins généralistes a
été recruté après contact par téléphone (travail mené par
l’agence TNS-Sofres Healthcare) ; il a été proposé à ceux
qui voyaient au moins cinq patients déprimés par semaine
de participer à l’enquête, chaque médecin devant renvoyer
trois à huit dossiers patients. La période d’inclusion durait
15 jours, durant lesquels les médecins participants devaient
proposer l’enquête à tous leurs patients pour lesquels ils
avaient eux-mêmes porté et communiqué le diagnostic de
dépression au cours des trois derniers mois.
Au total, 110 médecins ont renvoyé au moins un dos-
sier. Un questionnaire de pratique générale était rempli par
chaque médecin, de même qu’un registre recensant tous
les patients déprimés vus en consultation durant la période
d’inclusion. Pour chaque inclusion, le médecin et le patient
remplissaient un questionnaire en miroir, le volet patient
étant mis sous enveloppe cacheté et placé dans une urne
afin de garantir l’anonymat.
Résultats
Un total de 598 patients (172 hommes et 426 femmes) ont
été inclus. Pour 340 d’entre eux, l’épisode index était le pre-
mier épisode dépressif, pour 133 il s’agissait d’une rechute
de moins de sept ans et pour 116 d’une rechute de plus de
sept ans ; 112 patients étaient considérés comme présentant
un épisode dépressif sévère. L’âge moyen des patients inclus
était de 51 ans, avec une surreprésentation de la tranche
d’âge 35—65 ans (61 % de l’échantillon, contre 47 % dans la
population franc¸aise) ; 53 % des patients vivaient maritale-
ment, 56 % étaient en activité professionnelle.
L’origine supposée de la dépression a été recherchée chez
les patients et chez les médecins, montrant une remar-
quable concordance. Les patients déclarent connaître la
cause de leur dépression dans 76 % des cas : ils l’attribuent
alors dans 42 % des cas à un problème familial (plus fré-
quemment chez les femmes), dans 26 % à un problème
professionnel (plus fréquemment chez les hommes) et dans
13 % à une maladie somatique. De même, les médecins consi-
dèrent qu’il s’agit d’une dépression réactionnelle liée à la
famille dans 40 % des cas, liée au travail dans 24 % des cas,
liée à une pathologie médicale ou secondaire à une patholo-
gie somatique dans 12 % des cas ; ils évoquent une dépression
masquée dans 8 % des cas, une dépression récurrente dans
7 % et une dépression associée à un trouble de la personnalité
ou à un alcoolisme dans 7 % également.
L’évaluation de la sévérité de la dépression a été
demandée aux médecins et aux patients (avec des termes
légèrement différents) : 90 % des patients répondaient que
leur dépression était légère ou modérée et 9 % grave ou
très grave ; dans 81 % des cas, les médecins jugeaient la
dépression légère ou modérée, dans 19 % des cas sévère. La
comparaison des questionnaires grâce à un numéro permet-
tant de les apparier montre que les patients ont tendance à
sous-estimer le niveau de sévérité de leur maladie, puisque
30 % des patients considérés en épisode modéré ou sévère
par leur médecin jugent eux-mêmes leur dépression plutôt
légère.
Les informations anamnestiques sur le nombre d’épisodes
dépressifs antérieurs montre un parallélisme entre le décla-
ratif des patients et celui des médecins : dans 56 % des
cas selon les patients et dans 57 % selon les médecins, il
s’agissait d’un premier épisode. En cas de dépression récur-
rente, le premier épisode dépressif remontait à 10,4 ans en
moyenne selon les patients, à 8,8 ans en moyenne selon les
médecins. La même concordance est retrouvée en ce qui
concerne le nombre moyen d’épisodes antérieurs (2,8 épi-
sodes en moyenne d’après les patients comme d’après les
médecins, les patients déclarant dans 33 % des cas un seul
épisode antérieur et les médecins dans 30 % des cas).
Les médecins et la maladie dépressive
Concernant le niveau d’information sur la dépression, 39 %
des médecins généralistes participant à cette enquête se
disent très bien ou plutôt bien informés, 56 % se disent plutôt
mal ou très mal informés. Ce niveau apparaît d’autant plus
préoccupant qu’on peut considérer que les médecins partici-
pant à l’étude (un sur 15 initialement contactés) font partie
de ceux qui sont le plus sensibilisés à cette pathologie : en
effet, ces médecins sont 76 % à trouver plutôt intéressant
ou très intéressant le domaine de la dépression. En croisant
ces deux données, on constate que 40 % des médecins géné-
ralistes intéressés par la dépression se sentent mal informés
sur le sujet.
Concernant les traitements antidépresseurs, ils sont 95 %
à considérer être bien informés et 95 % également à déclarer
un intérêt pour ces traitements. Les médecins généralistes
apparaissent donc plus demandeurs de formation sur la cli-
nique de la dépression que sur les traitements. Un quart des
médecins seulement déclarent avoir très souvent des doutes
et des hésitations dans leur stratégie thérapeutique pour
les patients déprimés. De même, seuls 15 % des médecins
déclarent ne recourir aux antidépresseurs qu’après avoir
essayé d’autres alternatives thérapeutiques (comme la psy-
chothérapie, les oligoéléments...).
Chez leurs patients déprimés, ils considèrent que le diag-
nostic est pour eux difficile à porter dans un quart des cas.
Ils connaissent souvent au moins un outil d’aide au diag-
nostic sur les quatre suggérés par le questionnaire (critères
DSM-IV, critères ICD 10, échelle Ham-D, questionnaire MINI),
puisque seuls 15 % déclarent n’en connaître aucun. On peut
d’ailleurs relever que le pari de l’OMS de proposer une clas-
sification universelle, plus largement utilisable que le DSM,
est un échec, puisque 70 % des MG déclarent connaître les
critères du DSM-IV, contre 19 % ceux de l’ICD 10 (portant très
proches désormais)... Parmi ceux qui connaissent au moins
un outil diagnostique, 60 à 70 % (selon le test) l’estiment
utile et 30 à 40 % déclarent l’utiliser souvent.
Concernant la précocité du diagnostic, la majorité des
médecins (61 %) pensent que seuls les diagnostics précoces
permettent une prise en charge efficace.

208 P. Frémont et al.
La dépression masquée est l’une des préoccupation des
médecins. Face à une dépression masquée, 84 % des méde-
cins demandent des examens complémentaires et deux sur
trois en attendent le résultat avant de prescrire des antidé-
presseurs.
Dans le domaine thérapeutique, 90 % des médecins
pensent que les traitements antidépresseurs qui existent
aujourd’hui permettent de bien soigner la majorité des
patients déprimés et 95 % qu’ils participent de manière effi-
cace à la rémission. Enfin, les médecins sont également
95 % à estimer que l’observance thérapeutique participe de
manière efficace à la rémission.
Les médecins conseillent à 30 % de leurs patients dépri-
més d’entreprendre une psychothérapie : 17 % sont adressés
à un psychiatre, 5 % à un psychothérapeute, 7 % à un
psychologue ; mais ils pensent que seuls 15 % de leurs
patients déprimés en entreprennent effectivement une. Les
médecins sont 63 % à s’estimer mal informés sur les psycho-
thérapies, mais 71 % à trouver ce sujet intéressant : l’analyse
conjointe des réponses à ces deux questions montre qu’ils
sont ainsi 42 % à trouver le sujet intéressant mais à être mal
informé.
Ils sont 78 % à estimer que le suivi d’une psychothérapie
est un élément efficace de rémission du patient déprimé.
Enfin, ils sont 85 % à estimer que l’attitude de l’entourage
est un élément qui peut participer de fac¸on efficace à la
rémission.
Concernant la relation thérapeutique, 95 % des méde-
cins estiment que la qualité relationnelle participe de
manière efficace à la rémission. Les deux tiers des médecins
s’estiment bien informés sur la fac¸on de gérer la relation
thérapeutique avec un déprimé et 88 % trouvent ce sujet
intéressant : ainsi, un quart des médecins sont intéressés,
mais se sentent insuffisamment informés.
Près de 30 % des médecins estiment qu’aujourd’hui, il
n’est pas possible de soigner efficacement tout type de
patient déprimé, ce qui dénote un optimisme probablement
exagéré de la part de nos collègues généralistes.
Ils sont un sur quatre à ne pas se sentir suffisamment
bien formés pour vraiment bien prendre en charge des
dépressions, mais 90 % à contester que les patients dépri-
més nécessitent une prise en charge qui n’est pas de leur
ressort.
La consultation pour dépression chez le généraliste
Les médecins s’accordent sur la nécessité de prendre le
temps d’écouter un patient déprimé même si c’est long :
c’est ce que répondent 94 % des médecins. Ils déclarent avoir
fait, dans 30 % des cas, des examens cliniques ou biologiques
pour écarter une autre pathologie, ce qu’ils expliquent bien
à leurs patients puisque 29 % de ces derniers déclarent la
même chose.
L’annonce du diagnostic de dépression ne semble pas trop
difficile pour les médecins : le nombre moyen de consulta-
tions avant l’annonce est de 1,8 et dans plus de la moitié
des cas, cette annonce est faite dès la première consulta-
tion. Les médecins ont déclaré seulement dans 15 % des cas
que l’annonce du diagnostic a été difficile ou plutôt diffi-
cile. Des chiffres similaires sont retrouvés lorsqu’on pose la
même question en miroir aux patients.
Les patients considèrent dans 47 % des cas que le méde-
cin a pris son temps, lors de la consultation d’annonce, le
mot de dépression ne survenant qu’après un long proces-
sus de discussion ; la question posée en miroir aux médecins
montre qu’ils ne déclarent que dans 40 % des cas avoir pris
leur temps pour l’annoncer, laissant peut-être paraître une
certaine frustration de ne pouvoir consacrer assez de temps
à leurs patients déprimés.
Le vécu des patients
La grande majorité des patients (82 %) déclarent qu’ils
avaient pressenti qu’ils présentaient une dépression, avant
l’annonce du diagnostic par le médecin ; dans la question-
miroir, les médecins rapportent également, dans 83 % des
cas, que leur patient pressentait le diagnostic avant qu’ils ne
lui en parlent. En revanche, seuls 35 % des patients ont cher-
ché à s’informer sur la dépression, les moyens d’information
étant, à part égale, la presse, Internet et la télévision.
Un patient sur trois dit avoir accepté plutôt difficile-
ment ou très difficilement le diagnostic de dépression, mais
cette proportion s’élève à 67 %, lorsqu’on ne considère
que les patients pour lesquels le médecin estimait diffi-
cile l’annonce du diagnostic. Deux patients sur trois disent
l’avoir accepté plutôt facilement ou très facilement et cette
proportion s’élève à trois sur quatre parmi les patients qui
disaient avoir pressenti le diagnostic.
Fait important, l’acceptation du diagnostic par le patient
est, pour 94 % des médecins, un élément favorisant la rémis-
sion.
Le traitement de la dépression
Les médecins déclarent dans environ 90 % des cas prescrire
un traitement à leur patient : un antidépresseur dans 84 %
des cas (96 % des cas de dépression sévère), un anxiolytique
dans 54 %, un hypnotique dans 24 %. À la question en miroir,
les patients déclarent à 86 % qu’ils prennent un traitement
pour leur dépression, 12 % déclarent qu’ils n’en prennent
pas.
Le nombre moyen de consultations avant la mise en place
d’un traitement est de 1,8, c’est-à-dire le même que pour
l’annonce du diagnostic ; de la même fac¸on, dans plus de
la moitié des cas le traitement est prescrit dès la première
consultation.
Les patients déclarent accepter facilement le traitement
qui leur a été prescrit pour la dépression ; 19 % déclarent
l’avoir accepté difficilement et 12 % ne pas le suivre... En
miroir, les médecins considèrent dans 13 % des cas que le
patient a accepté difficilement le traitement et dans 10 %
des cas qu’il ne le suit pas : ils ne surestiment donc que très
peu l’adhésion du patient au traitement antidépresseur.
Les médecins estiment dans 87 % des cas avoir parlé au
patient des bénéfices et des effets secondaires des trai-
tements, mais, en miroir, les patients ne sont que 63 % à
déclarer que leur médecin leur a parlé des effets secon-
daires. D’une fac¸on générale, 85 % des patients se déclarent
globalement satisfaits par le traitement médicamenteux et
les médecins se déclarent dans 88 % des cas satisfaits de
la réaction du patient au traitement. Lorsqu’on croise ces
réponses, on retrouve dans 70 % des cas une satisfaction à la

L’alliance thérapeutique au début d’une prise en charge pour dépression par le généraliste 209
fois du médecin et du patient, dans 4 % des cas un patient
satisfait mais un médecin insatisfait, dans 5 % des cas un
médecin satisfait mais un patient insatisfait et dans 3 % des
cas une insatisfaction à la fois du médecin et du patient.
Ce taux de 12 % des «couples thérapeutiques »dans les-
quels l’un au moins est insatisfait s’élève à 24 % en cas de
dépression sévère.
En ce qui concerne les psychothérapies, 33 % des patients
disent avoir cherché à être suivis, dont 73 % sur les conseils
de leur médecin généraliste, tandis que les médecins
déclarent dans 35 % des cas avoir conseillé au patient un
suivi psychothérapique.
L’entourage
Les patients de l’enquête se sentent globalement bien
entourés, puisqu’ils sont 64 % à déclarer être très entourés
ou plutôt entourés par des proches : 57 % ont le sentiment
que leur entourage est compréhensif et les soutient, 7 %
qu’ils sont entourés mais sans soutien. Le point de vue des
médecins est proche, puisqu’ils estiment dans 51 % des cas
que leur patient bénéficie d’un entourage aidant.
Le soutien de l’entourage consiste en amont à inciter à
aller consulter (c’est le cas pour 81 % des patients entourés)
et en aval à suivre correctement le traitement prescrit par
le médecin (c’est le cas pour 84 % des patients entourés).
La relation médecin—malade
La relation thérapeutique dans la prise en charge d’une
dépression est généralement de bonne qualité : 64 % des
patients déclarent attendre beaucoup de leur médecin et
de leur traitement, 69 % estiment que leur médecin s’appuie
aussi sur eux pour la guérison et 60 % pensent qu’il s’agit
d’une aventure à deux, chacun participant au résultat. Cela
est corroboré par les déclarations des médecins, qui pensent
dans 76 % des cas qu’ils sont dans une vraie relation de
partenariat avec leur patient. Les patients pensent dans
82 % des cas que leur médecin comprend leurs préoccupa-
tions et les comprend et dans 90 % des cas qu’il prend soin
d’eux. Les médecins, quant à eux, estiment dans 82 % des
cas qu’ils doivent particulièrement encourager et rassurer
leur patient.
Les patients sont 90 % à estimer que leur médecin est clair
dans ses explications ; les médecins pensent dans 59 % des
cas que leur patient a besoin de beaucoup d’explications
et dans 60 % des cas qu’il est compréhensif en cas de
doute.
Un autre indice de satisfaction des patients est le temps
d’écoute de leur médecin : ils sont 81 % à le trouver très dis-
ponible et 88 % à estimer qu’il prend le temps de les écouter.
En miroir, les médecins estiment dans 62 % des cas que leur
patient leur prend beaucoup de temps et dans 63 % des cas
qu’il cherche toujours plus d’écoute. En croisant ces don-
nées, on retrouve que 37 % des patients sont satisfaits de
l’écoute de leur médecin quand celui-ci estime qu’ils ne lui
prennent pas trop de temps.
L’une des composantes de la relation thérapeutique est
la transparence des informations délivrées. Au total, 63 %
des patients affirment ne rien cacher à leur médecin et en
miroir, les médecins pensent dans 68 % des cas que le patient
ne leur cache rien. Le croisement de ces deux variables
montre que le taux de concordance reste perfectible : pour
les cas où le médecin pense que son patient ne lui cache
rien, le patient déclare dans 25 % des cas lui cacher quelque
chose et pour les cas où le médecin pense que son patient
lui cache des choses, le patient déclare dans 38 % des cas ne
rien lui cacher.
Les patients qui cachent des choses à leur médecin le
font dans 44 % des cas par crainte d’une prise en charge plus
lourde, dans 32 % des cas par crainte de reproches et dans
26 % des cas en raison d’une mauvaise observance.
La transparence doit être à double sens : ainsi, 76 % des
patients pensent que leur médecin leur dit tout, alors que
les médecins affirment seulement dans 54 % des cas tout dire
à leur patient, y compris leurs hésitations, en particulier par
crainte d’être trop anxiogène (59 % des cas).
La gravité de la maladie est souvent difficile à présenter
au malade : les médecins affirment dans 45 % des cas avoir
minimisé la gravité de la maladie pour ne pas affoler leur
patient ; en miroir, les patients sont 37 % à penser que leur
médecin a minimisé la gravité pour ne pas les affoler ; dans
les deux tiers des cas ce ressenti concorde avec l’affirmation
de leur médecin.
Les risques graves sont également difficiles à exprimer
pour le médecin : face à six patients sur dix, ils n’ont pu
parler à leur patient des risques graves tels que les tenta-
tives de suicide ; cette proportion n’est plus que de quatre
sur dix en cas de dépression sévère.
Satisfaction globale quant à la prise en charge
D’une manière générale, les patients se déclarent satisfaits
de la prise en charge : 42 % d’entre eux se déclarent très
satisfaits et 52 % plutôt satisfaits, soit 94 % au total. Le res-
senti des médecins est similaire (ils se disent satisfaits de
manière globale des consultations avec le patient dans 88 %
des cas) : en croisant les données, on retrouve dans 85 % des
cas qu’à la fois le médecin et le patient sont satisfaits, dans
9 % des cas une non-concordance (patient satisfait mais pas
le médecin dans 8 %, patient insatisfait et médecin satisfait
dans 1 %) et seulement dans 3 % des cas une insatisfaction à
la fois du médecin et du patient.
Typologie de la relation médecin—malade
En établissant, à travers cette enquête, une typolo-
gie de la relation médecin—malade, l’objectif principal
était d’identifier des groupes homogènes de couples
patient—médecin selon leurs caractéristiques. Une analyse
factorielle en composantes multiples a été réalisée afin
d’homogénéiser les variables actives (21 variables retenues
parmi celles décrites ci-dessus) et d’obtenir des regroupe-
ments préalables d’individus. Puis une classification mixte a
été construite où les individus d’une même classe devaient
être proches en terme de profil et deux individus de deux
classes distinctes devaient être éloignés, cela tout en mini-
misant le nombre de classes.
Cette méthodologie a permis d’identifier quatre types de
binômes patient—médecin, à partir des 598 binômes pour
lesquels étaient disponibles le volet médecin et le volet
patient.
 6
6
1
/
6
100%