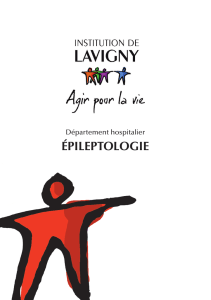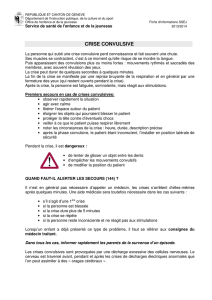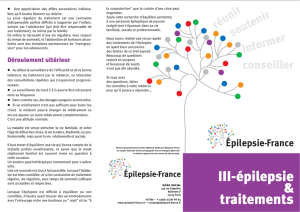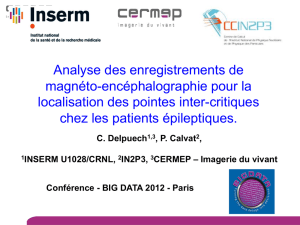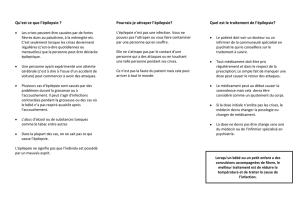Epilepsie et inflammation - site de l`association GENS

182 Neurologies • Mai 2013 • vol. 16 • numéro 158
spécial aaN épilepsies
LES HYPOTHÈSES
ET LES ARGUMENTS
EXPÉRIMENTAUX
Annamaria Vezzani, Milan [1]
On sait que, lors de pathologies
cérébrales, des molécules endo-
gènes libérées peuvent activer cer-
tains récepteurs impliqués dans
la réponse immunitaire. Ainsi,
les récepteurs Toll-like (TLR) ou
les récepteurs à l’interleukine 1
(IL1R) peuvent être activés res-
pectivement par l’HMGB1 et l’IL-
1ß, ce qui entraîne une activation
de la transcription de cytokines, de
la cascade mTOR, du complément,
de COX2, de molécules d’adhésion
et de métalloprotéines… Dans le
cas de l’épilepsie, l’hypothèse est
que l’hyperexcitabilité neuronale
puisse provoquer une libération
de ces médiateurs et être ainsi à
l’origine d’une réaction proinflam-
matoire entraînant une anomalie
de la barrière hémato-encépha-
lique qui, à son tour, aggraverait
l’hyper excitabilité neuronale
(Fig. 1)
.
QUELLES ÉVIDENCES
A-T-ON D’UNE ACTIVATION
DES PROCESSUS IMMUNITAIRES
DANS L’ÉPILEPSIE HUMAINE ?
L’IL-1ß est augmentée dans le lobe
temporal de patients porteurs
d’une épilepsie par rapport aux
contrôles, ainsi que dans les dys-
plasies corticales focales de type 2,
et ce au niveau des neurones et des
astrocytes. Cette augmentation
s’accompagne d’une rupture de la
barrière hémato-encéphalique.
On retrouve cette activation dans
des modèles expérimentaux d’épi-
lepsie. De même, l’HMGB1 est une
molécule endogène qui facilite la
transcription de gènes, et agit en
extracellulaire comme une molé-
cule proinflammatoire. Elle est
Inflammation et épilepsie
Une nouvelle approche thérapeutique ?
n
Toute une session [1], ainsi que des posters, ont été consacrés aux liens complexes qu’en-
tretiennent inflammation au niveau du système nerveux central et épilepsie. Une meilleure
connaissance de ces phénomènes semble faire espérer l’apparition de traitements agissant
sur l’épileptogenèse, et pas seulement sur les crises.
Cécile Marchal*
*Service de neurologie A, CHU de Bordeaux
Microglie
Ischémie
Cellules
endothéliales
Astrocyte
Synapse
Monocytes/Macrophages
Cytokines de l'inammation
intégrité de la BHE
intégrité de la BHE
Monocytes/Macrophages
Cytokines de l'inammation
Albumine
IL-1β
IL-1β/
HMGβ1
IL-1β/
HMGβ1
TGFβ
TGFβR
TGFβR
IL-1β/
HMGβ1
IL-1R
TLR
RAGE
IL-1R
TLR
RAGE
Crise
Inammation
transport du glutamate
Kir 4.1
signaux
GABAergiques
Neurone
Microglie
Figure 1 - L’albumine entrée par la BHE lésée est captée par les astrocytes, activant la
voie TGFß et déclenchant une réponse inflammatoire et un dysfonctionnement des
astrocytes. Ceci, en retour, module l’unité neurovasculaire et facilite l’épileptoge-
nèse. L’activité épileptique hypersynchrone elle-même entraîne la production et la
libération de médiateurs de l’inflammation et perturbe ainsi la BHE. Les molécules de
l’inflammation, IL-1ß et HMGB1, contribuent au début et à la persistance des crises,
d’une part en agissant sur leurs récepteurs spécifiques (IL-1R, TLR, RAGE) surexprimés
par les neurones impliqués et, d’autre part, par leur effet autocrine sur les astrocytes,
en induisant une promotion des gènes de l’inflammation. D’après Frigerio et al. [10].

Neurologies • Mai 2013 • vol. 16 • numéro 158 183
épilepsies spécial aaN
activée dans les astrocytes et les
neurones dysmorphiques des dys-
plasies corticales focales de type
2b, ainsi que l’expression de son
récepteur TLR4. Le même phéno-
mène est observé dans les épilep-
sies temporales et l’encéphalite de
Rasmussen.
QUELLES SONT LES
CONSÉQUENCES
FONCTIONNELLES D’UNE
INFLAMMATION CÉRÉBRALE ?
L’activation des récepteurs cités
plus haut par leur ligand endogène
va entraîner une augmentation
des entrées de Ca dans la cellule
par phosphorylation de la sous-
unité NR2B du récepteur NMDA,
ce qui va augmenter l’excitabilité
cellulaire. De même, Bernard et
al. ont montré la possibilité de
canalopathies acquises (HCN1
par exemple) secondaires à cette
activation. Par ailleurs, il semble
que les astrocytes périvasculaires,
situés à l’interface entre les neu-
rones et les cellules endothé-
liales, puissent jouer un rôle dans
l’épileptogenèse, en entretenant
l’inflammation et, du même coup,
l’augmentation anormale de la
perméabilité de la barrière héma-
to-encéphalique. Or il a été montré
que le passage anormal d’albumine
pouvait à son tour déclencher une
réaction inflammatoire et facili-
ter la survenue de crises en aug-
mentant la sécrétion d’IL-1ß et de
HMGB1.
LES ANTI-INFLAMMATOIRES
ONT-ILS UN EFFET
ANTICONVULSIVANT ?
De façon empirique, on connaît
depuis longtemps l’ecacité des
corticoïdes dans les spasmes infan-
tiles et des immunoglobulines IV
dans certains syndromes pharma-
corésistants. Dans les modèles ani-
maux d’épilepsie aussi divers que
l’injection de kaïnate, le kindling
et les rats GAERS, les anti-inflam-
matoires ont montré une ecacité,
avec une diminution des crises de
50 à 70% et une augmentation du
délai d’apparition des crises. Plus
récemment, a été testé un inhibi-
teur de la synthèse de l’IL-Rß, le
Vx 765, avec lequel a été notée une
diminution de la fréquence des
crises et des lésions histologiques
d’inflammation. Quant à un rôle
antiépileptogène, il a été testé en
administrant des anti-inflamma-
toires pendant la période latente
entre la lésion initiale et la surve-
nue de crises. Dans les modèles
animaux testés, le traitement ne
supprime pas les crises, mais modi-
fie leur intensité et leur fréquence.
Enfin, un poster original [2] a
regardé le délai de survenue des
crises en vidéo-EEG selon que
les patients prenaient ou non de
l’aspirine. Les patients présen-
tant une épilepsie partielle sous
aspirine (n = 24) avaient moins
de crises enregistrées à J2 que les
patients sans aspirine, de façon
significative. Par contre, l’eet de
l’aspirine n’était pas retrouvé chez
les patients ayant des crises non
épileptiques.
LES SYNDROMES
HUMAINS
Orrin Devinsky, New York [1]
LES MALADIES SYSTÉMIQUES
Elles s’accompagnent fréquem-
ment d’une épilepsie, par des
mécanismes variables : vascu-
laire, métabolique, autoimmun,
iatrogène… On peut citer le lupus
érythémateux disséminé, dans
lequel la présence d’antiphospho-
lipides est corrélée à l’existence
d’une épilepsie et d’une vascula-
rite. L’encéphalite de Hashimato
est une entité discutée qui com-
porte une encéphalopathie subai-
guë, à rechutes, avec déficits d’al-
lure pseudo-vasculaire et crises,
troubles psychiatriques, cogni-
tifs, répondant aux corticoïdes.
De façon générale, le traitement
des crises survenant au cours des
maladies inflammatoires systé-
miques doit comporter à la fois un
anticonvulsivant et un traitement
immunomodulateur par corti-
coïdes et/ou IgIV et/ou plasma-
phérèses.
L’ENCÉPHALITE
DE RASMUSSEN
Elle se manifeste le plus sou-
vent (56 à 92 % des cas selon les
séries) par une épilepsie partielle
continue, puis un déficit moteur
progressif avec ou sans troubles
phasiques, et troubles cognitifs.
L’âge de début se situe le plus sou-
vent autour de 6 ans, rarement
chez l’adulte. Des anomalies de
l’immunité humorale (anticorps
anti-GluR3) et surtout cellulaire
sont décrites, avec un taux de cel-
lules CD8 cytotoxiques élevé. Sur
le plan histologique, elle se carac-
térise par une atrophie au niveau
d’un hémisphère avec présence de
nodules de microglie.
LES ENCÉPHALITES LIMBIQUES
PARANÉOPLASIQUES (Fig. 2)
Elles sont de description récente.
Elles associent le plus souvent
des crises, des troubles psychia-
triques et des troubles cognitifs
évoluant de façon subaiguë, avec
des tableaux variables selon les
anticorps en cause, de même que
le type de néoplasie auquel elles
sont associées
(Tab. 1)
. Ici aussi le
traitement repose sur les immu-
nomodulateurs.
Un poster de la session [3] a atti-
ré l’attention sur un aspect EEG
inconstant mais typique au cours
des encéphalites limbiques à AC
anti-NMDAR, décrit précédem-
ment chez 7 patients d’une série de
23 par Schmitt et al. [4], et ici chez

184 Neurologies • Mai 2013 • vol. 16 • numéro 158
spécial aaN épilepsies
un patient sur deux. Il s’agit d’un
extrême delta brush, caractérisé
par un rythme delta à 1-2 Hz sur
lequel se surimposent des bouf-
fées bêta à 18-30 Hz
(Fig. 3)
.
LE FIRES
Le FIRES est un tableau drama-
tique touchant le jeune enfant,
comportant des crises partielles
évoluant vers un état de mal sou-
vent pharmacorésistant, parfois
répondant au régime cétogène.
L’IRM retrouve initialement un
hypersignal temporal et extra-
temporal, puis une atrophie tem-
porale bilatérale si le patient sur-
vit. Chez le jeune adulte, le même
type de syndrome a été décrit sous
l’acronyme NORSE (new onset re-
fractory status epilepticus).
Un poster présenté ici [5] montre,
à partir de 6 patients (colligés
entre 1989 et 2012, soulignant la
rareté de ce syndrome) que le pro-
nostic semble dépendre de la pré-
cocité de la mise en route du trai-
tement immunosuppresseur (ici
du cyclophosphamide IV).
LE SYNDROME HÉMIPLÉGIE
HÉMICONVULSIONS
IDIOPATHIQUE (IHH)
Décrit par Henri Gastaut en 1957,
il se caractérise par la survenue
d’une hémiplégie en contexte de
fièvre prolongée, suivie d’hémi-
convulsions.
Deux types d’étiologies : les IHH
idiopathiques et les IHH sympto-
matiques survenant chez des en-
fants porteurs d’un Sturge-Weber,
d’un Bourneville ou d’une atrophie
cérébrale.
Figure 3 - Delta brush comportant une rythme delta à 1-2 Hz sur lequel se surimposent
des bouffées bêta à 18-30 Hz chez un patient porteur d’une encéphalite limbique à AC
anti-NMDAR.
Figure 2 - Encéphalite limbique à AC
anti-VGKC chez un homme de 61 ans.
L’IRM retrouve un hypersignal FLAIR
bi-hippocampique.
Tableau 1 - Syndromes et tumeurs le plus fréquemment associés aux encéphalites limbiques.
D’après Didelot et Honnorat [11].
Anti-NMDAR Psy, dysautonomie, mouvements anormaux Tératome ovarien (60 %), CPPC, TT
Anti-Hu EL, encéphalomyélite… CPPC (> 98 % des cas)
Anti-LGI1 EL pure, SIADH rare Rare, 5 à 20 %
Anti-CASPR2 Syndrome d’Isaac, EL pure, encéphalite,
chorée fibrillaire
Pas de cancer associé
Anti-GABAR EL pure, crises +++ CPPC (60 %)
Anti-MA2 EL, rhombencéphalite, syndrome cérébelleux Séminome testiculaire (53 %), CPPC
Anti-AMPAR EL pure, rechutes fréquentes Thymome malin, CPPC, CPnPC (75 %)
Anti-CV2/CRMP5 EL, encéphalomyélite CPPC (60 %), thymome malin (13 %)
Anti-Tr EL, syndrome cérébelleux Lymphome de Hodgkin
Anti-amphiphysine EL, encéphalomyélite Sein (80 %), CPPC (20 %)
Anti-GAD EL, Stiff man CPPC, thymome malin

Neurologies • Mai 2013 • vol. 16 • numéro 158 185
épilepsies spécial aaN
LES AUTRES ÉPILEPSIES
L’analyse histologique des pièces
de cortectomies consécutives,
réalisée chez 92 patients porteurs
d’une épilepsie partielle phar-
macorésistante, a montré une
activation de la microglie dans la
moitié des cas. Il est plus dicile
de déterminer un rôle éventuel de
l’inflammation dans les épilepsies
généralisées qui ne sont jamais
biopsiées. Néanmoins, des essais
d’immunothérapie dans certains
cas d’épilepsies pharmacorésis-
tantes se sont avérés positifs. Ce
qui n’est pas tranché reste la place
de l’inflammation dans la phar-
macorésistance : cause ou consé-
quence ?
Un poster [6] présenté dans la
même session porte sur 8 patients
atteints de syndrome d’Aicardi-
Goutières, c’est-à-dire d’une épi-
lepsie génétique, dans le sérum
desquels les auteurs retrouvent
néanmoins un taux significatif
d’anticorps dirigés contre des pep-
tides de protéines d’oligodendro-
cytes.
RÔLE DE LA BARRIÈRE
HÉMATO-ENCÉPHALIQUE
Daniela Kaufer, Berkeley [1]
La barrière hémato-encéphalique
(BHE) est une unité neur ovasculaire
composée de cellu les endothé-
liales, de microglie, d’astrocytes
et de neurones. Or des atteintes
de la BHE peuvent précéder le
développement d’une épilep-
sie, par exemple lors d’un AVC
ou d’une tumeur. La question est
donc de savoir si ces anomalies de
la BHE jouent un rôle dans l’épi-
leptogenèse. On peut reproduire
ce type de lésion chez l’animal,
par exemple en appliquant des
sels biliaires sur le cortex, ce qui
entraîne une lésion focale de la
BHE durable (plus de 15 jours).
Dans ces conditions, on observe
le développement d’une activité
épileptiforme hypersynchrone,
dépolarisante, qui se propage aux
cellules environnantes [7]. Il a été
montré ensuite que l’application
de sérum sur le cortex produisait
les mêmes eets et que, parmi les
composants du sérum, l’albumine
était en cause. En eet, l’applica-
tion d’albumine in vitro ou in vivo
entraîne une activité épilepti-
forme évoquée, propagée dans un
délai de 48 heures sur des tranches
en culture ou de 45 jours sur l’ani-
mal entier, qui présente alors des
crises convulsives. Le mécanisme
en serait l’accumulation d’albu-
mine dans les astrocytes (qui se
produit en 10 min in vitro) par
endocytose cavéole-médiée
(Fig. 4)
.
L’albumine se fixe sur le récepteur
au TGFß (TGFßR11) aboutissant à
une cascade de phosphorylation de
protéines smad. Les conséquences
en sont multiples au niveau des
astrocytes : diminution de l’ex-
pression des courants K+ entrants,
des transporteurs du glutamate,
des connexines et, à l’inverse, up-
régulation des cytokines et des
thrombospardines, ces dernières
ayant pour eet d’augmenter le
nombre de synapses excitatrices.
Il s’avère que, chez l’animal, il est
possible de bloquer ces eets de
l’application d’albumine par du
Losartan®. Si on peut démontrer
la même ecacité chez l’Homme,
il serait possible de traiter “pré-
ventivement” les patients céré-
brolésés présentant une rupture
de la BHE, ce qui peut être facile-
ment mesuré par l’importance de
la prise de contraste en imagerie
conventionnelle [8].
DE NOUVELLES
PERSPECTIVES
THÉRAPEUTIQUES ?
Jacqueline French, New York [1]
Dans la suite d’un essai réalisé
chez le rongeur (22 souris), et tout
en soulignant combien ces études
précliniques étaient succinctes,
l’auteur a rapporté les résultats
préliminaires chez l’Homme du
VX-765, prodrogue d’un inhibiteur
sélectif et réversible de l’enzyme
de conversion de l’IL1ß (VRT-
043198). L’essai, randomisé contre
placebo, chez des patients porteurs
d’une épilepsie pharmacorésis-
tante, a montré une ecacité mo-
deste de la molécule à l’étude, mais
qui devient significative à la fin de
la période de traitement, limitée à
6 semaines, avec un nombre de pa-
tients sans crise intéressant. Il est
donc possible qu’un certain délai
d’ecacité soit à prévoir.
Par ailleurs, un poster présenté
500
400
CTR
+ Albumine 2h
+ Albumine 24h
GFAP IL-1β
Nombre d'astrocytes
IL-1β positifs
300
200
100
0
Figure 4 - L’injection intraventriculaire d’albumine entraîne une augmentation du
nombre d’astrocytes exprimant l’IL-1ß dans l’hippocampe, mesurée 2h et 24h après
l’injection. D’après Frigerio et al [10].

186 Neurologies • Mai 2013 • vol. 16 • numéro 158
spécial aaN épilepsies
dans la même session [9] a re-
gardé les interactions possibles
entre la plupart des anticonvulsi-
vants et le VX-765. A l’issue des 6
semaines de traitement, les taux
sériques de VX-765 et de son mé-
tabolite n’étaient pas modifiés, de
même que les taux sériques des
anticonvulsivants pris par les su-
jets. Il ne semble donc pas y avoir
d’interaction médicamenteuse à
craindre avec cette molécule ou
son métabolite. n
Correspondance
Dr Cécile Marchal
Service de Neurologie A
Hôpital Pellegrin-Tripode
CHU de Bordeaux
Place Amélie Raba-Léon
33076 Bordeaux Cedex
E-mail : [email protected]
Mots-clés :
Epilepsie, Inflammation,
Epileptogenèse,
Barrière hémato-encéphalique,
Maladies systémiques,
Encéphalite de Rasmussen ,
Encéphalites limbiques paranéopla-
siques, FIRES,
Syndrome hémiplégie
hémiconvulsions idiopathique
1. Baram TZ, French J. Integrated Neurosciences Session. Inflammation in
epilepsy. 66th AAN Meeting, San Diego, March 16-23, 2013.
2. Godfred RM et al. Does aspirin use alter seizure collections during elec-
tive adult inpatient video EEG monitoring? 66th AAN Meeting, San Diego,
March 16-23, 2013 : IN9-1.003.
3. Juersivich A. Seeking the extreme delta brush: review of EEG data from
two cases of NMDA receptor-AB encephalitis. 66th AAN Meeting, San Die-
go, March 16-23, 2013 : IN9-1.008.
4. Schmitt SE, Pargeon K, Frechette ES et al. Extreme delta brush: a unique
EEG pattern in adults with anti-NMDA receptor encephalitis. Neurology
2012 ; 79 : 1094-100.
5. Kaneko J et al. Retrospective review of 6 patients with new-onset refrac-
tory status epilepticus (NORSE) syndrome: early intervention with intrave-
nous cyclophosphamide may improve outcome. 66th AAN Meeting, San
Diego, March 16-23, 2013 : IN9-2.001.
6. Vanderver A et al. CNS Reactive autoantibodies in Aicardi Goutières syn-
drome: autoimmunity in a genetic disease. 66th AAN Meeting, San Diego,
March 16-23, 2013 : [IN9-1.007]
7. Seiffert E, Dreier JP, Ivens S et al. Lasting blood-brain barrier disruption
induces epileptic focus in the rat somatosensory cortex. J Neurosci 2004 ;
24 : 7829-36.
8. Tomkins O, Shelef I, Kaizerman I et al. Blood-brain barrier disruption in
post-traumatic epilepsy. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2008 ; 79 : 774-7.
9. Chen YX et al. Evaluation of drug-drug interactions between VX-765
and common anti-epileptic medications in subjects with treatment-resis-
tant partial-onset epilepsy. 66th AAN Meeting, San Diego, March 16-23,
2013 : IN9-2.002.
10. Frigerio F, Karaca M, De Roo M et al. Deletion of glutamate dehydroge-
nase 1 (Glud1) in the central nervous system affects glutamate handling
without altering synaptic transmission. Epilepsia 2012 ; 53 : 1887-97.
11. Didelot A, Honnorat J. Paraneoplastic neurological syndromes. Rev
Med Interne 2011 ; 32 : 605-11
BiBliographie
• En bref
Référence : Ho K et al. SCN5A mutation positivity in a patient with juvenile myoclonic epilepsy and congenital long-QT syndrome type 3. 66th AAN
Meeting, San Diego, March 16-23, 2013: P05.090.
L’ÉPILEPSIE MYOCLONIQUE JUVÉNILE ET LE CŒUR: UN POSSIBLE RÔLE
DE LA MUTATION SCN5A DANS L’ÉPILEPTOGENÈSE?
La base génétique de l’épilepsie myoclonique juvénile
(EMJ) est hétérogène, et le phénotype reflète probable-
ment une interaction, à la fois connue mais non encore
identifiée, entre des facteurs génétiques et environne-
mentaux. L’EMJ est une épilepsie généralisée idiopa-
thique dans laquelle plusieurs gènes ont été impliqués,
dont GABRA1, GABRD, CACNB4, CLCN2, EFHC1.
LQT3 est un sous-type de syndrome du QT long congé-
nital, une maladie arythmogène qui peut prédisposer
à des syncopes et une mort cardiaque brutale. L’ana-
lyse génétique a confirmé la présence d’une mutation
1051G-> A dans l’exon 9 du gène SCN5A. Bien que la
présence d’une mutation SCN5A chez cette patiente
ne démontre pas une relation de cause à eet, cela
soulève la question d’un possible rôle dans l’épilepto-
genèse.
Mihaela Bustuchina Vlaicu
(Hôpital Pitié Salpêtrière, Paris)
1
/
5
100%