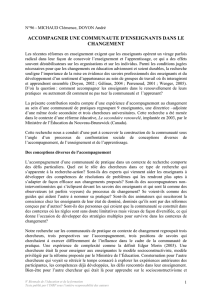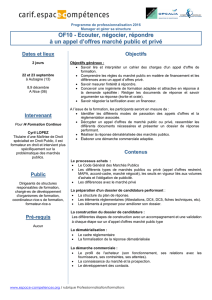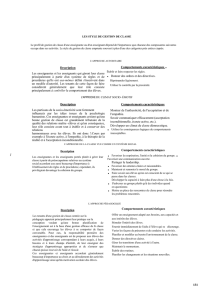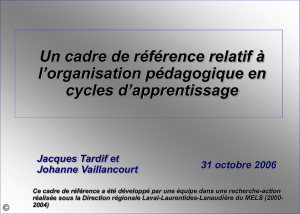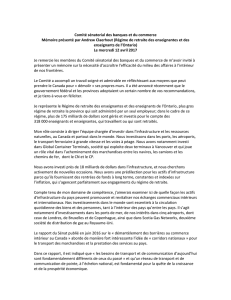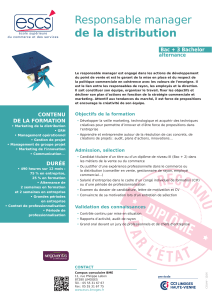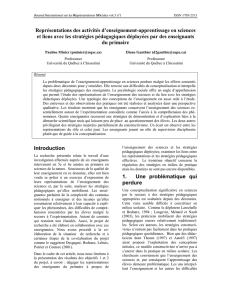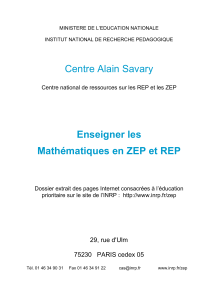La recension en pdf - Centre Alain Savary

Coordonner, collaborer, coopérer
De nouvelles pratiques enseignantes
Jean-François Marcel, Vincent Dupriez, Danièle Périsset Bagnoud, Maurice Tardif,
(sous la direction de), de Boeck, 2007, 206 p.
L’ouvrage, dirigé par un collectif, explore de nouvelles pratiques enseignantes. Celles-ci
reposent sur une dimension collective du travail, reléguant l’image traditionnelle de
l’enseignant isolé et individualiste dans son travail quotidien, qu’il s’agisse de préparer ou de
corriger les cours, ou d’enseigner de manière frontale face à une classe. Cette évolution du
métier est donc ici interrogée pour mieux comprendre ce qui se modifie, comment s’opèrent
ces transformations et quelles en sont les principales tensions en milieu scolaire. L’analyse
du travail collectif de ce livre, de telle ou telle activité en situation repose sur des études de
cas dont certaines sont particulièrement éclairantes sur la professionnalisation dans la
mesure où elles nous donnent à voir, au-delà des discours idéalistes, ce qui se passe
réellement sur le terrain. Il s’agit donc de voir comment de nouvelles pratiques enseignantes
définies par leur dimension collective sont ou non développées dans un établissement
scolaire alors que souvent la pratique de classe reste traditionnelle. Telle est la
problématique proposée.
Petit lexique
Par coordination, il faut entendre une nouvelle forme de travail conjoint reposant sur la
conception et la réalisation de projets communs. Elle fait l’objet de prescriptions d’ordre
administratif et hiérarchique à la différence des deux autres.
La collaboration se caractérise par la communication entre les acteurs concernés. Elle existe
quand des enseignants travaillent ensemble pour élaborer des objectifs, des projets, des
séances d’enseignement alors qu’ils restent seuls face à leurs classes.
Quant à la coopération, elle désigne la mutualisation du travail entre différents enseignants
qui vont œuvrer ensemble dans une situation d’enseignement face à des élèves. C’est le cas
lorsque, dans la classe, enseigne un maître surnuméraire. Cette dernière forme de travail
collectif est de loin la plus accomplie.
Aperçu des trois parties de l’ouvrage
Dans la première partie intitulée : « Nouvelles pratiques enseignantes et nouvelles
organisations », les auteurs respectifs des chapitres étudient principalement la nature et
l’objet de la collaboration entre enseignants, analyse les impacts du maître surnuméraire en
éducation prioritaire, les difficultés à collaborer sur des contenus disciplinaires spécialisés
dans les itinéraires de découverte au collège, appelés les IDD.
Dans la deuxième partie, « Nouvelles pratiques enseignantes et innovations », on découvre
que dans le cadre de l’éducation prioritaire, le processus de travail en équipe ne relève pas
d’une prescription de type descendant mais bien plutôt de type ascendant car les normes
professionnelles sont élaborées par les enseignants qui y adhèrent librement. Par ailleurs, il
est démontré que la collaboration entre enseignants relève d’un processus d’acculturation,
c’est-à-dire que les acteurs se retrouvent dans une dynamique de changement marqué par
l’acceptation de nouveaux codes culturels (connaissances, options ou croyances sur
l’environnement, soi-même…) différents des leurs. Ceci demande une période d’adaptation,
d’ajustements pour chacun. Enfin, on voit comment une équipe enseignante essaie de
résoudre l’échec scolaire dans une école primaire par l’instauration d’un cycle
d’apprentissage spécifique à la maîtrise de la lecture ; il s’agit de donner plus de temps aux
élèves, de leur permettre de travailler à des rythmes différents, ce qui profite particulièrement
aux élèves les plus en difficulté.
1
INRP, centre Alain Savary, 2008

Dans la troisième partie, intitulée « Nouvelles pratiques enseignantes et nouvelles
cognitions », on s’intéresse aux nouvelles connaissances et savoirs professionnels des
enseignants. Ceux-ci sont produits par ces nouvelles pratiques de dimension collective qui
permettent aux enseignants d’apprendre avec et par les autres dans des interactions.
Chaque chapitre apporte une contribution de chercheurs inscrits dans des cadres théoriques
variés de recherches et issus de laboratoires universitaires de différents pays : l’École
normale supérieure (ENS) de Cachan, le Centre de recherche sur l’éducation, les
apprentissages et la didactique (CRÉAD) de Rennes, l’École nationale de formation
agronomique (ENFA – éduc-agro) de Toulouse, le Centre d’études et de recherches en
sciences de l’éducation (CERSE) de Caen, l’université de Belgique, de Genève, du Canada.
Toutes ces contributions envisagent l’étude de ces pratiques innovantes en prenant en
considération les mêmes éléments qui sont : les caractéristiques de l’enseignant,
l’environnement dans lequel il travaille et l’action proprement dite en situation.
Historique du mouvement de professionnalisation de l’enseignement
Il est important de rappeler quand, où et comment s’inscrit le développement de la
professionnalisation. Il commence aux États-Unis au cours des années quatre-vingt. À la
suite de bouleversements sociopolitiques (crise du pétrole, émergence de TIC,
développement du néolibéralisme, etc.) on se met à interroger les formes organisationnelles
scolaires et les modes de gestion et on engage des réformes. Ce mouvement s’étend en
Europe. Vingt ans après, on retrouve les mêmes concepts et valeurs définissant l’identité
professionnelle, la formation enseignante, l’activité, etc. Ce modèle est hérité de la
profession médicale des États-Unis et des pays anglo-saxons dans la mesure où son
expertise dépend de ses connaissances et de ses compétences tirées de la recherche
scientifique. En Europe on privilégie les aspects cognitifs de la professionnalisation et moins
les aspects sociaux. Mais de nombreux changements ont eu lieu car les établissements ont
pris davantage d’autonomie et de responsabilité et les curriculums ont évolué (cycles
d’apprentissage, évaluation par compétences…). Durant les dix dernières années, les
réformes en France et aussi en Belgique, en Suisse francophone, accordent une importance
particulière à la professionnalisation collective des enseignants. C’est dans tout ce
mouvement historique qu’il faut situer les nouvelles pratiques enseignantes.
Les tensions caractérisant la professionnalisation enseignante
Pour présenter tout l’intérêt de cet ouvrage, nous retenons différents points de tension
générés par le travail collectif des enseignants que nous illustrerons par quelques exemples
du terrain.
Tensions entre le travail en classe et les pratiques collectives. Un exemple de
fonctionnement collectif opposé entre deux écoles primaires
Les pratiques collectives ne franchissent pas la porte de la classe et restent donc à la
périphérie. Le chercheur Vincent Dupriez1 montre à partir d’une comparaison entre deux
écoles primaires qui mènent un travail collectif fort différent que « l’intensité de la
collaboration entre enseignants semble être fortement liée aux pratiques pédagogiques
mises en place dans les écoles ».
Dans la première école primaire, l’apprentissage est organisé en cycles, l’enseignant
enseigne seul face à sa classe. Les parents n’ont pas la possibilité de rentrer dans l’école
1 chapitre I : « Quelles relations entre les formes organisationnelles et les formes de l’action au sein des
établissements ? » de Vincent Dupriez, p. 21-34.
2
INRP, centre Alain Savary, 2008

dès lors que leur enfant est âgé de six ans ; le travail pédagogique consiste à transmettre
des connaissances ; les enseignants ne se concertent pas ; les élèves en difficulté sont
intégrés dans un dispositif de remédiation particulier qui montre bel et bien que la pédagogie
classique fonctionne mal ; les enseignants ont d’ailleurs tendance à externaliser le problème
d’apprentissage de ces élèves en parlant par exemple de problèmes psychologiques. En
utilisant le concept de classification du sociologue Bernstein, le chercheur montre que cette
école offre un choix limité d’options entre le maître et l’élève et que les règles et les
frontières sont clairement délimitées. Le travail pédagogique y est affaire de transmission et
il est encadré par l’enseignant qui lui-même respecte le manuel, le programme.
Dans une autre école située dans un quartier sociologiquement marqué par la précarité,
avec un public hétérogène, le travail collectif est plus structuré et coordonné par la directrice
de l’école qui organise les réunions et a aussi un rôle d’animation et de suivi avec l’équipe
enseignante ; sur les questions pédagogiques, elle répond aux demandes et besoins des
enseignants ; les parents font partie de l’école. Tout en continuant à enseigner seuls devant
la classe, les enseignants ont mis en place pour des élèves en difficulté d’apprentissage des
groupes de besoin et des activités de tutorat ce qui demande une collaboration entre eux
plutôt intensive et aussi une coopération quand des enseignants se trouvent avec le même
groupe d’élèves. En reprenant le concept de classification de Bernstein, on voit qu’il s’agit
dans cette école d’un cadrage faible qui met en valeur la créativité et l’inventivité. Le travail
pédagogique est davantage centré sur l’intérêt et les besoins de l’élève. On peut en conclure
que la concertation revêt des sens différents. Dans un cas, elle vise à répartir les tâches ;
dans un autre à rechercher des solutions aux difficultés des élèves par les groupes de
besoin.
Tensions entre commande et nécessité. Les itinéraires de découverte au collège aux prises
avec des contradictions du système
Les réformes ont rendu obligatoire le travail collectif. Ces prescriptions ont produit des
collaborations de surface et des résistances chez les enseignants submergés par la charge
de travail, ce qui est difficilement conciliable avec une collaboration qui n’a pas assez de
sens pour leur pratique avec les élèves en classe.
Les itinéraires de découverte2 au collège demandent aux enseignants de travailler ensemble
et de faire apprendre à plusieurs. Les textes réglementaires précisent que « les itinéraires de
découverte doivent obligatoirement s’ancrer sur les programmes du cycle central et éviter
toute dérive vers des activités qui n’auraient pas pour finalité explicite des apprentissages
scolaires ». Ils mobilisent deux, voire trois enseignants travaillant en interdisciplinarité sur un
des quatre thèmes proposés (nature et corps humain ; arts et humanités, langues et
civilisations ; créations et techniques), à raison de deux heures hebdomadaires inscrites
dans l’emploi du temps des élèves. Mais l’ambiguïté de ces prescriptions apparaît entre les
objectifs visés de remédiation à l’échec scolaire, de pédagogie du détour et les moyens à
utiliser : démarche de projet, recherche documentaire… Dans huit cas sur dix, les IDD ou
itinéraires de découverte se font sans prendre en compte les contenus disciplinaires stricto
sensu. Les enseignants, qui le plus souvent se sont choisis par affinité, s’entendent sur le
projet à l’occasion de rencontres dans la salle des professeurs, puis reprennent leur
indépendance pour travailler de manière juxtaposée avec l’autre collègue. Il ne va pas de soi
de penser et réaliser un travail collaboratif en interdisciplinarité. On ne peut donc pas parler
de collaboration ou de coopération. Par ailleurs, dans la plupart des cas, les enseignants
ressemblent davantage à des éducateurs, des moniteurs. Il y a donc une difficulté à articuler
ce qui se fait dans ces activités avec le programme d’enseignement. À cela s’ajoute le fait
que le maintien de l’évaluation sommative ne porte pas sur le processus d’apprentissage des
2 Chapitre III : « Itinéraires de découverte au collège : des pratiques d’enseignement coordonnées face à des
“frontières de verre” » de Joël Lebeaume, p. 49-60.
3
INRP, centre Alain Savary, 2008

élèves mais sur leurs acquisitions. On aboutit ainsi à des contradictions entre forme scolaire
et ascolaire, entre contenus sur programmes et contenus adisciplinaires, etc. Pour en sortir,
il est nécessaire qu’évoluent en cohérence différents éléments du système dont les
organisations, les programmes et la forme scolaire.
Tensions entre savoirs individuels et savoirs collectifs. En quoi un projet collectif favorise-t-il
ou non l’acquisition de nouveaux savoirs professionnels ?
Les pratiques collectives enseignantes remettent en question les savoirs individuels
constitués dans l’acte pédagogique personnel et de manière contextualisée. Les chercheurs
parlent à ce titre de cognition partagée ou distribuée dans la mesure où elle s’élabore dans
les interactions entre enseignants, jalonnées de moments de conflits cognitifs et de points
d’accord entre des conceptions de nature pédagogique. L’idée principale est que
« l’enseignant apprend en travaillant ».
Dans l’étude de cas qui a retenu notre intérêt, il est question de deux collectifs d’enseignants
différents3. Le premier a en charge un projet sur la troisième d’insertion dans le but de
donner du sens aux apprentissages, et le deuxième, intitulé « délégués de classe » vise
l’éducation à la citoyenneté. Des contrastes saisissants apparaissent entre les deux sur
plusieurs points. D’abord les modalités de coordination diffèrent. Dans le premier projet, les
décisions sont prises par les coordonnateurs qui en informent les collègues ; l’engagement
des élèves est requis ; l’engagement plutôt faible des participants est restreint à des
réunions hebdomadaires ; le ressenti des élèves et des enseignants s’avère négatif. Dans le
deuxième projet, la présence des délégués et suppléants est obligatoire mais les élèves y
viennent sur la base du volontariat, les décisions sont débattues collectivement ;
l’engagement des élèves se fait sur la base du volontariat ; tous préparent le film, produit
final du projet et se montrent enthousiasme comme les enseignants qui envisagent un
prolongement. Le projet a pris de plus en plus d’ampleur et l’équipe enseignante a impulsé
une stratégie en rendant public par affichage dans le collège les productions intermédiaires
du projet. De toute évidence ce collectif d’enseignants a acquis des savoirs professionnels
car il a mobilisé des connaissances qu’il ne possédait pas avant cette expérience. En
travaillant conjointement, chaque enseignant a développé et enrichi ses savoirs
professionnels grâce à l’interaction. A contrario, dans le projet de troisième d’insertion, la
fonction du collectif d’enseignants s’est bornée à planifier de manière générale et chaque
enseignant restait isolé dans sa classe face aux élèves à faire le lien entre les réunions
hebdomadaires propres au projet et son enseignement en troisième d’insertion. Delà les
chercheurs se demandent si au lieu de parler de nouvelles pratiques enseignantes, il ne
vaudrait pas mieux établir une distinction entre le métier principal de l’enseignant et le métier
« émergent » hors de la classe.
Bilan : un nouveau champ de recherche est ouvert
Plusieurs conclusions s’imposent. D’abord on peut souligner que ces tensions gagneraient à
être réduites. L’évolution de la professionnalisation enseignante ne s’arrête pas aux seules
questions de pédagogie et devrait s’appuyer sur une réforme de l’organisation scolaire, de la
forme scolaire et des conditions de travail. Ensuite on peut regretter que les trois mots clés,
coordonner, collaborer, coopérer, figurant dans le titre de cet ouvrage, ne soient pas
davantage éclairés, analysés et discutés. Le terme de collaboration, le plus fréquent,
recouvre davantage la réalité décrite. En outre, on s’aperçoit que les expressions de « travail
en équipe » ou encore de « travail conjoint » sont fréquemment utilisées là où l’on attendait
les termes de collaboration, coordination et coopération enseignantes. Pourquoi ? On peut
faire l’hypothèse que sur le terrain, il n’est pas toujours aisé de distinguer ce qui est de
3 Chapitre IX : « “Nouvelles” pratiques enseignantes et développement professionnel » de Jean-François Marcel,
p. 130-142.
4
INRP, centre Alain Savary, 2008

l’ordre de la coordination, la collaboration, la coopération car le travail partagé peut dans une
même école, à un même moment, pour une même activité d’enseignement relever à la fois
de la coopération et de la collaboration par exemple. De plus, dans ces chapitres, si le terme
de collaboration est le plus fréquent, c’est que sans doute, cette pratique innovante apparaît
plus largement présente sur le terrain que les autres. On peut également regretter de ne pas
avoir vu comment des savoirs professionnels socialement construits hors de la classe étaient
mobilisés à l’intérieur de la classe. Il est sans doute trop tôt pour pouvoir conduire cette
étude.
On aura particulièrement apprécié que cet ouvrage aide le lecteur à réfléchir sur le
développement de la professionnalisation enseignante à partir de nombreuses études de cas
en multipliant les approches de la recherche. Un des intérêts de cet ouvrage est de nous
montrer que la professionnalisation enseignante en est à ses débuts et que sur le terrain,
elle rencontre nombre de difficultés. C’est dire combien ce champ de recherche scientifique
nouveau comme son objet a de beaux jours devant lui. Du moins, nous l’espérons !
Myriam Chéreau, chargée d'études au centre Alain Savary
5
INRP, centre Alain Savary, 2008
1
/
5
100%