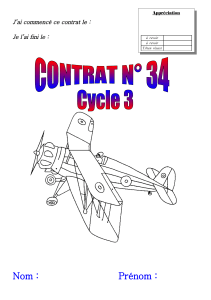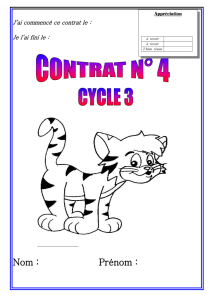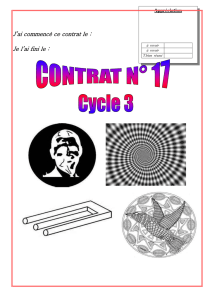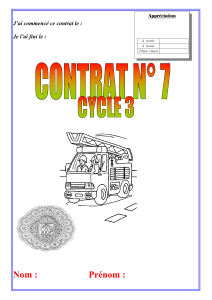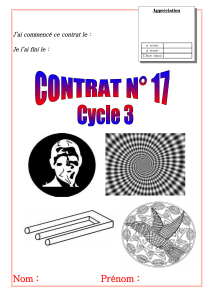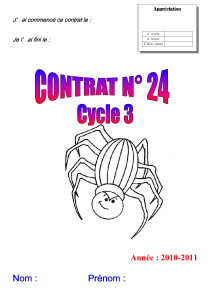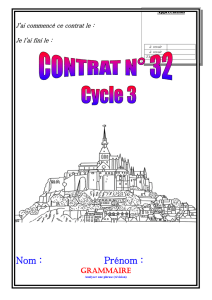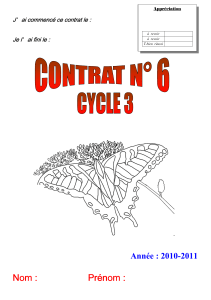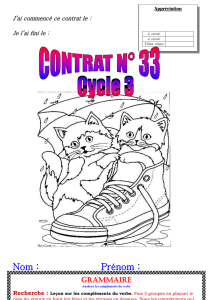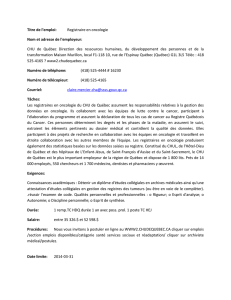A propos des GCO Les Groupes Coopérateurs en Oncologie

2
c/o 10 rue de la Grange-Batelière
75009 Paris
www.gco-cancer.org
A propos des GCO, version décembre 2015
Les groupes coopérateurs membres du réseau GCO
ARCAGY - GINECO, Association de Recherche sur les Cancers dont Gynécologiques.
Groupe d’Investigateurs Nationaux dans les Etudes des Cancers de l’Ovaire et sein
www.arcagy.org
FFCD, Fédération Francophone de Cancérologie Digestive
www.ffcd.fr
GERCOR, Groupe Coopérateur Multidisciplinaire en Oncologie
www.canceronet.com
GORTEC, Groupe d’Oncologie Radiothérapie Tête et Cou
www.gortec.fr
IFCT, Intergroupe Francophone de Cancérologie Thoracique
www.ifct.fr
LYSA, The Lymphona Study Association
www.lysa-lymphoma.org
LYSARC, The Lymphoma Academic Research Organisation
www.lysarc.org
IGCNO - ANOCEF, InterGroupe Coopérateur de Neuro-Oncologie
Association des Neuro-OnCologues d’Expression Française (groupe associé)
www.anocef.org
SFCE, Société Française de lutte contre les Cancers et les Leucémies de l'Enfant et de
l’Adolescent (groupe associé)
http://sfce.sfpediatrie.com/
IFM, Intergroupe Francophone du Myélome
www.myelome.fr

3
c/o 10 rue de la Grange-Batelière
75009 Paris
www.gco-cancer.org
A propos des GCO, version décembre 2015
A propos des Groupes Coopérateurs en Oncologie (GCO)
Des structures hyperspécialisées par domaine thérapeutique, sans équivalent
dans le domaine de la recherche clinique académique en oncologie
Les Groupes Coopérateurs en Oncologie (GCO) sont des groupes de recherche académique spécialisés
dans le domaine du cancer, indépendants et à but non lucratif. Leurs dates de création s’échelonnent
depuis 1981 jusqu’à 2003.
Face à une recherche clinique publique restant généraliste, encore très morcelée malgré un début de
structuration, et parfois en compétition entre hôpitaux, les GCO comblent un manque important : celui
de la mise en réseau d’experts géographiquement dispersés et de la mutualisation des moyens entre
centres hospitaliers dans un même domaine thérapeutique.
Les GCO associent des médecins et des professionnels de la recherche de plus de 700 centres de santé
et sont spécialisés par type de cancer : tumeurs gynécologiques (ARCAGY-GINECO), digestives
(FFCD), thoraciques (IFCT), cérébrales (IGCNO-ANOCEF), localisations tête et cou (GORTEC), cancers
du sang tels que leucémies de l’enfant et adolescent (SFCE), lymphomes (LYSA et LYSARC), myélomes
et gammapathies monoclonales (IFM), toutes tumeurs solides mais surtout très actif dans les cancers
digestifs et ORL, le GERCOR.
Une capacité unique de recrutement de patients permettant de contribuer aux
objectifs du Plan Cancer 2014-2019
Le Plan Cancer 2014-2019, présenté par le Président de la République en février 2014, reconnaît à
plusieurs reprises la capacité des groupes coopérateurs à mener des essais cliniques multicentriques
en réseau. Plus particulièrement l’action 5.2 du Plan Cancer projette d’inclure 50 000 patients par an
dans des essais thérapeutiques en 2019. Pour ce faire, le Plan prévoit que « la participation forte des
groupes coopérateurs, leur mise en responsabilité dans la proposition et la conduite d’essais
cliniques visant à répondre aux grandes questions thérapeutiques d’augmentation de la survie et de
réduction des effets secondaires et tardifs des traitements, doivent être facilitées »
1
.
Un fait essentiel qui distingue les GCO d’autres groupes est qu’ils possèdent leur propre structure
opérationnelle et ont donc la capacité de concevoir, promouvoir et conduire des études cliniques, en
France et à l'international. Grâce à leur fonctionnement en réseau, les GCO couvrent la totalité du
territoire français avec plus de 700 centres de soins participant activement à leurs études : centres
hospitaliers (CH), centres hospitaliers universitaires (CHU), centres hospitaliers régionaux (CHR), centres
de lutte contre le cancer (CLCC) et établissements privés. Ces réseaux coordonnés depuis la France
s’étendent parfois sur plusieurs pays et permettent donc à des milliers de patients de bénéficier
chaque année des innovations thérapeutiques ou des nouvelles stratégies en cancérologie.
Il est aussi important de préciser que tous les résultats des études des GCO, même négatifs, sont
systématiquement publiés dans les revues scientifiques internationales de premier plan dans leur
spécialité. Les GCO contribuent donc à l’action 13.5 du Plan Cancer qui vise à renforcer le partage des
informations et la valorisation des résultats de la recherche sur le cancer au niveau international.
1
Plan Cancer 2014-2019, objectif 5, action 5.2, p. 48:
http://www.e-cancer.fr/Expertises-et-publications/Catalogue-des-publications/Plan-cancer-2014-2019

4
c/o 10 rue de la Grange-Batelière
75009 Paris
www.gco-cancer.org
A propos des GCO, version décembre 2015
A propos des Groupes Coopérateurs en Oncologie (GCO)
Un poids très important dans la recherche clinique en oncologie
Les GCO ont en effet l’opportunité de tester, en amont de leur commercialisation, parfois à des phases
très précoces, l’efficacité et la tolérance des nouvelles molécules anticancéreuses et/ou de
leur combinaison avec d’autres médicaments. Ces travaux peuvent donc contribuer à la mise sur leur
marché de nouvelles thérapies, ou, à l’inverse, à l’arrêt du développement de molécules
inefficaces ou trop toxiques. De la même façon, pour des molécules anticancéreuses déjà
commercialisées, les GCO peuvent permettre, par leurs études, le développement de nouvelles
indications thérapeutiques ou l’optimisation de protocoles thérapeutiques dans l’intérêt du patient.
Une des spécificités des GCO est la réalisation d’études randomisées comparant entre elles différentes
approches thérapeutiques ou molécules, autorisant une évaluation systématique de la valeur
ajoutée des nouveaux traitements par rapport à ceux déjà disponibles, mais aussi des nouvelles
techniques de traitement (radiothérapie, chirurgie). Les GCO peuvent ainsi contribuer à la bonne
gestion des dépenses publiques, notamment lors de la démonstration du non bénéfice d’un traitement
coûteux.
Aussi, les GCO participent de plus en plus à la recherche de marqueurs biologiques et radiologiques
des cancers, permettant d’améliorer le diagnostic et le suivi pronostique des tumeurs.
Par leurs activités de formation des professionnels de santé, ils contribuent par ailleurs à diffuser les
bonnes pratiques et à améliorer la prise en charge des cancers.
Enfin, leurs activités de communication destinées au grand public et aux patients (souvent en
collaboration avec leurs associations) contribuent à la prévention et à une meilleure connaissance
de la maladie cancéreuse et de ses traitements.
Une reconnaissance de la qualité de l’activité de recherche des GCO à travers le
label INCa
En 2012, l'Institut National du Cancer (INCa) a labellisé six intergroupes coopérateurs
2
sur la base de
leur envergure, leur visibilité internationale, leur capacité à réaliser la recherche clinique et cognitive, à
collaborer dans le domaine de la recherche clinique, à gérer les essais cliniques et les ressources
humaines dévolues à la recherche.
La qualité de l’activité de recherche des membres fondateurs du réseau GCO (ARCAGY GINECO, FFCD,
GERCOR, GORTEC, IFCT, IFM, LYSA-LYSARC) a ainsi été officiellement reconnue par l’INCa en 2012 à
travers le label Intergroupe français de dimension internationale dans le domaine de la recherche
clinique sur le cancer. La SFCE et l’IGCNO-ANOCEF, membres associés au réseau GCO, ont été
labellisés par l'INCa, respectivement, en 2014 et 2015.
2
ARCAGY GINECO, Intergroupe Digestif (FFCD, GERCOR), Intergroupe ORL (GERCOR, GORTEC, GETTEC), IFCT, IFM, LYSA-
LYSARC. En juillet 2015, la labellisation de ces six intergroupes a été officiellement renouvelée par l’INCa pour une période de deux ans.
Voir les décisions de l’Institut National du Cancer en date du 28 novembre 2012 publiées dans le Bulletin Officiel Santé-Protection sociale –
Solidarité no 2013/1 du 15 février 2013 (p. 92-97): http://www.sante.gouv.fr/fichiers/bo/2013/13-01/ste_20130001_0001_p000.pdf
Voir les décisions de l’Institut National du Cancer en date du 21 juillet 2015 publiées dans le Bulletin Officiel Santé-Protection sociale –
Solidarité no 2015/8 du 15 septembre 2015 (p. 123-127): http://www.sante.gouv.fr/fichiers/bo/2015/15-08/ste_20150008_0000_p000.pdf

5
c/o 10 rue de la Grange-Batelière
75009 Paris
www.gco-cancer.org
A propos des GCO, version décembre 2015
A propos des Groupes Coopérateurs en Oncologie (GCO)
Un partenariat renforcé avec la Ligue Nationale contre le Cancer
L’intérêt du patient demeure au cœur des activités des GCO. Pour toutes les études cliniques des GCO,
les fiches d’information au patient qui sont utilisées afin d’obtenir son consentement sont au
préalable soumises pour relecture aux Comités de patients pour la Recherche Clinique en
Cancérologie. Ces Comités comptent aujourd’hui plus de 80 membres actifs, patients ou proches,
représentant les différentes pathologies dans le domaine du cancer, et répartis sur toute la France et
sont maintenant entièrement pilotés par la Ligue Nationale Contre le Cancer qui en assure les
formations.
La Ligue Nationale Contre le Cancer apporte aussi un soutien pluriannuel à des équipes de haut niveau
scientifique travaillant dans un domaine de la lutte contre le cancer au titre de Plateformes
Régionales de Recherche Clinique en cancérologie. En 2015, la Ligue Nationale contre le Cancer a
renouvelé son soutien à ARCAGY-GINECO, la FFCD et l’IFCT. Ce soutien couvre la période
2015/2016/2017.
Une charte régissant les relations avec l’industrie pharmaceutique, gage de
l’indépendance scientifique des GCO
Le financement des études des GCO est pluriel. Il est réalisé par des financements publics (Appels à
projets nationaux dans le cadre du Programme Hospitalier de Recherche Clinique piloté par l’INCa),
par des industriels de santé, mais aussi par des financements caritatifs (Ligue Nationale contre le
Cancer, fondation ARC, fondation A.R.C.A.D., fonds de dotation LYSA pour la recherche sur les
lymphomes).
Parmi leurs sources de financement, les GCO négocient donc avec les industriels de la santé des
subventions leur permettant de financer les études cliniques jugées utiles par leur conseil scientifique
aux progrès de la thérapeutique et de la santé publique. Les groupes coopérateurs, tout comme
l'industrie, doivent tenir compte des divergences possibles dans leur approche pour construire un
partenariat efficace et dont les modalités soient transparentes. Cela implique de la part des industriels,
l'acceptation de principes essentiels pour les groupes coopérateurs, destinés à assurer à la fois leur
indépendance et la confiance des industriels.
La collaboration entre les parties se distingue clairement d'une prestation. Elle doit donc, pour chaque
projet, être formalisée par une convention de partenariat. La charte des relations entre Groupes
Coopérateurs en Oncologie (GCO) et industrie énonce des principes utilisables pour établir une telle
convention de partenariat.
Cette charte des relations avec l’industrie est téléchargeable librement sur le site internet des GCO:
www.gco-cancer.org
 6
6
 7
7
1
/
7
100%