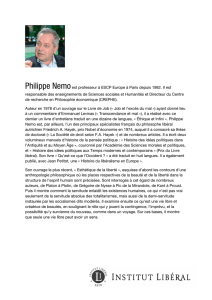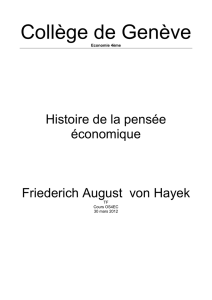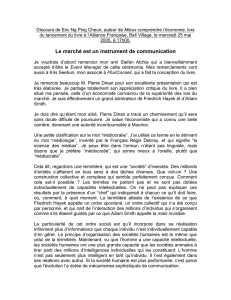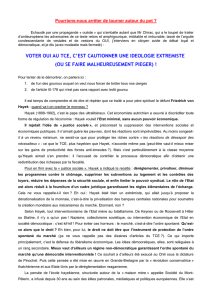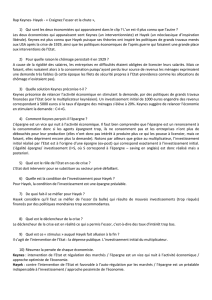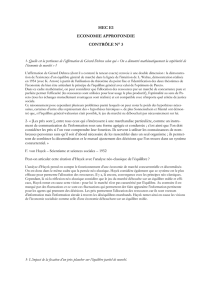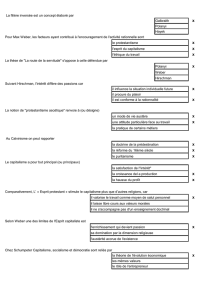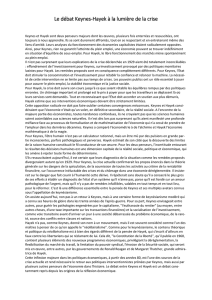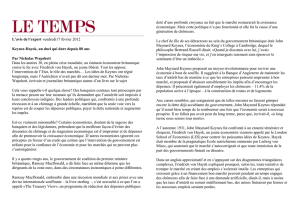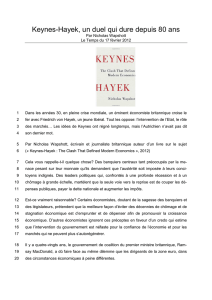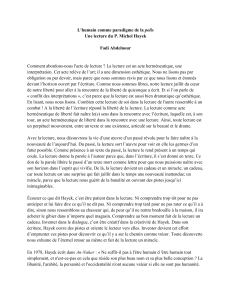Résumé documentaire n°5 Keynes/Hayek, un combat truqué ?

1
Résumé documentaire n°5
Keynes/Hayek, un combat truqué ?
Principaux intervenants :
- Alan Ebenstein, biographe de Friedrich
Hayek
- Kari Polanyi Levitt, économiste
- Abraham Rotstein, économiste
- James K Galbraith, économiste
- Lord Robert Skidelsky, historien de
l’économie
- Robert Boyer, économiste
- Michael Hudson, économiste
- Tohshaiki Taguchi, ancien président de
Totyota en Amérique du Nord
- Thomas Piketty, économiste
- Arnold Harberger, économiste
- Peter Bofinger, membre du conseil
allemand des experts économiques
Friedrich Hayek (1899 – 1992)
La Route de la servitude (1944)
La Constitution de la liberté (1960)
John Maynard Keynes (1883 – 1946)
Les conséquences économiques de la paix (1919)
Théorie générale de l'emploi, de l'intérêt et de la monnaie (1936)
Hayek contre Keynes, c’est le débat qui a modelé la pensée économique durant tout le
20ème siècle. Ils ont débattu ensemble de la sortie de la crise des années 30. L’un
(Keynes) veut diriger les marchés, l’autre (Hayek) veut les libérer.
Friedrich Hayek
Biographie, contexte
Après la première guerre mondiale Hayek s’inscrit à l’université de Vienne, berceau de
l’école autrichienne d’économie qui, depuis le 19ème siècle, présentait une alternative aux
théories dominantes de l’époque.
Cette théorie traitait non pas de grandes entités sociales (les classes), mais elle
s’intéressait aux décisions des acteurs individuels du marché : des consommateurs
individuels et des producteurs individuels considérés comme des petites entreprises
indépendantes. C’était un individualisme extrême dû à la peur panique du bolchevisme. La
révolution russe avait eu un impact énorme en Europe. Elle terrifiait les classes
possédantes à travers tout le continent.
Au départ, Hayek avait les idées d’un socialiste modéré ; il pensait que le gouvernement
avait un grand rôle à jouer en dirigeant les activités économiques puis il fut influencé par
Ludwig Von Mises1 qui a persuadé Hayek que le socialisme n’était pas réalisable. Mises
considère qu’aucun système de prix, de profit et de propriété, aussi sophistiqué soit-il, ne
peut parvenir à coordonner de façon rationnelle la masse infinie des relations entre les
1 Économiste autrichien puis américain qui a eu une influence importante sur le mouvement libéral et
libertarien moderne (1880 – 1973).

2
agents économiques : il affirme donc que toute tentative de centralisation de l’activité
économique est impossible et qu’un régime socialiste ne peut conduire qu’à l’échec.
Sa vision de l’homme
- Pour Hayek, l’altruisme et la solidarité sont des instincts très forts qui ont guidé
l’homme, mais seulement en petits groupes. Ses efforts sont dirigés uniquement
vers d’autres personnes familières.
- Le réseau économique est enraciné dans la nature humaine. Le cerveau est ainsi
fait et c’est rationnel.
- Le capitalisme est un système économique éternel car le plus rationnel, le plus
efficace et le plus juste en termes de récompense par rapport à la contribution des
acteurs.
Les thèses
- Hayek propose une théorie normative de l’économie. Il n’observe pas les phénomènes
qui ne rentrent pas dans sa théorie.
- La liberté des individus (il n’existe pas de société pour lui) est première et absolue. Le
rôle de l’Etat doit être minimal.
- Les dépenses publiques sont impuissantes à réduire le chômage.
- Les pauvres sont pauvres car ils se sont mis eux-mêmes dans le bourbier.
- Son héritage aujourd'hui se retrouve dans les thèses du Tea Party aux Etats-Unis.
- Les prix sont nécessaires pour orienter la production. Il n’existe pas de substitut au
système des prix parce que ce sont les prix qui donnent la valeur relative de tous les
biens de la société. Tout autre type de système économique serait ou ingérable ou
irrationnel sans les garde-fous que sont les prix.
- La crise de 29 s’explique par une trop grande accumulation du capital parce que les
taux d’intérêt ont été maintenus artificiellement bas. La politique à suivre est une
politique de non intervention pour permettre une récession naturelle et la liquidation
des investissements hasardeux.
John Maynard Keynes
Biographie, contexte
Keynes a grandi à Charleston, en Angleterre. Il est issu d’une vieille famille victorienne
appartenant à l’élite universitaire de Cambridge. Il a été élevé dans un milieu de
philosophes et de mathématiciens. Il appartenait au Bloomsbury group, un groupe « de
révolte fin de siècle » qui cherchait à composer un nouveau monde.
Il participe à la conférence de Paris qui conduit au Traité de Versailles. Profondément
déçu par les résultats de cette conférence, il écrit « Les conséquences économiques de la
paix » (1919). Il y dénonce le traité et prédit que s’il n’est pas révisé, la sanction sera
cruelle : la dette allemande ne pourra pas être payée ; ce trop lourd tribut va à l’encontre
de la nature humaine et de l’ordre social.
Les thèses
- Keynes observe l’économie réelle et cherche à la théoriser.
- L’économie doit être compatible avec le maintien de la cohésion sociale et de la
stabilité politique.
- Le niveau d’emploi dépend de la demande agrégée, c'est-à-dire du pouvoir d’achat
global au sein de l’économie. Le gouvernement doit donc stimuler l’emploi, en
investissant lui-même lorsque la demande globale est anémiée.

3
La crise de 1929
En vertu du traité de Versailles, la dette de l’Allemagne était sans limite. Les alliés insistent
pour être remboursés car ils doivent eux-mêmes rembourser les Etats-Unis. Les taux
d’intérêt ont été maintenus artificiellement bas pour que les pays puissent payer leur dette.
Les investisseurs se sont alors tournés vers les marchés boursiers pour obtenir des
rendements plus importants.
Le long chemin des idées libérales
Les théories d’Hayek appliquées en Allemagne
Les idées de Hayek sont mises en application en Allemagne. Dans la phase d’extrême
récession d’après 1929, l’Allemagne n’a pratiquement pas eu de déficit. Mais les
conséquences ont été catastrophiques : déclin de l’activité économique, forte déflation et
augmentation considérable du chômage, ce qui a conduit aux troubles politiques dont le
monde entier a souffert.
En 1932, la campagne électorale voit Hitler se servir des conséquences que la politique
économique a entraînées : « Une nation détruite économiquement, l’agriculture ruinée, la
classe moyenne appauvrie et les finances des Lander et des communes mises à plat. La
faillite complète et 7 millions de chômeurs. » Certaines idées de Hayek n’ont pas passé à
ce moment l’épreuve de la réalité historique.
Des théories oubliées
A la fin de la guerre, Hayek est oublié. Ce que dit Keynes retient bien plus l’attention de
sociétés en train de se rebâtir. La politique de nationalisation2 et d’investissement de l’Etat
montre que l’Etat peut se soucier du social sans pénaliser l’efficacité économique.
La croissance sera de 5% pendant 30 ans. L’Etat crée la sécurité sociale, met en place
des systèmes de régulation des marchés financiers. On pense avoir vaincu les méfaits du
capitalisme et combattu efficacement les inégalités. Un compromis politique avait été
passé avec le capitalisme
Les libéraux préparent leur retour
En 1944, Hayek écrit La route de la servitude. Il veut sonner une alarme : « Cette politique
peut conduire à la dictature ». Pour lui, les racines du fascisme et du nazisme résident
dans l’abandon des idées libérales qui constituent la base du libre marché. D’après lui,
l’intervention de l’Etat nous a menés à la servitude.
En 1947, il fonde la société du Mont Pèlerin, groupe international d’universitaires,
d’économistes, de philosophes, de journalistes qui se retrouvaient en Suisse pour des
colloques. Ces intellectuels cherchent à développer des arguments contre Keynes et à
restaurer le libre marché. Milton Friedman, jeune économiste à l’époque, y participait. Il
en devient le personnage central. Alors que l’influence de Hayek est faible, celle de
Friedman est considérable.
Milton Friedman est né à New-York en 1912. Il est fils d’immigrants juifs qui étaient venus de Hongrie aux
Etats-Unis. Pour lui, le problème était le gouvernement, gaspilleur et inefficace. Le marché devrait jouer
un plus grand rôle dans la société et l’économie. C’est un libertarien qui aura une grande influence :
abandon du système de changes fixes, restauration du monétarisme, du rôle minimal de l’Etat.
L’illusion libérale
Avec la fin des trente Glorieuses, l’ingérence de l’Etat dans l’économie est désormais
perçue comme un obstacle à la croissance. C’est le retour des idées libérales à partir de la
fin des années 70.
2 En France, par exemple : Renault, EDF, GDF, Charbonnages de France, Air France, Banque de France,
essentiel des banques et des compagnies d’assurances.

4
Le marché apparait comme l’utopie de l’existence, supposé générer abondance et
bienfaisance et qui s’autorégulerait. C’est une illusion : la liberté est grande pour ceux qui
ont beaucoup de capitaux, elle est nulle pour le prolétaire, le salarié ou le pauvre paysan
africain ; les contrats entre égaux sont extrêmement rares dans le capitalisme.
Thomas Piketty : « L’illusion néolibérale s’observe déjà au 19ème siècle. La France vit dans
l’idée de l’égalité des droits face au marché qui suffirait pour conduire à l’égalité tout court.
Pourtant, une des leçons du 19ème siècle et de 1914, c’est que ça ne marche pas : en
1913, 70% du patrimoine est détenu par 1% de la population. En fait, rien dans le marché
libre ne garantit une société relativement égalitaire car structurellement, les marchés très
libres n’empêchent pas que les rendements du capital puissent être, de façon
permanente, supérieurs au taux de croissance, ce qui génère une concentration très forte
du patrimoine. »
Le retour des idées de Hayek et Friedman
Friedman et Hayek deviennent les champions de la liberté, en prise directe avec les
réalités. On assiste à une contre révolution économique, nourrissant l’agenda néolibéral :
désintermédiation bancaire, désindexation des salaires, décloisonnement des marchés,
dérèglementation, privatisations. Ronald Reagan et Margaret Thatcher sont deux
dirigeants largement influencé par Hayek et Friedman.
Kari Polanyi Levitt : « Les politiques néolibérales mises en place par Thatcher et Reagan
ont été conçues pour restaurer la discipline du capital. Ainsi, les revenus et les salaires
moyens aux Etats-Unis n’ont pas augmenté depuis 1980 en valeur réelle bien que la
productivité ait augmenté. »
La chute du mur de Berlin et du bloc soviétique laisse le capitalisme sans rival et conduit à
une nouvelle période d’expansion démesurée d’un système de libre marché. Cette période
folle explique beaucoup des dérèglements des années 1990-2000.
Un capitalisme indomptable
Il faut se résoudre à deux constats amers :
- Le capitalisme n’a pas été dompté après la seconde guerre mondiale.
- La réduction des inégalités n’est pas la conséquence d’un processus démocratique
parlementaire. Le compromis passé entre la société et le monde économique était
précaire et dû aux circonstances : beaucoup des réductions d’inégalités au 20ème
siècle étaient causées soit par les guerres, soit par des réactions politiques prises
dans l’urgence à la suite des guerres.
Dans leur vision du capitalisme mythique et indomptable du 19ème siècle, Friedman et
Hayek n’ont jamais débattu des éléments qui ont contribué à ses ravages : l’inégalité, la
dette et la spéculation. Friedman pensait, comme Ricardo, que la dette privée ne posait
aucun problème, et que seule la dette publique devait être proscrite car elle se développait
aux dépens des agents privés. Pour lui, l’argent et la richesse n’ont pas d’importance, et
ne sont que la récompense des talents individuels. C’est cette vision étroite de l’école
de Chicago qui a été adoptée par les banquiers : il faut dérèglementer l’économie pour
qu’elle puisse tendre d’elle-même vers un équilibre naturel.
Toute la théorie économique néoclassique est bâtie sur l’idée d’un système rationnel
autorégulé, qui ne traverse des crises que du fait des interventions intempestives des
Etats. Pourtant, des bulles financières se créent même en système libéral : comme elles
ne sont pas modélisées par cette théorie économique, on les considère comme des
épiphénomènes dont la probabilité est infime…
1
/
4
100%