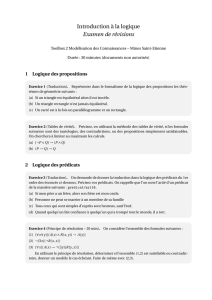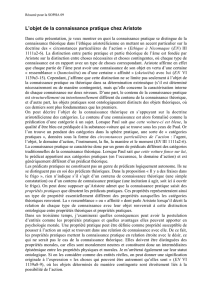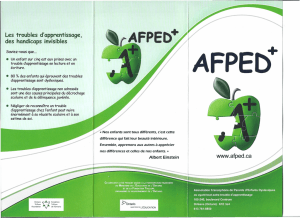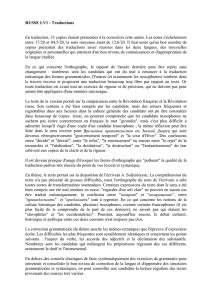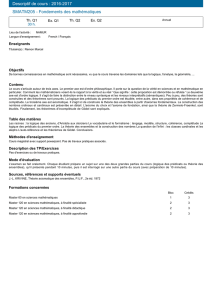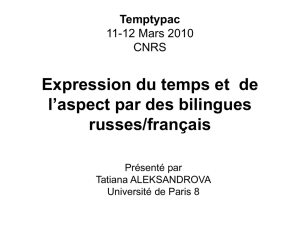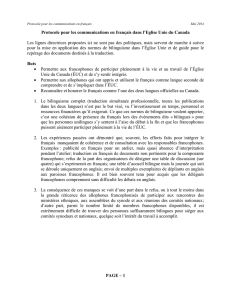Expression du temps et de l`aspect par des bilingues russes/français

Expression du temps et de l’aspect par des bilingues russes/français
Notre étude s’intéresse aux productions en français (L2) et en russe (L1) de quasi-
bilingues, mises en regard de productions de monolingues francophones et russophones. Elle
a un double objectif. D’une part, il s’agit d’analyser les productions en L2 et fournir une
description des phénomènes liés à l’acquisition d’une L2 au niveau très avancé. Et d’autre
part, il est question de voir dans quelle mesure la maîtrise très élevée dans une L2 pourrait se
refléter dans les productions des quasi-bilingues dans leur langue maternelle.
Tous nos sujets sont soumis à la tâche du récit d’un film muet appelé «Quest »
1
mettant
en scène un personnage de sable à la recherche d’eau.
Les résultats des études comparatives (Stutterheim von, Carroll, Klein, 2003) ont
montré, que les locuteurs de différentes langues utilisent les stratégies d’organisation de
l’information différentes selon les moyens grammaticalisés spécifiques aux langues. Le
français et le russe possèdent une morphologie verbale et des adverbes temporels pour
l’expression des relations temporelles et de l’aspect. Le français a plusieurs temps
grammaticaux pour l’expression des relations entre les événements, par exemple dans le
passé : Le Passé Récent, Le Passé Composé, L’imparfait, Le Passé Simple, Le Plus-que-
parfait. En revanche, presque chaque verbe russe forme une paire aspectuelle imperfective/
perfective. Par exemple, au verbe français faire, peuvent correspondre en russe la forme
imperfective – delat’- être en train de faire quelque chose, et la forme perfective sdelat’ –
avoir fait quelque chose. La forme imperfective, qui est la forme non marquée dans la paire,
encode l’action sans référer à ses limites temporelles. La forme perfective encode l’action
accomplie. Elle est généralement dérivée de la forme imperfective par l’addition d’un préfixe
ou un suffixe, mais parfois peut être formée à partir d’une racine verbale différente. La forme
imperfective peut être conjuguée aux trois temps : le présent, le passé et le futur. La forme
perfective – aux deux temps : le passé et le futur. L’accord avec le sujet est marqué sur le
verbe, qui s’accorde en personne et en nombre au présent et au futur, et en genre et en nombre
lorsque qu’il s’agit des formes du passé (imperfectives et perfectives).
Pour l’analyse des temps et aspects, nous nous appuyons sur les travaux de Klein (1994)
qui prend en compte trois intervalles temporels : TU (time of utterance – temps de l’énoncé),
TSit (time of situation – temps de situation) et TT (Topic time – temps de l’assertion).
L’expression de l’aspect grammatical est en lien avec les propriétés internes des prédicats, ou
l’aspect lexical. Klein fait la distinction entre trois types de prédicats pour décrire les
situations : prédicats à zéro temps (être russe), prédicats à un temps (lire), et prédicats à deux
temps qui amènent aux changements de la situation (lire un livre, sortir).
Les analyses des productions ont montré que 90% des francophones produisent des
récits au présent. Cependant, la moitié des locuteurs réfère aux formes du passé, qui sont
rencontrées 2 fois par production en moyenne. Dans 60% des cas, ces recours sont effectués
pour l’expression de l’aspect perfectif et sont associés aux prédicats à deux temps : il est
tombé. Les francophones encodent la phase du début des actions par les verbes : commencer,
se mettre à, qui occupent 2% du répertoire verbal et accompagnent les prédicats à 1 temps,
comme : creuser, taper, marcher, etc. Les francophones produisent des récits détaillés et ont
tendance à présenter les événements dans l’ordre dans lequel ils se sont produits dans le film
en marquant les liens de la postériorité encodés majoritairement par un moyen non spécifique,
la conjonction et : mais donc le sol se dérobe sous lui, et il est entraîné par le sable, et il
tombe sous le sable.
Chez les russophones, 34% des narrateurs commencent leurs productions par les formes
perfectives, en les associant aux prédicats à 2 temps : rojdat’sa – naître, prosipat’sa – se
1
Méthodologie utilisée par les chercheurs de l’Université de Heidelberg, Allemagne (Stutterheim von, Carroll,
Klein, 2003).

réveiller, popadat’ – arriver. Les autres, débutent leurs narrations par les formes imperfectives
du présent associées aux prédicats à 2 temps (prosipat’sa – se réveiller, podnimat’sa – se
lever), et moins souvent aux prédicats à 1 et à 0 temps. Le recours aux formes perfectives à
l’intérieur des productions représente le même pourcentage que dans le groupe des
francophones natifs. La phase inchoative des actions est exprimée par l’item nachinat’ –
commencer, qui représente 5% du répertoire verbal et accompagne les prédicats à 1 temps.
Les russophones encodent mois d’événements du film que les francophones, en choisissant les
événements les plus importants pour le développement de l’histoire. Les relations de la
postériorité sont moins souvent exprimées par ce type de locuteurs : on prosipaetsa, beret
butilku, nachinaet kopat’ – il se réveille, attrape une bouteille, commence à creuser.
Les bilingues, en produisant en français (L2), adoptent la stratégie des francophones
dans l’encodage d’un grand nombre d’événements en les présentant dans l’ordre du film. Ces
récits sont produits au présent avec le recours aux formes du passé pour l’encodage de
l’aspect perfectif. En revanche, les verbes qui encodent la phase du début des actions sont plus
fréquents que chez les francophones natifs et occupent 5% du répertoire verbal, ce qui
correspond au pourcentage trouvé chez les russophones monolingues et représente, à notre
avis, une influence de la langue maternelle (LM). Les relations de la postériorité sont
encodées presque aussi souvent que chez les francophones, mais le choix des moyens
lexicaux diffère. Les bilingues emploient moins souvent que les natifs la conjonction et, et
réfèrent plus souvent à la conjonction de coordination donc : il se retrouve dans le troisième
univers donc il roule, qui est beaucoup moins utilisée pour l’expression de la postériorité par
les francophones natifs.
En ce qui concerne les productions des bilingues en russe, moins de locuteurs (26%)
débutent leurs productions par les formes perfectives et emploient plus souvent les formes
imperfectives du présent associées aux prédicats à 1 ou à 2 temps : on nachinaet shevelit’sa –
il commence à bouger, ou chelovek prosipaetsa – homme se réveille. Ils encodent plus
d’événements du film que les russophones monolingues en les présentant en ordre
chronologique. Cette stratégie, qui n’est pas caractéristique aux productions des russophones
est renforcée par l’expression plus explicite des relations de la postériorité encodées
régulièrement par la conjonction i – et. Ce résultat montre que les bilingues en produisant en
LM emploient une stratégie de la L2 d’encoder les événements en ordre chronologique et de
les relier plus régulièrement que les monolingues par les liens explicites de la postériorité. En
revanche, les bilingues gardent la stratégie de leur LM en encodant aussi souvent que les
russophones la phase du début des actions.
En conclusion, nos résultats rejoignent ceux des études précédentes en montrant que les
productions des bilingues en L2 reflètent souvent l’organisation de l’information et le choix
des moyens linguistiques selon les principes de la L1 (expression de l’aspect inchoatif).
En même temps, leurs productions en L1 diffèrent systématiquement de productions des
russophones monolingues, notamment dans l’expression des relations temporelles (expression
de la postériorité), ce qui confirme l’hypothèse de Cook (2003) de l’existence d’une ‘multi
compétence’ linguistique des bilingues, dont les productions diffèrent systématiquement de
celles des monolingues des langues en question.
Références bibliographiques
Cook, V. (2003): Effects of the Second Language on the First, Multilingual Matters,
Clevedon.
Klein, W. (1994): Time in Language, Routledge, London.
Stutterheim C. von, Carroll M., Klein W. (2003): “Two ways of construing complex temporal
structures”, (éd.) Lenz F. Deictic Conceptualisation of Space, Time and Person, John
Benjamins Publishing Compagny, pp. 98-133.
1
/
2
100%