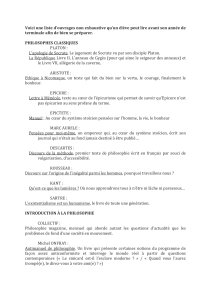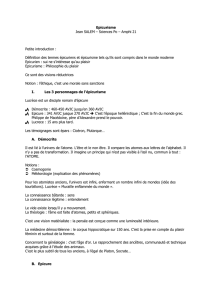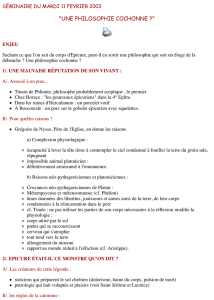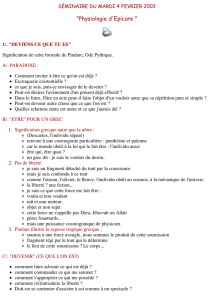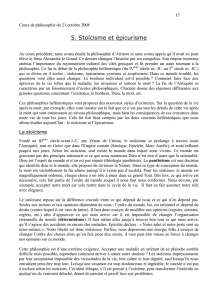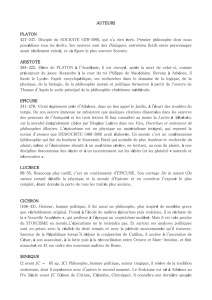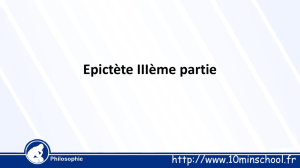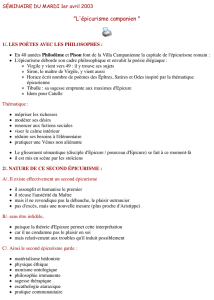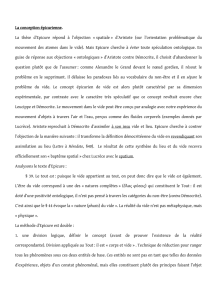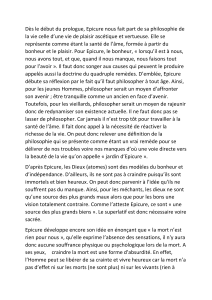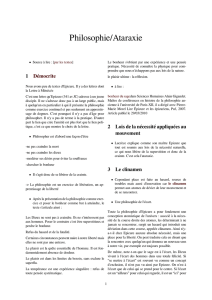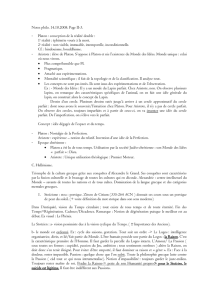Ma philosophie - E

1
Ma philosophie ?
Epicure ou Epictète ? Non ! Epicure et Epictète.
Le plus sage est peut-être de s’exercer à la vertu avec une énergie stoïcienne et une joie de
vivre toute épicurienne.
Kant, Métaphysique des mœurs
Epicure et Epictète, l’épicurien et le stoïcien. Deux maîtres de vie qui m’interpellent et
avec lesquels je tente modestement de m’appuyer pour mener ma vie avec plus ou
moins de réussite en essayant de suivre au quotidien les préceptes philosophiques.
Sans entrer dans des détails biographiques exhaustifs, il convient de signaler
qu’Epicure est le fondateur de la philosophie qui porte aussi son nom (l’épicurisme)
et qu’il vécut au IV-Ve siècle avant notre ère. Epictète, par contre, penseur éminent
du stoïcisme impérial vécut au sein de l’Empire romain au Ier et IIe siècle. Tous deux
proposent une philosophie de vie ayant pour objectif de conduire au bonheur.
Epicure et Epictète appartiennent aux deux plus importantes écoles de l’époque
hellénistique et de la période de la république romaine et du Haut-Empire romain,
deux écoles au demeurant rivales. En effet, si l’une, l’épicurisme est une philosophie
du plaisir, la seconde, la stoïcienne, met l’accent au contraire sur la vertu et l’effort.
Mais gardons-nous des simplifications dues aux définitions populaires. De nos jours,
être épicurien est devenu synonyme d’une personne désirant jouir sans entraves et il
se dit d’une personne qu’elle est stoïque si elle a réussi à supporter courageusement
les aléas et les agressions de la vie sans réagir. Il y a beaucoup de faux dans de
telles définitions simplistes.
Epicure nous apprend en réalité à tirer profit de plaisirs simples et à s’émerveiller de
chaque journée que la vie nous a fait don (l’amour de son conjoint, l’affection de nos
proches, le rire d’un enfant, une soirée entre amis…). Il n’approuvait nullement la
recherche de plaisirs exagérées comme le luxe, la soif de pouvoir ou la débauche qui
soit par l’impossibilité à les atteindre soit à cause de la satisfaction certes d’un plaisir
excessif mais qui demandant à être sans cesse renouvelé voir à être changé pour un
nouveau ne peut que perturber continuellement l’âme par un état de frustration
continuelle. On est donc loin de la luxure que l’on prête à Epicure et à ses disciples.
Epicure était d’une santé fragile et ne pouvait de toute manière pas se permettre de
vivre dans l’excès. En fait, si Epicure vivait de nos jours, il ne se définirait pas comme
épicurien.
La doctrine d’Epicure est simple, épurée, accessible à tous et il n’y a pas d’âge selon
lui pour commencer à philosopher. Elle est aussi profondément libératrice : la notion
de péché est absente, les dieux n’ont pas créé le monde et ne s’intéressent pas aux
affaires humaines, la mort n’est pas à redouter car il n’y a pas de châtiment divin à
craindre dans un au-delà qui n’existe pas ; La mort, n’étant qu’une dispersion
définitive des atomes nous constituant, elle est vue comme la privation de la

2
sensation. Nos atomes fragmentés sont ensuite recyclés pour créer de la nouvelle
matière. La souffrance est un mal mais elle peut être gérée : soit elle est brève ou
légère et finit par disparaître, soit elle est importante et c’est alors une mort qui en
arrivant vite nous en délivrera. Esprit étonnamment ouvert pour son époque, Epicure
accueillait au sein de son école aussi bien les hommes que les femmes, les esclaves
et même les hétaïres.
Si l’épicurisme est une philosophie de la détente, le stoïcisme traîne une réputation
d’austérité avec l’image de son sage sur lequel aucun accident de la vie n’est en
mesure d’affecter. La liberté chez le stoïcien est liée à la vertu, c'est-à-dire à notre
capacité à faire le bien. La pensée stoïcienne repose sur la différence, cruciale, entre
ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. Dépendent de nous nos actions et
nos opinions tandis que ne dépend pas de nous tout ce qui nous tombe dessus
(d’agréable ou de douloureux) qui est la conséquence du destin contre lequel il est
vain de s’opposer. Toutefois, le sage stoïcien ne se résigne pas, sa philosophie
propose au contraire un renversement du jugement que l’on porte sur ce qui nous
arrive. Comme nécessairement des choses désagréables vont nous affecter un jour
ou l’autre, nous devons ne pas nous soumettre à la nécessité mais l'accueillir et
reconnaître en elle un bien. C’est seulement par cet effort d’accompagner ce qui
nous fait du mal (et non dans une attitude vaine de révolte) que l’homme fait preuve
de liberté. Et c’est cette liberté qui permet à l’homme de pouvoir trouver le bonheur
car il coopère alors avec le destin. Il ne se bat plus en vain contre une situation où il
n’a de toute façon pas son mot à dire. Des choses irrémédiables sont ou vont
arrivées que nous devons accepter comme des données inéluctables qui ne
dépendent pas de nous. Le sage ne doit pas se laisser envahir par le chagrin, la
déception et le désespoir. En respectant ces conditions, le stoïcien se créé une
citadelle intérieure que rien ne pourra plus troubler.
Cette acceptation du destin est facilitée par l’explication métaphysique du monde des
stoïciens : nous ne sommes qu’une particule dans un univers mu par des lois
logiques et rationnelles et gouverné par une providence divine. Le stoïcisme a une
conception immanente du monde, le divin n’est pas hors du monde (comme dans les
monothéismes), au contraire, il est dans le monde. Les stoïciens ont aussi une vision
cyclique de l’univers : une grande conflagration a lieu à la fin de chaque monde au
cours de laquelle toute chose est absorbée par la substance divine avant que celle-
ci ne la restitue et que tout reparte à l’identique. C’est la loi de l’éternel retour,
concept stoïcien qui se retrouve dans l’hypothèse moderne de l’univers ekpyrotique,
un des éléments du modèle cyclique. Par sa théorie cosmologique, le stoïcisme
manifeste un sentiment religieux plus marqué que l’épicurisme.
Je rejette l’idée d’un dieu créateur ou horloger ainsi que l’idée du dieu vengeur et
juge des trois grandes religions monothéistes (judaïsme, christianisme et islam).
Cependant, même si je me définis comme agnostique, je me suis toujours interrogé
sur la force qui réside au sein de l’univers et qui régit la vie et qui m’apparaît comme
une énigme et un mystère. Je pense que si les hommes regardaient plus souvent les
étoiles, ils se rendraient mieux compte de la petitesse de leur existence et perdraient
un peu de leur arrogance. Nous ne sommes qu’une poussière de l’univers. Je suis
intimement persuadé que fixer de temps en temps la voûte étoilée, nous apprendrait
à la fois la modestie et à adopter une pensée plus relativiste.
Sans pour autant y adhérer, la religion du Bouddha, sans dieu créateur, a toujours eu
ma sympathie. Cette idée que le salut ne peut être venir que d’un travail sur nous-
mêmes - par l’exercice entre autre mais pas uniquement de la méditation - et non
obtenu par la grâce d’un dieu transcendant me plaît. Beaucoup d’occidentaux déçus
des monothéismes et en quête de sens recherchent une voie alternative en adoptant

3
le bouddhisme. Toutefois, je crois que la pensée orientale est, de part l’histoire, si
éloignée de notre mode de pensée occidentale qu’il n’est pas forcément aisé pour
les occidentaux d’intégrer sans risque d’erreur doctrinale la pensée bouddhique.
Comment ainsi appréhender correctement la doctrine bouddhiste du non-soi tandis
que des siècles de réflexion occidentale ont, au contraire, eu le moi individuel pour
sujet ?
Il est des rencontres intellectuelles qui savent répondre à une attente et dont
l’éclairage devient alors une révélation. Ainsi, lors de mes recherches réalisées pour
l’écriture de ma biographie consacrée à l’astronome, mathématicienne et philosophe
néoplatonicienne du IV-Ve siècle Hypatie d’Alexandrie, je suis tombé sur l’œuvre de
Pierre Hadot, philosophe spécialiste de l’Antiquité disparu en avril 2010, qui propose
une relecture de la pensée philosophique antique comme pratique, manière de vivre
et exercice spirituel. Sa vision m’a tout de suite enthousiasmé. La philosophie
antique a, pour lui, encore des choses à dire à nous contemporains. La
démonstration de Pierre Hadot montre qu’il est possible de mener aujourd’hui un
mode de vie selon une attitude épicurienne ou stoïcienne. On ne peut pas en effet
prendre pour base la philosophie spéculative de Platon ou de Plotin qui apparaît trop
éloignée des réalités vécues par les gens alors que celle d’Epicure et d’Epictète
faisant appel à la raison reste actuelle. Ces deux penseurs ont tenté dans leurs écrits
de répondre aux interrogations de leurs contemporains mais aussi par la même
occasion aux nôtres, ceci grâce à l’intemporalité de leurs propos. La philosophie
épicurienne ou stoïcienne n’est pas du baratin spéculatif, elle se vit d’abord. On est
épicurien ou stoïcien par la vie que l’on mène et non parce que l’on ânonne une
heure par jour des concepts doctrinaux.
Ma conception spirituelle est immanente. Le monde est foncièrement un. Rien ne
m’est plus étranger qu’une vision dualiste ainsi que l’idée de transcendance. L’idée
stoïcienne de revenir au final au sein de la substance est séduisante mais qu’est-ce
cela induit ou pas ensuite ? Une forme de survivance de notre pensée est-elle
envisageable ou bien n’est-ce finalement qu’un simple recyclage, comme le défend
Epicure, de notre matière pour la création de nouveaux éléments ? Ici, on s’éloigne
de la notion de philosophie pour glisser vers le champ de la croyance. Aucune
réponse n’est véritablement donnée par les philosophes stoïciens (cette interrogation
relève plutôt du domaine de l’espérance) mais finalement cela n’avait que peu
d’importance pour eux car leur priorité était de vivre et bien gérer le temps présent.
Pour conclure cette petite réflexion, Pierre Hadot a déclaré que pour mener une vie
en se réclamant à la fois de la philosophie d’Epicure et d’Epictète il faut « tantôt
adopter une attitude épicurienne, tantôt stoïcienne, dans la mesure où il est des
circonstances où il faut se détendre comme un épicurien, et des circonstances de
“tensions“, malheureusement souvent tragiques, où il faut être fort et actif en faisant
consciencieusement son devoir comme un stoïcien » (interview à Philosophie
Magazine n° 21). Ainsi, contrairement à la période antique où il fallait à l’étudiant
sélectionner sa tradition philosophique, de nos jours, ceux qui le souhaitent peuvent
désormais ne pas avoir à choisir entre la voie d’Epicure ou d’Epictète mais choisir au
contraire celles d’Epicure et d’Epictète car les deux pensées se complètent
parfaitement. Ainsi, je peux sans problème me définir comme un épicurien de
tradition philosophique avec des influences stoïciennes, me sentant en effet plus
attiré par la philosophie paisible d’Epicure - à rapprocher de celle du Bouddha - tout
en y intégrant une partie de la métaphysique stoïcienne (et notamment cette idée
que nous faisons partie d’un grand Tout) et en sachant également que les épreuves
de la vie nécessiteront d’y résister à la manière d’Epictète ; Tout ceci sans oublier
d’ajouter en complément du suivi de ces deux pratiques philosophiques des
exercices méditatifs de calme bouddhique. Epicure et Epictète, ces deux grands

4
maîtres de vie, m’ont aussi appris - et ce n’est pas le moins important - qu’il y avait
une forme possible de spiritualité laïcisée ancrée dans le réel que l’on peut trouver,
en dehors de la religion, parmi la pensée grecque.
1
/
4
100%