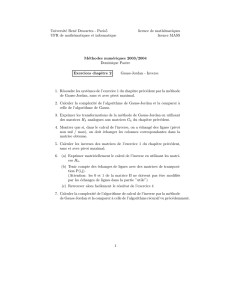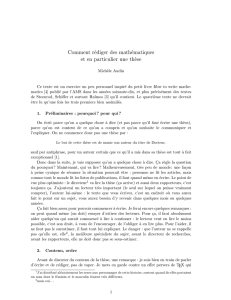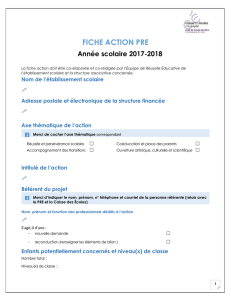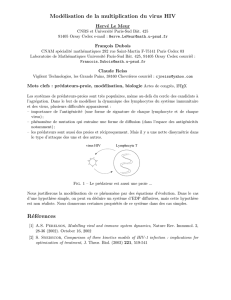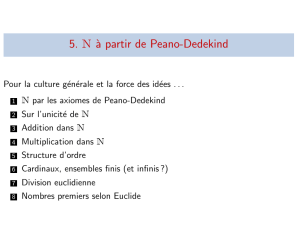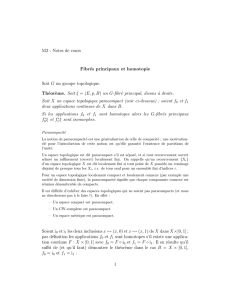Sens et nouveauté de la démonstration - Jean

Sens et nouveaut´
e de la d´
emonstration
Jean-Michel Salanskis,
Professeur de Philosophie des Sciences, Logique et ´
Epist´
emologie ;
Universit´
e Paris X Nanterre, D´
epartement de Philosophie
200, avenue de la R´
epublique 92001 Nanterre cedex
e-mail : [email protected]
March 6, 2005
Conform´
ement `
a l’annonce que j’en ai donn´
e, le but de cette conf´
erence est de
r´
efl´
echir sur ce que la vision contemporaine de la d´
emonstration a d’essentiellement
nouveau par rapport `
a une certaine entente philosophique, qui tiendra ici le rˆ
ole de la
r´
ef´
erence traditionnelle. Si, dans mon titre, je parle aussi du sens de la d´
emonstration,
c’est bien entendu, parce que je conjecture que l’´
ev´
enement contemporain touche `
a
la signification mˆ
eme du mot d´
emonstration : je fais l’hypoth`
ese que les conventions
contemporaines, les nouveaux usages et les nouvelles perspectives pr´
efigurent au moins
une nouvelle interpr´
etation de ce qui depuis les Grecs rec¸oit le nom de d´
emonstration.
La d´
emarche suivie consiste simplement `
a se livrer successivement `
a l’examen de
deux types de sources ou de documents.
D’abord, je me pencherai sur la compr´
ehension philosophique de la d´
emonstration
qu’a pu proposer le courant “ph´
eno-transcendantal”, le seul `
a vrai dire dont je puisse
exciper d’une connaissance suffisante : je d´
esigne ainsi les philosophes de la filia-
tion kantienne et post-kantienne, les allemands de Kant `
a Heidegger essentiellement.
Comme on le verra dans les pages qui viennent, cela ne me gˆ
ene pas d’int´
egrer `
a ce
courant les auteurs de l’“id´
ealisme allemand”.
Dans un deuxi`
eme temps, je prendrai en consid´
eration la conception de la d´
emon-
stration qui ´
emane de la logique math´
ematique moderne. Elle motive une branche
de la logique contemporaine – la th´
eorie de la d´
emonstration – dont la paternit´
e est
g´
en´
eralement attribu´
ee `
a Hilbert. Apr`
es Hilbert, les apports constituants de la branche
sont ceux de Gentzen et Prawitz. Ce renouvellement est donc, `
a vrai dire, d´
ej`
a une
affaire ancienne. J’essaierai, en revenant sur lui pour tenter de caract´
eriser la rupture
qu’il a introduite, de tenir compte de d´
eveloppements plus r´
ecents de la th´
eorie de
la d´
emonstration : essentiellement, de la “correspondance de Curry-Howard”, et des
notions directrices qui vont avec.
En tout ´
etat de cause, mon ´
evocation de la r´
eappropriation technique de la no-
tion de d´
emonstration dans l’aire logico-math´
ematique ne sera pas elle-mˆ
eme tech-
nique. J’essaierai de la comprendre dans des termes philosophiques g´
en´
eraux, de
la mˆ
eme sorte que ceux qui interviendront naturellement dans ma pr´
esentation de la
compr´
ehension ph´
eno-transcendantale.
1

Mon espoir est, au bout de cette ´
etude, de conqu´
erir une vision plus englobante, plus
int´
egratrice, de cela qui est pens´
e depuis fort longtemps d´
esormais sous le mot d´
emon-
stration, en profitant de tout ce qui aura ´
et´
e rencontr´
e et r´
efl´
echi au fur et `
a mesure.
Mais aussi, sans doute, de mieux appr´
ecier l’h´
et´
erog´
en´
eit´
e des ´
el´
ements “nouveaux”
qui auront ´
et´
e interrog´
es.
Je commence donc par revenir, en tˆ
achant de viser `
a l’essentiel, sur quelques textes
ou th`
emes de Kant, Hegel et Husserl.
1 Compr´
ehension philosophique de r´
ef´
erence
de la d´
emonstration
1.1 D´
emonstration, construction et d´
emarcation (chez Kant)
Kant dit quelques mots de la d´
emonstration dans la Discipline de la raison pure dans
l’usage dogmatique. Il n’est pas permis, si l’on veut comprendre, d’ignorer ce qui
est le contexte de ce passage1: Kant y expose et y argumente la d´
emarcation entre
philosophie et math´
ematiques au nom du crit`
ere de la construction de concepts. La
philosophie est la connaissance rationnelle par concepts et la math´
ematique la connais-
sance rationnelle par construction de concepts, comme on le sait. Ce qui est dit de la
d´
emonstration est dit `
a la fin d’une ´
enum´
eration `
a trois termes (d´
efinitions, axiomes,
d´
emonstrations) visant les d´
emarches sp´
ecifiques de la math´
ematique non r´
ecup´
erables
dans l’enceinte de la philosophie. Conform´
ement `
a la vision encadrante de Kant, c’est
`
a chaque fois le crit`
ere de la construction de concepts qui ruine la possibilit´
e d’un usage
philosophique de la voie math´
ematique envisag´
ee.
La d´
efinition au sens math´
ematique est impossible en philosophie parce que toute
la valeur d´
eontologique de la d´
efinition math´
ematique r´
esulte de ce qu’elle institue le
concept. La d´
efinition est d´
ej`
a construction, non pas au sens pr´
ecis de la construction
de concept chez Kant, mais au sens de la prescription d’un contenu conceptuel par le
vouloir rationnel de la math´
ematique. La philosophie en revanche ´
elabore des con-
cepts donn´
es, elle les analyse et tente de d´
eterminer la somme de traits en lesquels se
r´
esoudrait le concept tel qu’il est commun´
ement compris, analyse toujours douteuse et
rectifiable selon Kant, qui ressemble fort `
a ce qu’on appelle une interpr´
etation2.
L’axiome au sens math´
ematique est l’affirmation d’une ´
evidence comme primitive
de la pens´
ee (math´
ematique). Elle est en surface un jugement, une synth`
ese de con-
cepts : seulement l’unification de cette synth`
ese est autosuffisante, ne renvoie pas `
a un
troisi`
eme terme qui ´
eclairerait l’union des synth´
etis´
es. Cela n’est possible que parce
que les concepts “montrent” leur liaison dans l’intuition o`
u ils sont construits : or il en
va seulement ainsi dans le champ math´
ematique, pr´
ecis´
ement. Donc, Kant consid`
ere
l’axiome comme la reprise judicative d’une ´
evidence acquise dans la construction de
concepts.
La d´
emonstration est ´
egalement d´
ecrite par Kant comme une d´
emarche propre `
a
la math´
ematique. Soyons attentifs `
a l’argumentation qu’il donne, puisque c’est de
1. Kant, E., Critique de la raison pure, trad. Tremesaygues-Pacaud, Paris, PUF, 1971, p. 493-507 ;
Pl´
eiade, vol. I, 1294-1316 ; A708-738, B736-766.
2. Cf. `
a ce sujet Salanskis (1997).
2

notre objet en personne qu’il s’agit cette fois. La d´
emonstration est implicitement
d´
efinie comme une “ preuve apodictique, en tant qu’elle est intuitive3” . Une preuve
philosophique peut atteindre l’apodicticit´
e, mais pas l’intuitivit´
e :
“ Mais la certitude intuitive (anschauende), c’est-`
a-dire l’´
evidence,
ne peut jamais r´
esulter de concepts a priori (dans la connaissance dis-
cursive), quelque apodictiquement certain que puisse ˆ
etre, par ailleurs, le
jugement ”4.
Donc, Kant choisit de concevoir la d´
emonstration comme cela mˆ
eme qui administre
la certitude en l’attestant sur l’objet, ce qui ne se peut que si l’objet n’est pas affect´
e du
d´
efaut d’empiricit´
e en quelque sorte, c’est-`
a-dire s’il a la qualit´
e de g´
en´
ericit´
eque lui
conf`
ere le fait d’ˆ
etre une construction de concept :
“ Aussi donnerais-je plus volontiers aux preuves philosophiques le
nom de preuves acroamatiques (discursives), parce qu’elles ne peuvent
ˆ
etre faites que par de simples mots (par l’objet en pens´
ee), plutˆ
ot que
celui de d´
emonstrations, puisque ces derni`
eres, comme d´
ej`
a l’expression
l’indique, p´
en`
etrent dans l’intuition de l’objet 5”.
La d´
emonstration, donc, est une notion math´
ematique plutˆ
ot qu’une notion logico-
linguistique, la math´
ematique ´
etant d´
efinie dans sa distinction d’avec la logique comme
doctrine de l’intuition pure, et trouvant dans la construction de concepts le mode m´
etho-
dologique qui correspond `
a cette distinctivit´
e.
Kant voit bien qu’une objection peut ˆ
etre faite en s’appuyant sur les aspects alg´
e-
briques de la math´
ematique, spontan´
ement proches d’une discursivit´
e conventionnelle
(proximit´
e que va souligner `
a l’envi le point de vue moderne). Il revendique pour les
d´
emonstrations litt´
erales-alg´
ebriques aussi, n´
eanmoins, l’intuitivit´
e de la construction
de concepts :
“ La m´
ethode alg´
ebrique elle-mˆ
eme avec ses ´
equations d’o`
u elle tire
par r´
eduction la v´
erit´
e en mˆ
eme temps que la preuve, si elle n’est pas
sans doute une construction g´
eom´
etrique, est cependant une construction
caract´
eristique o`
u, `
a l’aide de signes, on repr´
esente les concepts dans
l’intuition, surtout ceux du rapport des quantit´
es et o`
u, sans mˆ
eme envi-
sager le cˆ
ot´
e heuristique, tous les raisonnements sont garantis contre l’erreur
par cela seul que chacun d’eux est mis devant les yeux ”6.
Ce texte capital est ´
etonnamment moderne, d’une part en ce qu’il r´
efute par avance
la th`
ese illusoire de la non-intuitivit´
e des math´
ematiques formelles-symboliques, d’autre
part en ce qu’il esquisse le probl`
eme tout `
a fait actuel du rapport entre preuve et calcul.
Il nous est donc confirm´
e, dans l’approche mˆ
eme de l’apparent contre-exemple, que
Kant voit dans l’attestation objective rendue possible par la construction de concept le
3.Ibid., 505 ; Pl´
eiade, vol. I, 1313 ; A734, B762.
4.Ibid., 505 ; Pl´
eiade, vol. I, 1313 ; A734, B762.
5.Ibid., 505 ; Pl´
eiade, vol. I, 1313 ; A735, B763.
6.Ibid., 505 ; Pl´
eiade, vol. I, 1313 ; A734, B762.
3

propre de la d´
emonstration. La d´
emonstration est monstration, et donc elle est tout
autre chose que la preuve logique, qui serait plutˆ
ot le lot de la philosophie.
Faisons deux remarques sur ce dispositif kantien :
1) il laisse dans l’ombre la “temporalit´
e” de la d´
emonstration ;
2) il est une sorte d’op´
erateur m´
eta-philosophique rendant compte de toute la d´
emar-
che de la Critique de la raison pure (critique de la m´
etaphysique dogmatique et sp´
ecificit´
e
de l’argument transcendantal).
Pour ce qui est du premier point, il r´
esulte de l’insistance sur l’´
evidence et la
g´
en´
ericit´
e : ce qui fait la d´
emonstration math´
ematique une d´
emonstration est qu’elle
emploie des singuliers qui sont des concepts construits et donc qu’elle procure une
´
evidence sp´
ecifique aux pr´
edications qui s’imposent en elle (au cours d’elle). Mais la
s´
equentialit´
e des assertions et le mode de connexion et d’engendrement qui lui corres-
pond ne sont pas en cause : cette s´
equentialit´
e, pour autant qu’on puisse la d´
efinir ou
qu’il soit int´
eressant de le faire, appartient tout aussi bien aux preuves acroamatiques
de la philosophie. Il y a donc chez Kant, de fac¸on coh´
erente avec sa d´
emarcation
de la logique et des math´
ematiques, s´
eparation compl`
ete entre la math´
ematicit´
e des
d´
emonstrations et le type de temporalit´
e discursive qui, selon notre concept moderne,
les caract´
erise.
Pour ce qui est du second point, il suffira de se souvenir de l’argument anti-m´
eta-
physique kantien : selon lui, les m´
etaphysiques qui ont pr´
ec´
ed´
e son criticisme avaient le
tort de croire progresser dans la connaissance aux moyens de preuves acroamatiques,
d’imaginer qu’elles ajoutaient des d´
eterminations `
a un concept au moyen d’un juge-
ment synth´
etique via de telles preuves. Mais, pour qui connaˆ
ıt la d´
emonstration math´
e-
matique dans ce qui lui est essentiel, et qui en fait le type de toute acte synth´
etique au
sens kantien, il est clair que les preuves acroamatiques ne sont que des reformulations,
des jugements analytiques, et donc ne permettent pas de capter la moindre nouveaut´
e
d´
eterminative. Il semblerait donc que Kant ait par avance rang´
e notre notion de preuve
formelle dans le cul-de-sac de l’analyticit´
e, et d´
ecr´
et´
e sa non-convenance aux math´
e-
matiques. Mais nous devons tout de mˆ
eme nous m´
efier de ce jugement, parce que, d’un
autre cˆ
ot´
e, nous avons vu que Kant anticipe le “travail dans le symbolique” comme cas
de la construction de concept. Restons donc prudents sur ce sujet, il y a quelque proba-
bilit´
e que nos d´
emonstrations formelles ne soient apr`
es tout pas la mˆ
eme chose que ses
preuves acroamatiques.
Abordons maintenant un second enseignement sur la d´
emonstration, celui de Hegel.
Il est d’autant plus pertinent d’y venir maintenant que son ´
elaboration de la question
est largement r´
eactive vis-`
a-vis de celle de Kant.
1.2 Le th´
eor`
eme dans la Science de la logique (chez Hegel)
Hegel aborde les figures ou tropes sp´
ecifiques de la math´
ematique – la d´
efinition, la di-
vision et le th´
eor`
eme – dans le chapitre Le connaˆ
ıtre synth´
etique de la section L’id´
ee du
vrai du troisi`
eme livre de la Science de la logique7. On est donc tout au bout du chem-
inement qui conduit, `
a travers les trois livres de ce trait´
e monumental, `
a l’id´
ee absolue.
7. Hegel, G.-W.-F., Science de la logique, La logique subjective ou doctrine du concept, trad. P.-J.
Labarri`
ere et G. Jarckyk, Paris, Aubier Montaigne, 1981, p. 315-358.
4

Autant dire que les math´
ematiques rec¸oivent, dans l’´
elaboration dialectique du th`
eme
logique, un statut comparable `
a celui de la religion ou de l’art dans la Ph´
enom´
enologie
de l’esprit : elles sont prises comme des accomplissement unilat´
eraux proches de la
totalit´
e, de l’Erinnerung.
Ajoutons `
a cela que la motivation de la rubrique Le connaˆ
ıtre synth´
etique s’accorde
aux th`
eses kantiennes que nous venons de rappeler : il s’agit bien, sous ce nom,
d’´
evoquer les aspects de la math´
ematique qui ´
echappent `
a quelque chose comme une
r´
eduction logicienne. La rubrique s’oppose `
a celle titr´
ee Le connaˆ
ıtre analytique, qui
la pr´
ec`
ede, et qui correspond `
a une figure de l’id´
ee connaissante plus enferm´
ee dans
la non-v´
erit´
e de la finit´
e, plus du cˆ
ot´
e de l“entendement” kantien et moins du cˆ
ot´
e du
“bon” concept h´
eg´
elien.
Mais la divergence apparaˆ
ıt aussitˆ
ot dans ce que Hegel consid`
ere comme l’exemple
type du connaˆ
ıtre analytique, `
a savoir les jugements arithm´
etiques finitaires (du type
7+5=12), pour les nommer comme nous le ferions aujourd’hui : ces jugements, pour
Kant, ´
etaient les exemples princeps de jugements math´
ematiques synth´
etiques.
Essayons ce comprendre ce qui motive ce “revirement” philosophique d’un auteur
`
a l’autre.
1.2.1 Le connaˆ
ıtre analytique : anticipation h´
eg´
elienne de la figure du construc-
tivisme
Tout d’abord, attestons le fait de ce revirement par une citation d´
epourvue d’ambigu¨
ıt´
e :
“ On sait que l’arithm´
etique et les sciences plus universelles de la
grandeur discr`
ete se trouvent nomm´
ees par excellence science analytique
et analyse8”.
Pour Hegel, le “connaˆ
ıtre analytique” prend les nombres entiers comme ext´
eriorit´
e
juxtapos´
ee-indiff´
erente, se posant comme ´
etrang`
ere `
a la d´
etermination conceptuelle,
qui ne pourrait donc lui revenir que du dehors et pas au titre d’un “passage” se jouant
en elle : (le mat´
eriau arithm´
etique est)
“ (...) quelque chose de d´
ej`
a fait de fac¸on tout abstraite et ind´
etermin´
ee,
en quoi toute caract´
eristique de relation est supprim´
ee, `
a quoi toute d´
etermination
et liaison est quelque chose d’ext´
erieur9”.
Hegel rapporte d’ailleurs cette conception du nombre entier `
a sa gen`
ese it´
erative,
`
a ce que j’appelle pour mon compte sa participation `
a l’objectivit´
e constructive10.
Les nombres entiers, en effet, sont vus par lui11 comme r´
esultant d’un “augmenter”
ext´
erieur du Un jusqu’au nombre num´
er´
e, augmenter qui en reste essentiellement `
a
l’atomicit´
e du Un (ne la transgresse pas : c’est bien la discr´
etion qui est en cause).
8.Ibid., 324.
9.Ibid., 324.
10. Cf. Salanskis (1995, 1999).
11. Cf. Hegel, G.-W.-F., Science de la logique, L’ ˆ
Etre, trad. P.-J. Labarri`
ere et G. Jarckyk, Paris, Aubier
Montaigne, 1972, 161-201, sp´
ecialement 189-201.
5
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
1
/
32
100%