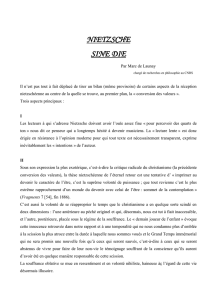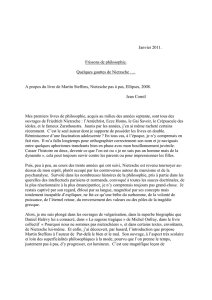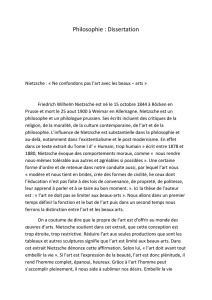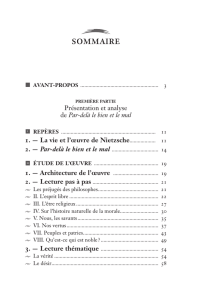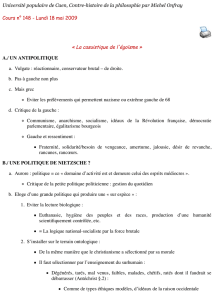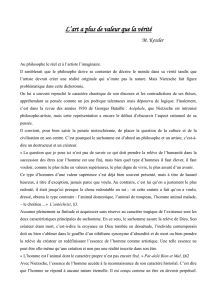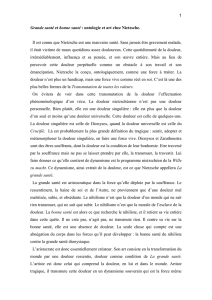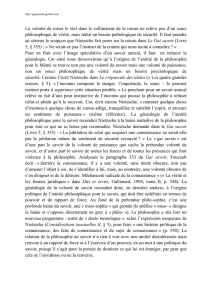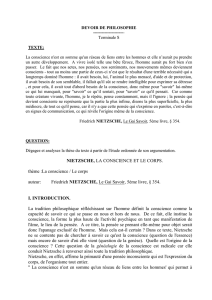Plan de cours - UQAM | Département de philosophie

UQÀM PLAN DE COURS
TITRE DU COURS : Nietzsche
CODE - GROUPE : PHI 4017-50
SESSION : Hiver 2009
HORAIRE : Vendredi 14h00-17h00
SALLE : A-2855
PROFESSEUR : Jacques Aumètre
BUREAU : W-5280
TÉLÉPHONE : 987-3000 poste 4423#
DESCRIPTION DU COURS SELON L’ANNUAIRE
Étude globale de la philosophie de Nietzsche et de son influence déterminante
sur le cours de la philosophie occidentale, de manière à apprécier l’essentiel de
son apport.
PROBLÉMATIQUE ET PERSPECTIVE
Nietzsche veut « renverser le platonisme », c’est-à-dire l’idéalisme
métaphysique qui s’est développé, depuis Platon, au principe non seulement de la
philosophie, mais de l’ensemble de la culture humaine du monde comme
entreprise « contre-nature » d’idéalisation rationnelle du réel. La méta-physique,
essentiellement idéaliste en tant que critique de la réalité naturelle de l’être au
nom de l’idéal rationnel de l’esprit, s’achève et s’accomplit au sein de la Science
philosophique de Hegel, où l’Esprit absolu s’éternise à la fin de l’histoire du
monde, ayant atteint la parfaite conscience de tout comme de soi. Alors, tandis

2
que la « sagesse » hégélienne assume la négativité d’une raison dialectique de
l’être, la
« folie » nietzschéenne rejette ce « nihilisme » de la raison au nom d’une
affirmation tragique de l’être sans raison.
À présent, « Dieu est mort » ! Et l’homme, qui l’a tué pour prendre sa place à la
tête du monde, sans lui dépérit, désastreusement étiolé, rabougri… Voilà le
« dernier homme », à la fin de l’histoire humaine-trop-humaine du monde. Le
« surhomme » est l’homme à venir qui surmontera le nihilisme métaphysique de
l’homme au comble de sa décadence historique, lorsque ce nihilisme s’annihilera
et que se renversera le sens de l’histoire, c’est-à-dire lorsque l’énergie vitale du
monde, que Nietzsche nomme « volonté de puissance », reviendra du Dieu Esprit
chrétien à la Déesse Nature païenne, et redeviendra ainsi affirmative de la vie
éternellement temporelle du monde. Le « Zarathoustra » de Nietzsche annonce
l’avènement du surhomme réintégrateur qui transvaluera toutes les valeurs
métaphysiques transcendantes, et transmutera le retour historique une fois
pour toutes du Dieu Esprit en et par « l’éternel retour » de la Déesse Nature.
« Dionysos contre le Crucifié »... et contre Prométhée l’Enchaîné. Même par son
« irrationalisme », Nietzsche s’oppose à Kierkegaard, comme il s’oppose à Marx,
même par son « athéisme ». Mais c’est à Hegel qu’il s’oppose le plus — et plus que
les deux autres, qui ne le font chacun qu’à moitié — en opposant à son
dépassement dialectique conservateur un surpassement tragique destructeur des
opposés que sont la foi chrétienne et la culture humaine immanentisant sa
transcendance métaphysique. Seul un tel surpassement, selon Deleuze,
permettra de défaire et refaire l’histoire, de détruire sa capitalisation
mémorielle d’un sens de l’être et recréer, à force d’oubli, l’être insensé du
monde, son absurde devenir éternel comme éternel revenir. Aussi Nietzsche
rejette-t-il à la fois christianisme et humanisme, ensemble ou séparément, pour
remonter vers le paganisme, et même un paganisme archaïque venu d’Orient en
Occident par les présocratiques.
Son ennemie, c’est la civilisation comme domestication, qui a fait de l’homme une
bête de troupeau, docile et pitoyable. Qui dit grégarité, dit médiocrité,
vulgarité, servilité ! Mais ce n’est pas que l’homme individuel du libéralisme vaille
beaucoup mieux que l’homme universel du socialisme, ni qu’il soit moins à
surmonter, à la faveur d’une surhumaine réintégration de la Nature, car
Nietzsche a la mystique aristocratique... En révolte contre la modernité

3
bourgeoise démocratique, contre la petitesse et la bassesse de son industrieuse
humanité marchande et de sa culture techno-scientifique utilitaire, il remonte
l’histoire à rebours, aristocratiquement, vers une Nature encore indomptée,
mystérieuse et sauvage —
une « Nature artiste » où soient réintégrés les hommes comme les dieux, le ciel
y recouvrant la terre à féconder.
Aux antipodes de la Science hégélienne de l’Esprit, l’Art nietzschéen de la
Nature
serait-il ainsi mieux à même d’assurer le salut de l’humanité en la soumettant à
une surhumanité, à une élite surhumaine de l’humanité, une élite d'hommes libres
créateurs de l'avenir, d'« individus souverains » maîtres de leur destin, fine
fleur d'une culture aristocratico-artistique violemment sélective, cruelle,
impitoyable ? Nullement, car sinon pourquoi la chute dans un devenir-réactif des
forces et un devenir-nihiliste de la volonté où triomphent les « esclaves » et leur
« faiblesse », pourquoi le progrès historique de la décadence, c’est-à-dire de la
culpabilité, du ressentiment, de la mauvaise conscience et de l’idéal ascétique... si
tout allait pour le mieux avec le paganisme primitif — avant Socrate, la Judée, le
christianisme, la Révolution démocratique et l’anarchie sociale moderne ? Non : la
négativité revient éternellement, la négation de l’autre doublant toujours
l’affirmation de soi ; nul ne se délivre du mal nihiliste une fois pour toutes. Il n’y
a pas de délivrance définitive, mais seulement temporaire, car le déclin
appartient au destin comme l’essor, et il faut l’aimer comme tel, aimer vivre
héroïquement jusqu'au malheur, à la souffrance et à la mort — « Amor
fati » ! Ainsi n'est-il pas de réunion sans séparation, pas de retour éternel sans
éternel départ… Voilà la « sagesse tragique » de Nietzsche.
Mais avec ce retour de l’Esprit à la Nature, Nietzsche ne se borne-t-il pas à
retourner contre soi l’Esprit transcendant ou transcendantal ayant inspiré la
critique méta-physique de la Nature ? Car la Nature, en effet, ne saurait elle-
même directement, sans intermédiaire spirituel divin ou humain, critiquer
l’Esprit, le juger, ni d’ailleurs vouloir, ni agir, ni créer des significations et des
valeurs, à proprement parler, et Nietzsche essaie en vain d’attribuer à la Nature
une volonté de puissance qui n’a jamais appartenu en propre qu’à l’Esprit. À
travers sa « philosophie au marteau », ce serait donc encore l’Esprit qui critique,
et cette fois s’auto-critique, hyperbolisant le criticisme kantien, jusqu’à
condamner violemment sa culture contre-nature, en une volte-face suicidaire.

4
Mais si c’est encore de l’Esprit, malgré tout, que Nietzsche se fait le porte-
parole, ne poursuit-il pas la révolution humanisatrice du monde naturel et social
qu’opéra l’Esprit, et ne constitue-t-il pas, comme le prétend Heidegger, le
dernier métaphysicien, l’ultime et suprême nihiliste, avec son « platonisme à
l’envers » ? La question reste ouverte — à propos de Nietzsche, mais aussi de
Heidegger à son tour, voire de quiconque s’aventure à la suite…
OBJECTIFS
Situation de Nietzsche à la fin de l'histoire de la métaphysique et réflexion sur
le statut de sa critique du nihilisme métaphysique au principe de sa critique
généalogique de la culture nihiliste — notamment de la morale, mais aussi de la
science et de l’art, de la religion et de la politique, etc.
Examen des notions-clés de la pensée nietzschéenne : nihilisme, généalogie
critique, perspectivisme vital , volonté de puissance, surhomme, transvaluation,
éternel retour, amor fati… et des principales questions philosophiques qu'elles
soulèvent.
Analyse de quelques textes de Nietzsche, depuis sa principale oeuvre de
jeunesse jusqu’aux fragments posthumes d'avant l'effrondement dans la folie,
en passant par le poème philosophique central de sa maturité.
ENSEIGNEMENT ET ÉVALUATION
Le cours alternera les exposés magistraux présentant la pensée nietzschéenne
avec des ateliers de discussion sur quelques textes importants de Nietzsche. La
présence aux cours est requise pour être en mesure de bien faire les travaux.

5
Les étudiants auront à lire cinq textes de Nietzsche, dont ils devront se
procurer le recueil à la COOP-UQÀM, au J-M205 ( cf. la bibliographie et le
calendrier, ces textes devant être lus pour les cours où ils seront discutés ).
Il y aura deux travaux à faire au cours de la session :
1) un résumé d’un des textes du recueil ( à l’exception du dernier des cinq, dont
le caractère récapitulatif fait un texte à part, à lire en plus, mais impropre à
résumer ), à remettre à la neuvième semaine ( le 06.11.09 ), comptant pour
40% de la note globale;
2) un travail de réponses à trois questions de cours parmi sept ( la question
générale et deux questions spécifiques au choix ), à remettre à la quinzième
semaine ( le 18.12.09 ), comptant pour 60% de la note globale;
Attention, d’abord, à ne pas oublier la nature conceptuelle argumentative du
discours philosophique et à ne pas se perdre en illustrations, descriptions,
narrations, etc.
Attention, ensuite, à distinguer les deux types de travaux. Pour le travail de
résumé de texte ( 5 pages ), il s’agit non seulement de comprendre le texte et
d’en exposer le contenu, mais d’en extraire l’essentiel, en condensant un maximum
d’idées dans un minimum de mots, de sorte qu’il faut s’en tenir au texte, sans
déborder sur les contextes de l’oeuvre ou de la vie de l’auteur, et résumer le
texte sans commentaire ni critique. Pour le travail de réponses à des questions
de cours ( 12 pages ), commentaires et critiques sont par contre de mise, car il
s’agit alors non seulement d’utiliser des connaissances, mais de développer une
réflexion qui fasse montre de jugement. Toutefois, pour répondre aux questions,
vous devez faire un minimum de recherches, quelques citations et signaler
correctement vos références bibliographiques.
Attention, enfin, à éviter la paraprase et le plagiat ! Il faut se détacher de la
lettre des textes des auteurs et commentateurs utilisés, ainsi que des notes de
cours, pour montrer que l’on s’est approprié les connaissances, qu’on les a
assimilées et que l’on est capable de les exposer sans se borner à recopier des
bouts de textes…
Le barème qui sera utilisé pour la notation est celui en vigueur au Département
de philosophie de l’UQÀM :
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
1
/
17
100%