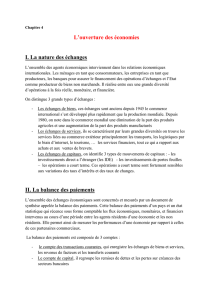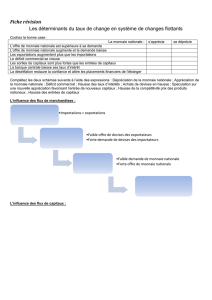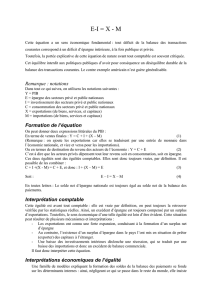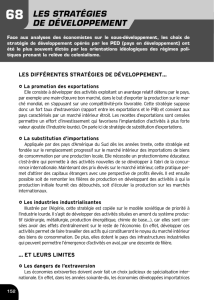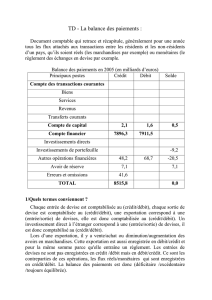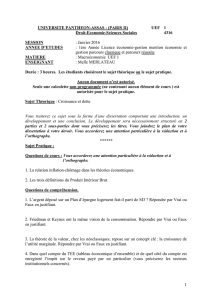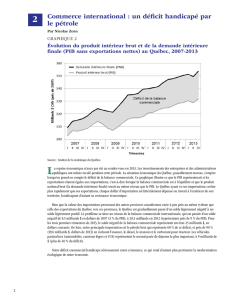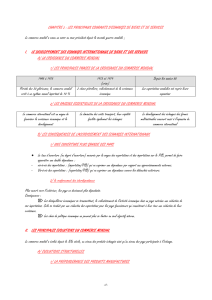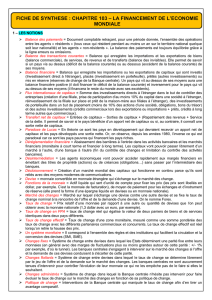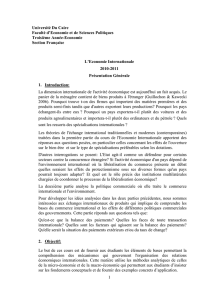Version PDF

Francis Malherbe www.comptanat.fr 1
Théorie keynésienne :
le reste du monde
Le modèle keynésien en économie ouverte
Le modèle keynésien est valide uniquement dans le cadre d'une
économie fermée, c'est-à-dire sans échanges extérieurs. Dans une
économie ouverte, il faut le modifier profondément. En effet, la
demande intérieure provenant des ménages et des administrations
génère une activité économique non seulement dans le pays mais
aussi dans les autres pays. Inversement, les autres pays adressent à
l'économie nationale une demande qui va se traduire par de l'activité
intérieure.
Dans une économie ouverte, il faut donc prendre également en
compte les importations et les exportations. Le compte de biens et
services s'écrit alors :
P + M = CI + CF + I + X
Où M désigne les importations et X les exportations. Cette équation
peut aussi s'écrire :
P − CI = (CF + I) + (X − M)
C'est-à-dire :
VA = (CF + I) + (X − M)
Dans cette formule, (CF + I) représente la demande finale intérieure
et (X − M) la demande extérieure nette. Grâce à la liberté des
échanges, certains pays peuvent donc avoir une valeur ajoutée
supérieure à la demande finale intérieure, d'autres au contraire
devront se contenter d'une valeur ajoutée inférieure à leur demande
finale intérieure.
La relation entre l'épargne et l'investissement
On peut également introduire le rôle de l'épargne. Dans une
économie ouverte, la valeur ajoutée génère des revenus qui peuvent
également être distribués à l'extérieur du pays et, inversement, une
part du revenu national peut provenir de l'étranger. On a donc :
R = VA + T

Francis Malherbe www.comptanat.fr 2
Où T désigne le solde des transferts de revenu provenant du reste
du monde. L'épargne nationale E est égale à :
E = R − CF = VA + T − CF
C'est-à-dire :
E = I + (X + T − M)
C'est-à-dire que l'épargne est égale à la somme de l'investissement
et du solde des transactions courantes de la balance des paiements.
L'équation fondamentale de la théorie keynésienne n'est donc plus
vérifiée. C'est extrêmement important car une croissance de
l'investissement dans un pays va se traduire par une augmentation de
l'épargne mondiale mais non plus nécessairement par une
augmentation de l'épargne nationale. En effet, l'augmentation de
l'investissement dans un pays peut tout aussi bien se traduire par une
dégradation de sa balance courante des paiements.
Le multiplicateur keynésien
Dans une économie fermée, la logique du multiplicateur keynésien
est que l'investissement détermine l'épargne. Si l'on suppose que
seuls les ménages épargnent, l'épargne nationale est aussi l'épargne
des ménages. L'investissement détermine alors l'épargne des
ménages ainsi que, par suite, leur revenu et leur consommation.
Dans une économie ouverte, ce n'est plus tout à fait vrai.
L'investissement du pays peut se traduire par une épargne dans
d'autres pays, il y a donc, en quelque sorte, une fuite dans le
système. Mais, à l'inverse, un pays peut profiter de l'épargne des
autres.
Nous supposerons ici que la consommation finale est déterminée par
une fonction de consommation de la forme CF=a.RM où le coefficient a
désigne la propension à consommer. Nous suppsoerons également
que les entreprises distribuent tout leur revenu aux ménages. Les
équations :
VA = (CF + I) + (X − M)
et
RM = VA + T
deviennent donc :

Francis Malherbe www.comptanat.fr 3
VA = a.(VA + T) + I + (X − M)
Soit :
On retrouve la formule du multiplicateur keynésien où l'excédent de
la balance commerciale (X − M) joue le même rôle que
l'investissement.
La concurrence entre pays joue donc ici un rôle fondamental. La
formule ci-dessus montre, en effet, que la valeur ajoutée est d'autant
plus forte que les exportations sont fortes et que les importations sont
faibles. Or, les exportations sont d'autant plus fortes que le pays est
concurrentiel sur les marchés extérieurs, les importations sont
d'autant plus faibles que le pays est concurrentiel sur son marché
intérieur. Autrement dit, les pays compétitifs sur le marché mondial
sont aussi ceux qui tirent le meilleur parti du multiplicateur keynésien.
Le rôle du taux d'épargne
Un pays peut réduire ses importations en gagnant une plus grande
part du marché intérieur, il peut aussi y parvenir en augmentant son
taux d'épargne pour réduire sa demande intérieure.
Pour le montrer, nous supposerons que les importations
représentent une part constante de la demande intérieure si bien que
l'on a l'équation suivante :
M = m · (C + I)
Où m est compris entre 0 et 1. Le compte de biens et services :
P = C + I + X − M
devient donc :
P = (1 − m)(C + I) + X
Puisque nous avons RM = P + T et C = a.RM, cette équation devient :

Francis Malherbe www.comptanat.fr 4
Dans cette équation, le revenu des ménages est une fonction
croissante de la propension à consommer a, c'est-à-dire une fonction
décroissante du taux d'épargne des ménages.
Accroître le taux d'épargne a donc, en économie ouverte comme en
économie fermée, un effet dépressif sur l'activité. Cependant, il faut
tenir compte du fait qu'en réduisant l'activité, on réduit aussi les
importations et l'on peut arriver à un excédent de la balance courante
des paiements. Or, cet excédent de la balance courante des paiements
a aussi, à terme, un impact sur les revenus provenant du reste du
monde et donc sur les revenus des ménages ainsi que, par suite, sur
leur consommation et l'activité économique.
En effet, la balance des paiements tenue du point de vue du pays se
présente ainsi :
Emplois
Ressources
Importations =
Achats de
biens et services
Exportations =
Ventes de
biens et services
Achat d'actifs
financiers
Revenus nets provenant
du reste du monde
Ventes d'actifs
financiers
Ce schéma montre que le solde de la balance courante des
paiements est aussi égal à l'opposé du solde de la balance des
capitaux. Autrement dit, un solde positif de la balance courante des
paiements signifie que le pays acquiert des actifs financiers à
l'étranger. Dans la mesure où ces actifs sont rémunérés, il accroît
aussi ses revenus provenant du reste du monde, ce qui accroît le
revenu des ménages et stimule l'activité.
Ainsi, en orientant son système de production vers les marchés
extérieurs et en maintenant une balance courante des paiements
excédentaire grâce à un taux d'épargne élevé, un pays peut très bien
voir son activité devenir indépendante de l'investissement net.
La compétition entre pays
Cette politique qui pourra paraître vertueuse à beaucoup a
cependant pour principal inconvénient de se faire aux dépens des
autres pays.

Francis Malherbe www.comptanat.fr 5
En effet, sur l'ensemble du monde, la somme des soldes des
balances courantes des paiements est strictement égale à zéro. Ainsi,
si un pays parvient à dégager des excédents de la balance courante
des paiements, c'est que d'autres ont des déficits.
Les pays qui ont des déficits sont également ceux qui vendent des
actifs financiers, c'est-à-dire qui financent leurs dépenses courantes
par des prélèvements sur leur patrimoine, autrement dit, ce sont des
pays qui s'appauvrissent. Les revenus nets qu'ils tirent du reste du
monde diminuent avec leur patrimoine, ce qui provoque la baisse du
revenu des ménages et, par suite, de leur consommation, ce qui
déprime l'activité.
Ainsi, le modèle keynésien en économie ouverte montre que les
pays sont en compétition pour maintenir leur activité et que cette
compétition se joue à deux niveaux :
compétition sur les marchés des biens et services pour gagner des
parts du marché mondial ;
compétition pour l'accumulation afin d'acquérir une part du
patrimoine mondial de plus en plus importante.
Le rôle de l'État
Lorsqu'un pays se trouve en difficulté du fait de sa faible
compétitivité sur les marchés mondiaux, il peut être tenté de
maintenir son activité économique par des politiques dites de relance
keynésienne.
Les politiques de relance keynésienne
Les politiques dites keynésiennes consistent à relancer l'activité par
des déficits publics. Pour montrer leur impact en économie ouverte,
nous pouvons reprendre le modèle précédent en supposant que les
exportations sont déterminées par le marché mondial et que la
demande intérieure, c'est-à-dire la consommation et l'investissement,
est satisfaite à la fois par les entreprises nationales et les importations
selon un ratio déterminé par la compétitivité du pays.
Pour simplifier, nous pouvons supposer que les seules dépenses de
l'État sont les salaires des fonctionnaires et ses seules recettes les
impôts. Dans ce cas, si nous désignons par D le déficit public, le
revenu des ménages est égal à :
R = P + T + D
Or :
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
1
/
15
100%