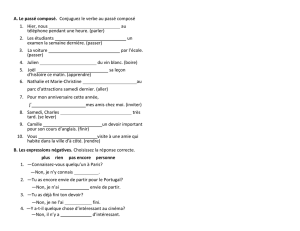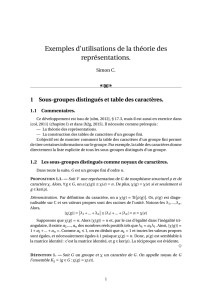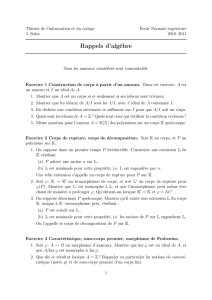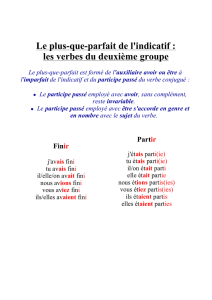Fonctions symétriques et polynômes de Hall

Polynômes de Hall
Travail Encadré de Recherche
Susanne Reh
encadré par M. Jérôme Germoni
Université Claude Bernard Lyon 1
Master 1 Mathématiques Générales
2013-2014

Table des matières
1 Rappels 3
1.1 Groupes .............................. 3
1.2 Anneaux.............................. 8
2 Structure des groupes abéliens de type fini 9
3 Forme normale de Smith 16
4 Partitions 21
5 Fonctions symétriques 25
5.1 L’anneau des fonctions symétriques . . . . . . . . . . . . . . . 25
5.2 Fonctions symétriques élémentaires et complètes . . . . . . . . 27
5.3 FonctionsdeSchur ........................ 31
6 Polynômes de Hall 38
6.1 o-modulesfinis .......................... 38
6.2 L’algèbredeHall ......................... 41
6.3 Suite LR d’un sous-module . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
6.4 Le polynôme de Hall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Bibliographie 53
2

1 Rappels
1.1 Groupes
Définition 1.1. Soient Gun groupe abélien et (Hi)i∈I)6=∅une famille de
sous-groupes de G. Si
∀j∈I, Hj∩X
i∈I,i6=j
Hi={0}
le sous-groupe Pi∈IHiest somme directe des sous-groupes Hiet est noté
Li∈IHi.
Définition 1.2. Soit Gun groupe abélien et H⊆G.Hest appelé facteur
direct de Gs’il existe un K⊆Gtel que G=H⊕K.
Proposition 1.3. Soient Gun groupe abélien, H⊆Get il’injection cano-
nique de Hdans G. Alors Hest un facteur direct de Gsi et seulement s’il
existe un p∈Hom(G, H)tel que p◦i=idH
Démonstration. ”⇐”: On suppose qu’il existe p∈Hom(G, H)tel que p◦i=
idHet on pose h=p(g)pour tout g∈G. Alors on a h=p◦i(h) = p(h), i.e.
(g−h)∈Ker(p). On a g=h+ (g−h)et pour x∈H∩Ker(p),x=p(x) = 0.
Donc G=H⊕Ker(p).
”⇒”: On suppose que G=H⊕K. Donc tout g∈Gs’écrit de manière
unique g=h+k,h∈Het k∈K. Si on prend p(g) = hpour p, on a le
résultat.
Définition 1.4. Un groupe abélien est dit libre s’il est somme directe de
groupes monogènes infinis.
On peut aussi dire que Gest libre si on peut trouver un ensemble Iet une
famille d’éléments de G,X={xi}i∈Itels que
G=M
i∈I
hxiiet hxii∼
=Z,∀i∈I
On dit que Xest une base de G.
Theorème 1.5 (propriété universelle d’un groupe abélien libre).Soient G
un groupe abélien, Xune partie de Get jXl’inclusion canonique de Xdans
G. Alors Gest abélien libre de base Xsi et seulement si, pour tout groupe
3

abélien Aet toute application σ:X→A, il existe un unique morphisme de
groupes f:G→Atel que f◦jX=σ.
XjX//
σ
G
f
A
Démonstration. On suppose que le groupe abélien Gest libre de base X.
Existence de f : On note X={xi}i∈Ila base donnée de G. Tout élément x
de Gs’écrit de manière unique x=Pi∈Inixi, où les nisont des entiers nuls
sauf pour un nombre fini de i∈I. Alors, si on pose f(x) = Pi∈Iniσ(xi),
cette somme est bien définie. On voit facilement que l’application fainsi
définie est un morphisme de groupes et vérifie f◦jX=σ.
Unicité de f : On suppose f0:G→Aun autre morphisme de groupes
vérifiant f0◦jX=σ. On a donc f(xi) = f0(xi)pour tout élément xi∈X,
d’où f(x) = f0(x)pour tout élément xde G.
Maintenant on suppose que le groupe abélien Gest tel que pour tout groupe
abélien Aet toute application σ:X→A, il existe un unique morphisme de
groupes d:G→Atel que f◦jX=σ. C’est en particulier vérifié si A=Z(X)
est libre de base Xet σ=iXest l’injection de Xdans Z(X). Le début de
la démonstration montre qu’il existe un morphisme de groupes g:A→G
tel que g◦iX=jX. Les morphismes fet gsont réciproques l’un de l’autre.
Donc ce sont des isomorphismes.
Corollaire 1.6. Tout groupe abélien est isomorphe à un quotient d’un groupe
abélien libre.
Démonstration. Soit Xune partie génératrice d’un groupe abélien Get σ
l’inclusion de Xdans G. On considère le groupe libre de base X,Z(X)et jX
l’inclusion de Xdans Z(X). D’après le théorème 1.5, il existe un morphisme
de groupes f:Z(X)→Gtel que f◦jX=σ. Tout élément xde Gs’écrit
x=X
1≤l≤k
niσ(xil) = X
1≤l≤k
nlf(jX(xil)) = f X
1≤l≤k
nljX(xil)!.
Donc fest surjectif. On en déduit que le groupe Gest isomorphe au groupe
Z(X)/Ker(f).
Corollaire 1.7. Soit Gun groupe abélien, G0un groupe abélien libre et p:
G→G0un homomorphisme (de groupes abéliens) surjectif. Alors il existe
un homomorphisme (de groupes abéliens) s:G0→Gtel que p◦s=idG0. En
particulier, s(G0)est un facteur direct de G.
4

Démonstration. Soit Xune base de G0. Comme pest sujectif, il existe une
application j:X→Gtelle que p◦j=idX. D’après le théorème 1.5, il existe
un morphisme de groupes s:G0→Gtel que p◦s=idG0. On déduit de la
proposition 1.3 que s(G0)est facteur direct dans G.
Remarque. Le morphisme sest injectif car p◦s=idG0et ça implique que
G0et s(G0)⊆Gsont isomorphe. De ce fait on peut dire que G0est isomorphe
à un facteur direct du Gsous les hypothèses du corollaire 1.6.
On a G=Ker(p)⊕s(G0)sous les hypothèses ci-dessus (cf proposition 1.3 et
corollaire 1.7).
Dans ce cas on apelle sune section de p.
Définition 1.8. On dit qu’un groupe est de type fini s’il est engendré par
une partie finie.
Définition 1.9. On appelle le cardinal d’une base d’un groupe abélien libre
Gle rang de G.
Définition 1.10. Soit Gun groupe abélien. Gest dit de torsion si tout
g∈Gest d’ordre fini. Il est dit sans torsion si tout g∈G, différent de
l’élément neutre, est d’ordre infini.
Proposition 1.11. Soit Gun groupe abélien. Les éléments de Gd’ordre fini
de Gforment un sous-groupe,
On note T(G)l’ensemble des éléments d’ordre fini de Get on l’appelle le
sous-groupe de torsion de G.
Démonstration. Il y a trois cas :
Si Gest un groupe sans torsion alors T(G) = 0, si Gest un groupe de
torsion alors T(G) = G; dans ces ceux cas le résultat est trivial.
On suppose que Gsoit un groupe tel que T(G)soit distinct de Get de {0}.
Soient xet ydeux éléments de T(G); on note p(resp. q) l’ordre de x(resp.
y). On a pq(x−y) = 0, donc (x−y)∈T(G)et T(G)est un sous-groupe de
G. soit xun élément du groupe G/T (G). S’il existe p∈N∗tel que px = 0,
on a px ∈T(G)et x= 0, d’où G/T (G)est un groupe sans torsion.
Définition 1.12. Soient Gun groupe abélien et pun nombre premier. La
composante p-primaire G(p)de Gest l’ensemble des éléments de Gdont
l’ordre est une puissance de p.
Proposition 1.13. Soient Gun groupe abélien et pun nombre premier. La
composante p-primaire G(p)est un sous-groupe de G.
5
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
1
/
53
100%